T. LOBSANG RAMPA
AINSI QU'IL EN ÉTAIT !
Titre original : As it was!
(Édition : 22/04/2020, paru précédemment sous le titre :
C'ÉTAIT AINSI)
Ainsi qu'il en Était ! — (Initialement publié en 1976) Ce livre reprend l'histoire de la vie du Dr Rampa du temps où il vivait au Tibet, et tout au long de ses voyages aventureux à travers le globe. Également l'HISTOIRE VRAIE – en direct de l'autre côté – de la vie de Cyril Henry Hoskins avant que le Dr Rampa n'ait transmigré dans le corps physique de ce dernier, expliquant les remarques outrageantes que le Dr Rampa était un plombier.
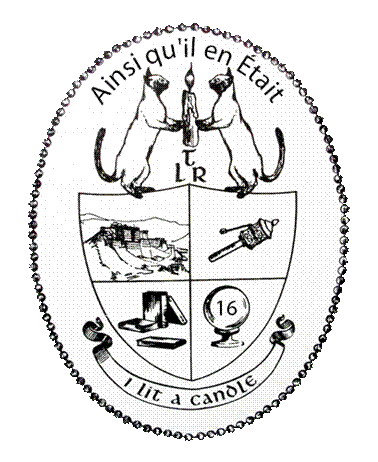
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
L'obscurité était maintenant tombée. Derrière la grande grille, un petit garçon solitaire regardait s'éloigner le dernier des invités. Il serrait ses mains l'une contre l'autre, pensant à la vie de misère qu'on lui avait annoncée, pensant aux horreurs de la guerre qu'il ne comprenait pas, pensant aux persécutions à venir. Il se tenait là, absolument seul au monde... tandis que la nuit s'épaississait. Personne ne vint le chercher pour l'emmener. Il finit par s'allonger sur le côté de la route et, presque immédiatement, un énorme chat s'étendit auprès de lui. Le petit garçon le serra dans ses bras et s'endormit, mais, vigilant, l'animal veillait...
AINSI QU'IL EN ÉTAIT !
Dédié à La Ville de Calgary
où j'ai connu la paix, la tranquillité,
et où ma vie personnelle a été respectée.
Merci à Calgary.
Livre UN — Ainsi qu'il en était au Commencement
Livre DEUX — L'Ère Première
Livre TROIS — Le livre des Changements
Livre QUATRE — Comme il en est Maintenant !
Table des matières
Avant-Propos
Les ‘meilleurs’ livres ayant tous un Avant-Propos, il est tout à fait indispensable que CE livre en ait un. Après tout, les Auteurs ont bien le droit de considérer que leurs propres écrits sont Les Meilleurs. Permettez-moi de commencer Le Meilleur en expliquant la RAISON qui m'a fait choisir ce titre : Ainsi qu'il en Était.
Pourquoi donc utilise-t-il un titre si bizarre alors qu'il affirme dans tous ses autres livres n'écrire JAMAIS que la vérité ! Je vais m'en expliquer, bien sûr, mais Gardez Votre Calme (faudrait l'écrire en lettres majuscules de six pouces <15 cm>) et CONTINUEZ À LIRE.
Tous mes livres SONT vrais. C'est une affirmation que j'ai maintenue à travers les persécutions et les calomnies ininterrompues. Mais, tout au long des âges, des gens sains et sensés ont été persécutés, torturés et mêmes tués pour avoir dit Tel qu'il en Était ! Un Homme Plein de Sagesse faillit connaître le bûcher pour avoir osé affirmer que la Terre tournait autour du Soleil, et n'était pas — comme l'avaient enseigné les Prêtres — le centre de la Création autour duquel tournaient toutes les planètes. Le pauvre diable passa un terrible moment, se retrouvant écartelé sur un Chevalet, et tout et tout, et ce ne fut qu'en abjurant sa théorie qu'il échappa au bûcher.
Ensuite, il y eut ceux qui se soulevèrent accidentellement par lévitation, cela à un moment inopportun, en présence de gens peu disposés à accepter la chose. C'est ainsi qu'ils furent supprimés de différentes façons, toutes spectaculaires, pour avoir fait savoir qu'ils différaient de la horde commune. Certains membres de la ‘horde’ SONT communs également, et tout spécialement s'ils sont journalistes !
Des humains de la pire espèce — vous LES connaissez ! — qui n'AIMENT qu'à rabaisser tous les êtres au même niveau ; ne pouvant tolérer que quiconque soit différent d'eux, ils crient comme des maniaques ‘détruisez ! détruisez !’ Et au lieu de chercher à prouver qu'une personne a raison, ils éprouvent toujours le besoin d'essayer de démontrer qu'elle a tort. La Presse, tout particulièrement, adore déchaîner la chasse aux sorcières et persécuter quelqu'un par goût de la nouvelle à sensation. Ce qui manque à tous ces crétins de la Presse, c'est l'intelligence qui leur permettrait de penser, qu'après tout, il POURRAIT bien ‘y avoir du vrai dans telle ou telle chose’ !
Edward Davis, ‘le Flic le plus Dur d'Amérique’, écrivait, en janvier 1975 dans True Magazine : "D'une façon générale, les Médias sont composés d'une bande d'écrivains de fiction ratés. Autrement dit, le Journalisme est plein d'espèces de Picasso qui, pinceau en main, brossent un portrait qui est censé être le mien, mais que personne ne reconnaît à part son auteur, le gars au pinceau." M. Davis, c'est clair, n'aime pas la Presse. Moi non plus. Nous avons tous deux de bonnes raisons de ne pas l'aimer. Un journaliste m'a dit : "La vérité ? Elle n'a jamais fait vendre un journal. Le sensationnel le fait. Qu'avons-nous à faire de la vérité ? Nous vendons du sensationnel."
Depuis la parution du ‘Troisième Œil’ — un livre VRAI ! — ‘d'étranges créatures sont sorties d'un peu partout’ et, trempant leur plume dans le venin, ont écrit des livres et des articles m'attaquant. Des gens s'intitulant ‘experts’ ont déclaré : CECI est faux, alors que d'autres affirmaient : CECI est vrai, mais CELA est faux. Il ne s'est pas trouvé deux ‘experts’ pour être d'accord.
Des ‘investigateurs’ itinérants ont interviewé à la ronde des gens qui ne m'avaient jamais rencontré, inventant de toutes pièces des histoires sorties de leur imagination. Les ‘investigateurs’ non plus ne m'ont jamais rencontré. À l'affût du sensationnel à tout prix, les Journalistes ont concocté des ‘interviews’ qui n'ont jamais existé. C'est ainsi que dans une ‘interview’ entièrement inventée, on a fait dire à Mme Rampa que le livre était une fiction. Ce qu'elle n'a jamais dit. Nous répétons tous deux : Tous mes livres sont VRAIS.
Mais que ce soit la presse, la radio ou les éditeurs, personne JAMAIS ne m'a permis de donner ma version sur le sujet ! JAMAIS ! On ne m'a pas davantage offert d'apparaître à la télévision ou à la radio afin de me permettre de dire la Vérité ! Comme beaucoup d'autres avant moi, j'ai été persécuté simplement pour être ‘différent’ de la majorité. Ainsi donc, l'Humanité détruit ceux qui pourraient l'aider grâce à leur savoir spécial, ou leurs expériences particulières. Si nous étions autorisés à le faire, nous pourrions, nous — les exceptionnels, les déroutants — repousser les Frontières de la Connaissance et faire avancer chez les humains la compréhension de l'Homme.
La presse me décrit à la fois comme étant petit et chevelu, gros et chauve, grand et petit, mince et gras. De même — selon des rapports de presse ‘dignes de foi’, je serais un Anglais, un Russe, un Allemand qui aurait été envoyé au Tibet par Hitler, ou un Indien, etc. Des rapports de presse ‘DIGNES DE FOI’ ! TOUT — absolument tout, sauf la vérité — mais celle-ci est dans mes livres.
On a dit sur moi tant de mensonges. Tant d'imagination malsaine s'est déployée contre moi, causant tant de misère et tant de souffrances — Mais ici dans ce livre se trouve la Vérité. Je la relate
Ainsi Qu'il En Était !
LIVRE UN
Ainsi qu'il en était au Commencement
Chapitre Un
D'un air las, le vieil homme s'adossa contre un pilier, son dos rendu douloureux par les longues heures passées dans une position inconfortable. Lentement, d'un revers de main, il se frotta les yeux qui devenaient chassieux avec l'âge, et regarda autour de lui. Des papiers — des papiers, rien d'autre que des papiers recouvraient la table devant lui. Des papiers pleins d'étranges symboles et des masses de chiffres rébarbatifs. À peine visibles, des gens se déplaçaient devant lui, attendant ses ordres.
Le vieil homme se leva lentement, écartant avec irritation les mains qui s'offraient à l'aider. Tremblant sous le poids des ans, il alla jusqu'à la fenêtre. Frissonnant quelque peu devant l'ouverture, il serra autour de sa maigre silhouette la vieille robe qui l'enveloppait. Les coudes solidement appuyés contre la maçonnerie, il regarda autour de lui. Doué, pour son malheur, de la capacité à voir de loin alors que son travail aurait exigé le contraire, il était en mesure, maintenant, de voir jusqu'aux limites extrêmes de la Plaine de Lhassa.
Pour Lhassa, c'était une journée chaude. Les saules resplendissaient de beauté, couverts de leurs jeunes pousses vert tendre. Les petits chatons coloraient d'innombrables raies jaunes l'arrière-plan vert et brun. Quatre cents pieds (122 m) au-dessous du vieil homme, les couleurs se fondaient de façon plus harmonieuse avec le reflet de l'eau transparente qu'on apercevait à travers les branches les plus basses.
Le vieil Astrologue en Chef méditait sur la terre qui s'étendait devant lui, contemplait le puissant Potala dans lequel il vivait, et qu'il avait quitté si rarement, et seulement pour des questions urgentes. "Non, non, se dit-il, ce n'est pas encore l'heure de penser à CELA ; il est préférable de reposer mes yeux en jouissant de la vue qui s'offre à moi."
Une grande activité régnait dans le village de Shö, blotti si confortablement au pied du Potala. Des brigands, pris alors qu'ils détroussaient des marchands dans les hauts défilés de la montagne, avaient été amenés au Tribunal de Justice du Village. La justice avait déjà été exercée envers d'autres délinquants ; des hommes reconnus coupables de crimes ou autres offenses graves quittaient le Tribunal, leurs chaînes sonnant au rythme de leurs pas. Incapables maintenant de travailler en traînant leurs chaînes, ils devaient errer de place en place en mendiant leur nourriture.
Le vieil Astrologue regarda mélancoliquement vers la Grande Cathédrale de Lhassa. Depuis si longtemps il avait rêvé d'y retourner pour renouer avec ses souvenirs d'enfance ; pendant trop d'années, ses devoirs officiels ne lui avaient pas permis de consacrer le moindre temps à son plaisir personnel. En soupirant, il s'apprêtait à quitter la fenêtre, mais s'arrêta en scrutant intensément au loin. Il appela un assistant en disant :
— Il me semble reconnaître ce garçon qui longe le Dodpal Linga du côté du Kesar ; n'est-ce pas le jeune Rampa ?
L'assistant fit un signe de la tête.
— Oui, Révérend, c'est le jeune Rampa et le domestique Tzu. Le jeune garçon dont vous préparez le futur dans cet horoscope.
Un sourire amer s'ébaucha sur les lèvres du vieil Astrologue tandis qu'il regardait le tout petit garçon et le domestique immense, haut de presque sept pieds (2 m 13), natif de la Province de Kham. Il les regarda avancer, le garçonnet chevauchant un poney de petite taille et l'autre montant un cheval puissant. Et quand la montagne les cacha à sa vue, il rejoignit la table couverte de papiers.
— Ainsi CECI, murmura-t-il, COÏNCIDERA AVEC CELA. Hmmn, et donc, pendant plus de soixante ans il connaîtra beaucoup d'épreuves de par l'influence défavorable de...
Sa voix se fit basse et monotone tandis qu'il brassait d'innombrables papiers, notant ici, effaçant là. Ce vieil homme était le plus fameux astrologue du Tibet, un homme instruit de tous les mystères de cet art hautement respectable. L'astrologie, au Tibet, est très différente de ce qu'elle est en Occident. Ici, à Lhassa, la date de la conception est mise en corrélation avec celle de la naissance. Au fur et à mesure, un horoscope était également préparé pour connaître la date à laquelle le ‘travail’ complet devait être livré. L'Astrologue en Chef prédisait le Chemin de la Vie des grands personnages et des membres importants de ces familles. Le gouvernement lui-même était conseillé par les astrologues, comme l'était le Dalaï-Lama. Mais CELA n'avait rien à voir avec l'astrologie Occidentale qui semble s'être prostituée à la presse à sensation.
Devant de longues tables basses, les prêtres-astrologues étaient assis, jambes croisées, vérifiant des chiffres, établissant des relations entre eux. On dessinait les graphiques des configurations célestes existant au moment de la conception, au moment de la naissance, au moment où allait se faire la lecture de l'horoscope, qui était connu bien à l'avance, et un graphique complet ainsi qu'une description annuelle étaient préparés pour chaque année de ‘la vie du sujet’. Le tout faisait alors l'objet d'un large rapport final.
Fait à la main, le papier tibétain se présente sous la forme de feuilles épaisses d'environ huit pouces (20 cm) de haut par environ deux pieds à deux pieds et demi (60 à 75 cm) de large. Le papier à écrire, en Occident, est plus long que large, alors qu'au Tibet c'est le contraire. Les pages des livres ne sont pas reliées entre elles, mais maintenues en une pile par deux planches de bois. En Occident, avec un tel système, les livres ne mettraient pas longtemps à être détruits ; les feuilles en seraient perdues ou déchirées. Au Tibet, le papier est sacré et fait l'objet de soins immenses ; gaspiller le papier constitue une offense grave et déchirer une page, c'est gaspiller du papier — d'où le soin extrême. Quand un lama lisait, un jeune acolyte se tenait toujours auprès de lui. La planche de bois recouvrant le dessus du livre était tout d'abord retirée avec grand soin, puis placée face au sol, à la gauche du Lecteur. La page du dessus une fois lue, l'acolyte l'enlevait avec respect pour la placer — toujours face au sol — sur la couverture de bois. La lecture achevée, les feuilles étaient alors soigneusement arrangées, et le livre attaché par des liens.
L'horoscope était préparé de cette façon. Chaque feuille écrite était mise de côté — pour sécher — car c'était une offense de gaspiller du papier par des bavures. Puis finalement, six mois plus tard, peut-être, le temps n'ayant aucune importance, l'horoscope était prêt.
Lentement, l'acolyte — qui dans ce cas était un jeune moine avec déjà plusieurs années d'expérience — soulevait respectueusement la feuille et la plaçait face contre terre sur la précédente. Le vieil Astrologue souleva la dernière feuille ainsi exposée et murmura mécontent :
— Tch, tch, cette encre n'est pas bonne. Même avant d'avoir vu la lumière, la couleur en est mauvaise. Cette page doit être récrite.
Prenant un de ses ‘bâtonnets à crayonner’, il nota rapidement une indication.
Ces bâtonnets à crayonner étaient une invention remontant à plusieurs milliers d'années, mais ils étaient fabriqués précisément de la même manière qu'ils l'avaient été deux ou trois mille ans auparavant. Il existait, en fait, une légende qui voulait que le Tibet ait été, en un temps, au bord d'une mer étincelante, et cette légende était étayée par la découverte fréquente de coquillages, de poissons fossilisés, et de nombreux autres objets qui ne pouvaient provenir que d'une région plus chaude et proche de la mer. On avait trouvé, enterrés, des objets sculptés, des outils, des bijoux, ayant appartenu à une race depuis longtemps éteinte. Tous ces objets, ainsi que de l'or, existaient en abondance sur les bords des rivières qui sillonnaient le pays.
Et maintenant les bâtonnets à crayonner étaient faits exactement de la même façon qu'auparavant. La première opération consistait à amasser une grande quantité d'argile, puis les moines se mettaient en route pour cueillir, sur les saules, les petits rameaux d'environ la moitié de l'épaisseur du petit doigt et peut-être d'un pied (30 cm) de long. Ceux-ci étaient très soigneusement rassemblés et alors apportés à un service spécial du Potala. Là, tous les rameaux y étaient soigneusement examinés et classés, les très droits sans faille étant traités avec une attention particulière, pelés et ensuite enveloppés d'argile, une grande prudence étant exercée pour s'assurer que les rameaux n'étaient pas pliés.
Les rameaux qui avaient une légère courbure ou une torsion étaient également enveloppés dans l'argile parce qu'ils seraient appropriés pour les moines juniors et les acolytes qui les utiliseraient pour écrire. Les paquets d'argile, chacun portant un sceau qui prouvait qu'il était d'une qualité supérieure (réservée aux lamas du plus haut rang et au Très Profond), puis ceux de première classe pour les lamas de haut rang, et ceux de seconde classe pour l'usage ordinaire, avaient un tout petit trou fait dans l'argile pour permettre à la vapeur de s'échapper au cours du processus de chauffage et éviter ainsi que l'enveloppe d'argile n'éclate.
L'argile était alors étendue sur des claies disposées dans une grande pièce, cela pendant un mois ou plus afin de laisser évaporer l'humidité. De quatre à six mois plus tard, les paquets d'argile étaient transportés sur un feu — un feu qui servait également à cuire, à chauffer l'eau, et ainsi de suite — et étaient soigneusement déposés sur la partie la plus rouge de ce feu. La température était maintenue pendant toute une journée, puis on laissait le feu s'éteindre. Une fois refroidies, les masses d'argile étaient ouvertes, l'argile maintenant inutile, jetée, et les bâtonnets de saule carbonisés (des fusains) étaient prêts pour le plus noble des usages, celui de la propagation de la vraie connaissance.
Les rameaux jugés impropres étaient utilisés pour entretenir le feu destiné à sécher l'argile enveloppant les bâtonnets de qualité supérieure. Ces feux étaient faits de bouse de yak bien sèche, et de n'importe quel bois mort trouvé à la ronde. Mais le bois n'était jamais employé pour les feux s'il pouvait servir à des fins ‘plus nobles’, car il était en très faible quantité au Tibet.
Ces bâtonnets à crayonner, ainsi, étaient cette commodité qui dans le monde Occidental est connue sous le nom de fusain et dont se servent les artistes pour les dessins en noir et blanc. Mais le Tibet avait également besoin d'encre et, pour sa fabrication, on utilisait un autre bois enveloppé également dans de l'argile qu'on soumettait plus longtemps au feu, et à une température beaucoup plus élevée. Quand les feux, après plusieurs jours, étaient éteints et les masses d'argile retirées du foyer maintenant froid, on les ouvrait et on trouvait à l'intérieur un résidu noir : du carbone presque pur.
Ce carbone, après avoir été examiné avec très grand soin pour éliminer tout ce qui n'était pas du carbone noir, était mis dans un morceau d'étoffe très grossière qu'on serrait et serrait au-dessus d'une pierre qui avait un renfoncement, qui avait, en fait, une cavité. La cavité pouvait avoir dix-huit pouces (45 cm) par 12 pouces (30 cm) et peut-être deux pouces (5 cm) de profondeur. Des moines de la classe domestique battaient l'étoffe au fond de la cuvette afin d'en faire sortir graduellement une poussière noire très fine. Cette poussière était ensuite mélangée à de la gomme chauffée, extraite de certains arbres de la région, et le mélange brassé, brassé et brassé jusqu'à ce qu'on obtienne une masse noire gluante. Mise à sécher en pains, il ne restait plus — lorsqu'on désirait de l'encre — qu'à frotter un de ces pains dans un récipient spécial en pierre et à ajouter un peu d'eau. L'encre obtenue ainsi était d'une couleur brun-roux.
Les documents officiels, de même que les graphiques astrologiques de grande importance, n'étaient jamais rédigés avec cette encre à usage commun. Pour une encre plus fine, on procédait ainsi : un morceau de marbre très poli était suspendu à un angle d'environ quarante-cinq degrés, sous lequel brûlaient une douzaine de lampes à beurre en grésillant. Les mèches en étaient maintenues trop longues — trop hautes — de façon à ce que les lampes dégagent une épaisse fumée noire. Cette fumée, en frappant le marbre poli, se condensait immédiatement en une masse noire. Quand l'épaisseur était jugée suffisante, un jeune moine faisait basculer la plaque de marbre et ramassait toute l'accumulation du ‘noir de fumée’, puis replaçait la plaque à son angle de quarante-cinq degrés pour recommencer l'opération.
Une résine recueillie des arbres était placée dans un récipient qu'on chauffait intensément, afin que la gomme arrive à la consistance de l'eau et devienne très claire. Il se formait sur la gomme en ébullition un épais résidu d'écume qu'on enlevait afin d'obtenir un liquide absolument clair, légèrement jaunâtre. Dans ce liquide, on déposait une masse de ‘noir de fumée’, et l'on brassait jusqu'à l'obtention d'une pâte assez dure. Cette mixture était alors mise à refroidir sur une pierre, où elle se solidifiait. Pour l'usage des lamas de haut rang et des officiels, le produit était présenté sous forme de rectangles et transformé en une masse assez présentable, mais les moines de l'échelon inférieur étaient pleinement heureux d'avoir une encre sous n'importe quelle forme. Pour l'utiliser on procédait comme pour le premier type, en somme, une pierre spéciale avec un renfoncement, ou une petite cavité, dans lequel on grattait en partie un petit bloc d'encre. On mélangeait alors avec de l'eau pour obtenir la consistance requise.
Le crayon en métal, bien sûr, n'existait pas au Tibet : pas de stylo-plume, pas de stylo-bille, mais des rameaux de saule soigneusement pelés et lissés, dont les extrémités étaient légèrement ébouriffés pour devenir, en fait, comme des brosses à poils très, très courts. Ces bâtonnets étaient ensuite mis à sécher avec grand soin — vraiment avec très grand soin pour éviter qu'ils ne se fendillent ou ne se déforment — et quand ils avaient assez séché, on les plaçait sur une pierre chaude, ce qui avait pour effet de les durcir par le feu afin de pouvoir être manipulés impunément et durer longtemps. L'écriture Tibétaine est, à dire vrai, une écriture au pinceau, car les caractères, les idéogrammes, sont traités de façon proche de celle des caractères Chinois ou Japonais.
Mais le vieil Astrologue continuait à maugréer sur la mauvaise qualité de l'encre d'une certaine page. Poursuivant sa lecture, il s'aperçut que ce qu'il lisait concernait la mort du sujet de l'horoscope. L'astrologie Tibétaine couvre tous les aspects d'une vie — de la naissance à la mort. Il parcourut avec attention ses prédictions, contrôlant, vérifiant, car il s'agissait là du membre d'une famille très importante. Prédictions importantes non seulement à cause de la famille, mais importantes en soi, vu la tâche qui lui était assignée.
Le vieil homme s'appuya en arrière, ses os craquant de lassitude. Avec un frisson d'appréhension, il se souvint que sa propre mort était dangereusement proche. C'était sa dernière grande tâche, la préparation d'un horoscope détaillé au point qu'il n'en avait jamais fait de tel auparavant.
L'achèvement de cette tâche et le succès de la déclamation de sa lecture aboutirait au relâchement des liens de la chair et hâteraient sa fin. La mort ne l'effrayait pas ; il savait qu'elle n'était qu'une période de transition ; mais transition ou non, c'était cependant une période de changement, et le vieil homme haïssait le changement et le redoutait. Il lui faudrait quitter son bien-aimé Potala, laisser libre sa position très convoitée d'Astrologue en Chef du Tibet, quitter toutes les choses qu'il connaissait, toutes les choses qui lui étaient chères ; il lui faudrait partir et, tout comme un novice arrivant dans une lamaserie, il devrait tout recommencer. Quand ? Il le savait ! Où ? Cela, il le savait aussi ! Mais c'était dur de quitter les vieux amis, dur de changer de vie, car la mort n'existe pas et ce que nous appelons mort n'est qu'une transition d'une vie à une autre.
Il se prit à penser au processus. Il se vit comme il en avait si souvent vu d'autres — mort, le corps immobile dorénavant incapable de mouvements, non plus une créature douée de sensations, mais juste une masse de chair morte soutenue par une ossature morte.
Il se vit ainsi, dépouillé de ses robes et recroquevillé, sa tête touchant ses genoux et ses jambes repliées en arrière. Il s'imagina chargé sur le dos d'un poney, enveloppé d'un tissu, et emmené au-delà de la périphérie de la Ville de Lhassa où on le confierait aux soins des Ordonnateurs de la Mort.
Ceux-ci prendraient son corps et le placeraient sur un grand roc plat préparé à cet effet. Son corps serait ouvert et les organes extraits. Le Chef des Ordonnateurs lancerait alors vers le ciel un appel sonore, et s'abattrait la troupe de vautours, bien habitués à de telles choses.
Le Chef des Ordonnateurs prendrait le cœur qu'il lancerait au vautour en chef, lequel l'avalerait sans sourciller, puis les autres vautours auraient droit aux reins, aux poumons et autres organes.
Mains couvertes de sang, les Ordonnateurs arracheraient la chair de dessus les os blancs, la couperaient en lamelles et la jetteraient aux vautours assemblés comme une congrégation solennelle de vieillards à une réunion.
Une fois toute la chair arrachée et tous les organes enlevés, les os seraient alors cassés en petits morceaux et poussés dans des trous du roc. Des piquets de roche les martèleraient alors jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'une poudre. Cette poudre serait mélangée avec le sang et les autres sécrétions du corps, et le mélange obtenu serait laissé sur les rochers pour nourrir les oiseaux. En l'affaire de quelques heures, il n'y aurait plus trace de ce qui avait été un homme. Plus trace, non plus, de vautours. Ils s'en seraient allés — quelque part — attendant qu'on fasse de nouveau appel à leurs sinistres services.
Le vieil homme pensait à tout cela, pensait aux choses qu'il avait vues en Inde où, chez les pauvres, le corps était jeté dans la rivière avec un poids ou enseveli dans la terre ; alors que les plus riches, ceux qui avaient les moyens d'acheter du bois, faisaient brûler les corps jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres friables qui étaient jetées dans quelque rivière sacrée, espérant ainsi que l'esprit de la personne serait rappelé au sein de la ‘Terre Mère’.
Le vieil homme se secoua violemment en murmurant :
— Ce n'est pas le moment de penser à ma transition. Que je finisse d'abord de préparer les notes sur la transition de ce petit garçon !
Mais ce ne devait pas être, car il fut interrompu. Il murmurait des instructions concernant la page qui devait être récrite avec une encre meilleure quand lui parvint le bruit de pas rapides et celui d'une porte qu'on claquait. Le vieil homme leva les yeux, irrité, car il n'était pas habitué à des interruptions de cette sorte ; il était anormal d'entendre du bruit dans le Service d'Astrologie. C'était, en effet, une zone de calme, de quiétude et de contemplation où le silence n'était rompu que par le bruit du fusain grattant la surface rude du papier. Puis on entendit des bruits de voix : "Je DOIS le voir. Je DOIS le voir sur-le-champ. Le Très Précieux le demande."
Des bruits de pas sur le sol et le bruissement d'une étoffe raide. Un lama du personnel du Dalaï-Lama apparut serrant dans sa main droite un bâton dont l'extrémité, qui portait une fente, laissait paraître un papier écrit de la main du Très Précieux lui-même. Le lama s'avança, s'inclina devant le vieil Astrologue, et abaissa le bâton dans sa direction pour qu'il puisse en retirer la missive. L'ayant lue, le vieil homme eut une moue de consternation.
— Mais, mais, grommela-t-il, comment puis-je aller maintenant ? Je suis en plein milieu de mes calculs et de mes évaluations. Si je m'arrête à ce stade... Mais il comprit qu'il n'avait pas le choix et devait partir ‘sur-le-champ’. Avec un soupir de résignation, il changea sa vieille robe de travail pour une plus soignée, prit quelques graphiques et quelques bâtonnets à crayonner et, se tournant vers un moine qui se tenait près de lui, lui dit :
— Prends ceci, mon garçon, et accompagne-moi.
Lentement, il sortit de la pièce, dans le sillage du lama à la robe d'or.
Le lama modérait ses pas pour permettre au vieil homme de le suivre sans trop de fatigue. Ils traversèrent d'interminables corridors, au long desquels moines et lamas arrêtaient leurs activités et s'immobilisaient respectueusement en s'inclinant au passage de L'Astrologue en Chef.
Après une marche considérable, et montant d'un étage à l'autre, le lama à la robe d'or et l'Astrologue en Chef atteignirent enfin le tout dernier étage où se tenaient les appartements du Dalaï-Lama, le Treizième Dalaï-Lama, le Très Précieux, celui qui allait faire plus pour le Tibet qu'aucun autre Dalaï-Lama.
Tournant un coin, les deux hommes rencontrèrent trois jeunes moines se conduisant de façon apparemment désordonnée, patinant, les pieds enveloppés d'étoffe. Avec respect, ils interrompirent leurs gambades et se mirent sur le côté pour laisser passer les deux hommes. Ces jeunes hommes avaient un travail à temps plein : il y avait de nombreux étages à entretenir impeccablement polis, et les trois jeunes moines passaient toutes leurs heures de travail les pieds enrobés de lourds chiffons, marchant, courant et glissant sur de vastes étendues de planchers, et leurs efforts ajoutaient à la patine de l'âge un brillant prodigieux. Mais — le sol était terriblement glissant. Avec égard, le lama à la robe d'or prit le vieil Astrologue par le bras, parfaitement conscient qu'à cet âge une jambe cassée ou un bras cassé constituerait pratiquement une sentence de mort.
Ils arrivèrent bientôt dans une grande pièce ensoleillée, où le Grand Treizième lui-même, assis dans la position du lotus, regardait le panorama des montagnes de l'Himalaya s'étendant devant lui et, en fait, tout autour de la Vallée de Lhassa.
Le vieil Astrologue se prosterna devant le Dieu-Roi du Tibet. Le Dalaï-Lama fit signe aux serviteurs de s'éloigner et, très vite, les deux hommes se retrouvèrent l'un en face de l'autre, assis sur des coussins qui, au Tibet, tiennent lieu de chaises.
Ils se connaissaient depuis longtemps, bien versés dans leurs habitudes mutuelles. L'Astrologue en Chef était au courant de toutes les affaires de l'État, connaissait toutes les prédictions concernant le Tibet, étant l'auteur de la plupart d'entre elles. Le Grand Treizième avait en ce moment un air grave, car le Tibet vivait des jours importants, des jours de stress, des jours d'inquiétude. La East India Company, une société Britannique, essayait de sortir de l'or et d'autres articles du pays, et divers agents et dirigeants du pouvoir militaire Britannique caressaient l'idée d'envahir le Tibet et d'en prendre le contrôle, mais la menace de la Russie à l'horizon empêcha la réalisation de ce projet drastique. Il suffira de dire que, à ce stade, les Anglais causèrent beaucoup d'agitation et beaucoup d'ennuis au Tibet, tout comme les Communistes Chinois devaient le faire beaucoup plus tard. En ce qui concerne les Tibétains, ils n'avaient que faire des Anglais et des Chinois et demandaient simplement qu'on les laissât en paix.
Le Tibet, malheureusement, avait à ce moment un autre problème plus sérieux, celui de deux sectes de prêtres — l'une connue sous le nom de Bonnets Jaunes, l'autre, sous celui de Bonnets Rouges. Il y avait parfois de violents conflits entre eux et les deux chefs, le Dalaï-Lama qui était à la tête des Bonnets Jaunes, et le Panchen-Lama, qui était à la tête des Bonnets Rouges, n'éprouvaient l'un pour l'autre aucune sympathie.
Il en était de même, à la vérité, entre les deux sectes. À ce moment, les partisans du Dalaï-Lama avaient le dessus, mais il n'en avait pas toujours été ainsi. En un temps, le Panchen-Lama — qui devait bientôt être contraint de quitter le Tibet — avait dominé la situation, et le pays avait alors été plongé dans le chaos jusqu'au moment où le Dalaï-Lama avait pu revendiquer ses droits aidé par les Tartares, et parce que du point de vue religieux les Bonnets Jaunes avaient ce qu'on pourrait appeler une ‘sainteté supérieure’.
Le Très Précieux — le Dalaï-Lama qui a reçu ce titre et qui était connu de tous comme Le Grand Treizième — posa plusieurs questions concernant l'avenir probable du Tibet. Cherchant dans le porte-documents qu'il avait apporté, le vieil Astrologue sortit des papiers et des graphiques sur lesquels se penchèrent les deux hommes pour les étudier.
— Dans moins de soixante ans, dit l'Astrologue, le Tibet n'existera plus en tant qu'entité libre. La Chine, l'ennemi héréditaire, avec une forme nouvelle de gouvernement politique envahira le pays et éliminera pratiquement l'Ordre des Prêtres du Tibet.
À la mort du Grand Treizième, le Dalaï-Lama fut informé, un autre serait choisi comme un palliatif à l'agression chinoise. On choisirait un enfant pour être la Réincarnation du Grand Treizième, et sans tenir compte de l'exactitude de ce choix, ce serait d'abord et avant tout un choix politique, car celui qu'on appellerait le Quatorzième Dalaï-Lama viendrait du territoire sous contrôle Chinois.
Le Très Précieux était extrêmement consterné par toute cette affaire et essayait de trouver un moyen de sauver son pays bien-aimé, mais, comme le fit remarque le vieil Astrologue avec sagesse, on peut faire beaucoup pour contourner le mauvais horoscope d'un individu, mais on ne connaît pas de moyen de modifier de façon substantielle l'horoscope et la destinée de tout un pays. Un pays est composé de trop d'unités différentes, de trop d'individus qui ne peuvent être ni moulés, ni commandés, ni persuadés de penser dans la même ligne, au même moment, et dans le même but. Ainsi, le destin du Tibet était connu. Le destin des Paroles de Sagesse, des Livres Saints et de la Science Sacrée n'étaient pas encore connu, mais on pensait que par des moyens appropriés il était possible de former un jeune homme, de lui donner un savoir spécial, des capacités exceptionnelles, et de l'envoyer ensuite dans le monde au-delà des confins du Tibet afin qu'il puisse mettre par écrit son savoir et sa connaissance du Tibet. Les deux hommes poursuivirent leur conversation, et le Dalaï-Lama finit par dire :
— Et ce jeune garçon, le petit Rampa, avez-vous préparé son horoscope ? Je voudrais que vous le lisiez lors d'une réunion spéciale chez les Rampa dans deux semaines à partir d'aujourd'hui.
L'Astrologue en Chef eut comme un frémissement. Deux semaines ? Il n'aurait été prêt ni dans deux mois ni dans deux ans s'il n'avait reçu une date fixe. Aussi, d'une voix chevrotante, il répondit :
— Oui, Votre Sainteté, tout sera prêt dans deux semaines à compter d'aujourd'hui. Mais ce garçon va connaître une vie d'infortunes, de souffrances et de tortures, la maladie, sera désavoué par ses propres compatriotes — tout obstacle imaginable sera placé sur son chemin par des forces du mal, dont une force particulière que jusqu'à présent je n'ai pas encore complètement comprise, mais qui semble être en liaison sous certains rapports avec ceux qui travaillent pour les journaux.
Le Dalaï-Lama laissa échapper un soupir sonore puis dit :
— Oublions cela pour l'instant, car ce qui est inévitable ne peut être modifié. Vous devrez travailler encore sur cet horoscope pendant les deux semaines à venir, afin d'être absolument sûr de ce que vous allez proclamer. Pour l'instant — j'aimerais me détendre des affaires de l'État en faisant une partie d'échecs avec vous.
La clochette d'argent résonna et un lama en robe d'or entra. Le Dalaï-Lama lui ordonna d'apporter l'échiquier afin que les deux hommes puissent jouer. Ce jeu était très populaire parmi les intellectuels de Lhassa, mais il ne se jouait pas de la même façon qu'en Occident, où, en début de partie, le premier pion de chaque camp peut se déplacer de deux cases, alors qu'au Tibet ce n'est que d'une case. De même, il n'existe pas, comme en Occident, de règle qui veut qu'un pion ayant atteint la ligne du fond puisse devenir une tour, et la position de pat n'est pas utilisée. On estimait qu'il y avait état d'équilibre ou d'inertie quand le roi restait seul, sans un pion ou une autre pièce sur l'échiquier.
Les deux hommes jouèrent avec une patience infinie, à l'aise dans le climat d'affection et de respect qui s'était établi entre eux, tandis qu'au-dessus d'eux, sur le toit plat qui recouvrait les appartements du Dalaï-Lama, les drapeaux de prières claquaient sous la brise des montagnes. Plus bas, au long du corridor, les moulins à prières cliquetaient, produisant en série leurs interminables prières imaginaires. Sur les toits plats, provenant des tombes des incarnations précédentes du Dalaï-Lama, des lueurs d'or aveuglantes brillaient, car selon la croyance Tibétaine chaque Dalaï-Lama, quand il meurt, va simplement en transition et revient sur Terre dans le corps d'un petit garçon. Au Tibet, la transmigration est un fait de la religion si bien accepté, qu'elle ne mérite même pas de commentaire. Ainsi donc, sur le toit plat, douze corps gisaient dans douze tombes dorées, chacune étant ornée d'un toit compliqué, décoré de spirales, volutes et autres motifs, destinés à éloigner les ‘mauvais esprits’.
Du toit où se trouvaient les tombes dorées, on pouvait voir le chatoyant bâtiment du Chakpori, le Collège de la Science Médicale, sur la Montagne de Fer, le centre médical du Tibet. Au-delà s'étendait la Ville de Lhassa, brillante en ce jour sous le soleil à son zénith. Le ciel était d'un profond violet et, sur le sommet des montagnes encerclant la Vallée de Lhassa, on voyait s'élever des volutes de pure neige blanche chassées par le vent.
Mais le jour avançait et les ombres des montagnes grandissaient annonçant aux deux hommes que l'heure de la prière approchait. À regret et en soupirant, ils abandonnèrent leur jeu. Pour le Dalaï-Lama, c'était le moment de se livrer à ses dévotions et, pour l'Astrologue en Chef, celui de retourner à ses calculs, s'il tenait à respecter le délai fixé par le Dalaï-Lama : être prêt dans deux semaines.
De nouveau la clochette tinta, et de nouveau apparut le lama en robe dorée, auquel le Dalaï-Lama donna l'ordre d'escorter l'Astrologue en Chef jusqu'à ses quartiers, trois étages plus bas.
Avec effort, le vieil Astrologue se leva, se prosterna selon le rituel et quitta son Chef Spirituel.
Chapitre Deux
— Oo-ee ! Oo-ee ! Ay-yah ! Ay-yah ! dit la voix dans le crépuscule de cette agréable journée. Avez-vous entendu ce qu'on dit sur cette Dame Rampa ? Elle a recommencé !
On entendit des pas sur la route, le bruit de graviers roulant sous les pieds, puis un soupir :
— Dame Rampa ? Qu'a-t-elle fait, maintenant ?
La première voix répondit avec une allégresse mal dissimulée. Pour un certain type de femme — peu importe sa classe sociale, sa nationalité — si elle est porteuse de nouvelles, de préférence mauvaises, elle a eu une bonne journée.
— La tante de mon beau-fils a entendu une étrange histoire. Comme vous savez, elle va épouser cet homme des douanes qui travaille à la Porte de l'Occident. Il lui a dit que, depuis des mois, Dame Rampa a commandé toutes sortes de choses en Inde, et les caravaniers commencent à livrer les marchandises. Avez-vous entendu quelque chose à ce sujet ?
— Ma foi, je sais qu'il va se passer quelque chose de spécial, très bientôt, dans leurs jardins ; mais vous devez vous souvenir que le Grand Seigneur Rampa était notre Régent quand le Très Précieux est allé en Inde durant l'invasion anglaise qui a fait tant de mal. Je trouve tout à fait naturel qu'une des premières dames de notre pays ait envie de commander certaines choses. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela !
L'informatrice prit sa respiration et lança :
— Ah ! Mais vous ne savez pas tout, pas même la moitié ! J'ai entendu dire, par un des mes amis qui est au service d'un des moines, en bas, au Kesar — il vient du Potala, vous savez — qu'un horoscope très, très complet était en préparation pour ce petit garçon, vous savez le petit nabot qui a toujours des histoires et qui doit donner du fil à retordre à son père. Je me demande si vous avez des informations à ce sujet ?
La seconde dame réfléchit un instant puis répondit :
— Oui, mais vous devez vous souvenir que Paljor est mort récemment — j'ai vu emporter son corps, je l'ai vu de mes propres yeux. Les Briseurs de Corps l'ont emmené de la maison avec beaucoup de respect, et les deux prêtres l'accompagnèrent jusqu'à la grille, mais j'ai vu également que, sitôt les deux prêtres disparus, on a laissé tomber ce pauvre petit corps sans aucun respect sur le dos d'un poney, et on l'a emmené au Ragyab afin que les Ordonnateurs de la Mort le mettent en pièces et qu'il nourrisse les vautours. Il fallait s'en défaire.
— Non ! Non ! corrigea l'informatrice exaspérée. Vous ne comprenez pas ; vous ne pouvez pas avoir le sens de ces questions sociales ; avec la mort de l'aîné, ce petit garçon, Lobsang, est maintenant l'héritier de tous les biens et de la fortune de la famille Lhalu. Vous savez qu'ils sont millionnaires. Ils ont de l'argent ici, en Inde, et même en Chine. Je dirai qu'ils sont les gens les plus riches du pays. Et pourquoi ce jeune garçon hériterait-il de toute cette fortune ? Pourquoi serait-il assuré de vivre dans le luxe quand nous devons, nous, travailler ? Mon mari m'a dit que cela n'avait aucune importance, qu'un de ces jours les choses changeraient, que nous prendrions les résidences des gens fortunés, et qu'à leur tour ils travailleraient pour nous. Nous verrons ce que nous verrons si nous vivons assez longtemps. Que ce jour-là soit loué !
Des pas très lents venaient à travers le crépuscule, et on discerna un visage et les tresses noires d'une femme Tibétaine.
— J'ai, sans le vouloir, entendu ce que vous disiez, dit la nouvelle arrivée. Mais n'oubliez pas que ce jeune garçon, Lobsang Rampa, a devant lui une vie très dure, parce que tous les gens riches ont une vie vraiment très, très dure.
— Alors ! s'exclama l'informatrice, nous devrions tous avoir une vie facile. Nous sommes tous pauvres, n'est-ce pas ?
Sur ce, elle ricana et gloussa comme une sorcière.
La nouvelle venue poursuivit :
— J'ai entendu dire, moi aussi, qu'on prépare une grande affaire où le Grand Seigneur Rampa annoncera que son fils Lobsang est son héritier. J'ai également entendu dire que le jeune garçon va être envoyé en Inde pour y recevoir une formation, et le difficile sera qu'il ne tombe pas aux mains des Anglais, car ceux-ci essaient de prendre le contrôle de notre pays, vous le savez, et regardez quel mal ils ont fait. Mais riche ou pauvre, ce garçon a devant lui une vie très dure ; rappelez-vous ce que je vous dis — rappelez-vous ce que je vous dis.
Les voix s'éteignirent tandis que les trois femmes s'en allaient au long de la Route de Lingkhor, passant devant le Temple du Serpent, et suivant le Kaling Chu pour passer le Pont Chara Sampa.
À quelques mètres de là — ou peut-être un peu plus de quelques mètres ! — le sujet de leur discussion, un petit garçon qui n'avait pas encore sept ans, se tournait et retournait sur le dur, dur plancher de sa chambre. Plus ou moins endormi, il avait des rêves agités et des cauchemars épouvantables ; il songeait à des cerfs-volants et à ce qui arriverait si l'on venait à découvrir que c'était lui qui faisait voler le cerf-volant qui était allé tomber sur des voyageurs en affolant tellement leurs poneys que l'un des cavaliers était tombé et avait roulé dans la rivière. C'était un homme très important que ce cavalier — l'assistant d'un Abbé dans une des Lamaseries. Le pauvre garçon s'agitait dans son sommeil en songeant à toutes les terribles punitions corporelles qu'il subirait si l'on venait à découvrir qu'il était le coupable.
La vie était très dure pour les jeunes garçons des familles éminentes de Lhassa. Ces garçons étaient censés être un exemple pour les autres, ils étaient censés supporter les difficultés pour s'endurcir pour les luttes de la vie, ils étaient censés avoir de plus grandes difficultés que ceux de naissance inférieure, pour servir d'exemple, pour montrer que même les fils de gens fortunés, même les fils de ceux qui gouvernaient le pays, étaient capables d'endurer la douleur, la souffrance et les privations. Et la discipline pour un petit garçon qui n'avait même pas encore sept ans était quelque chose que les garçons Occidentaux de n'importe quel âge ne pourraient jamais supporter.
D'au-delà du Pont parvenait le marmonnement des trois femmes qui venaient de s'arrêter pour un dernier brin de causette avant de se séparer pour rejoindre leurs maisons. Portés par la brise, on entendit les mots ‘Rampa’, ‘Yasodhara’, puis un murmure de voix, un bruit de gravier écrasé, et, s'étant mutuellement souhaité une bonne nuit, elles partirent chacune de leur côté.
Dans la grande résidence Lhalu, dont les grilles massives avaient si bien résisté aux assauts de l'infanterie Britannique qu'elle avait dû, pour pénétrer, faire une brèche dans le mur de pierre, toute la famille dormait, à l'exception des ‘Gardiens de la Nuit’, ceux qui veillent et annoncent les heures et le temps qu'il fait pour que ceux qui sont restés éveillés puissent suivre les progrès de la nuit.
Adjacents à la chapelle de la résidence Lhalu, se trouvaient les quartiers des Intendants. Les officiels Tibétains de la plus haute classe avaient un ou deux prêtres en permanence attachés à la chapelle de leur résidence. La résidence Rampa était d'une telle importance que deux prêtres étaient considérés absolument nécessaires. Tous les trois ans, ces prêtres — moines du Potala — étaient remplacés par d'autres, afin de leur éviter d'être trop gâtés par leur vie domestique. Un des lamas — car ces moines étaient en fait des lamas — n'était arrivé que récemment à la maison. L'autre s'apprêtait à retourner très bientôt à la discipline sévère de la lamaserie, mais il s'agitait nerveusement, cherchant comment il pourrait prolonger son séjour, car pouvoir assister à la cérémonie de proclamation de l'horoscope d'un hériter d'une grande famille était une chance unique, la chance qui permettrait à tous de savoir quel genre d'homme deviendrait le jeune héritier.
C'était un jeune lama, venu à la résidence Lhalu chaudement recommandé par son Abbé, et il s'était révélé décevant. Ses plaisirs n'étaient pas complètement ecclésiastiques, car il accordait une attention déplacée aux jeunes filles plaisantes du personnel domestique. L'Intendant, qui habitait du côté gauche de la chapelle, n'avait pas été sans le remarquer, il s'en était plaint, et le pauvre jeune lama, tombé en disgrâce, attendait son renvoi. Son remplaçant n'avait pas encore été nommé, et le jeune homme se demandait donc comment il pourrait bien gagner du temps et avoir l'honneur de participer à la cérémonie et aux célébrations religieuses qui suivraient.
Le malheureux Intendant connaissait de grandes inquiétudes et de gros soucis. Dame Rampa n'était pas une personne facile à vivre, dure parfois dans ses jugements et prête à condamner sans entendre les explications de celui qui se débattait avec de réelles difficultés. Depuis trois mois, il avait commandé des marchandises et — eh bien, chacun savait à quel point ces commerçants Indiens étaient lents — mais Dame Rampa ne voulait rien savoir et accusait le pauvre Intendant de torpiller la cérémonie par son inefficacité à se faire livrer lesdites marchandises.
— Que puis-je faire ? se répétait-il en se tournant et se retournant sur sa couverture étendue sur le sol. Comment puis-je persuader les commerçants de livrer les commandes à temps ?
Soudain, il s'endormit, la bouche grande ouverte, laissant échapper des ronflements si sonores que le gardien de nuit entra pour voir s'il n'était pas à l'agonie !
Dame Rampa s'agitait, elle aussi, sans pouvoir trouver le sommeil, tourmentée par son sens mondain et par celui des bons usages : l'Intendant était-il certain des règles de préséance ? Les invitations sur papier fait main avaient-elles bien été attachées par un ruban et placées dans la fente d'un bâton à message que des messagers rapides montés sur des poneys devaient aller porter aux invités ? Les choses se devaient d'être faites selon les usages, il fallait aussi veiller à ce que l'invitation à un inférieur ne parvienne pas avant celle destinée à un supérieur. Ces choses-là transpirent, et il y a toujours des gens qui sont ravis de critiquer une hôtesse qui s'efforce de faire de son mieux pour le prestige de la famille. Dame Rampa se tournait et se retournait, s'inquiétant à propos des commandes, s'inquiétant de savoir si tout arriverait bel et bien à temps.
Dans une petite chambre toute proche, Yasodhara, la sœur, se tracassait. Sa mère avait décidé de la robe qu'elle porterait pour la célébration, et ce n'était pas celle que Yasodhara aurait aimé avoir. C'était, après tout, une occasion unique de pouvoir examiner de près les garçons et voir celui qui, plus tard, pourrait être un époux convenable. Et pour cela, elle estimait qu'elle se devait d'être à son avantage et aussi attrayante que possible — robe seyante, cheveux bien brossés et enduits de beurre de yak, et les vêtements bien poudrés avec le plus fin des jasmins. Mais sa mère était comme les autres mères qui ne comprennent jamais les jeunes, car elles sont d'un autre âge et ont oublié leur propre jeunesse ! Elle continuait à penser à son apparence, se disant qu'elle pourrait peut-être ajouter un ruban par-ci, mettre une fleur par-là.
La nuit avançant de plus en plus et une aube nouvelle, l'aube d'un nouveau jour, étant prête à naître, le beuglement des conques et des trompettes éveilla toute la maisonnée. Le jeune Rampa ouvrit un œil chassieux, grogna, puis se retourna et se rendormit avant même d'avoir complété son mouvement.
En bas, près de l'office de l'Intendant, c'était la relève des veilleurs de nuit. Les plus humbles, parmi les domestiques, se réveillèrent en sursaut au vacarme provenant des temples environnants et bondirent sur leurs pieds, se débattant pour enfiler leurs vêtements à moitié glacés. Ils avaient, en effet, pour tâche de raviver les feux qui couvaient durant la nuit, puis de polir les sols et de procéder au nettoyage, pour que la ‘famille’ trouve la maison en bon ordre quand elle descendrait.
Dans les écuries qui abritaient plusieurs chevaux, et dans les bâtiments de la ferme où étaient parqués les yaks, les serviteurs s'affairaient à ramasser le fumier de la nuit. Séché et mélangé avec quelques parcelles de bois, il constituait le combustible du Tibet.
Les cuisiniers s'apprêtaient à contrecœur à faire face à une nouvelle journée. Ils étaient las, travaillant depuis plusieurs semaines à la préparation de quantités fantastiques de nourriture, et ayant la tâche supplémentaire d'essayer de la protéger contre les doigts agiles des petits garçons et ceux des petites filles, aussi. Ils étaient à bout, et en avaient assez de toute cette histoire. "Pourquoi, disaient-ils sans cesse entre eux, cette célébration ne se hâte-t-elle pas de commencer et de finir, pour que nous puissions avoir enfin un peu de paix ? Notre maîtresse a achevé de perdre la tête, avec tous ces préparatifs."
La maîtresse — Dame Rampa — avait en vérité été très occupée. Pendant des jours, elle avait importuné les secrétaires de son mari, afin qu'ils établissent la liste des gens les plus éminents de Lhassa et de quelques privilégiés choisis parmi d'autres centres voisins. De même, elle avait fait la difficile demande que soient invités les étrangers qui pourraient avoir plus tard une influence bénéfique, mais là encore, on se trouvait devant le problème du protocole et de l'ordre d'ancienneté : qui avait priorité sur qui ? Qui pourrait être insulté dans cette position-CI, alors que la personne en question estimait devoir être dans cette position-LÀ ? C'était toute une tâche, toute une épreuve, tout un tourment, et les serviteurs étaient fatigués de recevoir un certain jour une liste et de constater que le jour suivant une nouvelle liste remplaçait celle de la veille.
Les grands nettoyages duraient maintenant depuis plusieurs jours ; on avait frotté au sable fin tout l'extérieur du bâtiment pour en faire luire la pierre, et des serviteurs robustes parcouraient la maison les pieds enveloppés de chiffons, traînant de lourds blocs de pierre, eux-mêmes enveloppés de chiffons, sur des sols déjà luisants comme des miroirs.
Dans les jardins, on travaillait à enlever toutes les mauvaises herbes et même les graviers qui n'étaient pas de la couleur désirée. La maîtresse de maison exigeait des besognes dures ; ceci était le point culminant de sa vie. Le fils et héritier de l'établissement Lhalu, un garçon qui pourrait être prince — ou qu'en sait-on ? — allait être lancé dans la vie, et seuls les astrologues diraient ce qu'allait être son existence, mais ils gardaient secret ce qu'ils s'apprêtaient à révéler.
La dame de la maison, épouse d'un des hommes les plus puissants de la vie laïque du Tibet, espérait très fort que son fils pourrait quitter le Tibet pour être éduqué ailleurs ; elle espérait arriver à persuader son mari de la laisser aller voir fréquemment son fils dans le lieu où il ferait ses études. Elle espérait visiter différents pays, car on la surprenait souvent à regarder des magazines de voyages, apportés à Lhassa par des commerçants itinérants. Elle avait ses plans, ses rêves et ses ambitions, mais leur réalisation était soumise au verdict du Chef Astrologue, et chacun savait qu'il ne se laissait pas influencer par la position sociale de l'intéressée.
Le moment du grand Événement approchait rapidement. Les négociants entraient par la Porte de l'Occident et se hâtaient vers la résidence Lhalu, les plus malins — ou ceux qui avaient une plus grande perspicacité commerciale — sachant que Dame Rampa accueillerait tout ce qu'ils seraient à même de présenter qui n'aurait pas encore été vu dans Lhassa, tout ce qui emplirait d'une admiration simulée ses voisines et ses rivales mondaines qui, en fait, dissimulaient de la frustration et de la jalousie de ne pas avoir été, Elles, les premières à l'avoir.
Plus d'un négociant chemina lentement de la Porte de l'Occident au long de la Route de Lingkhor, passant derrière le Potala, le Temple du Serpent, jusqu'à la résidence Lhalu, pour essayer de séduire la dame de la maison avec d'étranges objets exotiques qui lui permettraient de surprendre et d'amuser ses invités. Ils venaient parfois en équipage traîné par des yaks, afin d'apporter toutes leurs marchandises à la résidence pour que la dame en personne puisse voir précisément ce qu'ils avaient à vendre, et les prix, bien sûr, étaient alors augmentés vu l'importance de l'occasion, car aucune dame digne de ce nom n'aurait osé marchander ou discuter les prix, de peur que les négociants ne mentionnent aux voisines que Lady Rampa ne pouvait payer un prix raisonnable, mais voulait un rabais, ou des concessions, ou des échantillons.
Jour après jour, les convois allaient et venaient ; jour après jour, les hommes chargés des étables recueillaient la manne laissée par les yaks et l'ajoutaient au tas qui grossissait rapidement. Il faudrait d'ailleurs une énorme quantité de combustible pour la cuisson, le chauffage et les feux de joie, car comment une fête serait-elle réussie sans un bon feu de joie ?
Les jardins une fois débarrassés des mauvaises herbes, les jardiniers s'occupèrent des arbres, s'assurant qu'ils ne portaient ni branches cassées ni branches mortes qui pourraient paraître inesthétiques et conduiraient à une accusation de jardin mal entretenu. Ce pourrait être encore plus désastreux si une petite branche tombait sur une noble dame et dérangeait sa coiffure qui avait demandée des heures pour être tressée sur un treillis spécial en bois laqué. Aussi les jardiniers étaient-ils las de ces préparatifs, las de travailler, mais ils n'osaient rester inactifs, car Dame Rampa avait l'œil partout ; si un jardinier se reposait quelques instants pour soulager son dos, elle arrivait sur lui, folle de colère, lui reprochant de retarder les préparatifs.
L'ordre de préséance fut enfin décidé et approuvé par le Grand Seigneur Rampa lui-même qui posa personnellement son sceau sur chacune des invitations au fur et à mesure qu'elles étaient soigneusement préparées par les moines-scribes. Le papier était spécialement fabriqué pour l'occasion, un papier épais avec un bord rugueux, presque frangé, en fait. Chaque feuille avait grossièrement douze pouces de large (30 cm) par deux pieds (60 cm) de long. Ces invitations n'étaient pas de la taille normale ni du modèle en usage dans les lamaseries, où le papier est plus large que long ; quand il s'agissait d'invitations très importantes, elles étaient sur un papier plus étroit, environ deux fois plus long que large. La raison en était que l'invitation une fois acceptée, le papier était attaché, à ses extrémités, à deux pièces de bambou richement décorées à leurs bouts, et l'invitation était alors soigneusement suspendue par une cordelette et devenait un motif décoratif, montrant l'importance de celui qui l'avait reçue.
Le Seigneur Rampa appartenait à l'une des Dix Premières familles de Lhassa. Il était en fait des Cinq Premières familles, et Dame Rampa appartenait à l'une des Dix Premières, autrement ils n'auraient pu être mariés. Vu le fait que chacun des deux avait un statut social si élevé, deux sceaux devaient être apposés sur les invitations, un pour Sa Seigneurie et un pour Madame, et comme ils étaient mariés et possédaient un si vaste domaine, ils avaient un troisième sceau, le Seau Immobilier, qui devait également figurer sur le document. Chacun des sceaux était d'une couleur différente, et Dame Rampa et son Intendant étaient dans un état proche de la panique à l'idée que les messagers pourraient par maladresse faire quelque chose qui ferait craquer les fragiles, friables cachets.
Des bâtons à message spéciaux étaient préparés. Ils devaient être exactement de la même longueur et presque de même épaisseur, et chacun avait une fente spéciale à une extrémité qui recevait et retenait le message. Puis, juste au-dessous de cette fente, une pièce était fixée portant les armoiries familiales. Sous celles-ci, on trouvait d'étroites bandes d'un papier résistant sur lequel des prières étaient imprimées pour la protection du messager et pour une livraison sans embûche du message au destinataire qui, on l'espérait, serait en mesure d'accepter l'invitation.
Pendant un certain temps, les messagers furent soigneusement instruits sur la façon la plus imposante de monter et de distribuer leurs messages. Montant leurs chevaux, ils agitaient leur bâton à message dans l'air comme s'il s'était agi d'une lance, puis, sur un signal, ils chargeaient en avant et, l'un après l'autre, s'approchaient du Capitaine des Gardes qui les instruisait. Ce dernier, feignant d'être le maître de la maison, ou son intendant, retirait gracieusement le message du bâton qui était tendu vers lui. Il s'inclinait alors respectueusement devant le messager qui, après tout, représentait la ‘famille’. Le messager, ayant retourné le salut, lançait alors son cheval au galop pour retourner d'où il venait.
Une fois les messages, ou invitations, préparés, ils étaient placés par ordre de préséance, le messager le plus imposant se chargeant du message le plus important, et ainsi de suite, et il partait ensuite au galop pour sa distribution. D'autres messagers se présentaient, prenaient chacun un message qu'ils logeaient dans la fente du bâton et partaient ensuite au galop. Ils revenaient bientôt et toute la procédure reprenait jusqu'à ce que, finalement, toutes les invitations soient parties ; c'est alors que commençait pour l'Intendant et les autres l'épreuve pénible de l'attente. Combien d'invitations seraient acceptées ? Avait-on préparé trop de nourriture, ou pas assez ? C'était quelque chose de très éprouvant pour les nerfs.
Certains des invités se contenteraient de rester dans les jardins, surtout s'ils n'étaient pas d'un statut social suffisant pour être admis dans la maison elle-même, mais d'autres — eh bien, ils étaient plus importants et se devraient d'entrer à l'intérieur, et les représentants du clergé auraient envie de voir la chapelle. Aussi, tous les autels et leurs balustrades devaient être décapés de leur vernis, et des hommes se virent confier cette besogne. Armés de chiffons, et à l'aide de sable humide, ils frottaient inlassablement afin de débarrasser le bois de son vieux vernis et le faire apparaître brillant et comme neuf. Ensuite était appliquée une couche de fond spéciale, et quand elle était sèche, on recouvrait les autels et les balustrades extrêmement soigneusement de plusieurs couches de vernis pour finalement leur donner l'apparence brillante d'une eau tranquille par un jour ensoleillé.
Puis ce fut l'inspection minutieuse des pauvres serviteurs, appelés chacun à leur tour devant la maîtresse de maison et l'Intendant, afin d'examiner l'état et la propreté de leurs vêtements. Si le nettoyage de ceux-ci était jugé nécessaire, on préparait de grands chaudrons d'eau chaude et on procédait au lessivage. Enfin, la tension ayant atteint son paroxysme, toutes les invitations ayant reçu réponse, tous les serviteurs ayant subi l'inspection, et tous les vêtements mis de côté pour la fête et ne devant pas être portés avant le Grand Jour, la résidence absolument épuisée se reposa pour attendre l'aube d'un nouveau jour, où le Destin serait révélé.
Le soleil, lentement, plongea derrière les montagnes à l'ouest, envoyant dans l'air une myriade de points de lumière scintillants à travers les éternelles spirales soufflant depuis les plus hauts sommets ; la neige se teignit en rouge sang, puis tourna au bleu et ensuite au pourpre. Finalement il n'y eut plus que la faible lueur de l'obscurité du ciel et l'éclat de points lumineux qui étaient les étoiles.
De mystérieux points lumineux apparaissaient dans les arbres bien entretenus de la résidence. Un voyageur qui suivait par hasard la Route de Lingkhor ralentit sa marche, hésita, s'apprêta à repartir, puis revint sur ses pas afin de voir de quoi il retournait.
Des voix excitées venaient des jardins, et le voyageur ne put résister à la tentation d'en savoir plus et de découvrir ce qui pouvait bien provoquer de tels éclats de voix et ce qui était, apparemment, une altercation. Aussi silencieusement que possible, il se hissa sur le mur de pierre et, s'appuyant sur la poitrine et les bras, ce qu'il vit était, en vérité, nouveau pour lui. C'était la maîtresse de la maison, Dame Rampa, rondelette, petite, presque carrée, en fait. Deux grands serviteurs se tenaient à ses côtés portant chacun une lampe à beurre, dont ils essayaient de protéger la flamme vacillante, afin qu'elle ne s'éteigne pas — ce qui aurait déchaîné le courroux de Dame Rampa.
Des jardiniers mécontents se déplaçaient d'un air abattu parmi les arbres, fixant de petites lampes à beurre sur certaines des branches les plus basses, puis avec un silex et des étincelles d'acier enflammaient l'amadou. Un souffle vigoureux produisait une flamme et un bâtonnet ‘bien imprégné de beurre’ était utilisé pour transférer la flamme aux lampes à beurre. La dame était très indécise quant à la place où fixer les lampes, de sorte qu'il y avait un tâtonnement sans fin dans l'obscurité, les petites lumières vacillantes intensifiant davantage le pourpre de la nuit. Puis il y eut une soudaine agitation et une silhouette imposante arriva en se pavanant, criant de rage :
— Vous abîmez mes arbres, mes arbres, mes arbres ! — vous abîmez mes arbres ! Je ne tolérerai pas cette sottise. Éteignez-moi ces lampes immédiatement !
Seigneur Rampa était particulièrement fier de ses merveilleux arbres et de ses jardins qui étaient célèbres dans tout Lhassa. Il était vraiment dans tous ses états à l'idée du dommage qui pourrait être causé à certaines de leurs fleurs bourgeonnantes.
Avec un air condescendant, sa femme se tourna vers lui, disant :
— Vous vous donnez vraiment en spectacle devant les domestiques, monsieur mon mari. Ne pensez-vous pas que je suis capable de m'occuper de ce problème ? Cette maison est la mienne autant que la vôtre. Je vous prie de ne pas me déranger.
Le pauvre Lord renifla comme un taureau — on imaginait presque le feu sortant de ses narines. Se détournant avec colère, il se hâta de regagner la maison. La porte claqua avec une telle force que si elle eût été moins massive, elle se serait certainement brisée sous le choc.
— Le brasier d'encens, Timon, le brasier d'encens ! Êtes-vous stupide ? Posez-le là-bas ; pas la peine de l'allumer maintenant — posez-le là-bas !
Le pauvre Timon, l'un des hommes de service, se débattait avec un lourd brasier, mais il y en avait encore plusieurs à transporter. La nuit s'épaississait de plus en plus et la dame de la maison n'était toujours pas satisfaite. Puis un vent froid finit par se lever et la Lune se montra, éclairant la situation de sa lumière blafarde. L'homme qui épiait la scène, perché sur le mur, se laissa tomber sur la route et, continuant son voyage, murmura pour lui-même :
— Eh bien, eh bien, si c'est là le prix de la noblesse, je suis joliment heureux de n'être qu'un humble commerçant !
Le bruit de ses pas se perdit dans l'obscurité, tandis que dans le jardin les lampes étaient éteintes l'une après l'autre. Les serviteurs et leur maîtresse se retirèrent. Un oiseau de nuit, humant l'odeur inhabituelle dégagée par l'une des lampes dont la mèche continuait à se consumer, s'envola en poussant des cris de protestation.
Puis la maison connut une agitation soudaine : le jeune garçon avait disparu, l'héritier du domaine, le petit prince — où était-il maintenant ? Il n'était pas dans son lit. La panique avait gagné la maison. La mère pensait qu'il s'était sauvé, effrayé par la sévérité de son père. Le père, de son côté, attribuait sa disparition aux colères de la mère qui l'avait harcelé tout le jour, ne cessant de le réprimander — d'abord pour s'être sali, puis pour avoir déchiré ses vêtements, ensuite pour ne pas être là où il aurait dû être à un moment donné, puis pour ne pas être à l'heure aux repas ; tout avait mal tourné pour lui.
Les serviteurs furent réveillés, les lieux fouillés, les lampes à beurre flambèrent, le silex et l'amadou fumèrent. Une procession de serviteurs firent le tour des jardins, appelant le jeune Maître, mais sans succès : il n'était nulle part. On réveilla sœur Yasodhara pour lui demander si elle était au courant des mouvements de son frère, mais — non — elle essuya ses yeux brouillés du revers de la main, et tomba endormie tandis qu'elle était encore assise.
Des serviteurs se précipitèrent sur la route obscure pour voir si le garçon s'était enfui, tandis que d'autres explorèrent la maison de haut en bas ; finalement, Lobsang fut trouvé dans une réserve, endormi sur un sac de grains, entouré de deux chats, et tous trois ronflaient comme des bienheureux. Mais pas pour longtemps ! Le père se précipita avec un rugissement de rage qui sembla presque ébranler les murs, qui certainement fit tourbillonner dans l'air la poussière sur les sacs de grain. Les lampes portées par les serviteurs vacillèrent, et une ou deux s'éteignirent. Le pauvre petit garçon fut saisi fermement par le cou, tandis qu'une main puissante le soulevait dans les airs. La mère se précipita en criant :
— Arrêtez ! Arrêtez ! Ne lui faites surtout aucune marque en le frappant, car demain il sera le point de mire des regards de tout Lhassa. Envoyez-le simplement au lit.
Il reçut une vigoureuse bourrade qui le fit tomber à plat ventre. Un des serviteurs le releva et l'emporta. Quant aux chats, ils avaient disparu.
Mais dans le grand Potala, à l'étage assigné aux Astrologues, l'activité se poursuivait. L'Astrologue en Chef vérifiait soigneusement ses chiffres, vérifiait soigneusement ses graphiques et répétait ce qu'il allait dire, mettant au point l'intonation jugée nécessaire. Autour de lui, les lamas-astrologues prenaient chaque feuille de papier, et avec deux autres lamas, s'assuraient que chacune des feuilles soit placée dans le bon ordre ; il ne pouvait y avoir ici aucune possibilité d'erreur, aucune possibilité de lire la mauvaise page et de jeter ainsi le déshonneur sur le Collège des Astrologues. Au fur et à mesure que chaque livre était complété, sa couverture en bois était placée sur le dessus et le tout était attaché avec deux fois plus de bandes qu'à l'habitude pour assurer une double protection.
Le moine désigné comme assistant personnel de l'Astrologue en Chef brossait avec soin sa meilleure robe, s'assurant que les signes du zodiaque qui la décoraient étaient brillants et fixés solidement. Puis, comme son âge obligeait le vieil homme à se servir de deux cannes, celles-ci furent soigneusement examinées pour détecter tout défaut ou toute fissure, puis passées à un moine qui travailla à les polir jusqu'à donner au bois l'aspect du cuivre bruni.
Provenant des quartiers du temple, les gongs résonnèrent, les trompes éclatèrent, puis ce fut le trottinement rapide des moines se rendant à leur premier service de nuit. Les moines astrologues, eux, en avaient été exemptés, vu l'importance de la tâche qui leur était assignée, car ils ne pouvaient pas prendre le risque de tout laisser tomber pour aller au service et constater le lendemain qu'une erreur s'était glissée.
Les lampes s'éteignirent finalement l'une après l'autre. Les seules lumières furent alors celles des cieux, des étoiles et du clair de lune, mais elles étaient amplifiées par les brillantes réflexions des lacs et des rivières qui traversaient et s'entrecroisaient dans la Plaine de Lhassa. De temps à autre, une éblouissante nappe d'eau cascadait dans un éclat d'argent scintillant, comme de l'argent fondu, quand un gros poisson se précipitait à la surface pour une bouffée d'air.
Tout était silencieux, à l'exception du croassement des grenouilles-taureaux et des cris des oiseaux de nuit, au loin. La Lune naviguait dans sa splendeur solitaire à travers le ciel pourpre, la lumière des étoiles pâlit soudain, voilée par des nuages venus de l'Inde. La nuit était descendue sur le pays, et toutes les créatures — sauf les nocturnes — étaient endormies.
Chapitre Trois
La première faible lueur apparut sur l'horizon dentelé, à l'est. Les grandes chaînes de montagnes se dressaient dans la plus complète obscurité, et derrière elles le ciel commença à se faire lumineux.
À l'étage supérieur des lamaseries, moines et lamas étaient prêts à accueillir le jour nouveau. Chaque lamaserie avait au dernier étage — le toit — une plate-forme spéciale, ou parapet, sur laquelle, reposant sur des appuis, se tenaient d'immenses conques et trompettes de quinze à vingt pieds de long (4,5 m à 5 m).
La Vallée de Lhassa était encore d'un noir d'encre. La Lune depuis longtemps s'était couchée et les étoiles se voyaient diminuées par la pâleur du ciel au-delà des montagnes de l'est. Mais la Vallée de Lhassa dormait toujours, encore plongée dans la plus profonde obscurité de la nuit, et les lamaseries ainsi que les maisons d'habitation ne connaîtraient le jour qu'au moment où le Soleil apparaîtrait bien au-dessus des sommets.
Çà et là, dispersés au hasard partout dans la Vallée, apparaissaient de minuscules points lumineux au fur et à mesure qu'un lama, ou un cuisinier, ou un gardien de troupeau s'apprêtait à commencer très tôt sa journée. Ces faibles, très faibles lueurs ne faisaient qu'accentuer le noir velouté de la nuit, un noir tel qu'il était impossible de distinguer le tronc d'un arbre.
Derrière les montagnes, à l'est, la lumière grandit. Ce fut d'abord un vif éclair de lumière, puis s'élança un rayon rouge immédiatement suivi par ce qui semblait être un faisceau lumineux absolument vert, l'une des caractéristiques des levers et des couchers de soleil. Bien vite, les rayons de lumière s'élargirent et, en quelques minutes, les hauts pics s'illuminèrent d'un éclat d'or étonnant, révélant la neige éternelle des glaciers et projetant en bas dans la Vallée les premiers signes de la naissance d'un nouveau jour. Dès la première apparition du soleil sur les crêtes, les lamas soufflaient dans leurs trompettes, d'autres faisaient résonner leurs conques, de sorte que l'air lui-même semblait vibrer avec le bruit. La Vallée prenait un certain temps pour réagir, car les gens étaient tout aussi habitués à ces sons que le sont les habitants des villes au rugissement des avions, au fracas du ramassage des ordures, et à tous les autres bruits de la ‘civilisation’.
De temps à autre, toutefois, un oiseau de nuit endormi lançait un cri d'effroi, et, se cachant la tête sous l'aile, reprenait son sommeil interrompu. C'était maintenant le moment des créatures diurnes. Les oiseaux s'éveillaient avec des piaillements ensommeillés, tout en secouant leurs ailes pour chasser l'engourdissement de la nuit, et la brise apportait, de temps à autre, quelques plumes tombées de leurs ailes.
Dans les eaux du Kyi Chu, et au Temple du Serpent, les poissons se réveillaient lentement en dérivant près de la surface. Au Tibet, les poissons pouvaient toujours monter à la surface puisque les Bouddhistes n'enlèvent pas la vie et qu'il n'y avait pas de pêcheurs au Tibet.
Au son des clairons et du rugissement des conques, le vieil homme se retourna et, encore endormi, se mit sur son séant. De l'angle où il reposait, il regarda le ciel, et, une pensée le frappant soudain, il se leva. Ses vieux os craquaient à chaque mouvement et ses muscles étaient extrêmement fatigués. Avec prudence, il alla jusqu'à une fenêtre proche et regarda au-dehors — vers la Cité de Lhassa qui, maintenant, s'éveillait. Au-dessous de lui, les petites lumières du Village de Shö commençaient à apparaître, l'une après l'autre, au fur et à mesure que les lampes à beurre étaient allumées afin de permettre aux officiels, qu'attendait une rude journée, d'avoir tout le temps pour se préparer.
Le vieil Astrologue frissonna dans l'air frais de l'aube et serra sa robe plus étroitement autour de lui. Sa pensée se tourna, bien sûr, vers la résidence Lhalu qu'il ne pouvait voir d'où il était, car il regardait par-delà le Village de Shö et la Cité de Lhassa, alors que la résidence Lhalu était de l'autre côté du Potala, faisant face au mur décoré de figures sculptées qui exerçaient une si grande attraction sur les pèlerins itinérants.
Le vieil homme s'étendit de nouveau sur ses couvertures et, tout en se reposant, songea aux événements de la journée. Ce jour-là, pensait-il, serait un des sommets de sa carrière, peut-être le point culminant de celle-ci. Déjà le vieil homme sentait l'approche de la main de la mort, sentait les fonctions de son corps se ralentir, sentait que déjà sa Corde d'Argent s'amenuisait. Mais il était heureux qu'il y ait encore un rôle de plus qu'il puisse accomplir et de faire honneur au poste d'Astrologue en Chef du Tibet. Tout en réfléchissant, la somnolence l'avait gagné et il s'éveilla en sursaut au bruit d'un lama faisant irruption dans sa chambre et s'exclamant :
— Honorable Astrologue, le grand Jour est arrivé et nous n'avons aucune minute à perdre, car nous devons encore vérifier l'horoscope et l'ordre dans lequel les points vont être présentés. Je vais vous aider à vous lever, Honorable Astrologue.
En disant cela, il se baissa, passa son bras autour des épaules du vieil homme et, gentiment, l'aida à se mettre debout.
La lumière augmentait maintenant avec rapidité et le soleil, dégagé de la chaîne de montagnes de l'est, envoyait sa lumière sur l'ouest de la Vallée ; alors que les maisons et les lamaseries juste au-dessous de la chaîne de l'est étaient encore plongées dans l'obscurité, celles situées sur le côté opposé connaissaient presque la pleine lumière du jour.
Le Potala s'éveillait. C'était l'étrange agitation que créent toujours les humains quand ils se mettent en action au commencement de la journée, et on sentait qu'il y avait ici des humains prêts à continuer la tâche parfois fastidieuse qu'est celle de vivre. On entendait le tintement de petites clochettes d'argent et, de temps à autre, le meuglement d'une conque, ou encore l'assourdissant retentissement d'une trompette. Le vieil Astrologue et ceux qui l'entouraient n'avaient pas conscience du cliquetis et de la rotation des Moulins à Prières ; ceux-ci faisaient tellement partie de leur existence quotidienne qu'ils avaient cessé d'en percevoir le bruit, tout comme ils ne remarquaient plus les Drapeaux de Prière que faisait claquer la brise du matin sur les hauteurs du Potala. Ce n'est que de la cessation de ces bruits qu'ils auraient pu prendre conscience.
Puis il y eut des pas pressés le long des corridors, le son de lourdes portes qu'on ouvrait. De quelque part vint la psalmodie d'un psaume, un psaume religieux, les psaumes accueillant encore une fois une nouvelle journée. Mais le vieil Astrologue n'avait pas le temps de remarquer de telles choses, car pour le moment il s'agissait de se réveiller complètement et de voir à ces fonctions qui sont si nécessaires après une nuit de sommeil. Dans un moment, il prendrait son repas du matin — tsampa et thé — et devrait assister au rituel de la préparation de la Lecture qu'il allait donner ce jour.
À la résidence Lhalu, les serviteurs étaient réveillés. Dame Rampa aussi. Et le Seigneur Rampa, après un petit déjeuner rapide, était parti à cheval accompagné de sa suite pour gagner les bureaux du gouvernement, dans le Village de Shö. Il était ravi, en vérité, de s'éloigner de sa femme, de son zèle accablant à l'approche des événements auxquels ils avaient à faire face. Il devait commencer sa journée de très bonne heure vu qu'il lui faudrait revenir assez tôt pour remplir ses devoirs d'hôte parfait de Prince de Lhassa.
On tira du sommeil l'héritier qui rechigna à s'éveiller. Aujourd'hui était ‘son’ jour et, l'esprit confus, il se demandait comment ce pouvait bien être son jour, quand sa mère projetait d'en faire un tel événement mondain. S'il avait eu le choix, il aurait fui vers la rivière pour regarder le batelier traversant les gens avec son bac, et peut-être, à l'heure où les passagers étaient peu nombreux, aurait-il réussi à le persuader de lui faire faire l'aller-retour sans payer — toujours avec l'excuse, bien sûr, qu'il aiderait à pousser avec la perche.
Le petit garçon était affreusement malheureux de l'opération à laquelle se livrait sur sa chevelure le serviteur impitoyable, l'enduisant de beurre de yak et en faisant une tresse curieusement tortillée. Le beurre de yak était amalgamé à la tresse jusqu'à ce que celle-ci atteigne la rigidité d'un baguette de saule.
Vers 10 heures, on entendit un bruit de sabots, et un groupe d'hommes à cheval entra dans la cour de la résidence. Seigneur Rampa et sa suite étaient revenus des bureaux du gouvernement, car la famille devait se rendre à la Cathédrale de Lhassa pour remercier des mystères qui allaient lui être révélés en ce jour, et aussi pour montrer aux prêtres — toujours enclins à croire que les ‘têtes noires’ étaient irréligieuses — qu'eux, les Rampa, étaient des ‘têtes noires’ particulièrement religieuses. Au Tibet, les moines ont la tête rasée, alors que les laïques ont de longs cheveux, presque toujours noirs, ce qui explique pourquoi ils sont surnommés ‘têtes noires’.
Les gens attendaient dans la cour, Dame Rampa déjà sur son poney, de même que sa fille Yasodhara. Au dernier moment l'héritier de la famille fut saisi et hissé sans cérémonie sur un poney aussi mal disposé que lui. On ouvrit les grilles de nouveau et la famille se mit en route, Seigneur Rampa en tête. Ils chevauchèrent dans un étrange silence pendant environ trente minutes jusqu'au moment où ils atteignirent les petites maisons et les boutiques entourant la Cathédrale de Lhassa, cette Cathédrale dressée là depuis tant et tant de centaines d'années pour permettre aux gens pieux de venir faire leurs adorations. Les sols en pierre d'origine étaient profondément rainurés et marqués par les pas des pèlerins et des touristes. Des rangées de Moulins à Prières — de bien grosses choses — se tenaient tout au long de l'entrée de la Cathédrale et chaque personne, en passant, tournait la Roue selon la coutume, ce qui provoquait un très curieux claquement argentin à l'effet presque hypnotique.
L'intérieur de la Cathédrale était lourd — accablant dans sa lourdeur — avec l'odeur d'encens et le souvenir de l'encens brûlé depuis treize ou quatorze cents ans. Des lourdes poutres noires du plafond semblaient se dégager des nuages d'encens, de fumée bleuâtre, de fumée grise, et parfois, d'une fumée d'une teinte brunâtre.
Divers Dieux et Déesses étaient représentés sous forme de statues dorées, statues de bois ou de porcelaine, et devant chacune étaient déposées les offrandes des pèlerins. Celles-ci étaient parfois placées derrière un grillage métallique pour les protéger des pèlerins dont la piété était moins forte que le désir de participer à la richesse des Dieux.
De lourdes chandelles brûlaient, faisant des ombres vacillantes à travers le bâtiment faiblement éclairé. Le fait que ces chandelles avaient été maintenues allumées en les alimentant de beurre pendant treize ou quatorze cents ans était une pensée donnant à réfléchir, même pour un garçonnet qui n'avait pas encore sept ans. Regardant autour de lui, les yeux écarquillés, le pauvre garçon pensait : "Que ce jour s'achève rapidement, et peut-être alors pourrai-je aller dans quelque autre pays, loin de toute cette sainteté." Il ignorait tout de ce que la vie lui réservait !
Un gros chat passa, se promenant paresseusement, et vint se frotter contre les jambes du jeune héritier de la famille Rampa. Le garçon se baissa et se mit à genoux pour caresser le gros chat qui ronronna avec ravissement. Ces chats étaient les gardiens du temple, observateurs subtils de la nature humaine, capables de discerner au premier coup d'œil les gens susceptibles de vol et ceux en lesquels on pouvait avoir confiance. De tels chats, normalement, n'approchaient jamais, jamais, que leur propre gardien. Il y eut pendant quelques instants un silence stupéfait parmi les spectateurs, et quelques-uns des moines hésitèrent dans leur chant en voyant le garçonnet à genoux caressant le gros chat. Le charmant tableau fut bien vite gâché, toutefois, par le Seigneur Rampa qui, le visage fou de rage, saisit son fils par la peau du cou, le leva au-dessus du sol et le secoua comme une ménagère ferait d'un chiffon ; puis, l'ayant gratifié d'une vigoureuse claque sur l'oreille qui fit croire au garçon qu'il faisait tempête, le laissa retomber sur le sol. Se tournant vers Sa Seigneurie, le chat lui lança un très long sifflement sonore, puis s'éloigna avec dignité.
Mais il était temps pour la famille de regagner la résidence Lhalu, car les invités ne tarderaient pas à arriver. Beaucoup, parmi ceux-ci, venaient très tôt, afin d'avoir ce qu'il y avait de mieux dans ce qui était offert, et ce mieux comprenait la meilleure place dans le jardin. La famille sortit donc de la Cathédrale et retrouva la rue. Levant les yeux, le garçon vit les drapeaux flottant sur la route qui mène en Inde et pensa : "Prendrai-je bientôt cette route pour quitter ce pays ? Je vais le savoir dans peu de temps, je suppose, mais bonté divine, que j'ai donc faim !"
Reprenant la route, le groupe, vingt-cinq ou trente minutes plus tard, entrait dans la cour de la résidence, où les accueillit l'Intendant anxieux. Redoutant qu'ils ne soient retardés, il se disait qu'il lui faudrait expliquer aux invités mécontents que leurs hôtes avaient été retenus par quelque incident inattendu à la Cathédrale.
Ils eurent le temps d'un repas rapide et, attiré par des bruits soudains sur la route, le jeune héritier se précipita à la fenêtre. C'était l'arrivée des moines musiciens, montés sur leurs poneys. De temps à autre l'un des moines soufflait dans sa trompette ou sa clarinette pour en vérifier l'accord ; puis un autre frappait sur son tambour, vérifiant, lui aussi, si la peau en était correctement tendue. Pénétrant dans la cour, ils gagnèrent les jardins par l'allée latérale et déposèrent leurs instruments sur le sol. Cela fait, ils se hâtèrent avec joie vers la bière tibétaine. On en avait prévu d'énormes quantités pour mettre les moines d'humeur joviale, afin qu'ils produisent de la musique gaie et non pas de ces ennuyeux morceaux classiques.
Mais déjà les premiers invités arrivaient en une véritable troupe serrée. Comme si tout Lhassa avait pris la route de la résidence Lhalu. Il arriva un petit groupe d'hommes à cheval, tous puissamment armés comme l'armée d'invasion envoyée par les Anglais ; mais ces hommes n'étaient armés que parce que le cérémonial et le protocole l'exigeaient. Les femmes chevauchaient entre des rangées d'hommes — où elles étaient protégées contre toute attaque imaginaire. Les serviteurs armés portaient des lances et des piques gaiement décorées de drapeaux et de banderoles. Et de-ci de-là, quand un moine était présent, le Drapeau de Prière flottait sur un bâton.
Dans la cour elle-même, alignés sur deux rangs, se tenaient les serviteurs, avec en tête l'Intendant, d'un côté, et, de l'autre, le Prêtre en Chef du Domicile. On se saluait abondamment, les saluts étaient retournés et reprenaient au moment où les invités étaient introduits à l'intérieur. Chacun d'eux était aidé à mettre pied à terre, tout comme si — pensait le jeune héritier — il s'agissait de mannequins ou de paralytiques. Leur cheval était ensuite emmené et nourri. Puis, selon le statut social de la personne, on la laissait dans les jardins, ou bien elle était priée d'entrer dans la maison où elle s'exclamait d'admiration sur ce qui s'offrait à sa vue, et n'avait été placé là que pour impressionner les invités !
La coutume, au Tibet, était bien sûr d'offrir et de recevoir des écharpes, ce qui créait une grande confusion à l'arrivée des invités qui présentaient leur écharpe et en recevaient une à leur tour. Ce qui donnait parfois lieu à des incidents gênants quand un serviteur distrait remettait à un invité l'écharpe que ce dernier venait tout juste de lui présenter. Il y avait alors des sourires embarrassés, on murmurait des excuses, et les choses étaient très vite arrangées.
Dame Rampa avait le visage tout rouge et transpirait abondamment. Elle était terrifiée à l'idée que le vieil Astrologue — l'Astrologue en Chef de tout le Tibet — pouvait être mort, ou tombé dans la rivière, ou piétiné par son cheval, ou tout autre accident du genre, car il n'y avait pas le moindre signe de lui, alors que tout le but de cette réunion était la Lecture de l'avenir de l'héritier de la famille. Sans l'Astrologue en Chef, rien ne pouvait se faire.
Un serviteur fut envoyé à la course pour monter au point le plus haut de la maison et regarder vers le Potala pour voir s'il n'y avait pas de signe d'une cavalcade approchant qui annoncerait l'arrivée imminente de l'Astrologue. Le serviteur partit et presque aussitôt on le vit sur le plus haut toit qui gesticulait, faisant de grands signes avec ses bras, et dansait d'excitation.
Dame Rampa, furieuse, ne comprenant pas ce qu'essayait de lui dire le serviteur qui donnait l'impression d'être ivre, en dépêcha un second pour savoir de quoi il retournait. Les deux domestiques revinrent et expliquèrent que la cavalcade traversait en ce moment la Plaine de Kyi Chu. Ce fut le signal d'une ardeur accrue. Dame Rampa se hâta de faire sortir tous les invités dans le jardin, leur conseillant de prendre leur place, car le grand Astrologue en Chef arrivait. Les moines musiciens se saisirent de leurs instruments, faisant vibrer l'air de l'excitation qu'ils mettaient dans leur jeu.
Les jardins de la résidence Lhalu étaient vastes et très bien tenus. On y voyait des arbres de toutes les régions du Tibet, et même de l'Inde, du Bhoutan et du Sikkim. Des buissons couverts de fleurs exotiques s'épanouissaient en abondance et ravissaient le regard. Mais les gens qui emplissaient à cette heure les jardins n'étaient pas là pour s'intéresser à l'horticulture, mais bien plutôt à la SENSATION. Le Grand Seigneur Rampa errait attristé en se mordillant les jointures dans une agonie de frustration angoissée, tout en essayant de sourire aimablement à ces gens envers qui il se sentait obligé.
Dame Rampa, elle, donnait l'impression de rapetisser en s'épuisant à courir d'un point à l'autre, veillant à ce que son mari n'ait pas l'air trop austère, cherchant à voir ce que faisait le jeune héritier, ce que faisaient les serviteurs, et, en même temps, guettant l'arrivée de l'Astrologue en Chef.
Soudain, on entendit le pas des chevaux. L'Intendant se hâta vers le portail principal qui fut soigneusement refermé derrière lui. Il se tenait prêt à donner l'ordre qu'on l'ouvre exactement au bon moment pour obtenir un effet maximal.
Les invités qui avaient entendu les chevaux se dirigeaient en file vers une grande pièce qu'on avait, pour la circonstance, arrangée en salle de réception. Là, ils trouvèrent du thé au beurre et, bien sûr, des friandises venues de l'Inde, des gâteaux très sucrés et collants, qui certainement ralentiraient le bavardage chez ceux qui se débattraient avec eux !
Puis le son d'un gong puissant se répercuta tout autour de la résidence — un gong imposant de quelque cinq pieds (1 m 50) de haut qui ne servait qu'aux occasions vraiment solennelles — un serviteur de haut rang qui y était préposé le frappant d'une façon particulière qu'il avait répétée pendant plusieurs jours sur un plus petit gong.
Le gong résonna, la grille s'ouvrit toute grande, et dans la cour on vit entrer une cavalcade de jeunes moines, de lamas, et le Chef Astrologue. C'était un vieil homme de quatre-vingts ans, de petite taille, et ravagé par l'âge. Tout près de lui, en fait presque jambe contre jambe, chevauchaient deux lamas dont la seule charge était de s'assurer que le vieil homme ne tombe pas et ne soit pas piétiné par le cheval.
Les chevaux s'arrêtèrent, parfaitement conscients que le voyage avait pris fin et qu'ils allaient être bien nourris. Sautant de cheval, les deux lamas-assistants, avec soin, soulevèrent le vieil Astrologue de sa monture. Seigneur Rampa s'avança alors et ce fut le traditionnel échange d'écharpes, le traditionnel échange de salutations. Puis l'Astrologue en Chef et le Seigneur Rampa pénétrèrent dans la pièce de réception où tous les gens qui y étaient assemblés s'inclinèrent pour le saluer.
Il y eut quelques instants de trouble et de confusion, puis, ayant poliment goûté au thé, le Chef Astrologue fit un signe aux deux lamas porteurs de ses notes et de ses cartes.
Le puissant gong retentit de nouveau : boum, boum, boum — boum. L'extrémité de la salle de réception fut ouverte toute grande, et l'Astrologue en Chef, suivi de ses deux assistants-lamas, quitta la pièce et entra dans le jardin où avait été dressée une marquise immense — spécialement importée de l'Inde. Un des côtés en fut ouvert pour permettre au plus grand nombre possible d'invités de voir et d'entendre ce qui allait se passer. À l'intérieur de la marquise, une estrade surélevée avait été érigée avec des balustrades sur trois côtés, et près de l'avant on avait préparé quatre sièges.
Le Chef Astrologue et ses deux lamas s'approchèrent de l'estrade, et quatre serviteurs apparurent portant des flambeaux, témoignant que ces hommes reconnaissaient que, sous cette tente, se trouvaient les flammes de la connaissance.
Quatre trompettes résonnèrent pour attirer l'attention sur Seigneur et Dame Rampa, vu que leur fils, l'héritier du domaine Lhalu, était — comme le disait un spectateur — la cause de toute ‘l'agitation’. Le Seigneur et sa Dame gravirent les marches lentement et se tinrent debout derrière les quatre chaises.
D'une autre direction arrivèrent, accompagnés de leur suite, deux hommes extrêmement âgés, appartenant à la Lamaserie de l'Oracle d'État. Ces deux vieillards de la Lamaserie de Nechung étaient, après l'Astrologue en Chef, les astrologues les plus expérimentés du pays. Ils avaient collaboré avec le vieil Astrologue, revoyant les diagrammes, les graphiques, les calculs, et chaque feuille de l'horoscope contenait les sceaux d'approbation de chacun de ces hommes.
L'Astrologue en Chef se tint debout. Les autres s'assirent. Le silence se fit soudainement dans assemblée. L'Astrologue en Chef posa son regard sur la foule et fit monter le suspense en restant tout à fait silencieux pendant un bon moment, puis sur un geste de lui, les deux lamas s'avancèrent et se placèrent à ses côtés. Celui à sa droite tenait le livre composé des feuillets de l'horoscope, tandis que celui de gauche retirait avec soin la plaquette de bois qui les recouvrait. L'Astrologue en Chef était prêt.
Les gens tendirent l'oreille car, avec l'âge, il avait une voix grêle et haut perchée et, pour ceux qui se tenaient à l'arrière-plan, elle se fondait dans le piaillement des oiseaux sur les hautes branches.
Ses commentaires d'ouverture furent ceux, rituels, prononcés en de telles circonstances :
— Les dieux, les démons et les hommes se comportent tous de la même façon, aussi le futur peut être prédit, mais il n'est pas immuable. Le Futur peut, dans une certaine mesure, être changé. Ainsi, nous ne pouvons donc prévoir que les probabilités, et ayant prévu les probabilités, ayant prédit le bien et le mal, nous devons en vérité abandonner le reste à ceux dont nous lisons l'horoscope.
Il s'arrêta, regarda autour de lui, et le lama à sa gauche retira la première feuille. Le vieil Astrologue, ayant respiré profondément, continua sa lecture :
— Nous avons ici l'horoscope le plus remarquable que nous trois ayons jamais calculé. (Il se tourna vers ses collaborateurs en les saluant. Puis, s'éclaircissant la voix, il reprit :) C'est là l'horoscope d'un jeune garçon de six ans seulement. C'est l'horoscope le plus difficile et la Vie la plus dure que nous ayons rencontrés.
Mal à l'aise, Seigneur et Dame Rampa remuèrent sur leur chaise. Ce qu'ils entendaient n'était certes pas ce à quoi ils s'attendaient ; ils n'étaient pas contents du tout. Mais ils appartenaient à une caste entraînée à ne pas laisser paraître ses sentiments. Derrière eux, la cause de tout ce trouble, le jeune héritier, Lobsang Rampa, se sentait réellement lugubre. Tout ce gaspillage de temps. Combien pouvaient-ils être à avoir traversé la rivière ? Que faisait le batelier ? Comment allaient les chats ? Il avait l'impression de se tenir là, comme un mannequin empaillé, tandis que trois anciens, presque des fossiles, décidaient de ce qu'il aurait à faire avec sa vie. Il se disait qu'il devrait lui aussi avoir son mot à dire dans cette question. Les gens n'avaient cessé de lui dire combien c'était merveilleux d'être l'héritier d'un domaine aussi immense, et quel honneur il pourrait être pour ses parents. Eh bien, pensait-il, ce qu'il voulait c'était être passeur, c'était de s'occuper de chats, quelque part ; chose certaine, il ne voulait pas travailler.
Mais l'Astrologue poursuivait de sa voix monotone devant une assistance captivée et complètement silencieuse :
— Ce garçon doit aller à la Lamaserie Médicale de Chakpori. Il doit faire pénitence et observance avant d'y être admis et une fois entré, il commencera comme le plus inférieur des inférieurs et travaillera à son ascension. Il devra apprendre tous les arts Médicaux du Tibet, et pendant un temps faire ce qui est presque tabou : il devra travailler avec les Ordonnateurs de la Mort, afin qu'en découpant les cadavres il comprenne la structure du corps humain. S'étant acquitté de cette tâche, il retournera à Chakpori et continuera à étudier. On lui montrera les mystères les plus profonds de notre pays, de notre Croyance et de notre Science.
Le vieil homme tendit la main et un assistant lui passa rapidement un petit gobelet d'argent contenant un liquide qu'il avala. L'assistant prit le gobelet et le remplit, le tenant prêt pour une autre demande.
L'Astrologue continua :
— Viendra alors le temps où il ne lui sera plus possible de rester dans notre pays, et où il devra se rendre en Chine pour étudier la médecine selon l'enseignement occidental, car il existe une École de Médecine Occidentale à Chongqing. À cette École de Médecine, il changera de nom, afin qu'on ne sache pas que l'héritier du domaine Lhalu a affaire avec les corps. Plus tard, il apprendra quelque chose qui, pour le moment, nous est tout à fait incompréhensible, quelque chose qui n'est pas encore concrétisé, quelque chose qui n'est pas encore convenablement inventé. Pour nos cerveaux doués d'expérience, il semble qu'il fera une certaine chose qui entraînera le fait de voler dans les airs, mais qui pourtant n'est pas la lévitation que certains d'entre nous peuvent faire, ici à Lhassa. Aussi, je ne peux être clair quant à ce point particulier, car en vérité il est très obscur pour nous trois. Le garçon, qui alors sera un jeune homme, devra travailler lui-même à ce problème qui sera celui de voler dans les airs, par un certain moyen. Nos images font apparaître quelque chose comme les cerfs-volants qui nous sont familiers, mais ce cerf-volant particulier n'est pas attaché au sol par une corde et semble plutôt être contrôlé par ceux qu'il emporte.
Dans l'assemblée, les murmures s'élevaient et on chuchotait beaucoup. L'étonnement était à son comble, car jamais encore on n'avait parlé de telles choses. Avant de rompre le trouble qui s'était établi, l'Astrologue, ayant bu un autre gobelet, se tourna vers ses feuilles, à présent, réduites :
— Il connaîtra une immense souffrance, d'immenses épreuves, il entrera en guerre contre les forces du mal, il sera incarcéré pendant quelques années et souffrira comme peu de gens ont souffert, dont le but sera de purifier et de chasser les impuretés de toute sensualité, et de développer le pouvoir du cerveau à endurer. Plus tard, il échappera à ses ravisseurs après une immense explosion qui jettera tout un pays, ou tout un monde, peut-être, dans la confusion. Il voyagera par des moyens que nous ne pouvons identifier à travers un vaste continent, et à la fin de ce voyage il sera de nouveau injustement incarcéré, et il souffrira au moins dans une aussi grande mesure que lors de l'autre emprisonnement. Finalement, grâce à l'intervention d'inconnus, il sera libéré et chassé de ce grand continent. Il errera dans plusieurs pays, rencontrant un grand nombre de gens et de cultures, et apprenant beaucoup de choses. Puis il se rendra enfin dans un pays où il sera encore une fois mal accueilli à cause de ses différences. Les souffrances l'auront tellement changé qu'il aura perdu les caractéristiques de sa race. Et quand les humains rencontrent quoi que ce soit de différent, ils craignent cette chose, et ce qu'ils craignent, ils le haïssent et essaient de le détruire.
Le vieil homme semblait très las. Ce que voyant, l'assistant supérieur s'avança, murmura quelque chose à l'Astrologue et dit à l'assistance :
— Nous allons arrêter un instant pour permettre au Chef Astrologue de se reposer un peu avant de donner la seconde partie de cette Lecture. Concentrons-nous pour le moment sur ce qui a été dit afin d'assimiler plus aisément ce qui suivra.
Des rafraîchissements furent apportés au vieil homme qui observa l'assistance. Assis et regardant autour de lui, il songea à son enfance, au temps où il escaladait les hauts sommets, au cœur de la nuit, pour admirer le spectacle des étoiles. Il avait réfléchi longtemps sur la signification de ces étoiles : avaient-elles de l'influence sur les gens ? Il avait décidé de le découvrir. Par divers moyens, et probablement parce que son destin était d'y parvenir, il était entré à la Lamaserie de l'Oracle d'État où l'on reconnut qu'il avait des capacités tout à fait inhabituelles pour l'Astrologie, une Astrologie, bien sûr, très supérieure à celle du monde Occidental, beaucoup plus complète et de loin, beaucoup plus précise. Elle comprend plus de variables et peut être projetée à une plus grande profondeur. Le jeune homme appelé à devenir l'Astrologue en Chef de tout le Tibet fit de rapides progrès, en étudiant, étudiant, étudiant. Il obtint les textes anciens de l'Inde, les textes de la Chine, et récrivit presque la Science de l'Astrologie au Tibet. Sa réputation augmentant en même temps que ses capacités, les chefs de toutes les grandes familles de Lhassa firent appel à lui, puis ceux d'autres villes du Tibet. Bien vite on le chargea de faire des prédictions pour le gouvernement et pour le Grand Treizième lui-même. Il était toujours strictement honnête. S'il ne savait pas, il disait qu'il ne savait pas. Il avait prédit l'invasion Britannique, il avait prédit le départ du Grand Treizième pour un autre pays, ainsi que son retour sain et sauf, et il avait fait la prédiction qu'il n'y aurait plus de réel Dalaï-Lama quand le Treizième s'en serait allé en état de transition ; il y en aurait un autre, mais choisi comme une commodité politique afin de tenter d'apaiser les ambitions territoriales des Chinois. Il avait fait la prédiction que, dans soixante ans, environ, ce serait la fin du Tibet, tel qu'on le connaissait ; un ordre complètement nouveau entrerait en vigueur qui causerait d'extrêmes épreuves et souffrances, mais qui pourrait peut-être, correctement géré, avoir pour effet de balayer un système dépassé et d'être, après une centaine d'années, bénéfique pour le Tibet.
Tout en sirotant son thé au beurre, l'Astrologue en Chef regardait les gens devant lui. Il observait la manière dont certains des jeunes hommes regardaient les jeunes femmes, et la façon pudique, coquette dont celles-ci répondaient à leurs regards. Il songea à ses longues années de célibat — près de quatre-vingts ans — et pensa qu'il ne savait guère en quoi un homme différait d'une femme. Sa connaissance était celle des étoiles, de l'influence des étoiles, et sur la façon dont celles-ci affectent les hommes et les femmes. Regardant quelques jeunes femmes avenantes, il se demanda si le célibat des moines était vraiment une bonne chose. Il est certain, pensa-t-il, que l'humanité devrait être composée de deux parties, le principe masculin et le principe féminin, et à moins que ces deux parties ne s'unissent, il ne peut exister d'Homme complet. Il songeait à toutes les histoires qu'il avait entendues — comment les femmes devenaient de plus en plus arrogantes avec le goût de gouverner. Son regard se porta alors sur les femmes plus âgées ; il remarqua que leur visage était dur et leur attitude dominatrice. Il se dit alors que peut-être le temps n'était pas encore mûr où homme et femme s'uniraient pour former un tout, pour former une entité complète. Mais ce temps viendrait, bien que ce ne soit pas avant la fin de ce cycle d'existence. Sur cette pensée, il tendit son gobelet à l'assistant, et indiqua qu'il était prêt à continuer.
Le silence à nouveau gagna l'assemblée, les gens levant les yeux vers l'estrade. On aida le vieil homme à se lever et on replaça les livres devant lui. Après avoir promené un regard sur l'assistance, il dit :
— Certaines des expériences que va connaître le sujet de cette Lecture dépassent tellement notre propre expérience qu'elles ne peuvent être prédites avec assez de précision pour être valables. Il est définitivement connu que cette personne à une grande, très grande Tâche à accomplir. C'est une Tâche d'une importance capitale pour l'ensemble de l'humanité, et non pas seulement pour le Tibet. Nous savons qu'il existe des forces du mal, des forces extrêmement malfaisantes, qui travaillent dur pour annihiler ce qu'il doit faire.
"Il rencontrera la haine, il rencontrera toutes les formes de difficultés et de souffrance ; il connaîtra ce que c'est que d'être à l'article de la mort et devoir subir l'épreuve de la transmigration dans un autre corps, pour permettre au travail d'avancer. Mais ici, dans cet autre corps, des problèmes nouveaux surgiront. Il sera désavoué par son propre peuple à cause de cette commodité politique que j'ai déjà mentionnée. On considérera à l'avantage du peuple dans son ensemble qu'il soit désavoué, qu'il ne soit pas soutenu par ceux qui devraient le soutenir, par ceux qui pourraient le soutenir, et je répète que ce sont des probabilités, car il est tout à fait possible que nos propres gens le soutiennent et lui donne la chance de parler devant les nations du monde afin que, d'abord, le Tibet puisse être sauvé, et deuxièmement, que la grande Tâche dont la nature ne peut être révélée, puisse être plus rapidement accomplie. Mais les gens faibles en position d'autorité temporaire ne seront pas assez forts pour l'assister et il sera donc seul pour lutter contre les forces du mal et contre les indifférents qu'il essaie d'aider."
Le vieil homme regarda autour de lui et fit signe à l'assistant sur sa gauche de retirer la feuille. Confus d'avoir été rappelé à l'ordre, celui-ci s'empressa de faire ce qui lui était demandé. L'Astrologue continua :
— Il existe une association spéciale, ou un groupe, qui donne des informations aux peuples du monde situés au-delà de nos frontières. Ils sont d'une stature spirituelle insuffisante pour comprendre la Tâche qui doit être accomplie, et leur haine sensationnelle rendra celle-ci incommensurablement plus difficile. En plus de ceci, il y a un petit groupe de personnes qui sera rempli d'une haine ardente et mettra tout en œuvre pour détruire le sujet de cet horoscope et lui causer toutes les misères.
Le vieil homme s'arrêta, posant la main sur la page pour exprimer qu'il en avait terminé avec les livres. Se tournant alors vers l'assistance, il s'adressa à elle :
— Riche de mon expérience, je vous dis ceci : quelle que soit la dureté de la lutte, quelle que soit l'intensité de la souffrance, la Tâche en vaut la peine. La seule bataille qui compte est la dernière bataille. Peu importe qui perd ou qui gagne, les guerres qui se poursuivent jusqu'à la bataille finale, la dernière bataille doit finalement être gagnée par les forces du bien, et ce qui doit être fait sera fait.
Il salua l'assistance par trois fois, puis se tourna et salua par trois fois le Seigneur et Dame Rampa. Il s'assit alors pour reposer ses jambes qui tremblaient sous le poids des années.
Les gens, tout en murmurant, se dispersèrent rapidement, gagnant les jardins à la recherche de divertissements. Ceux-ci étaient multiples — musiciens, acrobates, jongleurs et, bien sûr, nourritures et boissons. Après avoir pris quelque repos, l'Astrologue et ses deux collaborateurs se levèrent et entrèrent dans la grande maison, où ils avaient davantage à dire aux parents de Lobsang Rampa. Ils avaient davantage à dire à Lobsang aussi, à dire en privé, seuls avec lui.
Peu de temps après, l'Astrologue en Chef se mettait en route pour regagner le Potala, et ses deux collaborateurs rejoignaient la Lamaserie de l'Oracle d'État.
La journée s'écoula. Arriva le crépuscule, et avec sa venue les invités se mirent à cheminer vers le grand portail et prirent la route afin de rejoindre leurs maisons avant la nuit et les périls qu'elle réservait souvent aux voyageurs.
L'obscurité était maintenant tombée et sur la route, à l'extérieur du grand portail, un petit garçon solitaire regardait s'éloigner les derniers invités qui continuaient à s'en donner à cœur joie. Il se tenait là, les mains serrées l'une contre l'autre, pensant à la vie de misère qu'on avait prédite, pensant aux horreurs de la guerre qu'il ne comprenait pas, pensant aux persécutions insensées à venir. Il se tenait là, seul, absolument seul au monde, et nul n'avait un tel problème. Il se tenait là, la nuit s'épaississant et personne ne vint le chercher pour l'emmener. Quand la Lune enfin se fut levée, il s'allongea sur le côté de la route — de toute façon le portail était fermé — et, presque immédiatement, un ronronnement se fit entendre tout près de sa tête et un énorme chat s'étendit auprès de lui. Il le serra dans ses bras et le chat ronronna plus fort. Le petit garçon ne tarda pas à sombrer dans un sommeil agité, mais le chat était alerte, veillant, gardant.
Ainsi se termine le Premier Livre,
le Livre d'Ainsi qu'il en était au Commencement
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LIVRE DEUX
L'Ère Première
Chapitre Quatre
— Oh ! Lobsang, Lobsang, dit Mère le visage pâle de fureur. Tu nous as attiré le déshonneur absolu ! J'ai honte de toi. Ton Père a honte de toi ; il est si fâché contre toi qu'il est allé à son bureau où il passera toute la journée, ce qui a perturbé toutes mes obligations, et tout est de ta faute, Lobsang !
Cela dit, elle disparut brusquement, comme si elle ne pouvait supporter ma vue plus longtemps.
Honte de moi ? Pourquoi devrait-elle avoir honte de moi ? Je ne voulais pas être moine. Je refusais toutes les choses horribles qui m'avaient été prédites. Quiconque ayant le moindre bon sens le comprendrait. Les prédictions d'hier m'avaient rempli d'horreur. Ça avait été comme si des diables de glace avaient fait glisser leurs doigts de haut en bas de ma colonne vertébrale. Ainsi, elle avait honte de moi !
Le vieux Tzu, qui faisait songer à une montagne en mouvement tant il était énorme, s'approcha et dit en me regardant :
— Alors, jeune homme, tu vas avoir une rude existence, à ce qu'il paraît. Je pense que tu t'en tireras. Les grandes tâches ne sont dévolues qu'à ceux qui peuvent s'en acquitter. L'artisan choisit ses outils en fonction du travail qu'il a à faire. Peut-être — qui sait ? — l'artisan qui t'a choisi pour être son instrument a-t-il pris quelqu'un de supérieur à ce qu'il croyait.
Un peu réconforté, mais seulement ‘un peu’, je regardai le vieux Tzu et lui dis :
— Mais, Tzu, comment ai-je pu jeter le déshonneur sur Père et la disgrâce sur Mère ? Je n'ai rien fait pour cela. Je n'ai pas choisi d'être moine. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent dire. Aujourd'hui, tout le monde semble me haïr. Ma sœur ne m'adresse plus la parole, ma Mère m'injurie, mon Père fuit la maison pour ne pas me voir, et je ne sais pas pourquoi.
Le vieux Tzu se baissa péniblement pour s'asseoir sur le sol, jambes croisées, ses blessures infligées par les Britanniques le faisant grandement souffrir. Il avait subi une lésion à l'os de la hanche et maintenant — eh bien — il souffrait constamment. Mais il s'assit sur le sol et me parla.
— Ta mère, dit-il, est une femme de grande ambition sociale. Elle avait pensé qu'en tant que fils d'un Prince du Tibet, devant plus tard être Prince à part entière, tu serais allé dans une grande ville de l'Inde où tu aurais appris beaucoup sur les affaires du monde. Ta Mère pensait que tu serais un atout social pour elle, et que, si tu étais envoyé en Inde et peut-être dans d'autres pays, elle pourrait aller t'y rendre visite, car pendant des années, même avant ta naissance, cela a été une ambition qui la dévorait. Or, tu as été choisi pour une Tâche spéciale, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait, ce n'est pas ce que ton Père voulait. Ils souhaitaient un personnage brillant dans l'arène politique, un homme du monde, et certainement pas un moine qui va devoir lutter toute sa vie, un homme qui va parcourir la face de la Terre comme un paria, rejeté par ses semblables parce qu'il dira la vérité, et banni par ceux qui l'entourent parce qu'il essaiera d'accomplir une Tâche où les autres ont échoué.
Sur ce, le vieux Tzu renifla bruyamment.
Tout cela semblait par trop étrange pour y croire. Pourquoi devrais-je être pénalisé, maltraité, pour quelque chose que je n'avais pas fait, et quelque chose que je ne voulais pas faire ? Tout ce que je voulais c'était flâner sur les bords de la rivière et regarder les passeurs dans leurs bateaux de peaux se frayer un chemin à travers les eaux. Tout ce que je voulais, c'était de m'entraîner sur mes échasses et faire voler mon cerf-volant. Et maintenant, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas pourquoi ce devait être MOI.
Les jours passèrent trop rapidement et, comme il avait été prévu, je dus finalement quitter la maison et gagner la Lamaserie Chakpori tout en haut de la colline. Là, je dus subir l'épreuve de l'attente, l'attente à l'extérieur exposé à tous les regards. De jeunes garçons venaient s'assembler autour de moi tandis que j'étais assis jambes croisées dans la poussière, à l'extérieur des grandes portes. Les jours étaient insupportablement longs, mais je les supportai. Les nuits étaient intolérablement pénibles, mais je les endurai jusqu'au bout. Je fus admis à la lamaserie comme le plus humble parmi les humbles, un garçon nouveau, une proie facile, celui que l'on pouvait harceler, celui sur lequel on pouvait faire toutes les plaisanteries. J'étais le plus bas, au bas de l'échelle.
Le temps se traînait et je pensais à la maison avec nostalgie. Elle me manquait, Tzu me manquait, ma sœur Yasodhara me manquait ; quant à ma Mère qui maintenant ne m'aimait plus — eh bien, ce que j'éprouvais pour elle était vraiment curieux. Franchement, elle me manquait. Plus franchement encore, je me sentais coupable. Comment avais-je pu échouer ? Pourquoi étaient-ils si déçus de moi ? En quoi étais-je responsable du fait qu'un astrologue ait dit que je devais souffrir ceci et endurer cela ? Je n'avais pas choisi. Quel être sensé, pensai-je, aurait décidé d'opter pour l'existence de misère qui m'était dévolue ?
Je songeais à mon Père et à son comportement quand il me vit pour la dernière fois, avant mon départ de la maison. Me considérant avec une expression glaciale, il s'adressa à moi comme si j'étais déjà un étranger, n'ayant plus maintenant de chez moi, n'ayant plus maintenant de parents. Un condamné venant à la porte mendier sa nourriture n'eût pas été traité par lui avec plus de dureté. Il me dit que j'avais déshonoré la famille en ayant un karma tel, qu'il me fallait être un moine, un lama, un errant dont on se moquerait et qu'on se refuserait à croire.
Quant à Yasodhara, je ne savais pas quoi penser de son attitude. Elle avait changé. Nous avions l'habitude de jouer ensemble comme le font un frère et une sœur ordinaires, et nous nous entendions généralement assez bien, tout juste, en fait, comme des frères et sœurs ordinaires s'entendent ‘assez bien’. Mais elle m'avait jeté d'étranges regards, comme si j'étais un chien errant qui se serait glissé dans la maison et aurait laissé quelque part la trace malpropre de son passage. Les serviteurs ne me montraient plus aucun respect, le respect dû à l'héritier du domaine Lhalu. Je n'étais plus pour eux que quelque chose qu'on logeait encore dans la maison pour quelques jours de plus, jusqu'à la date de son septième anniversaire. Puis, au jour de mes sept ans, je partirais seul, sans un mot d'adieu de quiconque, faisant l'ascension du chemin long et solitaire vers un parcours que je ne souhaiterais pas à mes pires ennemis.
Il y avait à Chakpori le constant relent des herbes qui séchaient, le constant bruissement de la préparation du thé aux herbes. Ici, beaucoup de temps était consacré à l'herboristerie, et moins aux disciplines religieuses. Mais nous avions d'excellents professeurs, tous des hommes âgés, dont certains en fait étaient même allés jusqu'en Inde.
Je me rappelle un moine âgé, je devrais dire un lama, qui au cours de son enseignement attaqua le problème de la transmigration.
— Dans un passé fort lointain, nous dit-il, en fait longtemps avant que l'histoire ne soit documentée, des géants foulaient la Terre. Ils étaient les Jardiniers de la Terre, ceux qui viennent ici pour superviser le développement de la vie sur cette planète, car nous ne sommes pas le premier Cycle d'Existence ici, vous savez ; mais comme le font des jardiniers quand ils nettoient une parcelle de terrain, toute vie avait été retirée, et c'est nous, la race humaine, qui avons été laissés ici pour suivre notre propre chemin, pour faire notre propre développement.
Il s'arrêta, regardant autour de lui afin de voir si ses élèves étaient intéressés par le sujet dont il les entretenait. Il fut surpris et heureux de constater qu'ils étaient tous en effet profondément intéressés par ses propos.
— La Race des Géants, poursuivit-il, n'était pas faite pour la vie sur Terre, et c'est pourquoi, grâce à des moyens magiques, la taille de ces êtres diminua jusqu'à rejoindre celle des humains, et ainsi ils furent en mesure de se mêler à eux sans être reconnus comme étant les Jardiniers. Mais il arrivait souvent qu'un Jardinier supérieur soit obligé de venir pour accomplir certaines tâches spéciales ; il fallait trop de temps pour qu'un garçon naisse d'une femme, passe par les années de sa petite enfance, de son enfance et de son adolescence. Aussi la science des Jardiniers de la Terre avait-elle un autre système ; ils développaient certains corps humains et s'assuraient que ceux-ci seraient compatibles avec l'esprit destiné à les habiter plus tard.
Un garçon assis à l'avant questionna soudainement :
— Comment un esprit pourrait-il habiter une autre personne ?
Le lama sourit et lui répondit :
— Je m'apprêtais à vous l'expliquer. Les Jardiniers de la Terre permettaient à certains hommes et femmes de s'accoupler afin que de chacun de ces couples naisse un enfant, et la croissance de cet enfant était supervisée avec le plus grand soin pendant, peut-être, les quinze, vingt ou trente premières années de sa vie. Puis venait alors un moment où un Jardinier haut placé avait besoin de venir sur Terre en l'espace de quelques heures. Les aides mettaient ce corps entraîné en état de transe, de stase, ou, si vous préférez, en état d'animation suspendue. Les aides dans le monde astral venaient à la fois vers le corps vivant et vers l'entité désirant venir sur Terre, et pouvaient, grâce à leurs connaissances spéciales, détacher la Corde d'Argent et brancher, à sa place, la Corde d'Argent de l'entité qui était le Jardinier de la Terre venant sur la Terre. L'hôte devenait alors le véhicule du Jardinier de la Terre, et le corps astral de l'hôte partait dans le monde astral, tout comme c'est le cas quand une personne meurt.
C'est ce qu'on appelle la transmigration, la migration d'une entité dans le corps d'une autre. Le corps pris en charge est appelé l'hôte, et cela a été connu tout au long de l'histoire, ce fut pratiqué amplement en Égypte, et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on connaît sous le nom d'embaumement, car à cette époque, en Égypte, de nombreux corps étaient maintenus en état d'animation suspendue. Ils étaient vivants, mais immobiles, et étaient prêts pour l'occupation par des entités supérieures, tout comme nous gardons des poneys attendant le moine ou le lama qui les montera et s'éloignera.
— Oh la la ! s'exclama l'un des garçons, je suppose que les amis de l'hôte devaient avoir une réelle surprise quand le corps s'éveillait et que celui que, dans le passé, ils considéraient comme étant leur ami, était possédé par toute la connaissance. Dites donc, je n'aimerais pas être un hôte, ce doit être terrible d'avoir quelqu'un d'autre qui vient occuper votre corps.
Le professeur rit, puis dit :
— Ce serait certainement une expérience unique. Les gens la pratiquent encore. Des corps sont toujours préparés, spécialement élevés, afin que si le besoin surgit, une entité différente puisse prendre en charge un nouveau corps si cela devient nécessaire pour le bien de l'humanité dans son ensemble.
Les garçons discutèrent le sujet durant des jours et, à la façon des garçons, certains d'entre eux prétendaient qu'ils allaient reprendre des corps. Mais pour moi, repensant à cette effroyable prédiction, ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était rien d'amusant, c'était un supplice même d'y penser. C'était un choc continuel pour mon organisme, un choc tel, que je craignais parfois de perdre la raison.
Un des professeurs était tout particulièrement intrigué par mon amour pour les chats et leur visible affection pour moi. Il savait parfaitement que les chats et moi conversions par télépathie. Un jour, les cours terminés et alors qu'il était sûrement de très bonne humeur, il me vit, étendu sur le sol, avec quatre ou cinq des chats de notre temple assis sur moi. Ce spectacle l'amusa et il me pria de l'accompagner jusqu'à sa chambre, ce que je fis avec une certaine appréhension, car à cette époque, être appelé dans les appartements d'un lama voulait généralement dire une réprimande pour quelque chose qu'on avait fait ou qu'on avait omis de faire, ou des tâches supplémentaires à accomplir. À distance respectueuse, je le suivis donc et, une fois arrivés dans ses appartements, il me pria de m'asseoir et commença à me parler des chats.
— Les chats, me dit-il, sont à présent de petites créatures qui ne peuvent parler avec les humains que par télépathie. Il y a de cela très, très longtemps, avant ce Cycle d'Existence particulier, les chats peuplaient la Terre. Ils étaient beaucoup plus gros, presque aussi gros que nos poneys ; ils parlaient entre eux et pouvaient faire des choses avec leurs pattes de devant, qu'ils appelaient alors des mains. Ils s'occupaient d'horticulture et étaient en majeure partie végétariens. Ils vivaient parmi les arbres et leurs maisons étaient dans les très grands arbres. Certains arbres étaient alors très différents de ceux que nous connaissons maintenant sur la Terre, certains d'entre eux, en fait, avaient d'énormes cavités comme des grottes, et dans ces cavités, ou ces grottes, les chats faisaient leurs demeures. Ils y étaient au chaud, protégés par l'entité vivante de l'arbre, et ils formaient une très agréable association. Mais on ne peut obtenir la perfection avec aucune espèce, car, à moins que n'existe la compétition, ou l'aiguillon d'un mécontentement, les créatures vivant dans une telle euphorie dégénèrent.
Ayant souri aux chats qui m'avaient suivi et étaient maintenant assis autour de moi, il continua :
— C'est ce qui s'est passé pour nos frères les chats. Ils étaient trop heureux, trop satisfaits, ils n'avaient rien pour stimuler leur ambition, rien pour les inciter à aller vers de plus grandes hauteurs. Ils ne pensaient à rien d'autre qu'au fait qu'ils étaient heureux. Tout comme ces pauvres gens dépourvus de raison, que nous avons vus récemment, leur bonheur consistait à s'étendre sous les arbres en laissant les affaires du jour s'arranger toutes seules. Ils étaient statiques, et en étant statique, ils étaient un échec. Comme tel, les Jardiniers de la Terre les délogèrent comme on fait des mauvaises herbes, et la Terre eut le droit, pour un temps, d'être en jachère. Avec le temps, la Terre avait atteint un tel stade de maturité, que de nouveau elle pouvait être repeuplée avec un type différent d'entité. Mais les chats — eh bien, leur faute avait été de ne rien faire, ni en bien ni en mal ; ils avaient existé, et rien que cela — existé. Ils furent donc renvoyés sur la Terre sous l'espèce de petites créatures comme celles que nous avons ici ; ils furent renvoyés pour apprendre une leçon, renvoyés en sachant au fond d'eux qu'ILS avaient été autrefois l'espèce dominante, ce qui fit qu'ils devinrent réservés, très prudents dans le don de leur affection. Ils furent envoyés avec une tâche, celle d'observer les humains et de faire rapport de leur progrès ou de leurs échecs, de sorte qu'à l'heure du prochain Cycle de nombreuses informations auront été fournies par les chats. Les chats peuvent aller partout, peuvent tout voir, tout entendre, et, incapables de dire un mensonge, ils enregistrent tout précisément comme cela se produit.
Je sais que j'étais pour le moment absolument effrayé ! Je me demandais ce que les chats rapportaient sur moi. Mais alors, un vieux matou, champion victorieux dans plus d'une bataille, bondit sur mes épaules avec un ‘Rrrr’ pour venir buter sa tête contre la mienne ; je me sentis tranquille, comprenant que les chats ne rapportaient rien de mal sur moi.
Peu de temps après, j'étais étendu sur le sol de l'infirmerie, le visage contre ma couverture, car j'avais été très sérieusement brûlé en haut de la jambe gauche, brûlure dont les cicatrices n'ont pas disparu et qui m'a causé une gêne dont je souffre encore. J'étais sur le ventre, ne pouvant me coucher sur le dos, quand un bien-aimé lama entra et me dit :
— Plus tard, Lobsang, quand tu seras guéri et que tu pourras marcher, je vais t'emmener sur un certain sommet de nos montagnes. Je veux te montrer quelque chose, car, te le sais, la Terre a subi de nombreux changements, la Terre a changé, les mers se sont modifiées, les montagnes se sont développées. Je vais te montrer des choses que pas plus de dix personnes dans tout le Tibet n'ont vues au cours des cent dernières années. Alors, dépêche-toi de te rétablir, dépêche-toi de guérir, car tu as quelque chose d'intéressant qui t'attend.
Ce fut quelques mois plus tard seulement que mon Guide, le Lama Mingyar Dondup — qui représentait tant dans ma vie et qui était devenu pour moi plus qu'un père et une mère — me conduisit au long d'un sentier. Chevauchant un puissant cheval, il se tenait un peu en avant de moi, et je le suivais monté sur un poney aussi peu confiant en ma personne que je l'étais en la sienne. Il avait senti immédiatement que j'étais un mauvais cavalier, et j'avais compris qu'il savait reconnaître un mauvais cavalier. Nous étions, comme j'aurais dit plus tard, en état de neutralité armée, une sorte de — bien, si tu ne fais rien, je ne ferai rien moi non plus ; nous devons vivre ensemble de toute façon. Mais nous poursuivions notre route, et enfin mon Guide s'arrêta. Je me penchai sur l'encolure du poney et me laissai glisser de côté. Nous lâchâmes les cordes qui servaient de rênes, mais le cheval et le poney étaient trop bien dressés pour chercher à se sauver.
Mon Guide alluma un feu et nous prîmes un repas très frugal. Pendant un moment, la conversation tourna autour des merveilles du Firmament qui s'étendait au-dessus de nous. Nous étions dans l'ombre des montagnes et de grandes taches violettes d'obscurité balayaient la Vallée de Lhassa à mesure que le Soleil plongeait derrière la chaîne, à l'ouest. Finalement, ce fut la noirceur, à l'exception du faible scintillement des lampes à beurre venant d'une myriade de maisons et de lamaseries, et à l'exception de la splendeur des Cieux qui renvoyaient le léger scintillement de ses taches de lumière.
— Maintenant, Lobsang, il nous faut dormir, dit mon Guide. Il n'y a pas de service au temple ce soir, ni demain matin, ce qui fait que nous ne serons pas réveillés. Dors bien, car demain nous allons voir des choses que tu n'as jamais cru pouvoir être possibles.
Ayant parlé, il se roula dans sa couverture, se tourna sur le côté — et s'endormit — tout simplement. Je restai éveillé, cherchant à creuser un trou dans le roc pour y loger l'os de ma hanche qui me semblait saillir péniblement, et, me mettant à plat ventre, car la cicatrice de ma brûlure était encore douloureuse, je finis par m'endormir.
L'aube vint, brillante. De notre altitude dans les montagnes, le spectacle était fascinant — les premiers rayons du Soleil semblaient frapper horizontalement à travers la vallée et illuminer les sommets à l'ouest, avec ce qui paraissait être des doigts de feu. Pendant un moment, ce fut vraiment comme si toute la montagne était enflammée. Nous étions là, debout, à observer, puis simultanément nous nous tournâmes l'un vers l'autre en échangeant un sourire.
Après un petit déjeuner léger — il me paraissait toujours trop léger, de toute façon ! — nous menâmes les chevaux s'abreuver à un ruisseau de montagne et les nourrîmes avec l'abondant fourrage que, bien sûr, nous avions apporté, les attachant à quelques trente pieds (9 m) l'un de l'autre, ce qui leur laissait assez d'espace pour se déplacer et brouter le peu d'herbe qu'ils pouvaient trouver.
Le Lama Mingyar Dondup prit la tête, marchant sur le versant de la montagne dépourvu du moindre sentier. Arrivés à un immense rocher qui semblait inébranlablement accroché au flanc de la falaise, il se tourna vers moi en disant :
— Lobsang, au cours de tes voyages, tu vas voir nombre de choses qui te donneront l'impression d'être magiques. En voici un premier exemple.
Il se tourna et, à mon grand ahurissement, il n'était plus là ! Il avait simplement disparu de ma vue. Puis sa voix me parvint de ‘quelque part’, me priant de m'avancer. Ce que je fis. Je découvris alors que ce qui paraissait être une plaque de mousse accrochée au flanc de la falaise était, en fait, un ensemble de lianes. J'approchai et le Lama écarta ces lianes pour me permettre d'entrer. Je le suivis, regardant tout autour de moi avec crainte et émerveillement. Nous étions dans une espèce de très, très large tunnel et la lumière provenait d'une source que je ne pouvais discerner. Je le suivis de loin, me réprimandant pour mon retard car, comme je me doutais bien, si j'étais trop lent je pouvais me perdre dans ce tunnel de montagne.
Nous marchâmes pendant un certain temps, parfois dans une obscurité si absolue qu'il me fallait passer légèrement ma main sur un côté de la paroi. Je ne m'inquiétais pas des cavités ou des roches basses au-dessus de nous, car mon Guide étant beaucoup plus grand que moi, je me disais que s'il passait sans encombre, je passerais moi aussi.
Après quelque trente minutes de marche, tantôt dans un air suffocant, tantôt dans une vigoureuse brise de montagne, nous arrivâmes à ce qui paraissait être une zone éclairée. Mon Guide s'arrêta. Je m'arrêtai moi aussi en arrivant près de lui et regardai autour de moi. L'étonnement me coupa le souffle. Nous étions comme dans une immense salle, large d'environ cinquante ou soixante pieds (de 15 à 18 m), dont les murs étaient couverts d'étranges sculptures, sculptures dont le sens m'échappait. Elles représentaient des gens curieux, vêtus d'habits remarquables qui les couvraient de la tête aux pieds, ou, pour être plus précis, du cou aux pieds, car sur leur tête il y avait la représentation de ce qui semblait être un globe transparent. Levant les yeux, je vis au-dessus de nous comme un immense cube, et à l'extrémité de cela, je discernai un nuage moutonneux qui flottait.
Me voyant pensif, mon guide parla :
— Ceci est un endroit très étrange, Lobsang. Il y a des milliers et des milliers d'années, il y avait une puissante civilisation sur cette Terre. Elle était connue sous le nom d'Atlantide. Certains peuples du monde Occidental, où tu iras plus tard, pensent que l'Atlantide est une légende, un lieu imaginaire rêvé par quelque grand conteur. Je dois te dire, à mon grand regret, que beaucoup de gens penseront que tu as inventé tes propres authentiques expériences, mais peu importe à quel point on doutera de toi, peu importe à quel point tu ne seras pas cru, tu connais la vérité, tu vas vivre la vérité. Et ici dans cette salle, tu as la preuve que l'Atlantide a existé.
Il se tourna et partit en tête pour pénétrer encore plus avant dans cet étrange tunnel. Pendant un temps, nous marchâmes dans une obscurité d'encre, notre respiration coupée dans l'air inerte, vicié. Puis de nouveau nous retrouvâmes la fraîcheur et, d'un point invisible, une brise agréable nous arriva. La sensation de lourdeur disparut et bien vite, nous vîmes une lueur devant nous. Je pus distinguer la silhouette de mon Guide se profilant dans le tunnel, découpée sur le fond de lumière devant moi. L'air frais emplissant maintenant mes poumons, je me dépêchai de le rattraper. Il s'arrêta de nouveau dans une vaste salle.
D'autres choses étranges s'y trouvaient. Quelqu'un avait visiblement creusé de grandes étagères dans le roc, et sur ces étagères se trouvaient des artéfacts qui m'apparurent dépourvus de tout sens. Je regardai et touchai avec précaution quelques-unes de ces choses, qui me parurent être des machines. Il y avait de grands disques avec d'étranges sillons. Certains de ces disques avaient l'air d'être en pierre et avaient, peut-être, 6 pieds (1 m 83) de diamètre, avec une ondulation sur leur surface et un trou en leur milieu. Leur signification m'échappait. Abandonnant mes spéculations stériles, je me tournai alors vers les peintures et les sculptures qui ornaient les parois. C'était de curieuses peintures de grands chats qui marchaient sur deux pattes, d'arbres habités à l'intérieur par des chats pelotonnés sur eux-mêmes, de choses qui paraissaient flotter dans l'air et, plus bas, sur ce qui était visiblement le sol, d'humains indiquant ces choses. Tout cela me dépassait tellement que j'en avais la migraine.
Mon Guide dit alors :
— Ces passages atteignent les extrémités de la Terre. Tout comme nous, Lobsang, la Terre a une épine dorsale, mais celle de la Terre est faite de roc. Dans notre épine dorsale nous avons un tunnel, il est rempli de liquide dans notre cas, et notre moelle épinière le traverse. Ceci, ici, est l'épine de la Terre, et ce tunnel a été fait par la main de l'homme dans les jours de l'Atlantide, où l'on savait comment rendre le roc aussi fluide que l'eau sans générer de chaleur. Regarde ce roc, dit-il en se tournant et tapant sur le mur. Il est fusionné à une dureté presque totale. Si tu le frappais avec une grosse pierre, tu n'endommagerais rien du tout, sauf la pierre qui pourrait se briser. J'ai beaucoup voyagé, et je sais que cette épine rocheuse s'étend du pôle Nord au pôle Sud.
Il m'indiqua que nous devrions nous asseoir, et nous nous installâmes donc jambes croisées sur le sol juste au-dessous du trou qui s'étendait jusqu'à l'air libre et à travers lequel nous pouvions voir l'obscurité du ciel.
— Lobsang, me dit mon Guide, il y a sur cette Terre de nombreuses choses que les gens ne comprennent pas, il y a également des choses à l'intérieur de la Terre, car, contrairement à la croyance commune, la Terre est en fait creuse, et il existe une autre race de gens vivant à l'intérieur de cette Terre. Ils sont plus évolués que nous, et il arrive que certains d'entre eux sortent de la Terre dans des véhicules spéciaux. (S'arrêtant, il désigna l'une des étranges choses sur les peintures, puis poursuivit :) Ces véhicules sortent de la Terre et volent autour d'elle afin de voir ce que font les gens, et pour s'assurer que leur propre sécurité n'est pas menacée par la folie de ceux qu'ils appellent les ‘étrangers’.
Je pensai que l'intérieur de la Terre était un lieu bien étrange où vivre ; il devait y faire affreusement sombre. Je n'aime pas l'idée de vivre dans l'obscurité ; une lampe à beurre est tellement réconfortante. Mon Guide eut un rire amusé en captant mes pensées et me dit :
— Oh, il ne fait pas sombre à l'intérieur de la Terre, Lobsang. Ils ont un Soleil, un peu comme le nôtre, mais le leur est beaucoup plus petit et bien plus puissant. Ils ont beaucoup plus que nous et sont beaucoup plus intelligents. Mais dans les jours à venir, tu vas apprendre beaucoup de choses sur les gens de la Terre Intérieure. Viens !
Se levant, il se dirigea à travers un tunnel que je n'avais pas vu, un tunnel partant vers la droite et qui descendait, descendait, en pente. Dans l'obscurité, nous marchâmes interminablement, me sembla-t-il. Puis mon Guide me pria de m'arrêter net. Je l'entendais fouiller et tâtonner, puis ce fut un bruit comme celui d'un roc qui se déplaçait. Je vis ensuite quelques étincelles quand il frappa un silex contre de l'acier. Une faible lueur apparut quand l'amadou fut allumé, et, soufflant dessus, mon Guide obtint une petite flamme dont il approcha le bout d'une sorte de bâton qui devint une torche brillante.
La tenant à bout de bras, un peu au-dessus de lui, il m'appela. Je m'avançai et il me désigna la paroi en face de nous. Le tunnel se terminait là et, devant nous, s'étendait une surface impénétrable absolument lisse qui brillait vivement sous la flamme vacillante.
— Ceci, Lobsang, est aussi dur que le diamant ; en fait, certains d'entre nous sommes venus ici, il y a des années, et nous avons essayé de gratter cette surface avec un diamant. C'est le diamant qui a été endommagé. Ceci est un passage conduisant au monde intérieur. Nous pensons qu'il a été scellé par les habitants du monde intérieur afin de préserver leur civilisation lors d'un grand déluge qui frappa cette Terre. Nous croyons que si ceci était ouvert — je veux dire si nous pouvions l'ouvrir — les gens nous assailliraient et nous écraseraient pour avoir osé violer leur intimité. Nous, lamas de rang supérieur, sommes souvent venus en ce lieu pour essayer, par la télépathie, de communiquer avec ceux d'en-dessous. Ils ont reçu nos messages, mais ils se refusent à avoir quoi que ce soit à faire avec nous ; ils nous disent que nous sommes guerriers, que nous sommes aussi ignorants que des enfants essayant de faire sauter le monde, essayant de ruiner la paix ; ils nous ont dit, par télépathie, qu'ils avaient l'œil sur nous et qu'ils interviendraient s'ils jugeaient nécessaire de le faire. Nous ne pouvons aller plus loin : ceci est la fin, c'est la ligne de séparation entre les mondes extérieur et intérieur. Allons, retournons maintenant à la grande salle.
Il éteignit la torche avec soin et nous repartîmes à tâtons vers l'endroit où la lumière rayonnait du ciel à travers un trou dans le toit.
Revenus à nouveau dans la salle, le Lama attira mon attention dans une autre direction en disant :
— Si nous en avions le temps et la force, nous pourrions arriver tout droit au pôle Sud, en suivant ce tunnel. Certains d'entre nous avons parcouru des milles et des milles (km), emmenant avec nous suffisamment de nourriture et campant la nuit, où ce que nous pensions être la nuit. Nous avons couvert une quantité infinie de milles (km) pendant six mois pour finir par passer à travers un tunnel et découvrir que nous étions dans un pays étrange, en vérité, mais nous n'avons pas osé nous montrer. Toutes les issues étaient toujours si soigneusement camouflées.
Nous nous assîmes et prîmes notre repas frugal. Nous avions beaucoup marché et, si mon Guide ne montrait pas le moindre signe le plus naturel de fatigue, j'étais, quant à moi, épuisé.
Il reprit la parole pour m'entretenir de toutes sortes de choses. Il me dit :
— Quand je recevais ma formation, comme c'est le cas pour toi maintenant, moi aussi, je suis passé par la Cérémonie de la Petite Mort et on me montra les Archives Akashiques, on me montra ce qui avait été, et je vis que notre Tibet avait été une plaisante station balnéaire au bord d'une mer scintillante. La température était chaude, peut-être même excessivement chaude, et il y avait une abondante végétation, des palmiers et toutes sortes de fruits étranges qui ne signifiaient alors rien pour moi. Mais le Registre Akashique me montra une civilisation réellement merveilleuse. Je vis d'étranges engins dans le ciel, je vis des gens avec de remarquables têtes en forme de cône qui marchaient, qui se divertissaient, qui faisaient l'amour, mais qui faisaient aussi la guerre. Puis, dans ce Registre j'ai vu le pays tout entier trembler, le ciel devenir tout noir et les nuages aussi sombres que la nuit, leur contour souligné de flammes. La terre frémit et s'ouvrit. Il sembla que tout n'était que feu. Puis la mer se précipita dans la terre fraîchement ouverte et de terribles explosions se succédèrent. Le Soleil paraissait se tenir immobile et la Lune ne se leva plus. Les gens furent submergés par d'énormes inondations, brûlés à mort par des flammes qui apparaissaient de je ne sais où, qui étincelaient d'un horrible rougeoiement violacé, et, dès qu'elles touchaient les gens, leur chair se détachait des os, laissant les squelettes s'abattre sur le sol avec un cliquetis.
"Les jours succédèrent aux jours et le bouleversement allait en augmentant, bien qu'on puisse nier qu'une telle chose fût possible, puis se produisit une explosion déchirante, fulgurante, et tout devint noir, tout devint aussi noir que la suie qui vient de trop de lampes à beurre brûlant sans être ajustées.
"Après un temps qu'il ne me serait pas possible d'évaluer, poursuivit-il, les ténèbres se firent moins denses, l'obscurité diminua et, quand la lumière du jour reparut enfin après je ne sais combien de temps, je regardai le spectacle avec une terreur absolue. C'était un paysage totalement différent que je voyais : la mer avait disparu, un anneau de montagnes avait surgi dans les ténèbres, encerclant ce qui était, auparavant, la cité d'une civilisation très avancée. Je regardais autour de moi comme fasciné par l'horreur : la mer avait disparu, la mer — eh bien, il n'y avait plus de mer, mais à sa place des montagnes, des anneaux et des anneaux de montagnes. Je compris que nous étions des milliers de pieds (m) plus haut, et bien que regardant les Archives Akashiques, je pouvais tout autant ressentir, je pouvais sentir que l'air était rare, et qu'il n'y avait aucun signe de vie ici, absolument aucun. Et comme je le regardais, le tableau s'évanouit soudain et je me retrouvai au point d'où j'étais parti, dans les niveaux les plus profonds de la montagne du Potala, là où je subissais la Cérémonie de la Petite Mort et avais reçu tant d'informations."
Nous restâmes assis là à méditer sur le passé pendant un certain temps, et mon Guide me dit :
"Je vois que tu médites, ou essaies de méditer. Il y a deux très bonnes façons de méditer, Lobsang. Tu dois être content, tu dois être paisible. Tu ne peux pas méditer avec un esprit troublé, et tu ne peux pas méditer avec tout un rassemblement de personnes. Tu dois être seul ou avec juste une personne que tu aimes.
Il poursuivit en disant :
"Tu dois toujours regarder quelque chose de noir, ou quelque chose de blanc. Si tu regardes le sol, tu peux être distrait par un petit gravier ou tu peux être plus distrait encore par un insecte. Pour méditer avec succès tu dois toujours regarder ce qui n'offre aucune attraction à l'œil : que ce soit tout noir ou d'un blanc pur. Tes yeux se lassent alors de fixer une chose sans intérêt et deviennent, pour ainsi dire, dissociés du cerveau — ce qui fait que celui-ci, n'ayant rien pour le distraire optiquement, est alors libre d'obéir à ce que requiert ton sub-conscient ; et ainsi, si tu as instruit ton sub-conscient que tu vas méditer, tu méditeras. Tu constateras dans ce genre de méditation que tes sens sont accrus, tes perceptions plus aiguës, et c'est la seule méditation digne de ce nom. Dans les années à venir, tu rencontreras de nombreux cultes offrant la méditation pour une somme d'argent, mais ce n'est pas la méditation comme nous la comprenons, ni non plus la méditation comme nous la voulons. C'est juste une chose avec laquelle les gens d'un culte jouent, et elle n'a aucune vertu."
Sur ce, il se leva en disant : "Nous devons retourner, car la journée est déjà bien avancée. Il nous faudra passer encore une nuit dans la montagne, puisqu'il est trop tard pour nous mettre en route pour Chakpori."
Il reprit le chemin du tunnel et je me levai en hâte en me précipitant vers lui. Je ne voulais pas rester seul en ce lieu où les habitants du monde intérieur risquaient d'apparaître et de m'attirer à eux. Je ne savais pas à quoi ils pouvaient ressembler, je ne savais pas s'ils me trouveraient sympathique, et je ne voulais certainement pas rester seul dans l'obscurité de cet endroit. Je me hâtai donc à sa suite et nous rejoignîmes finalement l'entrée par laquelle nous étions venus.
Le cheval et le poney se reposaient paisiblement. Nous nous assîmes près d'eux et fîmes nos simples préparatifs pour notre repas. La lumière était déjà bien loin et une grande partie de la Vallée était maintenant dans l'obscurité. À l'altitude où nous étions le Soleil couchant nous baignait encore de ses rayons, mais il s'enfonçait rapidement derrière les montagnes pour aller illuminer d'autres parties du monde, avant de nous revenir.
La conversation dura encore quelques instants, puis, roulés dans nos couvertures, ce fut le plongeon dans le sommeil.
Chapitre Cinq
La vie à Chakpori était très affairée. J'étais choqué par le nombre de choses qu'il me fallait apprendre : les herbes — où elles poussaient, quand les cueillir et garder en tête qu'elles seraient totalement inutiles si elles étaient cueillies au mauvais moment. On m'enseigna que c'était là l'un des grands secrets de l'herboristerie. Plantes, feuilles, écorces et racines ne peuvent être recueillies efficacement que dans une période de deux ou trois jours. La Lune doit être en position exacte, les étoiles doivent être en position exacte, et le temps doit être exact lui aussi. De même, il faut se sentir calme lorsqu'on fait cette cueillette, car, m'a-t-on dit, celui qui ramasse les herbes avec mauvaise humeur leur fera perdre leurs propriétés.
Les cueillettes devaient ensuite être séchées. C'était tout un travail. Certaines parties des herbes seulement étaient utiles. Avec certaines plantes, il ne fallait retirer que l'extrême pointe des feuilles, pour d'autres, il fallait conserver les tiges ou l'écorce, et ainsi chaque plante ou herbe devait être traitée à sa propre manière individuelle et considérée avec respect.
Prenant les écorces, nous les frottions entre nos mains spécialement nettoyées — une épreuve en soi ! — et l'écorce était ainsi réduite en une espèce de poudre granuleuse. Tout était alors étalé sur un sol impeccablement propre, sans cire, mais un sol frotté, frotté, frotté jusqu'à ce qu'il n'y ait ni poussière, ni tâche, ni marque. Puis, tout était laissé tel quel, laissé au soin de la Nature de ‘sécher-sceller’ les vertus des herbes étalées devant nous.
Nous préparions du thé aux herbes, c'est-à-dire des tisanes d'herbes infusées, et je n'arrivais jamais à comprendre comment les gens pouvaient avaler cette terrible mixture. Ce me semblait un axiome que plus infects en étaient leur goût et leur odeur, plus ces herbes étaient bénéfiques et je dirai, pour l'avoir observé moi-même, que si une médecine a un goût suffisamment horrible, le pauvre patient préférera se dire guéri plutôt que d'absorber l'horrible chose. Tout comme la peur du dentiste et de ce qui vous y attend fait s'évanouir la douleur sur le seuil de sa porte. Cela me rappelle ce jeune homme anxieux et livide — un jeune marié — qui accompagnait à l'hôpital son épouse enceinte jusqu'aux yeux, car ‘l'heure était arrivée’. Se tournant vers elle devant le bureau de réception il lui dit : "Oh, ma chérie, es-tu bien certaine de vouloir aller jusqu'au bout ?"
En tant qu'étudiant spécial, contraint d'apprendre davantage et plus rapidement que d'autres, mon temps ne se passait pas qu'à Chakpori. Je devais me consacrer également à des études faites au Potala. Là, chacun des lamas les plus instruits m'enseignait sa propre spécialité. J'y apprenais diverses formes de médecine. J'y appris l'acupuncture, et plus tard, riche de l'expérience de nombreuses années, j'en vins à la conclusion indéniable que l'acupuncture était, en vérité, une chose merveilleuse pour les gens de l'Orient, conditionnés depuis si longtemps à cet art. Toutefois, comme je l'ai constaté en Chine, lorsque vous avez affaire à des Occidentaux sceptiques... eh bien, malheureusement, ils sont hypnotisés par leur propre incrédulité de quoi que ce soit qui ne vient pas du ‘Dieu de leur propre pays’.
Il y avait des passages sacrés à voir dans les grandes profondeurs de la montagne du Potala. Tout en dessous, il y avait une immense grotte avec ce qui semblait être une mer intérieure. C'était, me dit-on, ce qui restait du temps terriblement lointain où le Tibet était un pays plaisant au bord de la mer. Il y avait là des restes certainement très étonnants — squelettes de créatures fantastiques — que beaucoup, beaucoup plus tard au cours de ma vie, j'identifiai comme étant des mastodontes, des dinosaures, et autres spécimens d'une faune exotique.
On trouvait, en divers points, de grandes plaques de cristal naturel, et dans ce cristal naturel on pouvait voir du varech, différents types de plantes marines, et parfois un poisson parfaitement conservé dans son lit de cristal clair. Ces choses-là étaient considérées comme des objets sacrés, des messages du passé.
J'excellais dans l'art de faire voler les cerfs-volants. Une fois l'an, nous nous rendions dans les hautes montagnes afin d'y récolter des herbes rares, et aussi pour nous détendre de la vie laborieuse de la lamaserie. Quelques-uns d'entre nous — les plus téméraires — volaient dans des cerfs-volants capables de transporter un homme, et je pensai d'abord que c'était là ce qui avait été décrit dans la prophétie ; mais en y réfléchissant mieux je réalisai qu'il ne pouvait s'agir d'un cerf-volant soulevant un homme, parce que ces cerfs-volants étaient reliés à la Terre par des cordes, et que si l'une de celles-ci venait à se briser ou à échapper aux mains des nombreux moines, le cerf-volant s'écraserait au sol et ce serait la mort de son passager.
J'eus un bon nombre d'entretiens avec le Très Précieux, notre Treizième Dalaï-Lama, pour qui j'éprouvais tant d'amour et de respect. Il savait que le Tibet serait dans quelques années un État asservi, mais ‘les Dieux ayant prédit’, il fallait leur obéir. Il ne pouvait y avoir aucune forme réelle de résistance parce qu'il n'y avait aucune arme réelle au Tibet. On ne peut s'opposer à un homme armé d'un fusil quand tout ce que l'on a est un Moulin à Prières ou un chapelet.
Je reçus mes instructions, mes ordres sacrés, du Grand Treizième. Je reçus des directives et des conseils, ainsi que l'amour et la compréhension qui m'avaient été complètement refusées par mes propres parents, et je décidai que, quoi qu'il puisse arriver, je ferais de mon mieux.
Il y eut des occasions où je revis mon Père. Chaque fois il se détourna de moi après m'avoir regardé d'un air glacial comme si j'étais un moins que rien, ne valant même pas son mépris. Une fois, presque sur la fin de mon séjour au Potala, je rendis visite à mes parents à la maison. Ma mère m'exaspéra par son excès de formalité, par sa manière de me traiter uniquement comme quelque lama en visite. Père, fidèle à ses idées, refusa, lui, de me voir et s'enferma dans son bureau. Quant à ma sœur, Yasodhara, elle me regarda comme un monstre ou le produit d'un cauchemar particulièrement horrible.
Puis, un jour, je fus finalement appelé dans les appartements du Très Précieux, où me furent confiées nombre de choses que je n'ai pas l'intention de répéter ici. Mais il me dit que, dans la semaine à venir, je me rendrais en Chine pour y étudier la médecine à l'Université de Chongqing. Mais je devrais changer de nom, car si je gardais celui de Rampa, certains éléments de la rébellion Chinoise pourraient s'emparer de moi et m'utiliser comme instrument de négociations. Il existait à ce moment, en Chine, une faction qui voulait renverser le gouvernement et était prête à y parvenir par n'importe quelle méthode. Ainsi — je devais choisir un autre nom.
Mais comment un pauvre garçon Tibétain, un garçon approchant l'âge adulte, certes, mais comment pouvait-il prendre un nom Chinois quand il ignorait tout de la Chine ?
Je réfléchis longuement à cette terrible question, et soudain, de façon inattendue, un nom me vint à l'esprit. C'était celui de KuonSuo qui, dans l'un des dialectes Chinois, signifie ‘prêtre de la colline’. C'était sûrement un nom approprié. Mais c'était un nom que les gens trouvaient difficile à prononcer — c'est-à-dire, les Occidentaux — et qui, de ce fait, ne tarda pas à être simplifié et à devenir Ku'an.
Ainsi donc, mon nom était choisi. Mes papiers étaient en règle. Je reçus des documents spéciaux du Potala, attestations de mes statuts et de mon niveau, car, comme on me l'avait dit et comme je devais en vérifier la parfaite exactitude plus tard, les Occidentaux ne croient rien de ce qui n'est pas ‘sur papier’, de ce qui ne peut être touché ou mis en pièces. Mes papiers enfin prêts me furent remis avec un grand cérémonial.
Arriva bientôt le jour où je devais me rendre à cheval jusqu'à Chongqing. Je pris congé de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup : nos adieux furent très tristes. Il savait que, de son vivant, je ne le reverrais pas, mais il m'assura longuement que nous nous retrouverions souvent dans l'astral.
Un petit groupe de gens m'escortait, afin de me protéger contre les brigands Chinois, et aussi pour témoigner que j'étais bien arrivé à Chongqing. Nous nous mîmes en route et chevauchâmes progressivement tout au long des Hautes Terres de la Plaine de Lhassa, puis entreprirent la descente dans les Basses Terres, un lieu à la flore presque tropicale où poussaient de merveilleux rhododendrons. Nous rencontrâmes de nombreuses lamaseries et passions souvent la nuit dans l'une d'elles si elles se trouvaient sur notre chemin au moment opportun. J'étais un lama, en fait j'étais un abbé, et une Incarnation Reconnue, et quand nous allions dans une lamaserie nous y étions l'objet d'un traitement spécial. Mais je n'appréciais pas ce traitement spécial, parce qu'il me rappelait à chaque fois les épreuves que j'avais encore à subir.
Quittant les frontières du Tibet, nous entrâmes en Chine. Là, chaque village un peu important semblait être envahi par les Communistes Russes — hommes blancs qui se tenaient généralement debout sur un char à bœufs, vantant aux ouvriers les merveilles du Communisme, leur disant de se soulever et de massacrer les propriétaires terriens, répétant que la Chine appartenait au peuple. C'est le cas maintenant, et quel gâchis il en a fait !
Les jours s'écoulaient et notre voyage, en apparence interminable, progressait. J'étais ennuyé d'être accosté par certains paysans Chinois qui me regardaient bouche bée, parce que je ressemblais plutôt à un Occidental. J'avais les yeux gris et non pas bruns, les cheveux très noirs, mais non pas d'un noir luisant, et le bruit courut que j'étais un Russe déguisé ! À présent, maintenant que je vis en Occident, toutes les histoires les plus étranges ont couru à mon sujet ; une histoire qui m'a énormément amusé est celle qui voulait que je sois un Allemand envoyé à Lhassa par Hitler afin d'y apprendre les secrets de l'occultisme, puis de revenir à Berlin et de gagner la guerre pour Hitler grâce à des moyens magiques. Eh bien, j'ignorais même, en ce temps-là, l'existence d'un homme appelé Hitler. C'est une chose vraiment remarquable que le fait de constater qu'un Occidental est prêt à tout croire, excepté ce qui est absolument vrai ; plus une chose est vraie, plus l'Occidental a de peine à la croire. Mais puisque nous parlons d'Hitler et des Tibétains, il est exact qu'un petit groupe de Tibétains ont été capturés par les Nazis durant la guerre et contraints d'aller à Berlin, mais ils n'ont certainement rien fait pour les aider à gagner la guerre, comme le prouve l'histoire.
Après un dernier tournant, nous arrivâmes en vue de Chongqing — une vieille ville bâtie sur de hautes falaises en dessous desquelles coulent deux cours d'eau. L'un d'eux, la rivière Jialing, m'était particulièrement familière. Ainsi, la haute ville de Chongqing, aux rues en gradins pleines de galets, était baignée à sa base par le fleuve Yangtsé et la rivière Jialing. Ils formaient une branche en se rencontrant, ce qui de loin faisait ressembler la cité à une île.
Nous dûmes monter sept-cent-quatre-vingts marches pour atteindre la ville elle-même. Tels des campagnards, nous regardâmes les boutiques et tout particulièrement celles qui nous semblaient brillamment éclairées qui contenaient des articles complètement au-delà de notre compréhension. Les choses scintillaient dans les vitrines et, de plusieurs boutiques, nous parvenaient des bruits, des voix d'étrangers se servant de boîtes pour se parler, puis des éclats de musique sortant d'autres boîtes. Tout cela était pour nous un étonnement complet, et moi, sachant que j'aurais à passer beaucoup de temps dans un tel environnement, je me mis presqu'à trembler de peur à cette pensée.
Ma petite suite m'embarrassait par sa manière de regarder bouche bée. Chacun des hommes tremblait de fébrilité, et chacun d'eux avait la bouche ouverte et les yeux grands ouverts aussi. Nous devions faire l'effet d'une bande de rustres ignorants, pensai-je. Mais alors, je me rappelai que nous n'étions pas ici pour cela, quand même. Je devais m'inscrire à l'Université et nous reprîmes donc la route. Mes compagnons attendirent à l'extérieur, tandis que je me présentais officiellement, tendant l'enveloppe que j'avais protégée avec tant de soin depuis Lhassa.
À l'Université, je travaillai très dur. Mon éducation avait été d'une forme très différente de celle que demandait le système universitaire et il me fallait donc travailler au moins deux fois plus durement. Le Recteur de l'Université m'avait prévenu que les conditions seraient difficiles. Il m'expliqua qu'il était qualifié dans les plus récents systèmes Américains et qu'avec son personnel très compétent, il donnait aux étudiants une formation qui était un mélange de médecine et de chirurgie Chinoises et Américaines.
Certaines matières, l'Électricité, dont je ne savais rien, me demandèrent un gros effort, mais j'appris bien vite ! L'anatomie fut facile pour moi : je l'avais étudiée à fond avec les Ordonnateurs de la Mort à Lhassa, et je fus très amusé de voir la réaction des étudiants introduits pour la première fois dans la salle où se trouvaient les cadavres à disséquer. Certains d'entre eux tournèrent au vert pâle et furent pris de violentes nausées, tandis que d'autres s'évanouirent simplement, s'écroulant sur le sol. C'était pourtant si simple de se dire que ces corps morts ne pouvaient nullement souffrir des efforts d'amateurs que nous allions pratiquer sur eux, qu'ils étaient pareils à de vieux vêtements qui ont été jetés et que l'on retaillerait peut-être pour en faire de nouveaux habits. Oui, le travail universitaire était difficile au début, mais je parvins finalement à prendre place parmi les meilleurs de ma classe.
À peu près à cette période, je remarquai qu'un très, très vieux prêtre Bouddhiste donnait des conférences à l'Université. Quand j'essayai d'obtenir des informations, on me répondit : "Oh, ne perds pas ton temps avec lui, c'est un vieux bonhomme cinglé ; il est bizarre !" Eh bien, cela me persuada de prendre ce travail supplémentaire en assistant aux conférences du ‘vieux bonhomme cinglé’. Cela en valut vraiment la peine.
Je demandai formellement la permission d'y assister et je fus heureusement accepté. Quelques conférences plus tard, nous étions tous assis et notre conférencier entra. Comme le voulait la coutume, nous nous levâmes et attendîmes la permission de nous asseoir. Alors, il nous dit :
— La mort n'existe pas.
Pas de mort, pensai-je, voilà qu'il va traiter de l'occulte, appeler la mort ‘transition’, ce qu'elle est après tout. Mais le vieux conférencier laissa l'impatience nous consumer un moment avant de reprendre en riant :
— Je le dis littéralement. Si nous savions seulement comment le faire, nous pourrions prolonger la vie indéfiniment. Considérons d'abord le processus du vieillissement, et j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire.
Il continua :
— Un enfant naît et suit un certain schéma de développement. À un âge qui varie avec chaque individu, le réel développement est déclaré être stoppé, le développement réel valable s'est arrêté, et à partir de ce moment-là commence ce que l'on appelle la dégénérescence de la vieillesse, où nous avons un homme de grande taille qui rapetisse au fur et à mesure que ses os se tassent.
Promenant son regard autour de lui pour voir s'il était compris, il vit que j'étais tout particulièrement intéressé, et me sourit aimablement.
Il poursuivit :
— Une personne doit être reconstruite cellule par cellule, ce qui fait que si nous avons une coupure, une partie du cerveau doit se souvenir de ce qu'était la chair avant la coupure et doit ensuite fournir des cellules identiques, ou presque identiques, pour réparer la lésion. Or, chacun de nos mouvements crée une usure d'un certain nombre de cellules qui doivent être reconstruites, remplacées. Sans une mémoire exacte, il ne nous est pas possible de reconstruire le corps comme il était.
Il leva les yeux à nouveau, puis pinça les lèvres et reprit :
— Si le corps ou, plutôt, si le cerveau oublie le schéma précis, alors les cellules peuvent se développer sauvagement, ne suivant aucun ordre établi, et alors ces cellules sauvages sont appelées cellules cancéreuses. Cela signifie que ce sont des cellules qui ont échappé au contrôle de cette partie du cerveau qui régit leur schéma précis. C'est ainsi que vous avez une personne qui se retrouve avec d'importantes tumeurs sur le corps. Cela est provoqué par le développement anarchique de certaines cellules qui ont échappé au contrôle du cerveau.
Il s'arrêta pour prendre une gorgée d'eau, puis continua :
— Tout comme la plupart d'entre nous, ce centre destiné à la croissance et au remplacement, situé dans le cerveau, a lui aussi des défaillances de mémoire. Après avoir reproduit des cellules quelques milliers de fois, il oublie le schéma précis, et ces différences se produisant à chaque production de cellules provoquent finalement le processus dit de vieillissement. Or, si nous pouvions rappeler constamment au cerveau la forme exacte et la taille de chaque cellule à remplacer, alors le corps semblerait toujours être du même âge, semblerait toujours être dans le même état. En somme, nous aurions l'immortalité, l'immortalité sauf dans le cas de destruction totale du corps ou dommage des cellules.
Réfléchissant à cela, je me rappelai soudain que mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'avait, en termes différents, exprimé la même chose, mais j'étais alors trop jeune ou trop stupide — ou peut-être les deux — pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire.
Nos cours étaient intéressants. Nous étudiions de nombreux sujets qui ne sont pas abordés en Occident. Outre le type de médecine et de chirurgie occidentales courantes, nous étudiions l'acupuncture et les plantes médicinales ; mais tout n'était pas que travail, bien qu'il s'en fallût de peu.
Me promenant un jour avec un ami au bord de la rivière, nous vîmes un avion qui avait été laissé là pour une quelconque raison. Le moteur tournait au ralenti et l'hélice tournait, elle aussi. Pensant aux cerfs-volants que j'avais pilotés, je dis alors à mon ami :
— Je parie que je peux faire voler cet appareil.
Il éclata d'un rire moqueur et je lui dis alors :
— C'est bien, je vais te le prouver.
Regardant autour de moi pour voir s'il n'y avait personne à proximité, je m'installai dans l'engin et, à ma propre surprise et à celle de nombreux observateurs, je fis vraiment voler l'engin, mais pas de la manière réglementaire, mes acrobaties étant purement involontaires, et je survécus et atterris sans ennui seulement parce que mes réflexes étaient plus développés que chez la plupart des individus.
Je fus si fasciné par ce vol terriblement dangereux que j'appris à voler — officiellement. Et vu que je montrais, comme pilote, des aptitudes assez rares, je me vis offrir un poste dans les Forces Chinoises. Selon les grades Occidentaux, j'avais le titre et le rang de Chirurgien-Capitaine.
J'obtins mon diplôme de pilote, mais le commandant me conseilla de poursuivre mes études jusqu'à ce que j'aie aussi gradué comme médecin et chirurgien. Cela fut bientôt fait, et finalement, armé d'une masse de documents officiels, j'étais prêt à quitter Chongqing. Mais arriva un très triste message concernant mon Protecteur, le Treizième Dalaï-Lama, le Très Précieux, et ainsi, obéissant à une convocation, je rentrai à Lhassa pour un temps très court.
Le destin appelant, toutefois, il me fallut suivre les ordres des autorités supérieures et retourner à Chongqing, puis à Shanghaï. Je fus mis pour un temps en réserve, en tant qu'officier des Forces Chinoises. Les Japonais essayaient alors de trouver un prétexte pour envahir la Chine, ce qui fait que le pays vivait des jours très difficiles. Les étrangers étaient soumis à toutes sortes d'indignités dans l'espoir qu'ils causeraient des ennuis au gouvernement de la Chine. Hommes et femmes étaient dépouillés de leurs vêtements en public et soumis à une fouille corporelle par les soldats Japonais qui disaient suspecter les étrangers d'être porteurs de messages. Je vis une jeune femme qui résistait ; on la força à se tenir debout pendant des heures, toute nue, au centre d'une rue animée. Elle était franchement hystérique, mais chaque fois qu'elle essayait de fuir, une des sentinelles la poussait de manière obscène avec sa baïonnette.
Les Chinois qui observaient ne pouvaient rien faire, ne voulant pas provoquer d'incident international. Mais alors, une vieille dame Chinoise jeta un manteau à la jeune femme pour qu'elle puisse se couvrir ; une sentinelle se rua sur elle et, d'un coup, lui trancha le bras qui avait jeté le manteau.
Je trouve stupéfiant, maintenant, après tout ce que j'ai eu à souffrir, de voir les gens se ruer, de tous les points du monde, sur les Japonais en leur offrant leur amitié, etc., vraisemblablement parce qu'ils offrent en retour une main-d'œuvre bon marché. Les Japonais sont une plaie de la Terre en raison de leur soif insensée de dominer.
Installé comme médecin à Shanghaï, j'avais mon propre cabinet privé, et un cabinet très prospère aussi. Peut-être aurais-je continué à gagner ma vie dans cette ville si n'avait pas eu lieu, le 7 juillet 1937, l'incident du Pont Marco Polo, qui marqua vraiment le début de la guerre avec le Japon. Je fus envoyé aux docks de Shanghaï pour y superviser l'assemblage d'un très gros avion à trois moteurs qui avait été remisé là, prêt pour une firme qui se proposait de démarrer une compagnie de transport de passagers.
Je me rendis aux docks avec un ami et nous nous trouvâmes devant un avion en pièces, le fuselage et les ailes, tout cela séparé. Le train d'atterrissage n'était même pas relié, et les trois moteurs étaient emballés séparément. À force de psychométrie et, plus encore, de bon sens, je parvins à diriger les ouvriers pour assembler l'avion sur un très grand espace libre. Autant que je le pus, je vérifiai tout, j'examinai les moteurs, m'assurai qu'ils avaient le bon carburant et la bonne huile. L'un après l'autre, je mis en marche ces moteurs et les essayai, les laissant tourner au ralenti puis les faisant vrombir, et quand, après plusieurs ajustements, je fus satisfait du résultat, je fis rouler l'avion de long en large de ce grand terrain pour m'habituer aux commandes de l'engin, parce que l'on ne fait pas d'acrobaties très longtemps dans un avion trimoteur !
Je me sentis enfin persuadé de comprendre les contrôles et d'être en mesure de très bien les manipuler. Alors, avec un ami qui avait une foi énorme en moi, nous montâmes dans l'avion et roulâmes lentement jusqu'à l'extrémité de ce grand terrain. Des coolies avaient calé les roues à l'aide de gros blocs, avec instruction de les retirer immédiatement en actionnant les cordes qui les maintenaient au signal de ma main droite levée. Puis, j'ouvris tous les trois accélérateurs, de sorte que l'avion vrombit et trépida. Enfin, je levai la main, les blocs furent retirés et nous nous mîmes à cabrioler follement sur le terrain. Au dernier moment, je tirai sur les commandes et nous nous élevâmes à un angle que je qualifierais de vraiment peu orthodoxe, mais nous volions, et cela pendant peut-être une heure ou deux, pour avoir l'appareil en main. Nous finîmes par revenir sur le lieu d'atterrissage et je pris soin de noter la direction de la fumée. J'approchai lentement et atterris contre le vent, et je confesse que j'étais trempé de sueur ; mon ami l'était, lui aussi, en dépit de toute sa confiance en moi !
Un peu plus tard, je reçus l'ordre de garer l'avion en un autre point, où il pourrait être surveillé de jour et de nuit, car la brigade internationale devenait très active et certains de ces étrangers pensaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec la propriété des Chinois. Nous ne voulions pas que notre gros avion fut endommagé.
Sur une base retirée, l'avion fut modifié. La plupart des sièges furent retirés et des civières installées sur des supports. À l'une des extrémités de l'avion, une table de métal fut fixée et cet espace allait servir de petite salle d'opération. Nous allions pratiquer les opérations d'urgence, car maintenant — à la fin de 1938 — l'ennemi approchait des faubourgs de Shanghaï, et je reçus l'ordre de fermer mon cabinet que j'avais continué à maintenir à temps partiel. On me dit de conduire l'avion dans un lieu sûr où il pourrait être repeint tout blanc avec une croix rouge. De même, il porterait, peinte en caractères Chinois et Japonais, l'inscription ‘Avion-Ambulance’.
Mais la peinture n'était pas destinée à durer bien longtemps. Les bombes pleuvaient sur Shanghaï, l'air était rempli de la puanteur âcre des explosifs, pleine de particules de pierrailles qui piquaient les narines, irritaient les yeux — et décapaient la peinture de Old Abie, le nom que nous avions donné à notre avion. Une plus grosse déflagration ne tarda pas à se produire et Abie, après avoir bondi en l'air, s'effondra à plat sur le fuselage, l'explosion d'une bombe à proximité ayant arraché le train d'atterrissage. Grâce à un travail acharné et une considérable ingéniosité, nous réparâmes le train d'atterrissage avec des longueurs de bambou fendu, tout comme des attelles sur un membre cassé, pensai-je. Le bambou attaché fermement en place, je roulai d'un bout à l'autre du terrain troué de bombes pour voir comment l'appareil se débrouillerait : il semblait s'en tirer parfaitement bien.
Nous étions assis dans l'avion quand se produisit une vive agitation et qu'un général Chinois furieux — en grande pompe et plein d'assurance — arriva sur le terrain d'aviation entouré par les membres subalternes de son personnel. D'un ton brusque, il nous ordonna de le conduire à une certaine destination. Il se refusa à entendre notre point de vue selon lequel l'avion n'était pas en état de voler sans de plus amples réparations. Il ne voulut rien entendre sur le fait que nous étions un avion-ambulance et que les lois internationales ne nous permettaient pas le transport d'hommes armés. Nous argumentâmes, mais son argument était le plus fort : il n'avait qu'à dire, ‘emmenez ces hommes et qu'on les fusille pour refus d'obéir aux ordres militaires’, et cela aurait mis fin à nos jours. Nous nous serions envolés sans lui !
La troupe d'hommes grimpa dans l'avion, jetant l'équipement médical — l'éparpillant simplement par la porte ouverte — pour faire de la place pour leur propre confort. Nous vîmes ainsi partir nos civières, notre table d'opération, nos instruments — tout. Ils furent tout simplement jetés comme si nous ne devions plus en avoir aucun besoin. Ce qui, en fait, fut le cas.
Nous volions depuis environ deux heures quand surgirent les ‘Diables Rouges’, les avions de chasse Japonais, si nombreux qu'ils ressemblaient à un nuage de moustiques. Le symbole rouge, si haï, brillait sur les ailes. Ils tournèrent autour de notre avion-ambulance aux croix rouges si parfaitement en évidence, puis sans la moindre pitié, nous mitraillèrent à tour de rôle. Depuis lors, je n'ai jamais aimé les Japonais, qui allaient me donner bien d'autres motifs de les détester.
Notre avion fut abattu, et je fus le seul à m'en tirer. Je tombai dans un des endroits les plus insalubres de Chine — un tout-à-l'égout collectant tous les déchets. Je suis donc tombé dans le fossé d'égout, m'enfonçant complètement et me brisant les deux chevilles du même coup.
Des soldats Japonais me sortirent de là et me traînèrent jusqu'à leur quartier général où, refusant de leur donner aucune information — si ce n'est que j'étais un officier des services Chinois — je fus en vérité très, très mal traité. Cela sembla considérablement les ennuyer parce qu'ils me firent sauter les dents à coups de pied, m'arrachèrent les ongles, et me firent subir d'autres choses pénibles dont je n'ai depuis cessé de souffrir. Par exemple, on inséra des tuyaux dans mon corps, puis on ouvrit le robinet dont l'eau avait été approvisionnée de moutarde et de poivre, tout cela faisant gonfler mon corps énormément et causant de terribles dommages à l'intérieur. C'est l'une des raisons qui font que je souffre tant, même maintenant, si longtemps après.
Mais il est inutile d'entrer dans les détails, parce que si quelqu'un est intéressé à les connaître il peut les lire dans ‘Docteur de Lhassa’ (‘Lama Médecin’). Je souhaiterais que de nombreuses personnes lisent ce livre pour leur faire voir quelle sorte de (eh bien, VOUS savez quoi) sont les Japonais.
C'est dans un camp de prisonniers de guerre pour femmes que je fus envoyé, parce que cela était considéré dégradant. Certaines des femmes avaient été capturées dans des endroits comme Hong Kong. Certaines d'entre elles étaient dans un état vraiment choquant à cause des viols continuels.
Il y a lieu de mentionner qu'à ce moment-là il y avait certains officiers Allemands qui ‘conseillaient’ les Japonais, et ces officiers se voyaient toujours offrir les femmes les plus belles, et les perversions — eh bien, je n'ai jamais rien vu de tel. Il semble que les Allemands n'excellent pas seulement dans l'art de faire la guerre.
Après un certain temps, mes chevilles guéries et mes ongles repoussés, je parvins à m'évader et gagnai lentement et douloureusement Chongqing. La ville n'était pas encore aux mains des Japonais, et mes collègues médecins firent des merveilles pour restaurer ma santé. Mon nez avait été brisé. Avant d'être brisé, il était — selon les standards Occidentaux — plutôt plat, mais suite aux exigences de la chirurgie, mon nez devint une affaire assez large qui aurait fait la fierté de n'importe quel Occidental.
Mais la guerre atteignit Chongqing, la guerre violente de l'occupation Japonaise. Capturé de nouveau et de nouveau torturé, je finis par être encore affecté à un camp où je fis de mon mieux pour soigner les prisonniers malades. Malheureusement, un officier supérieur transféré d'une autre région me reconnut comme prisonnier évadé.
Tous les ennuis recommencèrent pour moi. On me brisa les deux jambes en deux endroits pour m'apprendre à ne pas m'évader. Ils m'installèrent ensuite sur un chevalet et j'eus les bras et les jambes tendus à l'extrême. Je reçus en plus un coup si terrible dans la région inférieure de la colonne vertébrale, que de graves complications s'ensuivirent, et qui font que même maintenant celle-ci se détériore au point que je ne peux plus rester debout.
Une fois de plus, mes blessures guéries, je réussis à m'échapper. Me trouvant dans une région où j'étais connu, je parvins à la maison de certains missionnaires qui étaient pleins d'apitoiement et de grandes exclamations d'affliction, de compassion — le grand jeu. Ils soignèrent mes blessures, me donnèrent un narcotique — et prévinrent de ma présence les gardes Japonais, parce que, me dirent-ils, ils tenaient à protéger leur propre mission, et je n'étais pas ‘un des leurs’.
De retour au camp de prisonniers je fus si maltraité qu'on craignit que je ne survive pas, et ils voulaient que je survive parce qu'ils étaient convaincus que j'avais des informations dont ils avaient besoin, et que je me refusais à leur livrer.
Estimant que j'étais par trop doué pour l'évasion, je fus finalement envoyé sur l'île principale du Japon, dans un village au bord de la mer près d'une ville appelée Hiroshima. Je fus de nouveau chargé — comme officier médical — d'un camp de femmes qui avaient été amenées de Hong Kong, de Shanghaï ainsi que d'autres villes, et qu'on gardait là avec l'arrière-pensée qu'elles pourraient servir d'otages, plus tard, à l'heure où l'on marchanderait, car pour les Japonais la guerre était en train de mal tourner, et les dirigeants savaient parfaitement qu'ils n'avaient aucun espoir de vaincre.
Puis un jour, on entendit le bruit des moteurs d'avions, le sol trembla soudain, et au loin on vit s'élever une immense colonne, une colonne en forme de champignon avec des nuages qui roulaient et se répandaient très haut dans le ciel. Parmi nous, ce fut la panique totale, les gardes se dispersèrent comme des rats effrayés, et moi, toujours alerte pour une telle opportunité, j'enjambai une palissade et me frayai un chemin jusqu'au bord de l'eau. Un bateau de pêche était là — vide. Je réussis à y grimper et, trouvant une perche, je n'eus suffisamment de force que pour le pousser en eau plus profonde. Je m'effondrai alors dans la cale puante. Le bateau fut entraîné vers le large avec la marée descendante et moi, — de l'eau jusqu'au cou au fond du bateau — je ne sus rien de ce qui se passait jusqu'à ce que je reprenne finalement conscience, éberlué, et compris avec un sursaut que je venais encore de m'échapper.
Je me traînai péniblement en me soulevant un peu hors de l'eau et regardai anxieusement autour de moi. Je me disais que les Japonais enverraient des vedettes rapides pour capturer un fugitif multirécidiviste. Mais non, pas le moindre bateau en vue, mais à l'horizon au-dessus de la ville d'Hiroshima, on voyait une lueur rouge, une lueur d'enfer ; le ciel était noir, et de cette noirceur tombaient ‘des choses’, grosses taches couleur de sang, puis des masses de suie, et une pluie noire et graisseuse.
J'étais torturé par la faim. Avisant un coffre à l'avant du bateau, je l'ouvris et y découvris des morceaux de poisson — pas de toute première fraîcheur, et qui devaient être là pour servir d'appât. Ils suffiraient à me maintenir en vie et je bénis le pêcheur de les avoir laissés dans ce coffre.
Je m'étendis sur les sièges du bateau et me sentis très mal parce que celui-ci se balançait d'une façon des plus étranges ; la mer elle-même semblait étrange, avec un type de vagues que je n'avais jamais vu auparavant, presque comme s'il y avait un tremblement de terre sous-marin.
Je regardai autour de moi et l'impression était angoissante. Il n'y avait aucun signe de vie. En un jour comme celui-ci, la mer aurait dû normalement porter une multitude de bateaux de pêche, car le poisson est la nourriture de base des Japonais. Je ressentis un profond sentiment de malaise parce qu'étant télépathe et clairvoyant j'obtenais de remarquables impressions, tellement confuses et en si grand nombre, que je ne pouvais tout simplement pas les comprendre.
Le monde entier semblait silencieux à part un étrange gémissement de vent. Puis loin au-dessus de moi je vis un avion, un très gros avion. Il tournoyait dans le ciel et en regardant attentivement je pouvais voir la grande lentille d'une caméra aérienne pointée vers le bas. De toute évidence, on prenait des photos de la région, pour une raison quelconque que je ne connaissais pas alors.
Peu de temps après, l'avion s'éloigna et disparut de mon champ de vision ; je me retrouvai à nouveau seul. Aucun oiseau ne volait. Étrange, pensai-je, car les oiseaux de mer viennent toujours vers les bateaux de pêche. Mais il n'y avait pas d'autres bateaux non plus aux alentours, il n'y avait aucun signe de vie nulle part, et j'avais ces bizarres impressions qui arrivaient à mes perceptions extra-sensorielles. Je dus finalement m'évanouir, car tout, soudain, devint noir.
Le bateau, transportant ma forme inconsciente, dériva vers l'Inconnu.
Chapitre Six
Après ce qui me parut une infinité de jours, et en fait je n'aurais pu dire pendant combien de temps, mais après cette période indéterminée, j'entendis soudain des voix étrangères, hostiles, et je sentis qu'on me soulevait par les bras et les jambes, qu'on me balançait en décrivant un arc, avant de me lâcher. J'atterris avec un plouf juste au bord de l'eau et j'ouvris des yeux troubles pour découvrir que j'étais sur un rivage inconnu.
Devant moi, deux hommes poussaient frénétiquement le bateau en avant et, à la dernière minute, sautèrent dedans. Je sombrai à nouveau — le sommeil ou le coma ayant raison de moi.
J'éprouvai des sensations assez particulières, car j'eus soudainement l'impression d'un balancement et puis, d'une cessation de mouvement. Au bout de cinq jours — je l'appris plus tard — je regagnai le Monde des Vivants et me retrouvai dans un taudis impeccablement propre, habité par un prêtre Bouddhiste. Il m'avait attendu, me dit-il de façon hésitante, car nos langues étaient semblables mais cependant différentes et il nous était difficile de communiquer.
Le prêtre était un vieil homme et il avait fait des rêves (c'est du moins ainsi qu'il les appelait) l'enjoignant de rester là pour prêter assistance à ‘un Grand qui viendrait de très loin’. Il était près de la mort due à la famine et à l'âge. Il était tellement sous-alimenté que son visage jaune brunâtre paraissait transparent, mais la nourriture fut obtenue de quelque part et je repris des forces au bout de plusieurs jours. Finalement, quand je songeai qu'il me fallait reprendre ma route au long du chemin de la vie, je m'éveillai un matin trouvant le vieux moine assis près de moi jambes croisées — mais mort. Le corps était complètement froid ; il avait donc dû mourir au début de la nuit.
J'appelai quelques personnes du petit hameau où il vivait ; nous creusâmes une tombe et l'enterrâmes avec tout le cérémonial Bouddhiste.
Cette tâche accomplie, je pris la route emportant avec moi les quelques provisions restantes.
Marcher était atroce. Je devais être beaucoup plus faible que je ne le pensais, parce que je me suis retrouvé malade et étourdi. Mais il ne pouvait être question de revenir en arrière. J'ignorais tout de ce qui se passait. Je ne savais pas qui était un ennemi ou qui était un ami, sans compter que je n'avais pas eu beaucoup d'amis dans ma vie. Aussi, je me hâtai.
Après une marche interminable, j'arrivai à une frontière. Des hommes armés se tenaient près du poste frontalier, et je reconnus leurs uniformes d'après des images que j'avais vues ; c'étaient des Russes. Je compris alors que j'étais sur la route conduisant à Vladivostok, un des grands ports de l'extrême Est de la Russie.
Les gardes, en me voyant, lâchèrent leurs énormes chiens mastiffs, et ils arrivèrent sur moi en grondant et bavant, mais alors, à la stupéfaction des gardes, ils sautèrent sur moi avec affection, ayant compris que nous étions des amis. On ne leur avait jamais auparavant parlé télépathiquement, et je suppose qu'ils me prirent pour un des leurs. De toute façon, ils m'accueillirent avec des bonds et des aboiements de joie. Les gardes en furent extrêmement impressionnés, ils crurent que je devais être l'un d'eux, et m'emmenèrent dans leur quartier prendre quelque nourriture. Je leur expliquai que j'avais échappé aux Japonais, et comme ils étaient également en guerre avec ceux-ci, je devenais automatiquement ‘de leur côté’.
Le lendemain, ils m'offrirent de me conduire à Vladivostok pour que je m'occupe des chiens qu'on ramenait à la ville, vu qu'ils étaient trop féroces pour les gardes. J'acceptai l'offre avec plaisir, et les chiens et moi fûmes installés à l'arrière du camion. Après un voyage plutôt cahoteux, nous arrivâmes à Vladivostok.
J'étais à nouveau livré à moi-même, mais comme je m'apprêtais à sortir de la salle des gardes à Vladivostok, un bruit formidable de cris perçants, de hurlements, et d'aboiements furieux fendit l'air. Quelques-uns des chiens qu'on gardait dans un grand bâtiment furent soudainement affligés de la soif du sang et attaquèrent les gardes qui essayaient de les contrôler. Un Capitaine, auquel on avait raconté l'incident de la frontière, m'ordonna de venir les maîtriser. Par chance, j'arrivai à reprendre le contrôle, et usant avec eux de télépathie, je leur fis comprendre que j'étais leur ami et qu'ils devaient se tenir tranquilles.
On me garda dans ce camp pendant un mois, tandis qu'on entraînait de nouveau les chiens, et le mois une fois écoulé, on me permit de repartir.
Ma tâche était maintenant de satisfaire ce terrible besoin que j'avais d'aller de l'avant, de l'avant. Pendant quelques jours, je m'attardai à Vladivostok, me demandant comment je pourrais bien atteindre la ville principale, Moscou. Je finis par apprendre qu'il existait le Transsibérien, mais que l'un des dangers était que beaucoup d'évadés essayant d'aller à Moscou, sur une grande distance des gardes étaient cachés dans des fossés d'où ils pouvaient voir sous les trains, tuant ceux qui s'y accrochaient.
Finalement, un des hommes de la patrouille de Vladivostok, que j'avais vu pendant tout le mois, me montra comment déjouer l'attention des gardes, et c'est ainsi que je me rendis à Voroshilov, où il n'y avait pas de contrôle sur le chemin de fer. J'emportai avec moi quelques provisions dans un sac à dos et m'installai à l'affût pour attendre le train approprié. Finalement, ayant réussi à approcher du train, je me couchai entre les roues, en fait je m'attachai sous le plancher du wagon afin d'être assez haut au-dessus des essieux et caché par les boîtes de graisse. Le train s'ébranla et pendant à peu près six milles (10 km), j'endurai d'être maintenu par des cordes jusqu'à ce que je décidai qu'il n'y avait plus de danger à grimper dans un des wagons. Il faisait sombre, très sombre, la lune n'étant pas levée. Avec un extrême effort, je parvins à faire glisser l'une des portes coulissantes du wagon et à grimper péniblement à l'intérieur.
Quelque quatre semaines plus tard, le train arrivait à Noginsk, une petite localité située à une quarantaine de milles (64 km) de Moscou. Pensant que c'était le meilleur endroit pour quitter le train, j'attendis une courbe où il ralentirait et me laissai tomber sur le sol gelé.
Je marchai sans arrêt, bouleversé par le spectacle de cadavres tout au long de la route, les cadavres de gens qui étaient morts de faim. Un vieil homme, chancelant devant moi, s'effondra sur le sol. Instinctivement j'étais sur le point de me pencher pour voir si je pouvais lui être de quelque secours, quand une voix murmura près de moi :
— Arrête, Camarade ! Si tu te penches sur lui, la police te prendra pour un pillard et tirera sur toi. Continue ton chemin !
J'atteignis enfin le centre de Moscou et m'attardai à regarder le Monument de Lénine, quand je fus soudain jeté au sol, frappé par la crosse d'un fusil. Des gardes soviétiques se tenaient au-dessus de moi et ne cessaient de me frapper à coups de pied pour me faire me lever. Ils me questionnaient, mais avec un accent si ‘pointu’, que j'étais totalement incapable de les comprendre et, finalement, encadré de deux gardes et d'un troisième qui me pointait un énorme revolver dans la colonne vertébrale, je fus conduit dans un bâtiment lugubre et l'on me jeta dans une petite pièce. L'interrogatoire y fut assez brutal et je crus comprendre qu'à Moscou où l'on craignait l'espionnage, on me prenait pour quelque espion essayant de pénétrer dans le Kremlin !
Après plusieurs heures passées debout dans un réduit de la grandeur d'une armoire à balais, une voiture m'emmena à la Prison de la Lubianka. C'est la pire prison de la Russie, c'est la prison des tortures, la prison de la mort, une prison avec son propre four crématoire afin de faire disparaître toute évidence de corps mutilés.
À l'entrée de la Lubianka, ou dans un petit vestibule, je dus retirer mes chaussures et aller pieds nus. Les gardes enfilèrent sur leurs bottes d'épaisses chaussettes de laine et m'emmenèrent dans un silence de mort tout au long d'un couloir obscur, un couloir qui me parut avoir des milles (km) de long. Il n'y avait pas le moindre son.
Une sorte de sifflement — puis les gardes me poussèrent la face contre le mur et me couvrirent la tête afin de me plonger dans l'obscurité. Je sentis, ou plus exactement j'eus le sentiment, que quelqu'un passait à mon côté, et après quelques minutes on arracha brusquement le tissu dont on m'avait recouvert la tête, et de nouveau on me poussa en avant.
Après un temps qui me parut interminable, une porte s'ouvrit dans un silence absolu et je reçus une très violente poussée dans le dos. Je trébuchai et tombai. Il y avait trois marches que je ne pus voir dans l'obscurité profonde de la cellule ; je m'écrasai à terre, inconscient.
Le temps passait avec une incroyable lenteur. Par intervalles, j'entendais des cris perçants déchirer l'air, puis s'éteindre et finir dans une sorte de gargouillement.
Un peu plus tard, des gardes entrèrent dans ma cellule. Ils me firent signe de les suivre. Comme je tentais de parler, on me frappa au visage, et un autre garde mit le doigt sur ses lèvres pour signifier dans le langage universel : ‘Pas un mot’ ! Conduit de nouveau au long de ces interminables corridors, je me trouvai finalement dans une chambre d'interrogatoire brillamment éclairée. Ici, les interrogateurs se relayaient, posant les mêmes questions à maintes et maintes reprises, et mon histoire ne variant pas, des instructions spéciales furent données à deux des gardes : celles de me faire faire un tour abrégé de la Lubianka. On m'emmena le long des corridors et on me montra des chambres de torture où de pauvres hères subissaient les tortures des damnés, tant hommes que femmes. Je dus assister à certaines — véritables performances bestiales que je tairai, sachant que les Occidentaux se refuseraient à me croire.
On m'introduisit dans une salle en pierre où il y avait ce qui me parut être des stalles. Elles s'étendaient à environ 3 pieds (1 m) d'un mur de pierre blanc, et les gardes me montrèrent comment un homme ou une femme étaient poussés, nus, dans l'une d'elles, les mains sur le mur d'en face. Le prisonnier recevait alors une balle dans la nuque, tombait par devant, et tout le sang s'écoulant dans un drain, cela n'occasionnait aucun dégât inutile.
Les prisonniers tués étaient dénudés, les Russes estimant inutile de gaspiller des vêtements qui pouvaient servir aux vivants.
De là, je fus précipité le long d'un autre corridor dans un endroit qui avait l'air d'un fournil. Je m'aperçus tout de suite que ce n'était pas un fournil, parce que des corps et des parties de corps y étaient incinérés. À mon arrivée, on était en train de retirer d'un four un squelette carbonisé que l'on jeta ensuite dans un grand broyeur qui tournait et pulvérisait le squelette avec un horrible crépitement. La poudre d'os, me fit-on comprendre, était envoyée aux fermiers comme engrais, tout comme l'étaient les cendres.
Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet de toutes les tortures que j'ai subies, et dirai simplement que je fus finalement traîné devant trois hauts fonctionnaires. Ils avaient devant eux des papiers attestant, dirent-ils, que j'avais aidé des gens influents à Vladivostok, et facilité l'évasion de la fille d'une autre personne, laquelle était prisonnière de guerre dans un camp Japonais. Pour ces raisons, me fut-il dit, je ne serais pas tué, mais envoyé à Stryj, en Pologne. Des troupes partaient de Russie pour se rendre là-bas et je partirais avec elles comme prisonnier, puis à Stryj, je serais déporté de Pologne aussi.
Finalement, après un très long délai, parce que j'étais vraiment trop malade pour être déplacé et que j'avais donc besoin de temps pour me rétablir — je fus remis à un Caporal, accompagné par deux soldats. On me fit marcher à travers les rues de Moscou jusqu'à la gare. Il faisait terriblement froid, un froid absolument glacial, et je ne reçus aucune espèce de nourriture, alors que mes gardes, l'un après l'autre, s'éloignaient pour aller se ravitailler.
Un important détachement de soldats Russes arriva à la gare, et le sergent annonça que les ordres étaient changés et que j'étais envoyé à Lvov (Ukraine — NdT). Je fus embarqué dans le train qui roula avec quantité de sauts et soubresauts, pour finir par arriver à la ville de Kiev (Capitale de l'Ukraine — NdT).
Là, je montai avec des soldats dans un véhicule de transport de troupes, ou, pour être plus exact, j'y fus entassé avec quarante soldats. Et le véhicule s'élança, mais notre conducteur roulant à toute vitesse ou étant trop inexpérimenté, finit par nous jeter contre un mur et ce fut l'explosion du véhicule qui prit feu suite au bris du réservoir d'essence. Je fus inconscient pendant un certain temps. Je finis par reprendre conscience au moment où on me transportait à l'hôpital. Là, je fus radiographié, et l'on me découvrit trois côtes cassées dont la pointe de l'une d'elles avait perforé mon poumon gauche. Mon bras gauche était cassé en deux endroits, et ma jambe gauche était encore une fois brisée au genou et à la cheville. L'extrémité cassée de la baïonnette d'un soldat avait pénétré mon épaule gauche, manquant de peu un endroit vital.
Je me réveillai de l'opération pour voir devant moi une grosse doctoresse qui me giflait pour essayer de me ranimer. Je vis que j'étais dans une salle avec quarante ou cinquante autres patients. La douleur était inimaginable et rien ne me fut donné pour la soulager ; j'oscillai pendant assez longtemps entre la vie et la mort.
Le vingt-deuxième jour de mon séjour à l'hôpital deux policiers entrèrent dans la salle, arrachèrent les couvertures de mon lit en vociférant :
— Allez, grouille-toi, t'es un déporté ! Tu devrais plus être ici depuis trois semaines !
Emmené à Lvov, on m'apprit que, pour me payer mes soins d'hôpital, je devrais travailler pendant un an à la réparation et la reconstruction des routes de Pologne. C'est ce que je fis pendant un mois, assis au bord de la route à casser des pierres, mais parce que mes blessures n'étaient pas suffisamment guéries, je m'effondrai en crachant le sang, etc., et emmené de nouveau à l'hôpital. Là, le docteur, estimant que j'allais mourir, refusa de me garder — sous le prétexte que si d'autres prisonniers venaient à mourir ce même mois, il aurait des ennuis, vu qu'il avait ‘dépassé son quota’.
C'est ainsi que je fus déporté et, encore une fois, devins un errant. Pour la première fois parmi tant d'autres on m'annonça que je n'avais que peu de temps à vivre, mais comme tant de fois depuis, je ne suis pas mort.
Marchant le long d'une route, je vis un homme très inquiet qui se tenait debout à côté d'une voiture en panne. Comme je m'y connaissais assez en moteurs de voitures et d'avions, je m'arrêtai et constatai que ce n'était rien de bien sérieux, rien qu'il ne m'était pas possible de réparer, du moins. Je réussis donc à la remettre en marche et il me fut si reconnaissant, qu'il m'offrit un travail. Maintenant, cela n'est pas si étrange qu'il n'y paraît, car cette voiture était passée à côté de moi quelques moments auparavant, quand nous avions traversé en même temps un pont enjambant une rivière, traversant juste là où étaient stationnés les gardes-frontière. Comme il était arrêté depuis longtemps, je supposai que le conducteur observait les piétons en se demandant ce qu'ils faisaient, où ils allaient — n'importe quoi pour faire passer le temps. Je franchis la frontière très rapidement — la seule fois de ma vie que cela m'arriva ! Ainsi donc, il m'offrit un travail et je vis, à son Aura, que c'était un homme raisonnablement honnête, c'est-à-dire aussi honnête qu'il pouvait se permettre de l'être. Il me dit qu'il avait besoin de faire livrer des voitures à différents endroits, et j'acceptai donc son offre, ce qui m'offrit une merveilleuse occasion de voir l'Europe.
Il connaissait très bien l'endroit et il avait des ‘contacts’. Il regarda mes papiers et frémit en les voyant, me disant qu'avec ces papiers portant le cachet ‘Déporté’, je ne pouvais guère aller nulle part, si ce n'est en prison. Me laissant pour un temps au bord de la route, il revint et m'emmena en un lieu — dont je tairai le nom — où l'on me donna de nouveaux papiers, un faux passeport, et tous les autres papiers de voyage nécessaires.
Ainsi donc, je conduisis pour lui. Il semblait avoir peur de conduire et c'était une chance pour moi que ce soit le cas. Je conduisis jusqu'à Bratislava (Capitale de la Slovaquie — NdT) puis à Vienne (Autriche — NdT). Vienne, je pus me rendre compte, avait vraiment dû être une ville merveilleuse, mais elle était maintenant durement frappée par les conséquences de la guerre. Nous y restâmes deux ou trois jours et je parcourus la ville autant que je le pus, malgré que ce ne fut pas facile parce que les gens se méfiaient excessivement des étrangers. Assez souvent, quelqu'un approchait un policier et débutait une conversation chuchotée ; alors le policier, après s'être assuré que son arme à feu était en ordre, venait à ma rencontre en disant : ‘Vos papiers’ ! Cela me permit de constater que mes papiers avaient l'air vraiment ‘authentiques’, car je n'eus jamais à répondre à aucune question.
De Vienne nous allâmes à Klagenfurt (Autriche — NdT). Il n'y eut à cet endroit qu'un léger retard ; j'attendis environ huit heures et devins complètement gelé sous une pluie glaciale persistante. J'avais aussi grand faim parce que les denrées étaient rationnées et je ne possédais pas la bonne sorte de coupons. Mais la faim était une chose à laquelle j'étais bien habitué, et donc, je la supportai.
Roulant de nuit, nous arrivâmes en Italie et nous rendîmes à Venise. Je dus, à mon grand regret, y passer dix jours, dix jours sans joie car je suis doué, ou affligé, d'un odorat absolument exceptionnel et, comme probablement tout le monde le sait, les canaux de Venise sont des égouts à ciel ouvert. Après tout, comment pouvez-vous avoir des égouts fermés quand le damné endroit tout entier est inondé ? Ce n'était certes pas un lieu où nager !
Les dix jours s'étiraient lentement. L'endroit me parut déborder d'Américains pleins d'argent et d'alcool. C'était un spectacle journalier que celui d'Américains exhibant une énorme liasse de billets qui aurait permis à la plupart des Italiens de vivre pendant un an. Ils étaient, me suis-je laissé dire, des déserteurs de l'armée ou de l'aviation américaines et faisaient fortune au marché noir.
De Venise, nous allâmes à Padoue (Italie — NdT), un endroit riche en histoire et imprégné du passé. J'y restai une semaine, mon employeur semblant y avoir beaucoup d'affaires à traiter, et il m'ahurit par son aisance à ramasser les filles, tout comme d'autres cueillent des fleurs sur le bord de la route ; sans doute en raison de l'importance de son compte en banque.
À Padoue, mon employeur dut soudain modifier ses plans et il vint me trouver pour m'en parler et me dire qu'il devait se rendre par avion en Tchécoslovaquie. Mais — un certain Américain désirait vraiment me rencontrer, un homme qui avait beaucoup entendu parler de moi, et je lui fus donc présenté. C'était un homme grand et costaud, avec de grosses lèvres épaisses, et qui était accompagné d'une petite amie qui ne semblait pas s'inquiéter d'être vêtue ou dévêtue. Il était lui aussi dans une affaire de voitures, camions et divers autres types de machines. Je conduisis pendant un temps, dans Padoue, un gros camion chargé de voitures officielles, certaines prises à de hauts dignitaires Nazis, et d'autres ayant appartenu à des dignitaires Fascistes décédés. Ces voitures — eh bien, je ne pouvais pas comprendre au juste ce qui leur arrivait, mais elles semblaient être exportées aux États-Unis où elles atteignaient des prix fabuleux.
Mon nouvel employeur, l'Américain, désirait que je livre une voiture spéciale en Suisse et une autre ensuite en Allemagne, mais, comme je le lui expliquai, mes papiers n'étaient pas assez valables pour cela. Il balaya de la main mes arguments, puis il me dit :
— Bon sang, j'ai exactement ce qu'il te faut ; je sais ce que nous pouvons faire. Il y a deux jours, un Américain, qui conduisait complètement ivre, est allé s'écraser contre un pilier de béton et on l'a retrouvé en charpie. Mes hommes ont eu le temps de prendre ses papiers avant qu'ils ne soient maculés de sang : les voici.
Il se tourna, fouilla dans sa grande serviette bourrée et en sortit un tas de papiers. Je fus immédiatement sur le qui-vive en voyant qu'il s'agissait des papiers d'un homme qui occupait le poste de Deuxième Mécanicien sur un navire. Tout y était : passeport, carte du Syndicat de la Marine, permis de travail, argent — tout. Une seule chose ne collait pas : la photographie.
L'Américain se mit à rire comme s'il n'allait jamais s'arrêter, et dit :
— La photo ? Viens avec moi, et nous allons arranger ça immédiatement !
Il me poussa hors de la chambre d'hôtel et nous nous rendîmes dans un drôle d'endroit où il fallait descendre une quantité de marches en serpentant. Il y eut des coups secrets à la porte et une sorte de mot de passe, puis nous fûmes admis dans une pièce sordide où un groupe d'hommes y fainéantaient. Un coup d'œil me suffit pour comprendre que c'était des faux-monnayeurs, bien que je ne puisse pas dire quelle sorte d'argent ils falsifiaient, mais je n'étais pas là pour cela. Le problème leur fut expliqué, ma photo fut prise sans tarder, ma signature également, et nous fûmes conduits hors de l'endroit.
Le lendemain soir, on frappait à la porte de ma chambre, et un homme entra avec mes papiers. Je les examinai et je pouvais vraiment croire que je les avais signés et avais rempli tous les détails de ma propre main, tellement ils étaient parfaits. Je pensai en moi-même : "Bien, maintenant que j'ai tous ces papiers, je devrais pouvoir monter à bord d'un bateau quelque part, être engagé comme Mécanicien et me rendre aux États-Unis. C'est là où il faut que je sois, aux États-Unis, aussi vais-je faire ce que me demande cet Américain dans l'espoir que ce travail m'amènera un jour dans un grand port."
Mon employeur était si enchanté de mon changement d'attitude que la première chose qu'il fit fut de me donner une importante somme d'argent et de me confier une voiture Mercedes, une voiture vraiment très puissante, que je conduisis en Suisse. Je passai les Douanes et l'Immigration sans aucun problème. Je changeai ensuite de voiture à une adresse spéciale et continuai jusqu'en Allemagne, à Karlsruhe, où l'on me dit que je devais aller à Ludwigshafen (Allemagne — NdT). Je m'y rendis et fus surpris d'y retrouver mon employeur Américain. Il était ravi de me voir parce que ses contacts en Suisse lui avaient rapporté que la Mercedes avait été livrée sans une égratignure.
Je restai en Allemagne pendant trois mois, un peu plus de trois mois, en fait. J'y conduisis différentes voitures en divers lieux, et franchement, cela n'avait simplement pas de sens pour moi, je ne comprenais pas pourquoi je conduisais ces voitures. Mais j'avais beaucoup de temps libre et j'en profitai pour me procurer des livres et étudier les moteurs marins et les fonctions d'un Mécanicien de bateaux. Je me rendis dans les Musées Maritimes où je vis nombre de modèles de bateaux et de moteurs de bateaux, et au bout de ces trois mois, je me sentis tout à fait confiant de pouvoir appliquer mes connaissances mécaniques en mécanique navale aussi.
Un jour, mon patron m'emmena avec lui sur un aéroport désert et s'arrêta devant un hangar désaffecté. Des hommes se précipitèrent pour en ouvrir les portes et je me trouvai devant une espèce de chose baroque à huit roues, qui semblait tout en croisillons de métal jaune, avec une pelle vraiment immense à une extrémité. Perchée à l'autre extrémité, il y avait une petite cabine vitrée, le compartiment du conducteur.
— Peux-tu conduire cette chose à Verdun (France — NdT) ? me demanda mon employeur.
— Je ne vois rien qui s'y oppose, répondis-je. Elle a un moteur et des roues, alors ce devrait être possible.
Un des mécaniciens me montra comment mettre le moteur en marche et comment la faire fonctionner, et je me pratiquai à la conduire de long en large sur les pistes d'atterrissage désaffectées. Un policier zélé se précipita sur le terrain et annonça que la chose ne pouvait circuler que la nuit et qu'elle devait avoir un homme à l'arrière pour surveiller la circulation routière. Je pratiquai donc pendant qu'on cherchait un autre homme. Puis, quand je fus persuadé de savoir comment faire avancer la machine et, plus important encore, comment l'arrêter, mon surveillant et moi prîmes la route pour Verdun. Nous ne pouvions conduire que de nuit à cause des règlements routiers allemands et français, et à une vitesse n'excédant pas vingt milles (32 km) à l'heure ; ce fut vraiment un lent parcours. J'eus le temps de regarder le paysage. Je vis la campagne rasée, les épaves brûlées de chars, d'avions et de fusils ; je vis les maisons en ruine dont certaines n'avaient plus qu'un pan de mur debout. "La guerre, pensai-je, quelle chose étrange que des humains traitent ainsi d'autres humains. Si seulement les gens obéissaient à nos lois, il n'y aurait pas de guerre. Notre loi : ‘Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent’, est une loi qui empêcherait efficacement les guerres."
Cependant, je vis également de très agréables paysages ; mais je n'étais pas payé pour admirer le paysage, j'étais payé pour conduire sans dommage ce gros engin cliquetant à Verdun.
Nous arrivâmes enfin dans cette ville et, de bonne heure le matin, avant que la circulation ne soit importante, je me dirigeai vers un immense chantier de construction où l'on nous attendait. Là, un Français à l'air sinistre qui semblait plus ou moins ringard, se précipita vers moi en disant :
— Maintenant, emmenez-moi cette chose à Metz (France — NdT) !
— Non, répliquai-je, j'ai été payé pour l'amener ici, et je n'irai pas plus loin !
À ma stupéfaction horrifiée il sortit un de ces terribles couteaux à ressort — en pressant le bouton la lame jaillit et se verrouille en place. Il se jeta sur moi avec ce couteau, mais j'avais été bien entraîné ; je n'allais pas me laisser poignarder par un Français, et d'une passe de karaté je l'envoyai au tapis avec un horrible fracas, le couteau voltigeant dans l'air. Pendant un terrible moment il resta là, sonné, puis avec un hurlement de rage il sauta sur ses pieds si rapidement que ceux-ci se mirent en mouvement avant même de toucher le sol, et il se précipita dans un atelier pour en ressortir avec une barre de fer de 3 pieds (1 m) utilisée pour ouvrir des caisses. Il se jeta sur moi en essayant de l'abattre sur mes épaules. Je me laissai tomber à genoux et attrapai une de ses jambes en la tordant. Je la tordis un peu plus fort que prévu, car sa jambe se cassa au genou avec un grand bruit sec.
Eh bien, je m'attendais à ce que la police m'arrête, mais, tout au contraire, j'eus la surprise de me voir applaudir par les employés de l'homme en question, puis, quand arriva une voiture de police avec des policiers à l'air vraiment sombre et qu'on leur expliqua ce qui était arrivé, ils se joignirent aux applaudissements et, à mon grand étonnement, m'emmenèrent prendre un bon repas !
Après le repas, ils me trouvèrent un hébergement et c'est là que j'eus alors la visite d'un homme qui me dit être bien informé à mon sujet et me demandait si je voulais un autre travail. Oui, bien sûr, et c'est ainsi qu'il me conduisit à un café où se trouvaient deux vieilles dames qui de toute évidence m'attendaient. Elles étaient terriblement âgées et terriblement autocratiques, et m'adressaient la parole avec des ‘mon homme’, jusqu'à ce que je leur dise que je n'étais pas leur homme, et qu'en fait je ne voulais rien avoir à faire avec elles. C'est alors que l'une d'elles éclata de rire en me disant qu'elle admirait réellement un homme de caractère.
Elles désiraient que je les conduise à Paris dans une voiture toute neuve. Eh bien, cela me convenait parfaitement puisque je voulais aller à Paris, et c'est ainsi que je leur donnai mon accord pour les y conduire, bien qu'elles aient mis comme condition de ne pas excéder trente-cinq milles (55 km) à l'heure. Ce n'était pas un problème pour moi ; je revenais tout juste de Ludwigshafen à vingt milles (30 km) à l'heure !
Je les amenai à bon port et elles me payèrent très bien pour le voyage, me firent beaucoup de compliments sur ma conduite, m'offrant même de demeurer à leur service, me disant qu'elles aimeraient avoir un homme de caractère comme chauffeur, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais. Ma tâche n'était pas encore accomplie, et je n'avais pas la moindre envie de conduire de vieilles dames ici et là à trente-cinq milles (55 km) à l'heure. Je refusai donc leur offre et les quittai pour trouver un autre travail.
Les gens chez qui je laissai la voiture des vieilles dames me suggérèrent un endroit où je pourrais trouver à me loger et je m'y retrouvai en même temps qu'une ambulance y arrivait. Je me tins à l'écart en attendant la fin de l'agitation et demandai à un homme ce qui s'était produit. Il me raconta qu'un homme qui avait un important travail de transport de meubles à faire à Caen (France — NdT) venait de tomber et de se fracturer une jambe et qu'il était très inquiet parce qu'il allait perdre son emploi s'il ne pouvait pas s'y rendre ou encore se trouver un remplaçant. Au moment où on l'emportait sur une civière, je m'empressai de le rejoindre pour lui dire que je pouvais faire le travail à sa place. Les ambulanciers firent halte un instant pendant que nous parlâmes. Je lui dis que je voulais me rendre dans cette ville et que s'il pouvait arranger l'affaire, il pourrait être payé pour le voyage et que je m'occuperais seulement du transport. Il était fou de joie malgré la douleur de sa jambe, et me dit qu'il m'enverrait un message de l'hôpital. Sur ce, il fut chargé dans l'ambulance et emmené.
Je réservai une chambre dans une pension de famille, et plus tard ce soir-là un ami du déménageur vint me voir pour me dire que le travail était à moi si j'étais prêt à aller à Caen et à aider à décharger les meubles, puis à charger un nouveau lot. L'homme, me dit-il, avait accepté l'offre que je lui avais faite de prendre l'argent et moi le travail !
Dès le lendemain, donc, il me fallut repartir. Nous dûmes nous rendre à l'une des grandes maisons de Paris et charger un grand camion de déménagement. C'est ce que nous fîmes — le jardiner de la propriété et moi — parce que le chauffeur était trop paresseux. Il trouva excuse après excuse pour se défiler. Finalement, le grand camion fut chargé et nous repartîmes. Après avoir fait environ un mille (1,6 km), ou moins, le chauffeur s'arrêta et me dit : "Tu prends le volant à partir d'ici ; j'ai besoin de dormir". Nous changeâmes de positions, et je conduisis toute la nuit. Nous arrivâmes à Caen au matin et nous rendîmes à la propriété où les meubles et les bagages devaient être déchargés. Encore une fois, un employé de la maison et moi déchargeâmes le tout parce que le conducteur dit devoir aller ailleurs pour affaires.
En fin d'après-midi, quand tout le travail fut fait, le chauffeur réapparu en annonçant : "Partons. Il nous faut encore aller prendre une nouvelle charge". Je pris le volant et conduisis jusqu'à la gare principale. Là, je ramassai mes affaires, sautai à terre, et dis au conducteur : "Je me suis tapé tout le travail ; à ton tour maintenant pour changer !" Sur ce, j'entrai dans la gare et pris un billet pour Cherbourg (France — NdT).
Arrivé dans cette ville, je rôdai un peu aux alentours et pris finalement une chambre au Logement des Marins, dans le quartier des docks. Je fis de mon mieux pour rencontrer autant de Mécaniciens de bateaux que possible et de leur être agréable, et c'est ainsi qu'avec un peu d'insistance j'eus l'opportunité de voir les chambres des machines à bord de leurs navires, et j'appris de très nombreuses astuces et indications que l'on ne peut pas facilement obtenir dans des manuels.
Jour après jour, je me présentai chez les agents maritimes en montrant ‘mes’ papiers, essayant d'obtenir une place comme mécanicien en second sur un bateau allant aux États-Unis. Je leur racontai que, venu en vacances en Europe, je m'étais fait voler mon argent et qu'il me fallait maintenant travailler pour rentrer. Je reçus de nombreuses marques de sympathie et, finalement, un bon vieux Mécanicien Écossais s'offrit à me prendre comme troisième Mécanicien à bord d'un bateau en partance la nuit même pour New York.
Je montai à bord avec lui, et nous descendîmes les échelles de fer jusqu'à la salle des machines. Il me posa alors plusieurs questions sur le fonctionnement des moteurs et sur la tenue des registres et des quarts. Il exprima finalement son entière satisfaction et me dit :
— Montons à la cabine du Capitaine pour signer le contrat d'engagement.
C'est ce que nous fîmes et le Capitaine du bateau me parut du genre plutôt morose ; il ne me plut pas du tout et je ne lui plus pas davantage, mais nous signâmes l'engagement et le Premier Mécanicien me dit ensuite :
— Va chercher ton bagage, tu prends le premier quart, nous levons l'ancre ce soir.
L'affaire était réglée. Et c'est ainsi que, fort probablement pour la première fois dans l'histoire, un lama du Tibet — et un lama médecin en plus — se faisant passer pour un citoyen Américain, servait sur un navire Américain en qualité de Troisième Mécanicien.
Je fus de service pendant huit heures dans la salle des machines. Le Second n'était pas de service et le Premier Mécanicien était occupé par un certain travail en rapport avec le départ. Je dus assurer ma tâche sans prendre le temps de manger, ni de me mettre en uniforme. Mais je bénis le fait d'être de service alors que nous étions au port. Ce fut pour moi l'occasion de pouvoir connaître les lieux, examiner les contrôles, et donc, au lieu d'être mécontent de la situation comme le Chef s'y attendait, j'en étais vraiment très satisfait.
Au bout de huit heures, le Chef Mécanicien descendit bruyamment l'échelle de fer et vint me relever officiellement, me conseillant d'aller prendre un bon repas parce que, me dit-il, j'avais l'air affamé, et de ne pas oublier de dire au cuisinier de lui apporter une tasse de cacao.
Ce n'était en aucune façon un bateau agréable. Le Capitaine et son Second croyaient commander un grand liner au lieu d'un vieux steamer cabossé, insistaient sur l'uniforme, insistaient sur l'inspection des cabines, chose inhabituelle à bord d'un bateau. Non, ce n'était vraiment pas un bateau agréable, mais nous traçâmes notre route à travers l'Atlantique, roulant et tanguant dans le rude temps de l'Atlantique Nord. Finalement, nous atteignîmes le bateau-phare à l'approche du port de New York.
C'était le petit matin et les tours de Manhattan semblaient rendues incandescentes par la lumière reflétée. Je n'avais jamais rien vu de pareil auparavant. En arrivant par la mer, les tours se dressaient comme quelque chose sortie d'une imagination fiévreuse. Nous descendîmes le fleuve Hudson, puis passâmes sous un grand pont. C'est de là que je vis la fameuse Statue de la Liberté qui, à mon grand étonnement, tournait le dos à New York, tournait le dos aux États-Unis. J'en fus choqué. Sûrement, pensai-je, si l'Amérique acceptait tout le monde, la liberté devait alors se trouver sur son territoire.
Nous atteignîmes notre poste d'amarrage après nous être faits beaucoup pousser et traîner par de petits remorqueurs avec un gros ‘M’ sur la cheminée. Puis il y eut le rugissement des moteurs, de grands camions arrivèrent, les grues commencèrent leur travail, tandis qu'une équipe côtière montait à bord. Le Chef Mécanicien me pressa vivement de signer pour un autre voyage, me promettant de faire de moi son Second. Mais je refusai, lui disant que j'en avais assez de ce navire et de certains de ses officiers de pont qui avaient vraiment été des types désagréables.
Nous nous rendîmes au bureau de navigation pour signer ma démission, et le Chef Mécanicien me donna une remarquable lettre de recommandation qui disait que j'avais montré un grand dévouement à mon devoir, que j'étais compétent dans toutes les branches de travail de la salle de machines, et il ajoutait une note spéciale qui m'invitait à signer de nouveau avec lui n'importe quand, sur n'importe quel bateau, parce que, écrivait-il, j'étais un ‘grand compagnon de bord’.
Le cœur en joie d'un tel adieu du Chef Mécanicien et transportant mes lourdes valises, je quittai les docks. Le vacarme de la circulation était terrible, les cris des gens s'ajoutaient aux cris des policiers, et l'endroit tout entier me donna l'impression d'être dément. Je me rendis dans ce qu'on pourrait appeler une auberge à matelots. Là non plus, pas le moindre signe d'hospitalité, rien d'amical ; en fait, de façon normalement polie, je remerciai l'homme qui me tendait la clef de ma chambre, et il me répliqua hargneusement :
— Pas besoin de me remercier. Je fais mon boulot, c'est tout.
Vingt-quatre heures était la limite que l'on pouvait rester dans cette auberge, quarante-huit si l'on s'embarquait sur un autre bateau. Le lendemain, je repris donc encore une fois mes valises, pris l'ascenseur, payai le réceptionniste revêche, et me retrouvai dans la rue.
Je marchai le long de la rue avec grande circonspection parce que, franchement, j'étais absolument terrifié par la circulation. Mais il se produisit alors un terrible tumulte, les voitures se mirent à klaxonner, un policier à faire retentir son sifflet, et c'est à ce moment-là qu'une énorme forme monta sur le trottoir, me frappa et me renversa. Je sentis la rupture de mes os. Une voiture conduite par un homme sous l'influence de l'alcool avait descendu une rue à sens unique, et dans une dernière tentative d'éviter une collision avec une camionnette de livraison, était monté sur le trottoir et m'avait renversé.
Je repris conscience bien plus tard pour me retrouver à l'hôpital. J'avais le bras gauche cassé, quatre côtes fracturées, et les deux pieds écrasés. La police arriva dans le but d'en savoir autant que possible au sujet du conducteur de la voiture — comme si j'avais été son ami intime ! Je les questionnai au sujet de mes deux valises et ils me répondirent avec entrain :
— Oh mais, aussitôt que vous avez été renversé, avant même que la police n'arrive sur les lieux, un gars est sorti d'une embrasure, a saisi vos valises et s'est enfui en courant. Nous n'avons pas pris le temps de le poursuivre vu qu'il fallait vous enlever du trottoir parce que vous entraviez le chemin.
Ma vie à l'hôpital fut compliquée. Suite aux fractures de mes côtes, je contractai une double pneumonie et j'y restai pendant neuf semaines, me rétablissant vraiment très lentement. L'air de New York n'était pas du tout comme celui auquel j'étais habitué, et tout le monde gardait toutes les fenêtres fermées et le chauffage allumé. Je pensai réellement que j'allais mourir de suffocation.
Je finis par me rétablir suffisamment pour me lever. Après neuf semaines au lit, je me sentais terriblement faible. C'est alors qu'une certaine employée de l'hôpital vint me trouver pour me parler de paiement ! Elle me dit :
— Nous avons trouvé 260 $ dans votre portefeuille et nous avons dû en garder deux cent cinquante pour votre séjour ici. La loi nous oblige à vous laisser dix dollars, mais il vous faudra payer le reste.
Sur ce, elle me présenta une facture de plus de mille dollars.
J'en fus très choqué et me plaignis à un homme qui se présenta après elle, un homme qui me parut être un quelconque supérieur. En haussant les épaules il me dit :
— Oh, eh bien, intentez un procès à l'homme qui vous a renversé. C'est une affaire qui ne nous regarde pas.
C'était pour moi le comble de l'absurdité, car comment pouvais-je retrouver l'homme en question quand je n'avais même pas pu le voir ? Et comme je lui disais que j'avais de l'argent dans mes valises, il me répliqua :
— Eh bien, attrapez l'homme et reprenez vos valises.
Attrapez l'homme... après neuf semaines à l'hôpital, et après que la police n'ait même pas pris la peine d'essayer de l'attraper. J'étais vraiment outré, mais j'allais l'être encore plus. L'homme — le supérieur — me présenta un papier en disant :
— Vous devez quitter l'hôpital maintenant puisque vous n'avez pas d'argent pour que l'on continue votre traitement. Nous n'avons pas les moyens de garder les étrangers ici, à moins qu'ils ne puissent payer. Signez ici !
Je le regardai en état de choc. J'étais là, le premier jour hors du lit depuis neuf semaines, après avoir eu les os brisés et une double pneumonie, et voilà que l'on m'obligeait à quitter l'hôpital. Pas la moindre sympathie, aucune compréhension, et tout au contraire j'étais littéralement — et je dis bien tout à fait littéralement — chassé de l'hôpital avec en tout et pour tout le costume que je portais et un billet de dix dollars.
Un homme dans la rue à qui j'expliquai mon problème leva brusquement le pouce pour m'indiquer la direction d'une agence de placement, et je m'y rendis après avoir monté de nombreux escaliers. Je finis par obtenir un emploi dans un hôtel extrêmement bien connu, un hôtel si connu qu'il n'y a à peu près personne au monde qui n'en a pas entendu parler. Le travail — laver la vaisselle ; le salaire — vingt dollars par semaine et un repas par jour, et ce seul repas ne se composait pas des bonnes choses servies aux clients, mais de ce que ces derniers avaient laissé, ou encore de ce qui ne pouvait pas leur être servi. Avec vingt dollars par semaine, je ne pouvais pas m'offrir une chambre — je n'y pensai même pas — et m'installai donc un peu partout, essayant de dormir dans une embrasure, essayant de dormir sous un pont ou sous une arche, un policier de nuit me poussant parfois son bâton dans les côtes, m'ordonnant en rugissant de me lever et de circuler.
Finalement, par un coup de chance, j'obtins un travail dans une station de radio. Je devins animateur de radio, parlant au monde entier sur les ondes courtes. C'est ce que je fis pendant six mois, et pendant ce temps-là j'obtins de Shanghaï mes documents et mes affaires que j'avais laissés là-bas chez des amis. Mes documents incluaient un passeport issu à la Concession Britannique par les autorités Britanniques.
Cependant, je commençai à sentir que je perdais mon temps comme présentateur de radio, j'avais une tâche à accomplir, et tout ce que je gagnais maintenant était cent dix dollars par semaine, ce qui était toutefois sans comparaison avec les vingt dollars par semaine et l'unique repas, mais je décidai de partir. Je donnai à la station de radio le temps nécessaire pour me trouver le remplaçant adéquat, et après lui avoir donné deux semaines de formation, je m'en allai.
Heureusement, grâce à une annonce demandant des gens pour conduire des voitures et à laquelle je répondis, j'eus la possibilité d'en conduire une qui m'amena jusqu'à Seattle. Il n'y a pas lieu de raconter ce voyage maintenant, mais je conduisis sans encombre jusqu'à Seattle et reçus une gratification pour avoir conduit prudemment et avoir livré la voiture sans une égratignure. Et ensuite — je réussis à me rendre au Canada.
Ainsi se termine le Second Livre,
le Livre de l'Ère Première.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LIVRE TROIS
Le Livre des Changements
"Ne laissez pas votre chagrin importuner
ceux qui ont quitté ce Monde de l'Homme."
"Ne nommez aucun nom, car nommer
ceux qui sont passés au-delà de cette sphère
c'est troubler leur paix."
"C'est ainsi que ceux qui sont pleurés
souffrent grandement des pleurs de ceux
qui les déplorent."
"Que la Paix règne."
. . . . . .
Cela relève d'ailleurs du Bon Sens,
la Loi de Diffamation étant ce qu'elle est !
C'est pourquoi je vous dis —
Les noms ne doivent pas être nommés.
PAX VOBISCUM.
Chapitre Sept
Il me semble inutile de raconter ici mon voyage à travers le Canada, traversant toutes les Rocheuses, Winnipeg, Thunder Bay, Montréal, et la ville de Québec. Des milliers de gens — des dizaines de milliers de gens — l'ont fait. Mais j'y ai eu certaines expériences assez inhabituelles au sujet desquelles je pourrais écrire, bien que ce ne sera pas pour le moment.
Durant mon voyage à travers le Canada, je réalisai que c'est en Angleterre que je devais me rendre. J'étais convaincu que la tâche qu'il me restait encore à accomplir devait commencer en Angleterre, ce petit endroit que j'avais vu seulement de loin, du hublot d'un bateau quittant Cherbourg et se dirigeant vers la Manche avant de se tourner vers les États-Unis.
À Québec, je me renseignai et je réussis à obtenir tous les documents nécessaires tels que passeport, permis de travail, et tout le reste. Je réussis également à obtenir une carte du Syndicat des Marins. Inutile, là encore, d'expliquer dans le détail comment j'ai obtenu ces choses. Dans le passé, j'ai déjà dit aux bureaucrates que leur stupide système de paperasserie ne servait qu'à étouffer les gens qui sont en possession légitime de tous leurs documents ; dans mon propre cas, je déclare catégoriquement que les seules fois où j'ai eu des difficultés pour entrer dans un pays furent lorsque mes papiers étaient en ordre. Ici au Canada, au temps où j'étais plus mobile et que je pouvais aller aux États-Unis, il y avait toujours des problèmes avec mes documents ; il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, quelque chose sur quoi l'agent d'Immigration ergotait. Les bureaucrates sont des parasites qui devraient être éliminés comme tels. Hey ! Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas ?
Je revins à Montréal et là, avec mes papiers parfaitement en règle je pus me faire engager comme matelot. Le salaire était maigre, mais pour moi il s'agissait d'aller en Angleterre, et comme je n'avais pas d'argent pour un billet, toute rémunération était mieux que d'avoir à débourser.
Le travail n'était pas trop dur, il s'agissait simplement de réarranger la cargaison et de la fixer en place avec des cales de retenue. Avant peu nous remontâmes la Manche et peu de temps après nous tournâmes dans le Solent en route vers Southampton. Comme je n'étais pas de service au moment où nous approchâmes de Southampton, je pus, assis à l'arrière du navire, admirer tout à loisir le paysage anglais, vert comme je n'avais rien vu d'aussi vert — je dois dire qu'à ce moment, je n'avais pas encore vu l'Irlande qui, pour ce qui est d'être verte, battrait l'Angleterre à tous les coups — et donc, j'étais tout à fait captivé.
L'Hôpital Militaire à Netley m'intrigua énormément. De notre point de vue sur l'eau, je pensai que ce devait être la résidence d'un roi ou de quelqu'un de ce statut, mais un membre de l'équipage rit à gorge déployée en m'expliquant que ce n'était qu'un hôpital.
Nous passâmes Woolston sur la droite, et Southampton à gauche. J'étais intéressé à aller voir à Woolston l'entreprise d'hydravions ‘Supermarine Aviation’ qui acquéraient une grande notoriété en Extrême-Orient.
Nous ne tardâmes pas à arriver à Southampton. Les autorités montèrent à bord, vérifièrent les papiers du bateau et examinèrent les quartiers de l'équipage. Enfin, l'autorisation fut donnée de quitter le bateau et je m'apprêtais à aller à terre quand on m'appela pour un nouveau contrôle d'Immigration. L'agent regarda mes documents et se fit très amical et approbateur quand, en réponse à sa question : "Combien de temps comptez-vous rester ?", je lui répondis : "Je vais vivre ici, monsieur." Il apposa les cachets nécessaires sur mon passeport et me donna des indications pour les logements des marins.
Je sortis du service d'Immigration et restai un moment à contempler une dernière fois le vieux cargo qui m'avait amené du Nouveau Monde à l'Ancien. Un agent des Douanes s'avançait, un sourire aux lèvres, quand soudain je reçus un formidable coup dans le dos qui me projeta contre un mur tout en me faisant échapper mes deux valises.
Reprenant mes esprits, je me retournai et vis un homme assis à mes pieds. Il s'agissait d'un cadre supérieur aux Douanes qui, s'empressant d'arriver au travail, avait mal calculé sa distance en essayant d'atteindre la porte. Je l'approchai pour tenter de l'aider à se relever, mais il frappa mes mains tendues avec une furie haineuse. Je reculai, complètement stupéfié, l'accident n'étant pas de ma faute, je me tenais là de façon parfaitement inoffensive. Je repris mes valises pour continuer mon chemin, quand il poussa un hurlement pour que je m'arrête. Il appela deux gardes pour me saisir. L'agent des Douanes que j'avais vu dans le bureau se précipita en disant :
— Tout va bien, monsieur, tout va bien. Ses documents sont en règle.
Le visage du haut fonctionnaire sembla devenir noir de rage, et personne ne pouvait placer un mot. Sur son ordre, je fus emmené dans une pièce où l'on ouvrit mes valises et tout leur contenu jeté au sol. Il n'y trouva rien d'anormal. Il demanda donc mon passeport et mes autres documents. Je les lui donnai, il les feuilleta, puis lança d'une voix rageuse que j'avais un visa et un permis de travail et que je n'avais pas besoin des deux. Sur ce, il déchira mon passeport de part en part et le jeta dans la poubelle.
Soudainement, il se pencha, ramassa tous les papiers et les fourra dans sa poche pour pouvoir, je suppose, les faire disparaître ailleurs.
Il sonna une cloche et deux hommes arrivèrent d'un bureau externe.
— Cet homme n'a pas de papiers, dit le haut fonctionnaire, il devra être déporté...
— Mais, répondit l'officier qui avait apposé les cachets sur mes documents, je les ai vus, je les ai estampillés moi-même.
Le supérieur se tourna vers lui, enragé, et lui dit des choses si terribles que le pauvre homme en pâlit. Et ainsi, je fus finalement emmené dans une cellule et laissé là.
Le lendemain, un jeune idiot minaudant du Ministère des Affaires Étrangères arriva, caressa sa face de bébé et fut d'accord avec le fait que j'avais dû avoir les documents nécessaires. Mais, dit-il, le Ministère des Affaires Étrangères ne pouvait se permettre d'avoir des démêlés avec le Service d'Immigration, et ils allaient donc devoir me sacrifier. La meilleure chose à faire, me dit-il, allait être d'admettre que mes papiers avaient été perdus en mer, car autrement il me faudrait être emprisonné assez longtemps avant d'être quand même déporté à la fin de ma sentence. Deux ans en prison était une pensée qui ne me réjouissait pas du tout. Je dus donc signer un papier disant que mon passeport avait été perdu en mer.
— Maintenant, me dit le jeune homme, vous allez être expulsé à New York.
C'en était trop pour moi car j'étais parti de Montréal et Québec, mais la réponse fut immédiate : je devais aller à New York, parce que si je retournais dans la Province de Québec et racontais mon histoire, la presse pourrait s'en saisir et en faire un scandale, toujours avide de sensationnel qu'elle était — non pas avec l'idée de faire du bien à qui que soit, mais simplement parce que la presse se nourrissait — et se nourrit — de sensation et de conflits.
Je fus gardé dans une cellule pendant un certain temps, puis un jour on me dit que j'allais être expulsé le lendemain. On me fit sortir de ma cellule au matin et le haut fonctionnaire était là rayonnant de joie du fait que lui — petit bureaucrate insignifiant qu'il était — avait réussi à subvertir la justice selon ses propres désirs.
Dans l'après-midi je fus emmené au bateau et on me dit qu'il me faudrait travailler et que ce serait le travail le plus dur qui soit à bord d'un navire, soit équilibrer le charbon dans les soutes de l'un des plus vieux parmi les vieux brûleurs de charbon.
Je fus ensuite ramené à la cellule parce que le bateau n'était pas prêt à appareiller et que le Capitaine ne pouvait m'accepter à bord qu'une heure avant le départ. Vingt-quatre heures plus tard on me reconduisit au bateau et on m'enferma dans une très petite cabine où on me garda jusqu'à ce que le bateau navigue au-delà des limites territoriales.
Après un certain temps, je fus libéré de ma cellule — car cette petite cabine n'était pas autre chose qu'une cellule — et on me donna une pelle cabossée et un râteau en me disant de nettoyer le mâchefer, etc.
C'est ainsi que je refis la traversée de l'Atlantique, de retour vers New York, et au matin de la première apparition de terre, le Capitaine me fit demander et me parla en privé. Il me dit qu'il savait bien que j'avais été injustement traité. Il me dit que la police allait monter à bord pour m'arrêter, que je serais condamné pour entrée illégale aux États-Unis, et qu'après avoir purgé une peine, je serais déporté en Chine. Il regarda autour de lui, puis se dirigea vers un tiroir de son bureau en disant :
— Un homme comme vous peut facilement s'échapper s'il le veut. Les menottes sont la plus grosse difficulté. Voici une clef qui s'adapte aux menottes américaines ; je vais me retourner et vous pouvez prendre la clef. Vous comprendrez que je ne peux vous la donner, mais si vous la prenez — eh bien, je ne suis au courant de rien.
En disant cela il se retourna, et j'empochai rapidement la clef.
Ce Capitaine était un homme vraiment très respectable. Lorsque la police américaine monta à bord avec ses menottes, il leur dit que je ne leur causerais sûrement aucun problème, que selon lui je n'avais rien fait de mal et que j'étais victime d'un coup monté par un agent d'immigration méchant. Avec un rire cynique, le policier en charge dit qu'il était bien d'accord, chaque homme était victime de quelqu'un ; sur ce, il me passa les menottes aux poignets et me donna un rude coup de poing pour me faire avancer vers l'échelle de Jacob — l'échelle par laquelle les pilotes et les policiers accèdent et quittent les bateaux encore en mer.
Avec difficulté je réussis à descendre l'échelle, bien que la police exprima l'espoir que je tombe à l'eau et qu'elle ait à me repêcher. À bord de la vedette de police, je fus brutalement poussé dans la poupe. Les deux policiers s'occupèrent alors à remplir leur rapport et à tourner leur vedette vers le rivage.
J'attendis ma chance jusqu'à proximité des quais, puis tandis que la police ne regardait pas dans ma direction, je sautai simplement par-dessus bord.
L'eau était affreuse. Il y avait une mince écume d'huile et de saletés en surface, saletés venant des eaux d'égout des bateaux et des paquebots amarrés là, saletés balayées des quais : journaux flottants, boîtes flottantes, morceaux de coke, toutes sortes d'étranges pièces de bois à la dérive. Je plongeai en profondeur et arrivai à me saisir de la clef et déverrouillai les menottes que je laissai tomber au fond de l'eau.
Je dus remonter pour prendre une bouffée d'air, mais comme je faisais surface il y eut une série de coups de feu assez près de moi, si près que l'une des balles fit éclabousser l'eau sur mon visage. Une rapide bouffée d'air et je replongeai en me dirigeant non pas vers les piliers de la jetée la plus proche, mais plutôt vers une des plus éloignés avec l'idée que la police s'attendait à ce que je nage vers la plus proche jetée.
Lentement, je me laissai remonter à la surface jusqu'à ce que ma bouche et mon menton seuls soient au-dessus de l'eau. Aucun coup de feu ne vint de mon côté, mais je pus tout juste apercevoir la vedette de police qui circulait autour du quai le plus proche.
Doucement, je m'enfonçai de nouveau et nageai lentement — afin de conserver ma provision d'air — vers le quai.
Il y eut un choc soudain et mes mains agrippèrent instinctivement ce sur quoi je m'étais frappé la tête. Il s'agissait d'un amas de madriers à moitié submergés qui étaient apparemment tombés du quai partiellement en ruine au-dessus de moi. Je m'y accrochai, ne laissant que mon visage hors de l'eau. Lentement, comme je n'entendais aucun bruit, je m'assis et pus voir au loin la vedette de police qui avait été rejointe par deux autres, rôdant autour des piliers de l'autre quai. Au-dessus du quai, des policiers armés se précipitaient pour fouiller les différents bâtiments.
Je me tins immobile parce que soudainement un bateau arriva avec trois policiers à son bord. Ils ramaient silencieusement. L'un des policiers avait une paire de jumelles et il scrutait tous les quais des alentours. Lentement, je me laissai glisser de la poutre et m'enfonçai dans l'eau ne laissant que mon nez et ma bouche faire surface. Finalement, je levai légèrement la tête et vis que le bateau était bien loin. Comme je regardais, j'entendis quelqu'un crier :
— Le gars doit être raide à l'heure qu'il est ; on ramassera son corps plus tard.
Je m'étendis de nouveau sur la poutre, tremblant de façon incontrôlable dans mes vêtements trempés et la forte brise qui m'arrivait de toute part.
Quand la noirceur tomba, je réussis à monter sur le quai et me précipitai à l'abri d'un hangar. Un homme approcha et je vis qu'il s'agissait d'un Lascar (matelot Indien — de plus amples détails sur cet épisode particulier dans ‘l'Histoire de Rampa’ — NdT) ; il me parut bien amical et je sifflai donc très doucement. Il s'avança nonchalamment et, comme si de rien n'était, il approcha de ma cachette. Il se pencha alors pour ramasser quelques morceaux de papier éparpillés sur le sol.
— Sois très prudent en sortant, me dit-il, un gentleman de couleur t'attend dans son camion ; il va te faire sortir d'ici.
Eh bien, je finis par sortir de là, mais j'étais vraiment en piteux état : je souffrais d'épuisement et d'hypothermie. Je grimpai dans le camion à ordures, une bâche fut tendue sur moi, et on y versa toute une charge de déchets !
L'homme de couleur m'emmena chez lui où l'on s'occupa bien de moi, mais pendant deux jours et deux nuits, je dormis du sommeil de l'épuisement total.
Au cours de mon épuisement, tandis que mon corps physique se réparait lui-même, je fis un voyage dans l'astral où je vis mon Guide bien-aimé et ami, le Lama Mingyar Dondup. Il me dit :
— Tes souffrances ont été vraiment grandes, trop grandes. Elles furent le fruit aigre de l'inhumanité de l'homme envers l'Homme ; mais ton corps est usé et tu devras très bientôt subir la cérémonie de transmigration.
Dans le monde astral, mon compagnon et moi nous assîmes. Il m'en dit davantage :
— Ton corps actuel est dans un état d'effondrement, la vie de ce corps ne durera plus très longtemps. Nous craignions que de telles conditions prévalent dans le monde Occidental sauvage en te portant atteinte, et nous avons donc cherché un corps dont tu pourrais prendre la relève et qui, avec le temps, finirait par reproduire tous tes propres traits.
"Nous avons identifié une telle personne. Son corps est sur une très, très basse harmonique du tien, autrement, bien sûr, un échange ne pourrait avoir lieu. Il faut que les corps soient compatibles et cette personne a un corps compatible. Nous l'avons abordé dans l'astral parce que nous avons vu qu'il envisageait le suicide. C'est un jeune Anglais qui est très, très insatisfait de la vie, qui n'est pas heureux du tout dans la vie, et qui essaie depuis un certain temps de décider de la méthode la moins douloureuse pour ce qu'il appelle ‘l'auto-destruction’. Il est parfaitement disposé à quitter son corps et à voyager ici, dans le monde astral, pourvu qu'il n'ait rien à y perdre !
"Nous l'avons persuadé, il y a quelque temps, de changer son nom pour celui dont tu te sers actuellement, et il y a donc certaines choses encore à mettre au point, puis — eh bien, tu devras changer de corps."
Il me fut dit qu'il importait que je retourne au Tibet avant de subir le processus nécessaire de transmigration. Des instructions précises me furent données et quand je me sentis assez bien, j'allai à une agence maritime et pris un billet pour Bombay. Encore une fois, je fus soumis à toutes sortes de tracasseries parce que mes bagages se réduisaient à une seule valise. Mais je finis par monter à bord, et une fois dans ma cabine deux détectives vinrent me rendre visite pour savoir pourquoi je n'avais qu'une seule valise. Apprenant que j'avais des bagages suffisants en Inde, ils me sourirent avec joie et s'en allèrent.
Étrange sensation que d'être un passager sur un bateau. Tout le monde m'évitait parce que j'étais un paria qui n'avait qu'une seule valise. Les autres, bien sûr, semblaient avoir assez de bagages pour approvisionner un magasin entier, mais moi — apparemment le plus pauvre d'entre les pauvres — je devais être un repris de justice, ou quelque chose du même acabit pour voyager comme je le faisais, et c'est ainsi qu'on m'évita.
Parti de New York, le bateau longea toute la côte d'Afrique et traversa le Détroit de Gibraltar. Puis, avant d'entrer dans le Canal de Suez et ensuite dans la Mer Rouge, le bateau fit escale à Alexandrie. La Mer Rouge était épouvantable, la chaleur meurtrière, et il s'en fallut de peu que je sois victime d'une insolation. Mais finalement nous longeâmes la côte d'Éthiopie et, après la traversée de la mer d'Arabie, ce fut enfin Bombay. Le bruit et les odeurs à Bombay étaient terribles, atroces, en fait, mais j'y avais quelques amis : un prêtre Bouddhiste et quelques personnes influentes y rendirent mon séjour d'une semaine intéressant.
Après cette semaine où je tentai de me remettre de tous les chocs et les tensions que j'avais subis, on me mit dans un train qui me fit traverser l'Inde jusqu'à Kalimpong. Je m'arrangeai pour descendre du train avant qu'il n'entre à Kalimpong, parce qu'on m'avait averti que l'endroit fourmillait d'espions Communistes et de journalistes ; les nouveaux arrivants étaient arrêtés et interrogés par ces derniers et comme je devais en découvrir la réalité plus tard — si l'on ne donnait pas d'interview, les journalistes en ‘inventaient’ un sans le moindre souci d'authenticité.
Je connaissais quelque peu Kalimpong, certainement assez pour prendre contact avec des amis et entrer ainsi dans ‘la clandestinité’, loin des espions et des journalistes.
Ma santé, maintenant, allait en se détériorant rapidement, et l'on craignait sérieusement que je ne vive pas assez longtemps pour pouvoir subir la cérémonie de la transmigration. Un lama qui avait été formé avec moi à Chakpori était à Kalimpong et il vint à mon aide avec des herbes très puissantes.
Accompagné par ce lama médecin — et après un pénible voyage de dix semaines, nous arrivâmes à une lamaserie surplombant la Vallée de Lhassa. Elle était haut perchée et inaccessible, quasi invisible, et les Communistes ne se souciaient pas d'un si petit endroit insignifiant. De nouveau, je me reposai, je me reposai pendant environ sept jours en tout. Puis un jour on m'annonça que le lendemain il me faudrait voyager dans l'astral et rencontrer le corps astral de l'homme dont j'allais occuper le véhicule physique.
Pour l'instant, je me reposais en réfléchissant aux problèmes de la transmigration. Le corps de cette personne ne m'était pas très utile, vu que c'était SON corps et qu'il avait une masse de vibrations incompatibles avec les miennes propres. En temps voulu, me dit-on, le corps correspondrait exactement à mon propre corps au même âge, et si les Occidentaux trouvent ceci difficile à croire ou à comprendre, permettez-moi de présenter la chose ainsi : le monde Occidental connaît l'électrodéposition, et le monde Occidental connaît également la galvanoplastie. Dans ce dernier système, un objet est plongé dans un certain fluide et un ‘connecteur’ spécial est appliqué en face de l'objet, puis quand le courant est amené à un débit et un ampérage corrects, on obtient un objet qui est la réplique exacte de l'original. Cela est connu sous le nom de galvanoplastie.
De même, il est possible de faire de l'électrodéposition. On peut appliquer un revêtement à une variété de métaux tels que le nickel, le chrome, le rhodium, le cuivre, l'argent, l'or, le platine, etc. Il suffit de savoir comment le faire. Mais le courant circule d'un pôle à l'autre à travers un liquide, et les molécules d'un pôle sont transférées à l'autre pôle. C'est un système assez simple, mais ceci n'est pas un traité sur le revêtement électrolytique. La transmigration et le remplacement molécule par molécule de la ‘structure’ de l'hôte par celle du — comment dirai-je ? — nouvel occupant sont très réels et ont été réalisés de nombreuses fois par ceux qui savent comment y parvenir. Heureusement, ceux qui savent comment le faire furent toujours des gens auxquels on pouvait se fier, car s'il en avait été autrement, c'eût été une chose vraiment terrible que quelqu'un puisse simplement prendre en charge le corps d'une autre personne et fasse le mal. Je me sentis plutôt suffisant, sottement peut-être, en pensant que — bon, c'est pour faire le bien, ce n'est pas que je veuille prendre en charge le corps stupide de quelqu'un d'autre ; tout ce que je veux c'est la paix. Mais il ne devait apparemment ne pas y avoir de paix dans ma vie.
En passant, et en tant que quelqu'un qui a étudié toutes les religions, je dois faire remarquer que les Adeptes en ont fait l'expérience vie après vie. Le Dalaï-Lama lui-même l'a faite, et le corps de Jésus a été pris en charge par l'Esprit du Fils de Dieu, et cela était de notoriété publique même dans la foi Chrétienne jusqu'à ce que ce soit interdit parce que cela rendait les gens trop complaisants.
De mon point de vue élevé dans cette lamaserie isolée, je pouvais voir au loin la ville de Lhassa ; on avait réussi à faire sortir du Potala un télescope puissant et à l'amener ici, et ce fut pour moi un grand divertissement de l'utiliser pour regarder les hargneux gardes Chinois du Pargo Kaling. Je vis les troupes se précipiter dans leurs jeeps, je vis à travers ce télescope de nombreuses choses innommables faites aux hommes et aux femmes, et je me souvins avec une grande horreur que j'avais combattu au côté des Chinois, comme tant d'autres, et maintenant ces Chinois ne se conduisaient pas selon leurs promesses, selon leurs déclarations. Ils ne songeaient qu'à la violence.
Regardant par la fenêtre sans vitre, j'avais peine à croire que ceci était Lhassa et le Tibet que j'avais connus auparavant. Ici, le Soleil doré frappait toujours de ses rayons les ravins des montagnes, la Lune argentée traversait toujours l'obscurité du ciel nocturne, et les petits points lumineux qui étaient les étoiles descendaient toujours de la Voûte Céleste. Mais les oiseaux de nuit ne lançaient plus leur appel comme jadis, car les Communistes Chinois tuaient tout ce qu'ils voyaient. Avec horreur je constatai qu'ils éteignaient la vie de ces créatures que j'aimais tant. Ils mangeaient les grains, disait-on, ce qui provoqueraient la famine des humains. Les chats furent tués, de sorte que, on me dit, il n'y avait plus aucun chat à Lhassa. Les chiens furent tués et mangés par les Chinois. C'était apparemment une spécialité gastronomique Chinoise. Ainsi, non seulement les pauvres humains étaient-ils condamnés à la mort aux mains des Communistes Chinois, mais les animaux aussi, ces animaux de compagnie des Dieux, étaient exterminés sans aucune raison valable. J'avais la mort dans l'âme de tant d'horreurs perpétrées contre un peuple innocent, sans défense. En contemplant le ciel qui s'obscurcissait, je me sentis submergé par l'émotion, submergé par le chagrin, et je songeai alors que j'avais cette tâche à accomplir, que tant de mal avait été prévu dans ma vie. Je souhaitai avoir assez de force pour endurer tout ce qui m'avait été prédit.
Depuis un certain temps j'étais vaguement conscient de beaucoup d'agitation, d'une atmosphère d'attente, et mon attention était attirée à maintes et maintes reprises vers Lhassa. Le télescope était merveilleux. Mais c'était difficile de regarder à travers la fente d'une fenêtre avec un objet si encombrant, aussi j'optai pour une paire de jumelles qui grossissaient vingt fois, qu'on avait également apportées, et qui offraient une plus grande maniabilité pour voir au-delà de l'angle du télescope dans la fenêtre.
Mon observation fut interrompue soudain par l'arrivée de deux hommes qui en soutenaient un troisième. Je me tournai et le regardai avec horreur : il était aveugle, ses yeux ayant été arrachés, laissant des mares rouges. Il n'avait plus de nez. Les deux hommes qui l'accompagnaient l'aidèrent doucement à s'asseoir, et saisi d'horreur, je le reconnus : c'était un lama qui m'avait aidé dans mes études à Chakpori. Les deux assistants saluèrent et se retirèrent et je demeurai seul en face du lama. À voix basse, il me dit :
— Mon frère, je peux bien discerner tes pensées. Tu cherches à comprendre pourquoi je suis dans cet état. Je vais te le dire : j'étais sorti pour m'occuper de mes affaires courantes et je jetai par hasard un coup d'œil vers la Montagne de Fer. Un officier Communiste Chinois qui était assis dans sa voiture se tourna soudainement et m'accusa de le dévisager avec, dans l'esprit, de mauvaises pensées. Naturellement, je niai l'accusation car ce n'était pas vrai, je regardais simplement notre gîte bien-aimé. Mais non, l'officier dit que tous les prêtres étaient des menteurs et des réactionnaires, et il donna abruptement des ordres à ses hommes. Je fus saisi et jeté à terre, puis on me passa une corde autour de la poitrine qu'on attacha derrière mon dos. L'autre extrémité fut attachée à l'arrière de la voiture de l'officier. Alors, en poussant des cris de joie, il roula en me traînant au long de la route, face contre terre.
Le vieux lama s'arrêta et souleva sa robe. Je suffoquai d'horreur parce que toute la peau et la chair en grande partie avaient été arrachées de la tête aux pieds, des lambeaux de chair pendaient, et l'intérieur de sa robe était tout ensanglantée. Il rabaissa soigneusement sa robe en disant :
— Oui, la rugosité de la route m'a emporté le nez, m'a arraché d'autre chose encore, et j'attends maintenant de rejoindre le Pays de l'Au-delà. Mais avant de connaître cette délivrance, j'ai à accomplir une dernière tâche.
Il fit une pause pendant un instant ou deux, récupérant un peu d'énergie, puis il dit :
— Cette matière de la transmigration et la possibilité que nous pourrions avoir à l'utiliser sont connues depuis de nombreuses années, et j'étais responsable du projet. J'ai dû étudier les anciens manuscrits pour en apprendre autant que possible sur le sujet. J'ai dû consulter les Archives Akashiques et amasser tout ce que j'ai pu de connaissances. (Il reprit après quelques instants de repos :) Les Chinois m'ayant enfin délivré de ma corde, l'officier estima qu'il n'en avait pas fini. Me frappant encore tandis que je gisais sur le dos dans la poussière, il s'écria : "Tu me fixais pour attirer sur moi le mauvais œil, eh bien ! tu ne fixeras plus personne". Ramassant sur la route une pierre pointue, un de ses hommes l'enfonça dans mes globes oculaires, l'un après l'autre, et les fit sortir de leurs orbites, de sorte qu'ils pendaient sur mes joues. Ils s'en allèrent ensuite en riant, me laissant là où j'étais, le nez arraché, le corps mutilé et en lambeaux, méconnaissable au point de ne plus pouvoir dire si j'étais un homme ou une femme puisque les parties concernées avaient été emportées, et sur mes joues reposaient mes yeux aveugles avec leurs orbites perforées, le liquide se répandant et coulant le long de mes oreilles.
"Quand les gens, horrifiés, qui avaient assisté à la scène, purent s'approcher de moi, ils me soulevèrent et m'emportèrent dans une maison. Je m'évanouis et, quand je revins à moi, je découvris que mes yeux avaient été retirés et que j'avais été très bien soigné avec des emplâtres d'herbes. Puis, furtivement, de nuit, on me porta dans les montagnes pour y attendre ta venue. Maintenant, il me faut te dire beaucoup de choses, et je dois t'accompagner dans un voyage dans l'astral d'où je ne reviendrai pas.
Il se reposa de nouveau quelque temps afin de regagner un peu de ses forces, et quand une légère couleur revint sur ses joues, il annonça :
— Nous devons aller dans l'astral.
Nous reprîmes donc le parcours familier. Chacun de nous s'assit dans la position du lotus, cette position que nous, Orientaux, trouvons le plus facile à maintenir. Et après avoir dit les mantras de circonstance, nos vibrations furent si amplifiées que, par le bond presque imperceptible qui accompagne une telle transition, nous quittâmes nos corps, moi temporairement et mon compagnon définitivement.
Nous perdîmes de vue la grisaille de la Terre et la blancheur des neiges éternelles. Devant nous apparut un voile, un voile chatoyant blanc bleuâtre qui, en l'approchant, donnait tout d'abord l'impression d'être une barrière impénétrable, mais qui n'était pas une entrave pour ceux qui savaient comment entrer. Ce qui était notre cas, et nous nous trouvâmes dans une zone de glorieuse lumière où régnait une impression de joie.
À l'endroit du monde astral où nous sommes entrés, nous étions sur un gazon vert et sous nos pieds l'herbe était courte et comme élastique.
— Ah ! dit le lama dans un soupir, comme c'est merveilleux de voir à nouveau, comme c'est merveilleux de ne plus souffrir. Ma tâche sera bientôt remplie, et alors je rentrerai à la Maison, au moins pour un temps.
Et disant cela, il me précéda au long d'un sentier plaisant.
Le paysage était couvert d'arbres portant tous des feuilles rouges, vertes et jaunes. À nos côtés, une majestueuse rivière coulait dans laquelle se reflétait le ciel d'un bleu profond. De légers nuages floconneux dérivaient paresseusement à travers le ciel et l'atmosphère qui régnait là était pleine de vie pétillante, de vitalité, de santé, de bonheur.
Dans les arbres chantaient des oiseaux, des oiseaux d'un type que je n'ai jamais vus sur Terre, car ceux-ci étaient vraiment de glorieuses créatures, des oiseaux de toutes sortes de couleurs, des oiseaux de toutes sortes de plumages.
Le vieil homme et moi marchâmes parmi les arbres, puis nous arrivâmes à un espace libre qui était en fait un jardin, un jardin de fleurs éclatantes, aucune d'un type que je pouvais reconnaître. Elles semblaient incliner la tête vers nous comme pour nous saluer. Au loin, je pouvais voir des gens se promener comme s'ils festoyaient dans ce glorieux jardin. De temps à autre, une personne se baissait pour respirer une fleur. Parfois, quelqu'un levait les bras vers le ciel et un oiseau venait se percher sur sa main tendue. La peur n'existait pas, ici, seulement la paix et le contentement.
Nous marchâmes pendant un moment puis, devant nous, s'éleva ce qui semblait être un immense temple. Sa coupole était d'or, et les murs qui la soutenaient d'une sorte de couleur fauve. D'autres bâtiments s'étendaient à partir de ce dernier, chacun d'une teinte pastel, toutes harmonisées, mais à l'entrée du temple un groupe de gens attendaient. Certains portaient la robe du Tibet, et un autre — je n'arrivai pas à discerner ce qu'il portait à ce moment-là, il semblait être vêtu de quelque chose de noir ou de très sombre. En approchant, je vis qu'il s'agissait d'un Occidental vêtu de vêtements occidentaux.
À notre approche, les lamas se tournèrent et tendirent leurs mains dans notre direction, tendirent les mains pour nous accueillir. Je vis que l'un d'eux était mon Guide et ami, le Lama Mingyar Dondup, et je sus que tout irait bien car cet homme était bon, et uniquement bon. Je vis un autre personnage qui était même encore plus éminent quand il vivait sur le plan terrestre, mais qui n'était en ce moment que l'un des membres du ‘comité’ d'accueil qui nous attendait.
Nos salutations joyeuses furent bientôt échangées, puis nous entrâmes ensemble à l'intérieur du grand temple, traversant le hall central et pénétrant plus avant dans cet édifice. Nous entrâmes dans une petite pièce dont l'existence n'était pas facile à discerner, ses murs semblant coulisser et, nous ayant admis en sa présence, se refermant hermétiquement derrière nous.
Mon Guide, qui était visiblement le porte-parole, se tourna vers moi en disant :
— Mon frère, voici le jeune homme dont tu vas occuper le corps.
Je me tournai et regardai en face le jeune homme, consterné. Il n'y avait certes aucune ressemblance entre nous : il était beaucoup plus petit que moi, et la seule similitude entre nous était que nous étions tous les deux chauves ! Mon Guide se mit à rire et leva un doigt réprobateur en disant :
— Doucement, doucement, Lobsang, continua-t-il en riant, ne sois pas si rapide dans tes décisions. Tout ceci a été planifié ; je vais d'abord te montrer des images des Archives Akashiques.
Et il joignit le geste à la parole.
Comme nous achevions de les regarder, il s'adressa au jeune homme :
— Maintenant, jeune homme, je pense qu'il est temps que vous nous parliez un peu de vous, car il importe que celui qui est sur le point d'habiter votre corps sache ce à quoi il sera confronté.
Le jeune homme, à ces mots, prit un air vraiment très agressif et répliqua d'un ton renfrogné :
— Eh bien, non, je n'ai rien à dire sur mon passé ; il a toujours joué contre moi. Si j'en parlais, ce que je dirais ne serait utilisé qu'à mon désavantage.
Le regardant d'un air triste, mon Guide répondit :
— Jeune homme, nous avons tous ici une vaste expérience de ces choses et nous ne jugeons pas un homme par ce qu'est sa naissance, mais par ce qu'il est lui-même.
Mon Guide soupira et lui dit :
— Vous alliez commettre le péché mortel du suicide, véritablement un péché, un péché qui eût pu vous coûter de très nombreuses vies d'épreuves pour vous racheter. Nous vous offrons la paix, la paix dans l'astral, afin que vous puissiez gagner la compréhension de certaines des choses qui vous ont tourmenté tout au long de votre vie. Plus vous coopérerez, et mieux nous pourrons vous aider, et aider à la tâche que nous avons devant nous.
Le jeune homme secoua la tête :
— Non, dit-il, l'arrangement était que je voulais laisser mon corps et que vous vouliez y mettre quelqu'un d'autre dedans ; c'était là tout notre arrangement, et je le tiens.
Il y eut un éclair soudain, et le jeune homme disparut. Le vieux lama qui était avec moi, et qui était maintenant un jeune homme plein de santé, s'exclama :
— Oh ! la la ! avec des idées si féroces, il ne pouvait pas demeurer avec nous ici sur ce plan astral. Il nous faudra maintenant nous rendre chez lui, dans cette chambre où il dort seul. Mais nous devons le laisser dormir pour cette nuit. Nous ne voulons pas causer de dommages à l'organisme, aussi il me faudra trouver le moyen de repartir avec toi pour Lhassa jusqu'à la nuit prochaine.
Le temps passait, et me rendant compte que le vieux lama s'affaiblissait rapidement, je dus lui dire :
— Il est temps que nous allions dans l'astral.
— Oui, répliqua-t-il, je ne reverrai plus ce corps qui est mien. Il nous faut partir, car si je mourais avant d'arriver dans l'astral, cela nous retarderait.
Ensemble, nous éprouvâmes cette secousse et nous nous élevâmes d'un bond, mais pas dans le monde astral que nous avions déjà visité. Cette fois nous nous élançâmes à travers le monde vers une maison d'Angleterre. Nous vîmes, dans le physique, le visage de l'homme que je n'avais précédemment vu que dans l'astral. Il semblait si mécontent, si malheureux. Nous tentâmes d'attirer son attention, mais il dormait d'un sommeil vraiment très profond. Le vieux lama murmura : "Venez-vous ?" Je murmurai à mon tour : "Venez-vous ?" Et nous continuâmes ainsi, d'abord l'un, puis l'autre, jusqu'à ce que finalement de façon très, très réticente, la forme astrale de cet homme émergea de son corps physique. Lentement elle s'échappa, et ensuite se reforma au-dessus de lui dans la forme exacte de son corps, puis inversa sa position, la tête du corps astral aux pieds. La forme s'inclina et atterrit sur ses pieds. Il avait certainement l'air très agressif, et je vis qu'il ne se rappelait pas nous avoir jamais vus. J'en fus étonné, mais mon compagnon me chuchota que le fait d'avoir été de si méchante humeur et de s'être retiré si violemment dans son corps avait totalement oblitéré tous les souvenirs de ce qui lui était arrivé.
— Ainsi, vous voulez quitter votre corps ? demandai-je.
— Bien sûr que oui, me lança-t-il d'une voix presque rageuse. Je déteste absolument être ici.
Je le regardai et frémis d'appréhension et, à franchement parler, de pure frayeur. Comment allais-je prendre le corps d'un tel homme ? Un homme si agressif, si difficile ? Mais c'était le cas. Il rit et dit :
— Ainsi, VOUS voulez mon corps ? Eh bien, peu importe ce que vous voulez, peu importe qui vous êtes en Angleterre, tout ce qui compte c'est qui vous connaissez, combien vous possédez.
Lui ayant parlé pendant un moment, il se calma et je lui dis alors :
— Eh bien, une chose, vous devrez vous faire pousser la barbe. Je ne peux pas me raser parce que les Japonais m'ont abîmé les mâchoires. Pouvez-vous faire pousser votre barbe ?
— Oui, monsieur, répliqua-t-il, je le peux et je le ferai.
Je réfléchis un moment, puis lui dis :
— Eh bien, en un mois, elle devrait avoir suffisamment poussé. Dans un mois, donc, je viendrai et prendrai possession de votre corps et vous serez autorisé à vous rendre dans un monde astral afin de pouvoir retrouver votre tranquillité et vous rendre compte qu'il est agréable de vivre. (J'ajoutai :) Cela nous aiderait grandement, grandement, si vous nous racontiez l'histoire de votre vie, parce que même si nous avons beaucoup vu dans l'astral par le biais des Archives Akashiques, on peut tirer un grand avantage en entendant les expériences réelles de la personne concernée.
Reprenant un air terriblement agressif, il répondit :
— Non ! Non ! Je ne peux pas supporter d'en parler. Je ne vais pas ajouter un mot de plus.
Tristement, nous nous détournâmes et entrâmes dans le monde astral afin de pouvoir de nouveau consulter le Registre Akashique pour voir une grande partie de sa vie, mais dans le Registre Akashique, si l'on peut voir tout ce qui s'est produit, on n'obtient pas nécessairement les opinions inexprimées de la personne, on voit l'acte mais non la pensée qui a précédé l'acte.
Mais faisons maintenant un bond dans le temps. Le jeune homme, depuis de nombreuses années à présent dans l'astral, s'est adouci quelque peu et, dans une faible mesure, comprend les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il a, ainsi, accepté de nous conter l'histoire de sa vie. Lui, dans le monde astral, et moi, Lobsang Rampa, ici sur le monde terrestre, essayant de consigner précisément ces choses par écrit, comme elles sont dites par le jeune homme. Nous aurons bientôt son histoire, mais il faut d'abord préciser que des noms ne seront pas donnés car ils causent de la détresse aux autres. Ceci n'est pas une histoire de vengeance, ceci n'est pas une histoire d'amertume. En fait, dans ce livre, c'est une histoire de triomphe sur des obstacles en apparence insurmontables. Il y a eu de nombreuses tentatives pour stopper mes livres, mais j'ai toujours été attentif à la façon dont un homme va de l'avant même si des chiens jappent à ses pieds ; j'ai toujours été conscient qu'un homme peut continuer son travail même entouré de moucherons et de mouches à viande bourdonnant autour de lui. Je dis donc que je n'ai aucun besoin d'être amer, car ce que je voulais faire est maintenant possible, et ma tâche actuelle consiste simplement à compléter la tâche d'un autre qui est ‘tombé en cours de route’.
De nouveau, je répète avec la plus extrême sincérité que tous mes livres sont vrais, absolument vrais, ils sont écrits sans forme poétique de l'auteur, ils contiennent la vérité telle que ces choses me sont arrivées. Je peux faire toutes les choses dont je parle, mais pas pour une démonstration publique, pour la simple raison que je ne suis ni un charlatan ni un acteur de foire. Ces choses que je fais ne servent qu'à la réalisation de ma tâche.
Tournons maintenant la page et voyons ce qu'a dit ce jeune homme.
Chapitre Huit
Voici l'histoire de la vie de l'Hôte. C'est une histoire qui est difficile à raconter, vu que le conteur est sur le plan astral et que celui qui doit transcrire ce récit est sur le plan terrestre, dans la ville de Calgary, Alberta, au Canada. Cette histoire de vie est hors contexte et crée une coupure entre ce qui a déjà été écrit et ce qui suivra ; mais quand on a affaire à l'astral, on se doit de faire des concessions en matière de temps, parce que le temps sur le plan astral n'est pas le même que sur le plan terrestre. Par conséquent, cette histoire de vie nous est livrée maintenant, et si j'explique ici pourquoi elle nous est livrée maintenant, c'est pour éviter un monceau de lettres posant toutes sortes de questions. À partir de cet instant, donc, et jusqu'à ce que je précise autrement, tout ce qui est écrit est dicté par celui que nous appellerons ‘l'Hôte’.
Grand-père était, à la vérité, un homme très important ; du moins dans le district rural de Plympton qui, pour autant que je m'en souvienne, incluait Plympton St Mary, Plympton St Maurice, Underwood, Colebrook, et un bon nombre d'autres petites localités.
Grand-père était Chef du Réseau de Distribution d'Eau de Plympton. Il avait l'habitude d'escalader chaque jour la colline avec charrette et poney sur une distance d'environ un mille (1,6 km) pour arriver à un promontoire clôturé où il y avait une petite hutte qui recouvrait le réservoir. Grand-père avait l'habitude d'aller là-haut avec un bâton de quatre pieds (1,20 m) de long, dont une extrémité était en forme de soucoupe et l'autre, arrondie. Il marchait, l'oreille collée à l'extrémité en forme de soucoupe, tandis que l'autre reposait sur le sol. Cela lui permettait d'entendre l'eau se précipiter à travers les tuyaux pour s'en aller alimenter les robinets de Plympton, Underwood, Colebrook, et autres districts.
Grand-père avait également une entreprise assez prospère, employant plusieurs hommes et de nombreux apprentis. Il leur enseignait la plomberie — d'où les racontars injurieux qui devaient naître plus tard — la ferblanterie et la mécanique générale. À cette époque, tout au début du siècle, les gens ne se précipitaient pas dans les supermarchés quand ils avaient besoin de bouilloires, de casseroles, de poêles à frire, et de tout le reste ; ces choses étaient faites à la main, et les hommes de Grand-père les fabriquaient.
Grand-père habitait Mayoralty House, à Plympton St Maurice. Cette maison avait en fait été celle du Maire et était située juste en face de l'Hôtel de Ville et du Poste de Police.
Mayoralty House consistait en quatre ou cinq acres de terre, divisées en trois sections. La première section était contiguë à la maison de quatre étages et formait un jardin clos de probablement un peu moins d'une acre. Dans ce jardin près de la maison il y avait une grotte faite de très grosses pierres, avec des fenêtres aux verres de couleurs variées. À l'extérieur s'étendait une petite pelouse bordée de fleurs et de plantes. Au milieu, un grand étang à poissons joliment carrelé avec une fontaine et des roues à aubes à ses extrémités. Un jet d'eau pouvait être actionné et les roues à aubes se mettaient à tourner. Il y avait alors un petit flotteur qui descendait dans l'eau et à certains moments de la journée les poissons tiraient sur ce flotteur, ce qui actionnait une cloche, et on leur donnait alors leur nourriture.
Faisant face à l'étang à poissons se dressaient deux grandes volières murales, très soigneusement entretenues et nettoyées à fond. Dans celles-ci il y avait deux arbres morts contre le mur et ils offraient un endroit idéal pour les oiseaux bien apprivoisés. Ils étaient si bien apprivoisés que lorsque Grand-père pénétrait dans les volières, en ouvrant les portes bien sûr, aucun oiseau ne s'échappait.
Plus loin, vers le bas de cette première partie du jardin, il y avait une serre, l'une des joies de Grand-père. Et au-delà, s'étendait un petit verger.
À l'extérieur de ce jardin clos il y avait un chemin privé qui quittait la rue principale et descendait sous une partie de Mayoralty House — qui faisait comme un pont à travers ce chemin, et au fond il y avait ce qui avait autrefois été des malteries. Les malteries n'étaient plus utilisées de mon temps parce que c'était beaucoup moins cher, apparemment, de se faire expédier du malt provenant d'un endroit à quelques centaines de milles (km) de Plympton.
À côté de la malterie il y avait le Poste d'Incendie. Grand-père possédait le Service d'Incendie et il avait des chevaux qui tiraient les voitures de pompiers sur la scène des incendies. Il offrait tout cela comme un service public, et si des entreprises ou de grandes maisons étaient sauvées d'une perte totale, Grand-père, bien sûr, leur facturait alors des honoraires raisonnables, mais pour les gens pauvres, il n'exigeait aucune rétribution. Tous les engins étaient très bien entretenus et étaient conduits par des volontaires ou par son propre personnel.
Ici, aussi, il y avait les cours où était gardé une grande partie de son équipement extérieur, des wagons et des choses comme ça. Ici, aussi, il avait deux paons qui faisaient sa fierté et sa joie et qui venaient toujours à lui quand il émettait certains sons.
On traversait cette cour et on franchissait une grille pour arriver dans un jardin qui devait s'étendre sur deux acres et demie ou peut-être trois. Là, il faisait pousser des légumes, des arbres fruitiers, et le jardin tout entier était extrêmement bien soigné.
Sous la maison — sous cette maison de quatre étages — il y avait des ateliers sans fenêtres, mais apparemment bien ventilés. C'est là que les maîtres artisans, ferblantiers, chaudronniers et les apprentis travaillaient, et ils devaient travailler durement aussi.
Grand-père avait deux fils et une fille. Bon gré mal gré, les deux fils furent poussés dans l'apprentissage. Ils durent apprendre la mécanique générale, la ferblanterie, le métier de chaudronnier — et la plomberie omniprésente — et il leur fallait rester à leurs études jusqu'à ce qu'ils puissent réussir tous les examens et obtenir une attestation d'inscription.
Mon Père était un très bon mécanicien, mais après un certain temps il se sépara de Grand-père, disant que celui-ci exerçait un contrôle trop strict, trop dominateur. Il le quitta donc et s'installa, toujours à St Maurice, dans une maison qu'on appelait ‘Brick-House’, car c'était la seule maison de brique rouge de cette rue. Père se maria et vécut pour un temps à St Maurice. D'abord, un fils naquit, mourant bien vite, puis une fille, et, assez longtemps après, je vins au monde, ne parvenant jamais à chasser l'idée que je fus l'enfant non désiré, mais un simple accident ; je ne fus certainement jamais privilégié de quelque façon que ce soit, je ne fus jamais apprécié, et je n'eus jamais le droit d'avoir des amis. Tout ce que je faisais était automatiquement mal, tout ce que ma sœur faisait était automatiquement bien. Après un certain temps on finit par être plutôt dégoûté de toujours être l'indésirable et de voir la personne favorisée tout obtenir, de la voir avec ses amies et ses réceptions et tout le reste. Même la seconde place était considérée trop bonne pour moi.
Mère et Père déménagèrent à Ridgeway dans la Paroisse de St Mary. Là, ils démarrèrent une entreprise — non, pas de plomberie — une entreprise d'ingénierie qui incluait l'électricité, laquelle commençait juste à entrer dans l'usage courant. Mon Père était un homme vraiment très gentil, dans la mesure où il pouvait se permettre d'être très gentil. Son signe était le Scorpion, et celui de ma Mère était la Vierge. Elle venait d'une excellente famille d'une autre partie du Devonshire. Sa famille avait possédé beaucoup d'argent et de nombreuses terres auparavant, mais son père et un voisin se prirent de querelle au sujet d'un droit de passage, et — eh bien — ils allèrent finalement en justice. Un verdict fut rendu et fut porté en appel, et cela continua ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus d'argent, certainement pas suffisamment d'argent pour poursuivre le litige, et c'est ainsi que la terre qui avait été la cause de tous les ennuis fut vendue.
Mère et Père ne s'entendaient pas. Mère avait un caractère trop dominateur. Dans la localité, on l'appelait ‘la Dame’ à cause de ses grandes ambitions. La perte de la fortune familiale l'avait rendue très aigrie. Malheureusement, elle semblait reporter son amertume sur son mari et sur moi.
Grand-père avait un frère, peintre de grand talent et membre de l'Académie Royale, qui avait une très bonne renommée. Je me souviens qu'un de ses tableaux tout particulièrement m'avait toujours captivé. Il s'agissait d'une représentation du Vieux Barbican de Plymouth (port originel de Plymouth, dans le Devon — NdT), le Barbican tel qu'il était quand le Mayflower navigua vers les États-Unis. C'était un tableau merveilleux, éclatant de couleurs vives, serein, et en le regardant on avait sitôt l'impression de se trouver ‘là’. Oncle Richard, comme nous l'appelions, disait toujours que cette toile irait à l'un des enfants. Il revint à ma sœur, et c'était une chose que vraiment, vraiment, je convoitais, c'était la chose que je désirais plus que tout, exception faite d'un train miniature qui, quelques années plus tard, m'avait été promis — un train bleu — et qui était à mes yeux d'enfant le train le plus merveilleux du monde entier. Il m'avait été solennellement promis, puis le jour où je devais le recevoir on me dit : "Oh mais tu ne peux pas l'avoir. Ta sœur veut un piano. Ton Père et moi allons le lui acheter maintenant". Oui, je voulais réellement ce train tout comme je voulais le tableau.
Ce fut toujours comme cela que les choses se passèrent. Ma sœur eut un superbe vélo, je dus aller à pied. Mais ce n'est pas le but de ce récit. Il me faut raconter tout ceci parce que, me dit-on, cela faisait partie de l'accord lorsque j'ai consenti à ce qu'on prenne possession de mon corps. De toute façon, j'en avais assez de ce damné corps. Rien n'allait.
Je suis né maladif, et ma naissance rendit ma mère très malade. Il semble qu'elle ait subi une sorte d'empoisonnement quand je suis né, et pour quelque étrange raison, de cela je fus tenu pour responsable tout juste comme si je l'avais empoisonnée. Je ne pouvais rien y faire, j'étais trop petit pour réaliser quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, elle était très malade, je l'étais également et le restai toute ma vie sur Terre. J'étais chétif. Nous avions un médecin, le Dr Duncan Stamp, qui était l'un des véritables docteurs, toujours à étudier et à ajouter de nouvelles lettres à la suite de son nom. Il n'avait pas beaucoup de compassion, mais il possédait un grand savoir. Il ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas non plus. Mais je me souviens d'une chose extraordinaire : un jour j'étais — eh bien, tous disaient que j'étais en train de mourir. Ce Dr Stamp s'approcha de mon lit et sembla accrocher quelque chose en l'air à partir d'une lampe, d'où il fit descendre des tubes jusqu'à moi. Je ne sais toujours pas ce qu'il me fit, mais je me rétablis, et après cela, je n'ai jamais cessé de le considérer comme un faiseur de miracles.
Je me souviens de la Grande Guerre, c'est-à-dire de la Première Guerre Mondiale. Mes parents, ma sœur et moi étions à North Road Station (une station de trains — NdT), à Plymouth. Nous avions dû visiter quelqu'un dans un endroit appelé Penny-Come-Quick. C'était tard le soir et soudainement nous entendîmes des coups de feu et vîmes des faisceaux de projecteurs scintiller à travers le ciel, et c'est dans un faisceau de projecteur que je vis mon premier Zeppelin. Il volait au-dessus de Plymouth, puis s'envola de nouveau vers la mer, mais c'est un autre incident que je n'ai jamais oublié : l'aspect de ce dirigeable traversant les faisceaux lumineux.
Plympton est un lieu très ancien, tout plein d'histoire. Il y a la grande église de St Mary, au pied de Church Hill. En descendant la colline le clocher de l'église avait toujours l'air d'être plus haut que le sommet de celle-ci. On descendait, passait le long du cimetière, puis on tournait à gauche. Passé l'église, on arrivait au prieuré et aux diverses vieilles maisons religieuses qui avaient été abandonnées par le clergé parce que, apparemment, une certaine division des pouvoirs avait eu lieu et les sièges sociaux de l'église avaient été déplacés à Buckfast.
Derrière le prieuré il y avait un agréable cours d'eau bordé de roseaux et d'osiers. C'est là que les gens avaient l'habitude de venir chercher les roseaux et les joncs pour la fabrication de paniers et autres récipients. C'est là, également, qu'environ une centaine d'années auparavant ils fabriquaient de l'hydromel, la boisson de l'époque.
L'église, en pierre grise avec un grand clocher et quatre petites colonnes à chacun de ses coins, était quelque chose d'extrêmement imposant. Les cloches étaient merveilleuses à entendre quand on en jouait correctement, et les carillonneurs venaient de tout le Devon pour sonner les changements, comme ils disaient, et les carillonneurs de Plympton allaient à leur tour démontrer leurs propres compétences.
L'Église à St Maurice n'était pas aussi grandiose que celle de St Mary. Elle était plus petite et était manifestement une église secondaire. À cette époque, St Maurice et St Mary étaient des communautés séparées n'ayant presque aucun mouvement social entre elles. Colebrook et Underwood n'avaient pas d'églises, de sorte qu'il leur fallait se rendre à St Maurice ou St Mary.
Plympton avait sa part de grandes maisons, mais la plupart d'entre elles avaient été très endommagées par Oliver Cromwell et ses hommes. Beaucoup d'entre elles avaient été démolies par ordre du Juge Jeffreys, mais Plympton Castle restait un endroit qui me fascinait. Il y avait un très grand monticule avec, dessus, les restes de solides murs de pierre, des murs extrêmement épais, et certains d'entre nous découvrîmes qu'il y avait un tunnel qui s'étendait tout au long des murs. Quelques-uns des garçons les plus audacieux affirmèrent être allés dans une chambre étrange sous les murs, où apparemment il y avait des squelettes, mais je n'ai jamais pu être aussi aventureux, je les crus tout simplement sur parole. Plympton Castle se dressait sur un amphithéâtre, un grand espace rond entouré d'un talus surélevé. Le talus surélevé était un lieu de promenade très agréable, et la partie intermédiaire enfoncée — comme au centre d'une soucoupe — servait beaucoup pour les cirques et autres formes de divertissements publics.
Pour ma première école on m'envoya à un endroit appelé — de tous les noms improbables — Co-op Fields. Elle était ainsi nommée parce qu'à l'origine elle avait été la propriété de Plympton Cooperative Wholesale Society (la Coopérative de Vente en gros de Plympton — NdT). Le terrain avait été vendu pour recueillir des fonds pour quelque autre développement, et quelques maisons y avaient été construites, puis quelques-unes de plus, et quelques-unes encore, pour finir par devenir une communauté séparée, presque un petit village en soi. Et c'est là que j'allai à l'école. C'était — eh bien, je pense que c'était ce qu'on appellerait une École de Dames. Dirigée par Miss Gillings et sa sœur, ce n'était pas à proprement parler une école, mais une garderie où les parents envoyaient leurs enfants pour ne pas les avoir sur le dos. La marche depuis Ridgeway jusqu'à l'école de Miss Gillings était pour moi une terrible épreuve dans mon état maladif, mais je ne pouvais rien y faire, je devais y aller. Après un certain temps, toutefois, je fus considéré trop grand pour continuer à cette école et fus placé dans une École Préparatoire qu'on appelait ‘Mr Beard's School’. Mr Beard était un charmant vieil homme, un vieil homme réellement intelligent, mais il était incapable de faire régner la discipline.
Il avait pris sa retraite de l'enseignement et puis, trouvant la vie de retraité ennuyeuse, il avait ouvert sa propre école et n'avait pu trouver comme emplacement qu'une grande pièce attenante au George Hotel, situé au sommet de George Hill, un hôtel très réputé. On entrait en passant sous une arcade où le sol était pavé, puis pour arriver à l'école de Mr Beard, il fallait traverser toute la cour en passant devant toutes les anciennes écuries et les remises à calèches. À l'autre bout de la cour, il y avait des marches en bois qui montaient vers une pièce qui avait l'air d'une salle de réunion. Ce fut la première école où je commençai à apprendre quelque chose, et je n'y appris pas grand-chose, mais c'était ma faute et non pas celle du vieux Beard. En fait, il était beaucoup trop doux pour être un maître d'école et l'on profitait de lui.
Au bout d'un certain temps l'École Secondaire de Plympton rouvrit ses portes dans un nouvel emplacement. L'École Secondaire de Plympton était l'une des plus fameuses écoles secondaires d'Angleterre qui vit passer beaucoup de gens célèbres, y compris Joshua Reynolds (Sir Joshua Reynolds < 16 juillet 1723 – 23 février 1792 > est un peintre Britannique spécialiste de l'autoportrait et du portrait. Il fut le premier président de la Royal Academy — NdT). Dans l'ancienne École Secondaire à St Maurice, son nom et ceux de nombreux autres gens très connus étaient gravés sur les pupitres et les boiseries, mais cette école dut fermer vu que les ravages du temps avaient attaqué l'édifice et que les étages supérieurs étaient considérés comme dangereux.
Après une longue recherche, une très grande maison fut trouvée qui était située dans l'ombre de Plympton Castle, dans l'ombre, en fait, de cette partie ronde qui servait aux cirques.
D'énormes sommes furent dépensées pour sa transformation, et je fus l'un des premiers élèves à être inscrit à cette école. Je détestais l'endroit de tout cœur. Certains de ses enseignants avaient été démobilisés des forces armées et plutôt que de traiter les enfants comme des enfants, ils les traitaient comme des soldats bornés. Un professeur en particulier avait une habitude des plus vicieuses de casser des bâtons de craie en deux et d'en lancer chaque morceau de toutes ses forces à un fautif, et bien que vous puissiez penser qu'un morceau de craie ne peut pas causer beaucoup de dégâts, j'ai été témoin d'un garçon dont la figure fut lacérée par l'impact. De nos jours, je suppose que ledit professeur serait mis en prison pour sévices corporels, mais au moins, cela maintenait l'ordre dans la classe.
Pour la récréation, nous devions nous rendre aux terrains de jeu de l'ancienne École Secondaire, ce qui signifiait un mille (1,6 km) de marche : un mille pour aller, ensuite les exercices, etc., et un mille pour le retour.
Finalement, le temps vint de quitter l'école. Je n'y avais rien fait de très bien, mais alors, je n'y avais rien fait de très mauvais non plus. En plus du travail scolaire, je dus prendre des cours par correspondance et j'obtins un bon nombre de papiers me qualifiant pour ceci, cela, ou quelque chose d'autre. Mais quand vint le temps de quitter l'école, mes parents, sans une telle frivolité que celle de me demander ce que j'aimerais faire, me placèrent comme apprenti dans une entreprise de mécanique automobile de Plymouth. Ainsi, presqu'à partir du jour où je quittai l'école, on m'envoya dans cette entreprise de Old Town Street, à Plymouth. Ces gens vendaient quelques voitures, etc., mais ils étaient axés davantage sur les motos ; en fait, ils étaient les agents de Douglas motocycles pour le Devon du Sud. De nouveau, ce n'était pas un endroit sympathique parce que tout ce qui importait était le travail. Je quittais Plympton tôt le matin et voyageais par bus jusqu'à Plymouth, à cinq milles et demi (environ 9 km) de là. Quand arrivait l'heure du déjeuner j'étais affamé, aussi, indépendamment du temps qu'il faisait je partais avec mes sandwiches — il n'y avait rien d'autre à boire que de l'eau — et me rendais à un petit parc derrière l'église St Andrew, à Plymouth. Je m'asseyais dans ce parc et avalais mes sandwiches le plus rapidement possible, car autrement je me serais mis en retard pour le retour au travail.
C'était du très dur labeur en vérité, parce que nous, les apprentis, étions parfois envoyés à des endroits aussi éloignés que Crown Hill pour aller y chercher une lourde moto. Eh bien, nous y allions avec le bus — un seul apprenti par endroit, bien sûr — et il nous fallait alors faire face au problème de ramener les satanées motos. Nous ne pouvions pas les conduire puisqu'elles étaient défectueuses, et ce n'était que dans les descentes que nous avions la chance de les monter.
Je me souviens d'une fois où je dus aller à Crown Hill chercher une très grosse Harley Davidson. Le propriétaire nous avait téléphoné et expliqué que la moto se trouverait à l'extérieur ; c'est ainsi que je m'y rendis, descendis du bus, vis cette moto, donnai une poussée à son support et m'éloignai en la poussant. J'avais fait à peu près trois milles (4,8 km), quand une voiture de police s'arrêta juste en face de moi. Deux policiers en sortirent et je pensai qu'ils allaient me tuer ! L'un d'eux m'attrapa par le cou, l'autre m'empoigna les bras dans le dos, et tout cela si soudainement que la moto bascula et me blessa les tibias. La moto fut relevée sur le bord de la route et je fus poussé à l'arrière de la voiture de police et emmené au Poste de Police de Crown Hill. Là, un sergent de Police criait en me menaçant d'épouvantables peines de mort si je ne leur disais pas qui était mes complices.
Or, je n'étais pas très âgé à cette époque et je n'arrivais tout simplement pas à comprendre de quoi il parlait, ce qui fait qu'il m'administra des tapes sur les oreilles et me mis dans une cellule. Il ne voulait pas écouter l'explication que j'étais allé chercher une moto comme on me l'avait demandé.
Environ huit heures plus tard, un des hommes de la firme vint m'identifier et confirmer que j'étais allé tout à fait légitimement recueillir une moto défectueuse. Le sergent de police me gratifia d'une gifle au visage et me dit de ne plus leur causer d'ennuis et de ne plus les déranger. Ainsi, je n'aime pas la police, j'ai eu des ennuis toute ma vie avec la police et je jurerai ceci : jamais je n'ai fait quoi que ce soit qui justifie la persécution de la police. Chaque fois, la cause en était la négligence de celle-ci, comme cette fois où ils ne me permirent pas d'expliquer ce qui s'était produit.
Le jour suivant, cela dit, le propriétaire de la moto vint à l'entreprise et rit comme un fou. Il ne fit preuve d'aucune compassion, ne semblant pas avoir idée du choc que ce pouvait être d'être embarqué et enfermé dans une cellule de police.
Un jour, je n'arrivai pas à me lever, je me sentais malade, je me sentais tellement malade que j'aurais voulu mourir. Ce n'était pas une raison pour ne pas aller travailler ; ma Mère insista pour me faire sortir du lit. Finalement, je dus partir sans petit déjeuner, et le temps était humide et froid. Elle m'accompagna jusqu'à l'arrêt d'autobus et me poussa dans le vieux bus du Devon Motor Transport avec tant de rudesse, que je tombai à genoux.
J'arrivai au travail, mais environ deux heures plus tard je m'évanouis et quelqu'un expliqua que je devais être ramené à la maison, mais le responsable déclara qu'il n'avait pas de temps à perdre avec les ennuis des apprentis, et on me garda donc là jusqu'à la fin de la journée, sans petit déjeuner, sans déjeuner, sans rien du tout.
À la fin de la journée de travail, en proie à de terribles étourdissements, je marchai le long de la rue jusqu'à l'arrêt d'autobus en face de l'église St Andrew. Heureusement, un bus attendait et je m'effondrai dans un siège du coin. Arrivé à la maison, j'eus tout juste assez de force pour chanceler jusqu'à mon lit. Personne n'était intéressé à mon état de santé, personne ne me demanda comment je me sentais, personne ne me questionna pour savoir pourquoi je ne pouvais pas manger ; j'allai tout simplement au lit.
Je passai une nuit épouvantable, je me sentais en feu et j'étais baigné de sueur. Au matin, ma Mère vint me réveiller assez brusquement — car j'étais tombé dans un sommeil épuisé — et même elle pouvait voir que je n'étais pas bien. Elle finit par téléphoner au Dr Stamp. Il arriva une demi-journée plus tard. Il me jeta un coup d'œil et dit : ‘L'hôpital !’ Ainsi l'ambulance arriva — en ce temps-là l'ambulance était conduite par l'entrepreneur local des pompes funèbres — et je fus emmené au South Devon and East Cornwall Hospital. J'avais une très grave maladie pulmonaire.
Je passai onze semaines à cet hôpital, et on discuta ensuite longuement pour savoir si l'on m'enverrait ou non en Sanatorium, parce que j'étais atteint de tuberculose.
Père et Mère s'y opposèrent parce que, dirent-ils, ils n'auraient pas le temps de venir me rendre visite si j'étais envoyé au Sanatorium à quelques milles (km) de chez nous. Je restai donc à la maison et ma santé ne s'améliorait guère. De temps en temps, il me fallait retourner à l'hôpital. Puis ma vue me donna des ennuis et on m'envoya au Royal Eye Infirmary, à Mutley Plain, qui n'était pas très loin du South Devon and East Cornwall Hospital. C'était un hôpital très agréable, si on peut dire que quelque chose soit agréable quand on est aveugle. Mais finalement, je reçus mon congé de l'hôpital avec une vue très déficiente et je retournai à la maison.
À ce moment-là, le sans-fil (la télégraphie sans fil ou TSF — NdT) était bien connu — le sans-fil existait avant la radio. Mon Père possédait un récepteur à cristal et je pensais que c'était la chose la plus merveilleuse que j'aie jamais vue dans ma vie. Père étudiait beaucoup la radio et il fabriqua de très grands appareils de radio contenant plusieurs lampes, puis il monta une affaire de fabrication d'appareils radio et faisait aussi des travaux électriques pour les gens.
À ce stade il fut décidé qu'il me fallait un changement d'air, et c'est ainsi que, malade comme je l'étais, on me mit sur une vieille bicyclette et on m'envoya, en compagnie d'un ouvrier, à Lydford où j'y avais une tante. J'ai souvent souhaité que cette tante fût ma mère. C'était vraiment une très bonne femme, et je l'aimais comme je n'ai certainement jamais aimé ma Mère. Elle s'occupa de moi, elle me traita vraiment comme si j'étais l'un de ses propres enfants et, comme elle le dit, ce n'était pas génial de faire faire vingt-cinq milles (40 km) à bicyclette à un enfant malade quand il pouvait difficilement respirer. Mais je dus finalement retourner chez moi et le trajet fut beaucoup plus facile cette fois. Lydford est là-haut dans les landes du Devonshire, en haut dans Dartmoor au-delà de Tavistock, non loin de Okehampton, et l'air y était pur et la nourriture y était bonne.
De retour chez moi à Plympton, je commençai à prendre d'autres cours par correspondance, mais mes études furent interrompues par ma Mère qui décida que je devais travailler. Comme mon Père avait un stock de postes de radio et de matériel électrique à vendre, on me chargea d'aller placer ces articles chez les petits revendeurs. Je parcourus Elburton, Modbury, Okehampton, et autres endroits comme ceux-là pour vendre des accumulateurs, des pièces de radio, et du matériel électrique. Mais après un certain temps, cette existence se révéla trop harassante pour ma santé qui, de nouveau, lâcha. J'étais au volant d'une voiture quand je fus pris soudain de cécité. Or, c'est quelque chose d'extrêmement pénible de perdre complètement et carrément la vue en conduisant. Heureusement, je pus arrêter la voiture sans aucun dommage et je restai tout simplement là où j'étais jusqu'à ce que quelqu'un vienne voir ce qui se passait et pourquoi je bloquais la circulation. Pendant un moment, je ne pus convaincre les gens que j'étais malade et que je ne pouvais plus voir, mais ils finirent par appeler la police qui me fit transporter à l'hôpital par ambulance. La première pensée de mes parents, quand on les informa, fut pour la voiture. Quand on la ramena à la maison, on découvrit que tout ce que j'y avais à l'intérieur avait été volé : postes de radio, batteries, équipement d'essai, tout. Je ne fus pas apprécié. Mais un séjour à l'hôpital me remit d'aplomb pour un temps, et je retournai ensuite à la maison.
J'étudiai un peu plus et il fut finalement décidé que je devais essayer d'obtenir une formation d'opérateur radio. Comme il existait dans les faubourgs de Southampton une école spéciale formant les opérateurs radio d'aviation, je partis donc pour Southampton. J'y étudiai pendant un certain temps, passai mes examens et obtins une licence d'opérateur sans-fil (radiotélégraphiste — NdT) de première classe. Je dus aller à Croydon pour passer l'examen, et je le réussis. En même temps, j'appris à piloter un avion et je pus tout autant en obtenir une licence. Mais — je fus recalé pour une licence commerciale à l'examen médical et je fus cloué au sol avant même d'avoir débuté dans la carrière.
De retour à la maison, on me blâma beaucoup pour ma mauvaise santé et pour gaspiller de l'argent en prenant ces cours quand ma santé était défaillante au point de ne pouvoir être accepté. J'en fus plutôt irrité, parce que je n'étais pas responsable de mon état de santé : je ne voulais pas être malade. Mais il y eut une grande réunion familiale et mes parents décidèrent qu'il fallait faire quelque chose, que je ne faisais que gaspiller ma vie.
Au même moment l'inspecteur sanitaire local, qui était très lié avec mes parents, leur dit qu'il y avait une excellente ouverture pour les inspecteurs de fumée, particulièrement dans les grandes villes ; les gens commençaient à se préoccuper de l'écologie et il y avait trop de pollution causée par les fumées d'usines et les entreprises industrielles, aussi une nouvelle catégorie d'inspecteurs avait-elle commencé. Il y avait, bien sûr, des inspecteurs sanitaires et des inspecteurs sanitaires qui étaient inspecteurs des viandes, mais il y avait maintenant une nouvelle catégorie — inspecteurs des fumées. L'inspecteur sanitaire en chef déclara que c'était fait pour moi, que c'était un bon travail, bien payé, et que j'aurais besoin de prendre un cours spécial, naturellement. Un nouveau cours par correspondance venait d'être mis sur pied pour les inspecteurs de fumée. J'étudiai à la maison et je réussis très rapidement l'examen — en trois mois, en fait — et on me dit par la suite que je devais me rendre à Londres pour étudier au Royal Sanitary Institute à Buckingham Palace Road. De mauvaise grâce, mes parents avancèrent l'argent et je partis pour Londres. J'assistai chaque jour aux cours au Royal Sanitary Institute, et nous avions souvent des sorties éducatives dans les usines, les centrales électriques, et toutes sortes d'endroits bizarres. Finalement trois mois plus tard, nous nous rendîmes dans une immense salle d'examen où semblaient fourmiller des milliers de personnes. Nous étions partagés en petits groupes : ceux qui s'apprêtaient à passer un examen particulier allaient être isolés des autres qui allaient passer le même type d'examen. Bref, je passai l'examen et obtins mon certificat d'inspecteur de fumée.
Je retournai à Plympton avec mon certificat en pensant que maintenant tout irait comme sur des roulettes. Mais ce ne devait pas être. Je postulai pour un travail à Birmingham et je me rendis à Birmingham — à Lozelles — pour une entrevue. Là, on me dit que je ne pouvais pas obtenir le poste parce que je ne résidais pas dans ce comté.
De retour à Plympton, j'essayai d'obtenir un emploi à Plymouth. Mais le conseil municipal de Plymouth ne pouvait m'employer pour à peu près la même raison, sauf que j'étais dans le bon comté mais pas dans la bonne ville. Et il en fut ainsi jusqu'à ce que, après quelques années durant lesquelles je fis tout ce que je pus — tout pour gagner suffisamment d'argent pour maintenir ensemble corps et âme et tâcher d'avoir quelque chose à me mettre sur le dos — mon Père mourut. Il avait été en très mauvaise santé pendant des années. Il était au lit la plupart du temps, et environ un an avant sa mort son entreprise fut vendue et le magasin fut transformé en cabinet médical. Les fenêtres furent peintes en vert et le magasin lui-même devint le cabinet avec, comme salle de consultation et d'infirmerie, la partie où nous vivions. Ma Mère et moi dûmes nous installer dans ce qui avait été notre atelier.
Mais après la mort de Père, l'association médicale décida de déménager dans un nouveau secteur, nous laissant ainsi sans aucun revenu. Ma santé n'était pas bonne du tout, aussi ma Mère alla vivre chez sa fille, ma sœur, et comme j'avais été un étudiant de valeur d'un établissement d'enseignement par correspondance, j'obtins un emploi pour une firme d'appareils chirurgicaux à Perivale, Middlesex. Je fus d'abord nommé manager des travaux, mais quand le propriétaire de l'entreprise constata que j'étais en mesure de rédiger un bon texte publicitaire, il me mit également en charge de la publicité.
Je dus prendre des cours dans l'installation des équipements chirurgicaux et je devins ensuite consultant en installation de ces équipements.
Je fus considéré tellement bon dans ce travail qu'on me déplaça de Perivale au cœur de Londres, où je fus installateur en chef dans les bureaux de Londres.
La guerre fut déclarée entre l'Angleterre et l'Allemagne un jour que je terminais ma journée de travail. Dès lors, tout était plongé dans l'obscurité et je trouvais chaque jour le trajet Perivale-Londres-Perivale absolument épuisant, il mettait totalement mes forces à l'épreuve, sans parler que durant cette période, je me mariai. Mais je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit à ce sujet, car je vois que la presse sur Terre en a déjà trop parlé, et de façon presque toujours mensongère. On m'a demandé de parler de ma vie, et donc je m'en tiendrai strictement à ma vie.
Nous ne pouvions continuer à vivre à Perivale parce que les conditions de déplacement étaient trop mauvaises, aussi nous finîmes par trouver un appartement dans le quartier Knightsbrigde de Londres. C'était une bénédiction de pouvoir me rendre chaque jour à mon bureau par le métro.
La guerre s'intensifiait, les choses devenaient difficiles, il y avait de rigoureux rationnements et des pénuries alimentaires. Londres était lourdement bombardée. Une grande partie de mon temps passait à la surveillance des incendies ; je devais escalader des échelles de fer rouillé jusqu'au sommet des bâtiments et surveiller l'approche des bombardiers Allemands, et si je les apercevais à temps, je devais donner l'alarme aux travailleurs d'en bas.
Un jour que je me rendais au travail à bicyclette en roulant à travers Hyde Park, je vis approcher des bombardiers. L'un d'eux fit tomber des bombes qui me semblèrent venir un peu trop près dans ma direction, aussi je lâchai ma bicyclette et courus me mettre à l'abri des arbres. Les bombes tombèrent, manquèrent le Parc et atterrirent dans Buckingham Palace où elles causèrent de considérables dommages.
Les bombes semblaient tomber partout. Un jour, je dus sortir pour un cas d'ajustement chirurgical spécial et j'approchais Charing Cross Station quand une grosse bombe tomba soudainement des nuages et traversa de part en part la station jusqu'au métro qui était bondé de monde. Je revois encore le nuage de poussière et les morceaux épars de — quoi ? — qui étaient soufflés hors du trou dans le toit de la station.
Une nuit, il y eut un énorme raid aérien et l'endroit où ma femme et moi vivions fut bombardé. Nous dûmes sortir en pleine nuit dans la tenue où nous étions. Pendant longtemps nous errâmes dans l'obscurité, comme tant d'autres gens. Tout était chaotique. Les bombes tombaient et le ciel était rouge des flammes de l'incendie d'East End. La Cathédrale St Paul se silhouettait contre les flammes, tandis que vers le ciel montaient de grands nuages de fumée. De temps en temps nous entendions le rat-tat-tat des mitrailleuses, et parfois des cartouches vides tombaient autour de nous. De partout tombaient des éclats d'obus et nous portions nos casques en acier, car les fragments fumants qui s'écrasaient auraient transpercé un corps non protégé.
L'aube arriva enfin et je téléphonai à mon employeur pour lui dire que j'avais été victime d'un bombardement. Il me répondit : "Peu importe, tu dois te présenter au travail. D'autres gens aussi sont dans le même cas." Ainsi, sale et affamé, je montai dans un train et me rendis au bureau. En approchant de notre rue, je m'aperçus que l'accès en était interdit. Je tentai de passer la barrière, mais un policier très zélé arriva et m'accusa de pillage — les tempéraments étaient rudes en ce temps-là. À ce moment précis mon patron sortait de sa voiture et venait vers moi. Il montra ses papiers d'identification au policier et nous traversâmes ensemble la barrière, nous rendant au bureau.
L'eau fuyait de partout. L'endroit avait été touché par une bombe et l'équipement de l'approvisionnement d'eau avait été mis en pièces. Du toit, plusieurs étages au-dessus, l'eau cascadait sur la marchandise. Le sous-sol était inondé et il y avait du verre partout, il y avait des fragments de pierres partout, et en nous tournant nous découvrîmes une enveloppe de bombe logée dans un mur.
Tout était dans un état de chaos. Il n'y avait pas grand-chose qui valait la peine d'être sauvé. Nous réussîmes à récupérer quelques documents et seulement quelques pièces d'équipement, et nous nous mîmes tous à essayer de nettoyer un peu l'endroit, mais c'était inutile — il n'y avait aucun espoir qu'il soit de nouveau remis en état. Finalement mon employeur expliqua qu'il partait s'installer dans une autre partie du pays et m'invita à l'accompagner. Je ne pouvais le faire parce que je n'avais pas l'argent. C'était vraiment très difficile d'acheter des choses, et devoir me réinstaller dans une partie éloignée du pays était une dépense que je ne pouvais tout simplement pas envisager. Ainsi — parce que je ne pouvais pas le suivre, je perdis mon job en pleine guerre.
Je me présentai à divers bureaux de placement pour tenter d'obtenir un quelconque emploi. J'essayai de devenir policier de guerre, mais je ne pus passer l'examen médical. Les conditions de vie devenaient désespérées : on ne peut pas vivre de l'air du temps, et en dernier recours je me rendis au bureau de l'école par correspondance où j'avais pris tant de cours.
Il s'avéra qu'ils avaient besoin d'un homme, un de leurs hommes ayant été mobilisé, et j'avais — me dit-on — un dossier enviable qui pourrait me permettre d'obtenir un poste au service consultatif. Le salaire serait de cinq livres par semaine et je devrais vivre dans le Surrey, à Weybridge. Non, me fut-il dit, ils ne pouvaient rien m'avancer pour m'aider à m'y rendre. Il me fallait y aller d'abord pour une entrevue avec l'un des directeurs. Je me renseignai donc et constatai que le moyen de transport le moins onéreux était par le Green Line Bus, aussi, au jour fixé je me rendis à Weybridge, mais il y eut une formidable attente, le directeur ne s'étant pas présenté. On me dit :
— Oh, il n'arrive jamais à l'heure dite, il se peut qu'il ne vienne pas avant quatre heures. Vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre.
Il finit par se présenter, me reçut, fut très affable, et m'offrit le poste à cinq livres par semaine. Il m'annonça qu'il y avait un appartement inoccupé au-dessus du garage et que je pouvais l'avoir en payant ce qui était vraiment un loyer assez élevé, mais j'étais pressé d'avoir un emploi et j'acceptai alors ses conditions. Je retournai à Londres et nous empaquetâmes nos pauvres choses, telles qu'elles étaient, et emménageâmes à Weybridge, en haut du vieil escalier en bois de l'appartement au-dessus des garages. Je débutai le lendemain mon travail comme employé affecté à la correspondance — c'est réellement ce dont il s'agissait — à une école de correspondance.
Il existe tellement de termes terriblement prétentieux : les collecteurs d'ordures sont maintenant appelés experts sanitaires quand ils ne font vraiment que ramasser les ordures. Certains employés à la correspondance se nommaient eux-mêmes conseillers consultatifs ou consultants en carrières, et pourtant nos seules fonctions étaient celles de commis à la correspondance.
Il semble que ce soit un crime que d'être d'une certaine catégorie. On m'a toujours dit que mon Père était plombier ; en fait, il ne l'était pas, mais quel mal y aurait-il eu à ce qu'il l'ait été ? Certes, il a fait un apprentissage de plombier mais, tout comme moi, il n'avait pas le choix. J'ai fait un apprentissage en mécanique automobile. Et de toute façon, que dire du célèbre Mr Crapper, le gentleman qui inventa le cabinet de toilette que nous connaissons actuellement ? Il n'a pas été amélioré depuis le temps de ce vieux Crapper. Ce monsieur — si vous vous souvenez — était un plombier, et un rudement bon plombier, aussi, et son invention du système des toilettes à chasse d'eau le rendit très cher au Roi Edward qui le traita comme un ami personnel. Ainsi, voyez-vous, un plombier peut être l'ami d'un roi tout autant que peut l'être un épicier : Thomas Lipton était censé être un épicier. Il l'était certainement ; il possédait une grande entreprise alimentaire, et était un ami du Roi George V. Ce qu'était le métier du père d'une personne n'a sûrement pas d'importance. Pourquoi serait-il si honteux d'avoir un parent qui était commerçant ? De nos jours, des filles de familles royales sont mariées à des commerçants, n'est-ce pas ? Mais cela m'amuse toujours parce que Jésus, dit-on, était le fils d'un charpentier. En quoi cela serait-il une disgrâce ?
Tout cela m'a considérablement éloigné de mon histoire ; mais je tiens à affirmer que je préfère de beaucoup être fils d'un plombier que fils de ces pauvres types qui s'appellent eux-mêmes journalistes. Pour moi, il n'y a pas de travail plus dégoûtant que celui de journaliste. Un plombier débarrasse les gens de leurs saletés. Un journaliste les couvre de saletés.
Depuis que je suis venu ici, j'ai découvert diverses choses d'intérêt, mais une chose en particulier qui me fascine est celle-ci : je porte un nom fort honorable non seulement par ‘Oncle Richard’, mais par d'autres qui l'ont précédé, dont l'un qui était un collègue de Sir Joshua Reynolds, et un autre qui était Lord Lieutenant (représentant de la Couronne dans un comté de Grande-Bretagne — NdT), ou quel qu'ait pu être son titre, de la Tour de Londres. Et cela se passait au temps où il y eut une tentative de vol des Joyaux de la Couronne, une tentative qui a été déjouée.
Il y a beaucoup à voir ici, beaucoup à apprendre, et on me dit que j'ai encore énormément à apprendre parce que, disent-ils, je n'ai pas encore appris l'humilité, je n'ai pas encore appris à m'entendre avec les gens. Eh bien, je fais de mon mieux en dictant toutes ces choses qui, je le jure sur une pile de Bibles, sont la vérité et rien d'autre que la vérité.
Chapitre Neuf
La vie à Weybridge n'était pas gaie. Je devins guetteur d'attaques aériennes. Un autre guetteur se prit d'une forte jalousie à mon égard et fit tout ce qu'il put pour me causer du tort. J'offris ma démission, mais on ne voulut pas l'accepter.
Une nuit, il y eut une attaque aérienne pendant que j'étais à Weybridge, et après l'attaque un policier apparut à ma porte. Apparemment, une petite lumière — à peine suffisante pour que quiconque s'en aperçoive à cent pieds (30 m) de distance — se voyait. Il y avait un interrupteur défectueux dans l'appartement, sur le palier, un de ces anciens interrupteurs en laiton avec un gros bouton, et je suppose que la vibration causée par les détonations et tout cela, l'avaient secoué en position ‘on’. Le policier pouvait bien voir par lui-même que la lumière s'allumerait même à l'éternuement d'une mouche, le ressort du levier basculant étant défectueux. Mais, non, il y avait de la lumière, un point c'est tout. Il y eut donc une comparution en Cour et une amende. Et c'est quelque chose qui m'a fort contrarié depuis lors, parce que c'était totalement injustifié : c'est le surveillant ‘ennemi’ qui m'avait dénoncé. Après cela, je démissionnai de l'A.R.P. (Air Raid Precautions — NdT), convaincu que si les gens ne pouvaient pas travailler ensemble, il valait mieux se séparer de ‘l'équipe’.
À Weybridge, j'étais censé tout faire : répondre aux lettres, persuader les gens de prendre des cours par correspondance, entretenir les voitures du patron — et il était toujours en train de changer les satanés engins — servir de garçon de courses non rémunéré et faire tout ce qui se présentait. Tout cela pour cinq livres par semaine !
Les gens étaient appelés sous les drapeaux, les conditions de vie devenaient plus difficiles, la nourriture manquait de plus en plus, et il y avait toujours d'étranges bruits venant de l'usine d'avions de Brooklands. Un jour qu'un Wellington était testé en vol, il s'écrasa juste à côté du village de Weybridge. Le pilote sauva le village au prix de sa propre vie, puisqu'il dirigea son avion sur la ligne ferroviaire électrifiée. L'avion était comme un jouet cassé en mille morceaux, éparpillés un peu partout, mais les gens de Weybridge furent sauvés par le sacrifice du pilote.
C'est à ce moment-là que je reçus mes papiers m'informant que j'étais appelé. Je devais me présenter devant le Comité des Médecins Légistes, une formalité avant d'entrer dans l'un des Services.
Au jour fixé, je me rendis dans la grande salle où il y avait une foule d'autres hommes attendant d'être examinés. Je dis au préposé qui était là : "J'ai eu la T.B., vous savez." Il me jeta un regard et me dit : "C'est vrai que tu as l'air plutôt mal en point, jeune homme. Assieds-toi là-bas." Je m'assis donc à l'endroit indiqué, et j'attendis, j'attendis. Finalement, quand à peu près tout le monde dans la salle eut été examiné, l'un des médecins du comité se tourna vers moi :
— Qu'est-ce que c'est ? déclara-t-il. Vous dites que vous avez eu la T.B. ? Vous savez ce que c'est que la T.B. ?
— Je le sais très certainement, monsieur, répondis-je. Je l'ai eue.
Il me posa un tas de questions, puis grogna et grogna. Il eut ensuite un mot avec ses associés. Il se tourna finalement vers moi comme s'il prenait la décision la plus importante au monde :
— Je vous envoie à Kingston Hospital. On vous y examinera et on saura immédiatement si oui ou non vous êtes tuberculeux ; si vous ne l'êtes pas... que Dieu vous aide !
Il remplit soigneusement un formulaire, le scella, le mit dans une autre enveloppe qu'il scella aussi et qu'il me jeta ensuite à la volée. Je la ramassai sur le sol et rentrai chez moi.
Le lendemain, j'informai mon employeur que je devais aller à l'hôpital me faire examiner. Il parut absolument ennuyé, j'eus l'impression qu'il pensa : "Ah pourquoi ce type me fait-il perdre mon temps, pourquoi ne s'engage-t-il pas et que je ne le revois plus". Toutefois, je terminai mon travail ce jour-là, et le lendemain, tel qu'indiqué, je pris le bus pour Kingston-on-Thames. Je me rendis à un hôpital de l'endroit. Je subis toutes sortes de tests, puis je fus radiographié. Après la radiographie, on me poussa dans un placard à séchage où un tas de radiographies humides étaient accrochées pour sécher. Une demi-heure plus tard une femme vint me dire : "Bien, vous pouvez rentrer chez vous !" Ce fut tout, rien de plus ne fut ajouté, et je rentrai simplement à la maison.
Arriva ensuite une convocation pour aller à la Clinique de Tuberculose à Weybridge. Bien sûr, elle arriva trois ou quatre semaines plus tard ; ainsi donc, la convocation m'arriva et je me rendis à la Clinique de Tuberculose comme un bon petit garçon. Depuis le temps, j'étais profondément écœuré par toute cette affaire. À la Clinique de Tuberculose, je fus reçu par le plus merveilleux médecin qui soit, un homme qui était vraiment tout ce qu'un médecin devrait être. Il avait mes radiographies en main, et il m'accorda que c'était absolument stupide que je sois ballotté d'un département à un autre. Il me dit qu'il était parfaitement évident que j'avais de mauvaises cicatrices aux poumons dues à la tuberculose et que si j'entrais dans l'Armée, je serais un boulet, pas un atout. L'Angleterre n'en était sûrement pas arrivé au point d'enrôler ceux qui étaient visiblement malades.
— Je vais envoyer, me dit-il, un rapport déclarant que vous êtes inapte à tout service.
Le temps passa et je finis par recevoir une carte par la poste m'informant que je ne serais pas demandé pour le service militaire puisque j'étais classé au Niveau Quatre — soit au plus bas niveau.
Je montrai ma carte à mon employeur et il sembla penser que — eh bien, qu'il aurait quelqu'un pour poursuivre le travail si tous les autres étaient appelés. À ce moment-là, il y avait une ruée frénétique de gens essayant d'obtenir un sursis d'incorporation, tout un chacun essayait d'obtenir un sursis. L'homme qui était manager sous notre employeur quitta pour trouver un autre emploi et un autre fut nommé à sa place, mais lui et moi ne nous entendions pas du tout, mais alors pas du tout. Il était d'un type que je détestais à fond et il sembla que je fus d'un type qu'il détestait tout autant. Toutefois, je fis de mon mieux, mais les choses devinrent de plus en plus difficiles parce qu'il y avait de plus en plus de travail sans aucune augmentation de salaire. Il était évident que quelqu'un se précipitait chez l'employeur pour lui rapporter des histoires, etc., des histoires pas nécessairement véridiques non plus.
Un jour après le travail, je me promenais simplement dans le jardin. Nous avions un jardin de trois acres et demie et je passai par un petit taillis boisé. C'était le soir et le crépuscule croissait. Je ne sais comment, je trébuchai contre une racine dénudée et m'étalai de tout mon long avec un horrible thonk qui me fit sortir littéralement et brutalement de moi-même !
Je me relevai, mais alors — que Dieu bénisse mon âme ! — je découvris que ‘je’ n'étais pas ‘moi’, car je me tenais debout et mon corps était étalé face contre terre. Je regardai autour de moi avec plus que de l'étonnement, et vis des gens à l'air étrange autour de moi. Des moines, pensai-je, mais que diable des moines pouvaient-ils bien faire ici ? Je les regardai, puis regardai — eh bien, ce que je supposais être mon corps sur le sol. Mais alors, j'entendis une voix ou quelque chose dans ma tête. J'eus d'abord l'impression d'un jargon étranger, mais en écoutant, j'eus la surprise de découvrir que je le comprenais.
"Jeune homme, dit la voix dans ma tête, vous pensez d'une manière diabolique, vous pensez à en finir avec votre vie. C'est quelque chose de véritablement très mal. Le suicide est injustifiable, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la raison imaginée ou l'excuse, le suicide est toujours injustifié."
"C'est facile pour vous de parler ainsi, pensai-je, vous n'avez pas les problèmes que j'ai. Je suis là, dans ce — eh bien, j'eus le plus grand mal à me retenir pour ne pas dire exactement ce que je pensais de ce lieu de travail — je ne peux obtenir d'augmentation, et mon patron semble m'avoir pris en grippe : pourquoi devrais-je rester ici ? Il y a plein d'arbres à proximité et une belle corde à y suspendre."
Mais je n'en dirai pas plus sur ce sujet, parce qu'une pensée fut mise dans mon esprit affirmant que si je le désirais, je pouvais être libéré de ce que je considérais comme les tortures de la Terre. Si je le désirais, si j'étais vraiment sérieux, je pouvais faire quelque chose pour l'humanité en rendant mon corps disponible pour quelque fantôme ou esprit qui voulait y pénétrer presque avant que j'en sorte. Cela me parut un tas de sottises, mais je pensai que j'allais tenter le coup et je les laissai parler. Tout d'abord, me dirent-ils, comme une marque de véritable intérêt, je devais changer mon nom. Ils me donnèrent un nom étrange qu'ils voulaient que j'adopte, mais — eh bien, je ne confiai à ma femme que le fait que j'allais changer mon nom ; elle me crut un peu dérangé ou je ne sais trop, mais elle en resta là, et je changeai ainsi de nom tout à fait légalement.
Puis, mes dents commencèrent à me donner des problèmes. Je passai une horrible période. Finalement, n'y tenant plus, j'allai voir un dentiste local. Il essaya d'extraire la dent, mais sans succès. Il fit un trou dans la chose afin de pouvoir utiliser un élévateur — non pas celui qui permet aux gens de passer d'un étage à un autre, mais celui qui sert à soulever une dent par levier. Ce dentiste téléphona à un spécialiste de Londres, et je dus me rendre en toute hâte dans une maison de soins infirmiers.
Ma femme informa mon employeur que je devais me rendre dans une maison de soins infirmiers, et elle se vit répondre : "Eh bien, je dois quand même travailler quand j'ai un mal de dents !" Et ce fut là toute la sympathie que nous eûmes. J'allai donc dans cette maison de soins infirmiers, à mes frais, bien entendu, car il n'y avait rien de tel que les systèmes de santé qui semblent exister à présent, et je subis cette petite opération qui n'était pas si facile que cela, après tout. Le dentiste était bien, et l'anesthésiste était encore meilleur. Je restai une semaine dans la maison de soins infirmiers, puis je retournai à Weybridge.
Il y eut plusieurs petits incidents désagréables, des tracasseries et tout ce genre de chose, ainsi que d'injustes accusations. Il est inutile d'entrer dans tous les détails, de ratisser le fumier parce que, après tout, je ne suis pas un journaliste. Mais il y eut de fausses accusations, et après discussion, ma femme et moi décidèrent que nous n'en pouvions plus, et je donnai ainsi ma démission. À partir de ce moment, j'aurais pu avoir la lèpre, ou quelque autre fléau, parce que pour le reste de la semaine je restai assis dans mon bureau sans que personne ne vienne me voir — selon les ordres apparemment reçus — et aucun travail d'aucune sorte ne me fut donné. Je restai là tout simplement comme un condamné purgeant sa peine. À la fin de la semaine, enfin, j'en avais terminé.
Nous quittâmes Weybridge avec joie et partîmes pour Londres. Nous déménageâmes si souvent que j'en oublie le nombre d'endroits, ce qui d'ailleurs importe peu, mais nous trouvâmes les conditions intolérables et finîmes par venir habiter une banlieue de Londres, appelée Thames Ditton.
Oh, j'ai tellement hâte d'en finir avec toute cette stupide histoire — je n'aime pas parler de tout cela — que dans ma hâte j'ai oublié une chose. La voici : il y a quelque temps, on m'a dit qu'il me faudrait me faire pousser une barbe. Eh bien, pensai-je, quelle importance ? Autant être pendu pour un mouton que pour un agneau, alors, pendant que j'étais à Weybridge je me suis fait pousser cette barbe, et je me suis fait joliment railler par mon employeur et par ceux avec qui je travaillais. Aucune importance, pensai-je, je ne serai pas avec eux beaucoup plus longtemps.
Nous déménageâmes à Thames Ditton. Pendant une brève période, nous restâmes dans une pension gérée par une drôle de vieille femme qui ne pouvait tout simplement pas voir la saleté. Elle croyait habiter un manoir ducal, ou quelque chose du genre, et était tout à fait incapable de voir d'immenses toiles d'araignées tout en haut des coins de l'escalier. Mais elle était trop distinguée et nous cherchâmes un autre endroit. Au bas de la rue, nous trouvâmes une maison d'appartements en paliers qui était mise en location. Bien que n'ayant pas la moindre idée comment nous allions obtenir l'argent puisque j'étais sans travail, sans travail du tout, nous y emménageâmes. Je faisais plutôt n'importe quoi pour gagner les quelques pièces de monnaie qui nous permettraient de survivre. J'allai au Bureau de Chômage, mais parce que j'avais quitté mon emploi au lieu d'être renvoyé, je ne fus en mesure d'obtenir aucune allocation de chômage. C'est ainsi que jamais je ne reçus la moindre allocation ; comment je pus réussir à m'en passer, je me le demande encore aujourd'hui, mais j'y suis arrivé.
J'avais une vieille bicyclette que j'utilisais pour tâcher de trouver du travail, mais non, aucun travail disponible. La guerre venait de finir, les hommes étaient démobilisés, et le marché du travail se trouvait saturé. C'était bien pour eux puisqu'ils avaient des prestations de chômage et peut-être une pension ; je n'avais rien.
Puis, une nuit, je fus approché par un groupe d'hommes. Ils me tirèrent hors de mon corps, me parlèrent, et me demandèrent si j'étais toujours désireux de quitter mon corps et aller dans ce que je pensais être le Paradis. Je suppose que c'est le Paradis, mais ces gens l'appelaient le monde astral. Je leur assurai que je le désirais plus que jamais, et ils me répondirent que je devais rester chez moi le lendemain. L'un de ces hommes — il était tout drapé dans une robe jaune — m'emmena à la fenêtre et en pointant il me dit : "Cet arbre — vous devez aller à cet arbre et empoigner cette branche, vous vous hissez et puis vous lâchez." Il me donna l'heure exacte à laquelle je devais le faire, me disant qu'il était tout à fait essentiel de suivre les instructions à la lettre, autrement je souffrirais beaucoup et d'autres personnes également. Mais le pire, pour moi — je n'arriverais pas à quitter cette Terre.
Le lendemain, ma femme pensa que j'avais perdu la tête, ou peu s'en fallait, parce que je restai à la maison plutôt que de sortir comme d'habitude. Puis, une ou deux minutes avant l'heure dite, j'allai dans le jardin et me dirigeai vers l'arbre. Je tirai sur une branche de lierre, ou quel que soit le nom de ce qui attache le lierre, grimpai pour atteindre la branche indiquée. Et je tombai alors comme si j'avais été frappé par la foudre. Je n'eus aucun besoin de faire comme si j'allais tomber, je tombai — je m'abattis ! Je tombai, et puis — bonté divine ! — je vis une corde d'argent qui sortait de moi. Je cherchai à m'en saisir pour voir ce que c'était, mais mes mains furent doucement tenues à distance. J'étais étendu là, sur le sol, ayant terriblement peur, car deux personnes faisaient quelque chose à cette corde, et une troisième était là, avec dans sa main une autre corde d'argent, et, horreur des horreurs, je pouvais voir à travers eux tous ; je me demandai si je voyais vraiment tout cela ou si mon cerveau m'avait quitté. C'était tellement étrange.
Finalement, il y eut une sorte de bruit de succion et un plop, et je m'aperçus — ô joie sans pareil — que je flottais librement dans un beau, très beau monde, et cela signifie qu'étant arrivé jusqu'ici, j'en ai fini avec ma partie du contrat ; j'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de ma vie passée, et je retourne maintenant à ma propre partie du monde astral...
Je suis Lobsang Rampa, et j'ai fini de transcrire ce qui me fut livré de si mauvaise grâce, si à contrecœur, par la personne dont j'ai pris la relève du corps. Permettez-moi de continuer là où il s'est arrêté.
Son corps était sur le sol, tremblant légèrement, et moi — eh bien, je confesse sans grande honte que je tremblais aussi, mais mes tremblements étaient causés par l'effroi. Je n'aimais pas l'aspect de ce corps étendu là devant moi, mais un lama du Tibet obéit aux ordres, agréables ou non, aussi je me tins près du corps tandis que deux de mes frères lamas se débattaient avec la Corde d'Argent de l'homme. Il leur fallait attacher la mienne avant que la sienne ne soit débranchée complètement. Le pauvre type était, fort heureusement, complètement étourdi et ne bougeait pas.
Enfin, après ce qui me parut des heures, mais qui en fait n'était qu'environ un cinquième de seconde, ils attachèrent ma Corde d'Argent et détachèrent la sienne. Il fut rapidement emmené, et je regardai ce corps auquel j'étais maintenant attaché et frissonnai. Mais alors, obéissant aux ordres, je laissai ma forme astrale s'enfoncer dans ce corps qui allait être le mien. Ooh, le premier contact fut terrible, froid, visqueux. Je bondis de nouveau dans les airs, effrayé. Les deux lamas s'avancèrent pour me stabiliser et, petit à petit, je m'enfonçai à nouveau.
Encore une fois je pris contact, et je frémis d'horreur et de répulsion. C'était vraiment une expérience invraisemblable, choquante, et une expérience que je ne veux plus jamais connaître.
Je semblais être trop large, ou le corps semblait être trop étroit. Je me sentais contracté, je me sentais compressé à mort, et l'odeur ! La différence ! Mon vieux corps était en lambeaux et se mourait, mais au moins c'était mon propre corps. Maintenant, j'étais coincé dans cette chose étrangère et je n'aimais pas ça du tout.
D'une façon ou d'une autre — et je ne peux pas expliquer ceci — je tâtonnai à l'intérieur en essayant de saisir les nerfs moteurs du cerveau. Comment parvins-je à faire marcher cette maudite chose ? Pendant un moment, je restai étendu, impuissant et comme paralysé. Le corps se refusait à fonctionner. J'avais l'impression d'être maladroit comme un conducteur inexpérimenté avec une voiture très complexe. Mais finalement, avec l'aide de mes frères astraux, je pris le contrôle de moi-même. Je réussis à faire fonctionner le corps. Tremblant, je me mis debout, et faillis crier d'horreur en découvrant que je marchais à reculons au lieu d'avancer. Je chancelai et tombai de nouveau. C'était vraiment une expérience effroyable. Ce corps me donnait réellement la nausée et j'avais peur de ne pas arriver à le maîtriser.
J'étais étendu sur le sol face contre terre, incapable de me mouvoir, et, du coin de l'œil je vis les deux lamas qui se tenaient là, l'air très préoccupé par la difficulté que je confrontais. Je grognai :
— Eh bien, vous essayez et voyez si vous pouvez faire faire à cette abominable chose ce que vous lui demandez !"
Soudain, l'un des lamas s'écria :
— Lobsang ! Tes doigts ont bougé, essaie maintenant de faire bouger tes pieds.
Ce que je fis, et je compris qu'il y avait une incroyable différence entre un corps Oriental et un corps Occidental. Je n'aurais jamais cru cela possible, mais je me souvins alors de quelque chose que j'avais entendu quand j'étais Mécanicien sur un bateau : dans les eaux Occidentales, l'hélice du navire doit tourner dans une direction, et dans les eaux Orientales, elle doit tourner dans la direction opposée. De toute évidence, me dis-je, je dois recommencer à zéro. Par conséquent, je restai calme, sortis du corps, et l'examinai soigneusement à partir de l'extérieur. Plus je l'examinais et moins je l'aimais, mais alors, pensai-je, je n'ai pas d'autre choix que celui de réessayer. Alors, de nouveau je m'entassai inconfortablement dans la chose gluante, froide, qu'était un corps Occidental.
Avec un immense effort, j'essayai de me lever, mais retombai, puis parvins tant bien que mal à me mettre debout et à presser mon dos contre cet arbre amical.
Il y eut un bruit soudain venant de la maison et une porte s'ouvrit brusquement. Une femme accourut en s'écriant :
— Oh ! qu'as-tu fait maintenant ? Entre et viens t'étendre.
Cela me donna tout un choc. Je pensai à ces deux lamas qui étaient avec moi et je craignis que la femme ne pique une crise en les voyant, mais de toute évidence ils étaient invisibles pour elle, et c'était encore une des choses étonnantes de ma vie. Je pouvais toujours voir les gens de l'astral qui me rendaient visite, mais si j'étais en conversation avec eux et qu'alors quelqu'un entra dans la pièce — eh bien, la personne croyait que j'étais en conversation avec moi-même, et je ne voulais pas acquérir la réputation de ne pas être sain d'esprit.
La femme vint vers moi et, en me regardant, une expression de grande alarme traversa son visage. Je pensai vraiment qu'elle allait être prise d'hystérie, mais elle parvint à se contrôler et passa un bras autour de mes épaules.
Silencieusement, je réfléchis à la manière de contrôler le corps puis, très lentement, me concentrant sur un pas à la fois, j'arrivai à entrer dans la maison, montai à l'étage, et m'effondrai sur ce qui était visiblement mon lit.
Pendant trois jours entiers, je restai dans cette chambre, prétextant une indisposition pendant que je pratiquais comment faire faire au corps ce que je voulais lui faire faire, et essayant de me contrôler, parce que c'était vraiment l'expérience la plus effrayante de ma vie. J'avais supporté toutes sortes de supplices en Chine, au Tibet, et au Japon, mais ceci était une expérience nouvelle et tout à fait révoltante, l'expérience d'être emprisonné dans le corps d'une autre personne et devoir le maîtriser.
Je songeai à ce qui m'avait été enseigné il y avait tant d'années, tant d'années en fait qu'il me paraissait s'agir d'une autre vie. "Lobsang, m'avait-on dit, dans le lointain passé, les Grands Êtres vivant bien au-delà de ce système, et les Êtres qui n'avaient pas la forme humaine, ont dû, pour des fins spéciales, se rendre sur cette Terre. Or, s'ils étaient venus sous leurs propres aspects, ils auraient trop attiré l'attention, de sorte qu'ils avaient toujours des corps prêts à être enfilés et contrôlés, et ainsi passer pour des habitants de l'endroit. Un jour, me fut-il dit, tu connaîtras une telle expérience et tu vas la trouver extrêmement choquante."
En vérité !
Pour le bénéfice de ceux qui sont sincèrement intéressés, permettez-moi de donner quelques détails au sujet de la transmigration, parce que vraiment j'ai tant de choses à dire au monde, et cependant à cause des calomnies de la presse, les gens ont été amenés à rejeter mon histoire. Je vous en dirai davantage à ce sujet dans le Livre qui suit, mais une des choses que je me proposais de faire était de montrer aux gens comment fonctionne la transmigration, car il y a tant d'avantages à en tirer. Pensez à ceci, que je vous présente comme une indéniable possibilité : l'humanité a envoyé un messager sur la Lune, mais elle ne sait pas comment voyager dans les profondeurs de l'espace. À l'échelle des distances de l'univers, le voyage vers la Lune est tout simplement insignifiant. Il faudrait des millions d'années à un vaisseau spatial pour atteindre d'autres étoiles, et cependant, il existe un moyen tellement plus simple, et je vous dis de façon absolument incontestable que le voyage astral peut être ce moyen. Cela s'est fait auparavant, cela se fait actuellement par des créatures (je dis ‘créatures’ parce qu'elles ne sont pas sous forme humaine) qui viennent d'une galaxie complètement différente. Elles sont ici en ce moment même, elles sont venues en effectuant le voyage astral, et certaines d'entre elles occupent des corps humains comme le faisaient les Anciens de Jadis.
Les humains, s'ils savaient comment le faire, pourraient envoyer des voyageurs astraux n'importe où, transcendant le temps et l'espace. Le voyage astral peut être aussi rapide que la pensée, et si vous ne connaissez pas la vitesse de la pensée, je vais vous le dire — cela prendrait un dixième de seconde à partir d'ici pour se rendre sur Mars, en voyage astral. Mais le jour viendra où les explorateurs seront en mesure d'aller sur un monde par le voyage astral et là, par transmigration, seront capables d'entrer dans le corps d'un natif de ce monde de façon à pouvoir acquérir une expérience de première main de ce que sont les choses. Or, ceci n'est pas de la science-fiction. C'est absolument vrai. Si d'autres gens sur d'autres mondes peuvent le faire, alors les gens de la Terre peuvent le faire aussi. Mais hélas, je dois dire que purement à cause des doutes non fondés semés sur mes paroles, cet aspect particulier n'a pas pu être enseigné aux gens.
Malheureusement, quand on prend la relève d'un corps, il y a certaines graves limitations fonctionnelles. Permettez-moi de vous donner un exemple : peu de temps après avoir pris la relève du corps, je me suis aperçu que je ne pouvais pas écrire le Sanskrit, je ne pouvais pas écrire le Chinois. Oh oui, je connaissais incontestablement la langue, je savais ce qu'il me fallait écrire, mais — le corps que j'habitais n'était pas ‘conçu’ pour faire ces gribouillis que sont le Sanskrit ou le Chinois. Il n'était capable que de reproduire, disons, les lettres comme celles de l'anglais, du français, de l'allemand ou de l'espagnol.
Tout cela concerne le contrôle musculaire. C'est ce qui se produit même en Occident quand vous constatez qu'un Allemand encore mieux éduqué que la plupart des Anglais, disons, n'arrivera tout de même pas à prononcer l'anglais comme le fera un natif. Il n'arrivera pas à ‘faire tourner sa langue autour’ des sons. Ainsi, peu importe à quel point il est instruit, il ne pourra toujours pas arriver à prononcer correctement les sons. Il est connu presque universellement que l'on peut toujours dire si un homme est natif ou non d'un district par la manière dont il prononce ses mots, c'est-à-dire, arrive-t-il à contrôler ses cordes vocales comme un natif le ferait, ou bien l'habitude entraîne-t-elle certaines dissonances que les natifs n'ont pas ?
En transférant à un corps différent on peut émettre tous les sons, etc., parce que le corps produit les sons auxquels il est habitué : l'anglais, le français ou l'espagnol, par exemple. Mais quand il s'agit d'écriture, c'est une autre affaire.
Voyez la chose comme ceci : certaines personnes sont capables de dessiner ou sont capables de peindre. Disons que ces gens — les artistes — ont l'aptitude de produire certains gribouillis qui ont un sens spécifique. Maintenant, la plupart des gens, quoiqu'ils soient de la même race, ne peuvent le faire, et même avec de l'entraînement — même avec énormément de pratique — à moins que la personne ne soit un ‘artiste-né’, les formes d'art ne sont pas considérées comme acceptables. Le même type de chose se produit quand une entité Orientale prend la relève d'un corps Occidental. Elle peut communiquer par la parole, mais quoiqu'elle puisse savoir tout ce qui peut être fait par écrit, elle ne peut plus écrire dans ce qui fut sa langue originelle, qu'il s'agisse du Sanskrit, du Chinois, ou du Japonais, parce qu'il faut des années de pratique, et ses efforts sont tellement maladroits, tellement rudimentaires, que les idéogrammes n'ont aucun sens intelligible.
Une autre difficulté est que l'entité est Orientale et que le corps, ou véhicule, est Occidental. Si vous trouvez cela étrange, je vous dirai que si vous êtes en Angleterre, les contrôles de votre voiture étant à droite, vous conduirez du côté gauche de la route, mais si vous êtres en Amérique, votre volant étant à gauche, vous conduirez du côté droit de la route. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas ? Eh bien, vous prenez un pauvre diable de conducteur qui a l'habitude de conduire dans les rues d'Angleterre, vous le sortez subitement de sa voiture et fourrez la pauvre âme dans une voiture américaine puis, sans le moindre apprentissage, vous le lâchez sur les routes américaines. Le pauvre type n'aurait que très peu de chance, n'est-il pas vrai ? Il n'irait pas loin. Tous ses réflexes essentiels qui ont subi un conditionnement pendant peut-être la moitié d'une vie se révolteraient de se voir subitement inversés, et dans l'urgence de la situation, il conduirait immédiatement du mauvais côté de la route et causerait l'accident qu'il essayait d'éviter. Me suivez-vous clairement ? Croyez-moi, je sais ce qu'il en est, tout cela m'est arrivé. Ainsi, la transmigration n'est pas pour les non-initiés. Je le dis en toute sincérité, beaucoup pourrait être fait par la transmigration si les gens pouvaient acquérir la bonne connaissance, et je suis surpris que les Russes, qui sont tellement en avance dans tant de domaines, ne soient pas encore tombés sur l'idée de la transmigration. C'est facile — si vous en connaissez le processus. C'est facile — si vous pouvez prendre les précautions appropriées. Mais si vous essayez d'enseigner ces choses, comme je le pourrais, et que vous ayez un tas d'enfants sans cervelle, ou gens de la presse, alors tout est réduit à néant presque avant d'avoir pu commencer.
Un autre point qui doit être pris en considération est celui d'obtenir le véhicule ou corps convenable, parce que vous ne pouvez pas simplement sauter dans n'importe quel corps et prendre le contrôle comme le ferait un bandit entrant dans une voiture arrêtée à un feu de circulation. Oh non, c'est beaucoup plus difficile que cela. Vous devez trouver un corps qui soit en harmonie avec le vôtre, qui possède une harmonique quelque part, et cela ne veut pas dire que le propriétaire du corps doive être bon ou mauvais, cela n'a rien du tout à y voir ; il s'agit de la fréquence vibratoire de ce corps.
Si vous êtes intéressé par la radio, vous saurez que vous pouvez avoir, disons, un récepteur superhétérodyne qui a trois condensateurs de réglage. Maintenant, si le poste fonctionne correctement, vous captez clairement une station, mais lorsque vous vous trouvez sur des harmoniques, vous captez en fait le même signal sur différentes longueurs d'ondes ou différentes fréquences — tout ça c'est la même chose. Dans une fréquence, on compte simplement le nombre de fois que l'onde change du positif au négatif, etc. Mais quand vous prenez une longueur d'onde, vous mesurez simplement la distance entre les crêtes des ondes adjacentes. Cela revient au même que de donner un autre nom à une rose, mais ce que je cherche à vous dire c'est que la transmigration est possible si vous en connaissez le processus. Non seulement est-elle possible, mais elle deviendra une chose quotidienne dans un avenir lointain, ici, sur Terre.
Mais revenons à Thames Ditton. C'était vraiment un charmant petit endroit, l'une des banlieues de la grande ville de Londres. Je crois qu'on l'appelait aussi l'un des dortoirs de Londres. Il y avait là un certain nombre d'arbres, et chaque matin on pouvait voir les hommes d'affaires qui convergeaient avec empressement vers la station de Thames Ditton pour attraper le train qui les mèneraient à Wimbledon et autres parties de Londres pour leur journée de travail. Plusieurs d'entre eux étaient de la Ville de Londres : courtiers, agents d'assurances, banquiers, et tout le reste. Le Cottage Hospital se trouvait juste en face de là où je vivais. Beaucoup plus loin sur la droite, on arrivait à une sorte de terrain de sport, et tout à côté se trouvait un grand édifice appelé le Milk Marketing Board (Office de Mise en Marché du Lait — NdT).
Thames Ditton était habitée par des gens de la ‘meilleure classe’ et certaines des voix que je pouvais entendre par ma fenêtre ouverte étaient beaucoup trop ‘meilleure classe’, parce que je trouvai certaines des voix lourdement accentuées vraiment difficiles à comprendre.
Mais l'élocution n'était pas facile pour moi. Je devais penser avant de pouvoir prononcer un son, et puis je devais visualiser la forme du son que j'essayais de dire. Pour la plupart des gens, l'élocution vient naturellement. Vous pouvez bavarder sans aucune difficulté, sans trop réfléchir, mais non pas quand vous êtes un Oriental qui a pris la relève d'un corps Occidental. Même à présent, je dois penser à ce que je vais dire, et cela fait paraître mon langage plutôt lent et parfois hésitant.
Quand on prend la relève d'un corps, pendant les une ou deux premières années, le corps est essentiellement celui de l'hôte, en somme, celui qui a été repris. Mais avec le temps, la fréquence du corps change et devient finalement de la même fréquence que celle du corps d'origine et ses cicatrices originelles apparaissent. C'est, je vous l'ai dit précédemment, comme l'électrodéposition ou comme la galvanoplastie, parce qu'il y a ce changement : molécule pour molécule. Ce ne devrait pas être trop difficile à croire, parce que quand vous vous coupez et que votre coupure guérit, vous avez alors des molécules de remplacement, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les mêmes molécules qui ont été coupées, mais de nouvelles cellules qui se sont développées pour remplacer celles endommagées. C'est quelque chose du genre dans la transmigration. Le corps cesse d'être le corps étranger qui a été occupé, devient plutôt, molécule par molécule, ‘son’ propre corps, le corps que l'on a développé.
Juste une dernière information sur la transmigration. Elle rend l'individu ‘différent’. Elle donne à l'entourage un sentiment bizarre d'en être à proximité, et si une personne transmigrée touche à l'improviste une autre personne, cette dernière peut pousser un petit cri d'étonnement et dire : "Oh, vous m'avez donné la chair de poule !" Ainsi, si vous voulez pratiquer la transmigration, vous devrez prendre en considération les désavantages aussi bien que les avantages. Vous savez comment des chiens inconnus tournent en rond en se reniflant, pattes raidies, attendant le premier mouvement de l'autre ? Eh bien, c'est de cette façon que se comportent les gens du monde Occidental envers moi. Ils ne me comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent et ne savent pas ce que c'est, et seront donc souvent incertains à mon sujet. Ils ne savent pas s'ils m'aiment ou s'ils me détestent carrément, et cela provoque vraiment des difficultés, des difficultés qui se manifestent dans le fait que les policiers se méfient toujours de moi, les gens de la douane sont toujours prêts à croire le pire, et les agents d'immigration veulent toujours s'informer plus avant sur les pourquoi, comment, et quand, etc., etc. La transmigration vous rend, en fait, inacceptable aux ‘natifs du pays’. Mais il est maintenant temps de passer au Livre suivant. Toutefois, avant de le faire, voici un dernier mot au cas où vous ayez de la difficulté à comprendre ce que j'ai écrit sur les Orientaux qui après avoir transmigré sont incapables d'écrire leur propre langue : si vous êtes droitier, écrivez ce paragraphe avec votre main droite, puis essayez de faire de même avec votre main gauche !
Ainsi se termine le Troisième Livre
Le Livre des Changements.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LIVRE QUATRE
Comme il en est Maintenant !
Chapitre Dix
Le soleil faisait ricocher sa lumière sur la rivière placide qui descendait majestueusement vers la mer, tout comme les Archives Akashiques, vers la mer de la Connaissance Universelle. Mais ici, CETTE rivière retenait mon attention. Les yeux entrouverts, j'admirais toutes les petites étincelles, la surface tachetée de lumière quand, de temps en temps, une feuille passait en flottant. Il y eut un bruissement soudain et un flottement, et trois oiseaux aquatiques vinrent se poser avec de grandes éclaboussures à la surface de l'eau. Pendant un moment, ils pataugèrent, s'arrosant sous les ailes, et en jouant comme savent le faire les oiseaux aquatiques. Puis, comme sur un signal, ils déployèrent soudain leurs ailes, pataugèrent un peu puis s'élevèrent en formation, laissant dans l'eau trois cercles allant s'agrandissant.
Les rayons du soleil à travers les feuilles des arbres mettaient en contraste des taches de lumière et d'ombre sur le bord de l'eau devant moi. Le soleil était chaud. Je m'étendis et devins conscient d'un bourdonnement. J'ouvris lentement les yeux et là, juste en face de mon nez, une abeille me regardait avec grand intérêt. Puis, comme si elle avait décidé que je n'étais pas une source adéquate de nectar, ou quoi que ce soit que recherchent les abeilles, elle bourdonna de plus belle et vira vers une fleur qu'abritait l'ombre d'un arbre. Je pus l'entendre bourdonner à distance pendant qu'elle explorait activement la fleur, et je la vis ensuite sortir à reculons, ses pattes et son corps couverts de pollen jaune.
C'était agréable ici, allongé sous les arbres au bord de la Tamise à Thames Ditton, en face du grand Palais de Hampton Court. Mon attention vagabonda et je suppose que je m'assoupis. Quoi qu'il en fût, je pris soudainement conscience d'un bruit au loin. J'eus des visions de la Barge Royale venant de la Tour de Londres et transportant la Reine Elizabeth Ire avec son favori du moment et son escorte de serviteurs qui semble inévitable dans les cercles royaux.
Il y avait de la musique à bord de la Barge Royale, et une telle musique me sembla incongrue venant de la Tamise, mais je pouvais entendre l'éclaboussement des rames et le grincement des tolets. On riait beaucoup et je pensai en moi-même, dans mon état de demi-sommeil, qu'au début des années Élisabéthaines les gens ne devaient sûrement pas se comporter comme les adolescents d'aujourd'hui.
J'ouvris les yeux et, juste au détour de la rivière, s'avançait une grande barque emplie d'adolescents, avec à bord radio et gramophone, crachant chacun leurs propres airs. Ils ramaient en jacassant, chacun semblant parler d'un sujet différent, personne ne se souciant de l'autre. Ils passèrent devant Hampton Court, puis disparurent de ma vue, et, pour un temps, tout redevint paisible.
Je pensai de nouveau à la grande Reine Elizabeth et à ses excursions à Hampton Court, depuis la Tour de Londres ; presque en face de là où j'étais étendu sur la rive, se trouvait l'endroit où il y avait autrefois une jetée d'embarquement. Les rameurs s'en approchaient, jetaient les cordes et la Barge était doucement tirée de façon à ne pas déséquilibrer la Reine, parce qu'elle n'avait pas le pied marin, pas même sur la Tamise ! Hampton Court lui-même était un endroit que je trouvais fascinant. Je le visitais souvent, et même dans des conditions inhabituelles, et je pouvais voir clairement que l'endroit était vraiment hanté par les esprits de ceux dont les corps avaient disparu depuis si longtemps.
Mais on discutait beaucoup derrière moi, et en me tournant je vis là quatre personnes.
— Bonté divine ! s'exclama une femme, vous étiez tellement immobile — vous n'avez pas bougé pendant les dix dernières minutes — que nous vous pensions mort !
Sur ce, ils s'en allèrent en parlant, parlant et parlant. Le monde, pensai-je, est beaucoup trop bruyant ; les gens parlaient trop et avaient trop peu à dire. Sur cette pensée, je jetai un coup d'œil autour de moi. Il y avait quelques bateaux sur la Tamise en face de moi. Un peu plus bas sur ma gauche se trouvait un vieil homme qui paraissait être le Père Temps personnifié. Il était figé sur place comme un vieux tronc d'arbre. Il avait une pipe à la bouche et un léger nuage de fumée s'en dégageait. Il avait une canne à pêche attachée à un bâton devant lui, dont le flotteur — rouge et blanc — se balançait juste devant moi. Je l'observai pendant un court moment, il ne bougeait pas non plus, et je me demandai quel intérêt les gens trouvaient réellement dans la pêche. J'en vins à la conclusion que pour certaines personnes âgées c'était juste une excuse pour rester immobiles et méditer, pour penser au passé, et réfléchir sur ce que l'avenir leur réservait.
Le futur ? Je jetai un coup d'œil à ma montre, alerté, et m'empressai de me mettre sur pied et de monter mon vieux vélo qui était à côté de moi, sur la rive.
Avec plus de hâte que d'habitude, je pédalai en descendant la route, tournai à droite, et continuai ainsi vers West Molesey, là où se trouvait le Bureau de Chômage.
Mais non, il n'y avait pas d'emploi pour moi, aucune offre de travail. Il y avait apparemment trop de gens et trop peu d'emplois, et comme un homme me le dit sans ambages :
— Eh ben, mon vieux, v'z'avez quitté votre emploi et c'est vot'e faute ; donc, comme vous l'avez quitté par vot'e faute, vous recevez rien, voyez-vous ? C'est sûr que l'gouvernement va pas payer un type qui quitte son travail, parce qu'il avait un travail avant de le quitter ; donc vous recevrez pas d'allocation, et aussi longtemps qu'vous recevrez pas d'allocation, le Bureau de Chômage vous trouvera pas de travail. Le Bureau de Chômage garde ses emplois pour ceux qui reçoivent une allocation, parce que s'il trouve du travail au type, plus besoin de le payer et comme ça les statistiques ont l'air meilleures.
J'essayai les bureaux de placement privés, ces endroits où vous allez et déboursez de l'argent, et où en théorie on vous trouve un emploi. Ma propre expérience a pu être particulièrement malheureuse, mais en dépit d'en avoir essayé un bon nombre, aucun bureau ne m'a jamais offert un travail.
Je me débrouillai pour trouver des petits travaux à faire à Thames Ditton et dans le district. Je fus en mesure de faire certains travaux médicaux que le médecin orthodoxe ne pouvait pas ou ne voulait pas faire et je pensai — eh bien, je suis un médecin dûment qualifié et je possède les papiers pour le prouver, aussi pourquoi ne pas faire les démarches pour être enregistré en Angleterre ?
De façon officieuse, je pris contact un peu plus tard avec le Conseil de l'Ordre des Médecins. Puis je m'y rendis et expliquai ma situation. On me dit que — oui, j'avais toutes les qualifications, mais malheureusement Chongqing était maintenant aux mains des Communistes et, me dirent-ils, je ne pouvais tout simplement pas m'attendre à ce qu'elles soient reconnues, vu qu'elles avaient été obtenues dans un pays Communiste.
Je sortis mes papiers et les fourrai directement sous le nez du Secrétaire. Je lui dis :
— Écoutez, quand ces papiers furent préparés la Chine n'était pas un pays Communiste, mais alliée de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, et de plusieurs autres pays. Je me suis battu pour la paix exactement comme en Angleterre les gens se sont battus pour la paix, et le fait que j'étais dans un autre pays ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes sentiments que vous.
Après avoir hésité et tergiversé, il finit par dire :
— Revenez dans un mois. On verra ce qu'on peut arranger. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, vos qualifications sont telles qu'elles devraient être reconnues. La seule chose empêchant une telle reconnaissance c'est que Chongqing est maintenant une ville d'un pays Communiste.
Ainsi je quittai son bureau et me rendis au Hunterian Museum pour regarder tous les spécimens gardés dans les bocaux, ce qui m'amena à penser combien amusant était le fait que partout les humains étaient — des humains ; ils fonctionnaient tous plus ou moins de la même manière, et pourtant une personne, si elle était formée dans un pays donné, n'était pas jugée qualifiée pour soigner les gens d'un autre pays. La chose me dépassait.
Mais les emplois étaient vraiment difficiles à obtenir, et le coût de la vie à Thames Ditton était terriblement élevé. Je constatai qu'en tant qu'homme marié — ce que j'étais, en théorie — les dépenses étaient de loin beaucoup plus nombreuses que quand je devais me débrouiller seul.
À ce point de mon livre, je pourrais peut-être prendre un instant pour répondre à certaines personnes qui m'écrivent de façon horriblement injurieuse pour me demander comment il se fait que moi, un lama du Tibet, je vive avec une femme — que je sois marié. Eh bien, à vous toutes ‘ladies’ qui m'écrivez de façon si injurieuse, permettez-moi de vous dire ceci : je suis toujours un moine, je vis toujours comme un moine, et peut-être que certaines d'entre vous, ‘ladies’, ont entendu parler de célibataires qui vivent avec une logeuse ou une sœur, sans nécessairement penser à CELA ! Ainsi, ‘ladies’, la réponse est — non, je ne... !
Mais le temps était venu de quitter Thames Ditton, et nous nous rapprochâmes de Londres car mes propres efforts m'avaient fourni un travail. J'en étais venu à la conclusion que le corps que j'occupais maintenant vivant en ‘surtemps’, il n'y avait plus pour lui aucune possibilité. Le précédent occupant du corps — je l'avais vu dans les Archives Akashiques — était réellement et véritablement sur le point de se suicider, et cela avait mis fin à toutes les chances que son véhicule, son corps, aurait pu avoir. Aussi, malgré tous mes efforts, je ne pourrais jamais trouver un travail qu'une autre personne serait susceptible de faire. Le seul emploi serait celui que je produirais moi-même. Maintenant, mon intention n'est pas de m'étendre sur le sujet d'un tel emploi, ni de son endroit, parce que cela n'a rien à voir avec cette histoire, mais il s'avéra adéquat pour nos besoins immédiats et pour nous permettre de tenir. Mais je dois vous dire une chose qui m'irrita énormément et qui était en rapport avec ma vieille ennemie, la police. Je conduisais dans South Kensington avec un mannequin à l'arrière de ma voiture. C'était un de ces mannequins servant à faire les vitrines ou qui sont parfois fournis pour la formation des installateurs chirurgicaux. Ce mannequin était à l'arrière de ma voiture, et au départ, je l'avais recouvert d'une housse ; mais les glaces de la voiture étaient ouvertes, l'étoffe s'était déplacée et mon mannequin devait être à moitié découvert.
Je conduisais tranquillement en pensant à ce que j'allais faire ensuite, quand soudainement il y eut un tel beuglement tout près, que je faillis passer à travers le toit. Je regardai dans le rétroviseur et découvris deux personnages gesticulant vers moi, me faisant signe de me mettre sur le côté de la route. Comme il y avait de nombreuses voitures stationnées au bord de la route, j'avançai encore un peu dans l'espoir de trouver où m'arrêter. Et puis, cette voiture de police — car c'en était une — essaya de me percuter, pensant, dirent-ils, que j'essayais de m'échapper — à quinze milles (24 km) à l'heure dans une pareille circulation ! Eh bien, je m'arrêtai tout juste là où j'étais, bloquant la circulation, et je me moquai complètement de ce que les gens des autres voitures se montrent en colère : je m'arrêtai tout juste là. Les policiers me firent signe de venir à eux, mais je pensai — non, ce sont eux qui veulent me voir, pas moi ; je restai donc assis. Finalement, un policier sortit avec sa matraque toute prête à la main. Il avait l'air de quelqu'un qui allait faire face à un peloton d'exécution, ou peu s'en fallait, car il paraissait vraiment effrayé. Lentement, il approcha de ma voiture en marchant plus ou moins de côté, cherchant vraisemblablement à être le moins possible ciblé au cas où je me mettrais à tirer. Il regarda alors à l'arrière de ma voiture et devint rouge comme une tomate.
— Eh bien, monsieur l'agent, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que je suis censé avoir fait ? demandai-je.
Le policier me regarda et il eut l'air vraiment sot, il eut l'air absolument embarrassé.
— Je suis désolé, monsieur, me dit-il, mais on nous a dit qu'un homme roulait en voiture et que l'on voyait les jambes d'une femme nue par la fenêtre arrière.
J'étendis le bras vers l'arrière et retirai le tissu qui recouvrait le mannequin, puis je lui dis :
— Eh bien, monsieur l'agent, montrez-moi un quelconque signe de vie dans cette poupée. Montez-moi comment elle a été assassinée. Regardez-la bien.
Et je recouvris alors le mannequin plus soigneusement. Le policier retourna à sa voiture et toutes les voitures derrière nous klaxonnèrent à qui mieux mieux comme pour remplir une salle de concert ou je ne sais trop quoi. Me sentant parfaitement écœuré, je m'éloignai.
Il y eut un autre événement avec la police qui peut faire sourire. J'avais un bureau à Londres qui était très près d'une station de métro. Ma femme venait souvent me rendre visite à l'heure du déjeuner, et quand elle me quittait, j'avais l'habitude de la suivre du regard par la fenêtre, simplement pour m'assurer qu'elle traversait en toute sécurité cette rue bondée de Londres.
Un jour, je me préparais tout juste à terminer et à rentrer à la maison, quand on frappa bruyamment de façon officielle à la porte. Je me levai pour aller ouvrir et me trouvai face à deux très grands policiers. L'un me dit : "Nous voulons savoir ce que vous faites ici." Je me tournai et les laissai entrer dans mon bureau. Le policier regarda autour de lui avec intérêt et son associé se tenait prêt à agir comme témoin. Partout où le policier en chef regardait, son associé regardait aussi.
Je les invitai à s'asseoir, mais non, il n'en était pas question, ils étaient là en mission officielle, me dirent-ils. Ils ajoutèrent qu'ils pensaient que je participais à une activité illicite et que je donnais des signaux à un gang.
J'en fus réellement stupéfié ; en fait, j'étais presque abasourdi de stupéfaction, et je ne pouvais tout simplement pas comprendre de quoi il était question.
— Que voulez-vous dire ? m'exclamai-je.
— Eh bien, on nous a rapporté, répondit le policier en chef, que vous faisiez d'étranges signaux vers midi, et après vous avoir mis sous observation, nous avons vu ces étranges signaux. À qui signalez-vous ?
C'est alors que je compris soudain et me mis à rire. Je répondis :
— Oh ! bon sang, dans quel monde de fous vivons-nous ? Je salue simplement ma femme de la main en m'assurant qu'elle traverse la rue sans risque et entre dans la station de métro.
Il me répliqua :
— Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas voir la station d'ici.
Sans dire un mot, je me levai de ma chaise, ouvrit la fenêtre qui était juste à ma droite en disant :
— Venez vérifier par vous-même.
Ils se regardèrent puis, ensemble, s'approchèrent de la fenêtre. Bien entendu, comme je le leur avais dit, la station de métro se trouvait en face. Tous deux pâlirent quelque peu, et je leur dis — pour les faire pâlir un peu plus :
— Oh oui, je vous ai vu tous les deux, dans cet immeuble en face, et j'ai vu que vous tentiez de vous cacher derrière les rideaux. Je me suis demandé ce que vous y faisiez.
Le policier en chef me dit alors :
— Vous occupez l'étage en dessous de ce bureau. Nous avons des informations selon lesquelles vous êtes impliqué dans des activités sexuelles dans cet appartement du dessous.
J'en eus assez de tout cela et répondis :
— D'accord, descendez avec moi et venez voir toutes ces femmes nues de vos propres yeux.
Ils ne furent pas heureux du tout de mon attitude et se demandèrent ce qu'ils avaient fait de travers.
Nous descendîmes ensemble l'escalier et je déverrouillai la porte d'une grande sale d'exposition dont les fenêtres étaient lourdement garnies de rideaux avec du filet de dentelle coûteuse.
Au-dessus des fenêtres garnies de rideaux, il y avait de petits ventilateurs d'environ un pied (30 cm) carré qui, bien sûr, n'avaient pas de rideaux.
Je me dirigeai vers l'un des mannequins, le soulevai et leur dis :
— Regardez. Si une personne transporte ceci, le plaçant d'ici à là — j'en fis la démonstration — une vieille bonne femme fouineuse comme celle qui habite cet appartement en face pourrait penser que c'est un corps nu. Allez, regardez-les, et dites-moi s'ils vous paraissent obscènes ?
Les policiers changèrent complètement de ton, et le supérieur me dit :
— Je suis désolé que vous ayez été importuné, monsieur, je suis vraiment terriblement désolé, mais nous avons reçu une plainte de la sœur d'un officier de police très haut placé disant que des choses étranges se passaient ici. Nous sommes parfaitement satisfaits de ce que nous avons vu. Vous ne serez plus importuné à nouveau.
Eh bien, je le fus ! Je dus me rendre à mon bureau un soir vers 7:00 heures ; je déverrouillai la porte et entrai, comme j'avais parfaitement le droit de le faire. Je terminai le petit travail que j'étais venu y faire, puis repartis. Comme je verrouillais la porte derrière moi, deux policiers se saisirent brutalement de moi et essayèrent de me tirer vers une voiture de police. Mais je connaissais mes droits et demandai une explication immédiate. Ils me répondirent qu'on leur avait rapporté (oui, il s'agissait de la même femme !) qu'un homme à l'air sinistre (c'était moi !) avait été vu faisant irruption dans le bâtiment, et donc ils m'attendaient. Ils ne voulurent pas croire que j'avais le droit d'être là, aussi je déverrouillai de nouveau et nous pénétrâmes dans mon bureau, où il me fallut en plus téléphoner à l'agent immobilier qui m'avait loué la place, et qui m'identifia à ma voix. Cette fois encore les policiers eurent l'air stupide et partirent sans un mot.
Peu de temps après, je décidai que cela n'avait pas de sens de rester dans ce bureau où il était évident que cette vieille bonne femme d'en face n'avait rien de mieux à faire que de jouer à l'agent de police en rapportant toutes sortes de délits imaginaires. Je quittai donc l'endroit pour aller ailleurs.
De nouveau, je donnai certains traitements psychologiques à des gens qui ne pouvaient obtenir aucune aide de la médecine orthodoxe et je réussissais très bien, vraiment très bien. Je guéris nombre de personnes jusqu'à ce qu'un jour un homme essaye de me faire chanter. J'appris ainsi qu'à moins d'être effectivement enregistré, on se trouvait beaucoup trop à la merci de gens qui obtiendraient volontiers toute l'aide possible et s'essaieraient ensuite au chantage. Mais le maître-chanteur — eh bien, il ne parvint pas à ses fins, après tout !
Précisément à ce moment, une jeune femme entra dans notre vie, entra dans notre vie de son propre accord, de son plein gré. Nous la considérâmes comme notre fille, ce qui est toujours le cas, et elle vit toujours auprès de nous. Sa destinée, elle le sentit, était telle qu'elle devait vivre avec nous, et c'est ce qu'elle fit. Plus tard la presse en fit toute une histoire, essayant de présenter la chose comme un cas de l'éternel triangle. La vérité ne pouvait être que la plus forte. Nous nous tenions ‘dans un carré’ (en anglais ‘standing on the square’ signifie quelque chose de stable, une fondation sur laquelle on bâtit — NdT) plutôt que ‘dans l'éternel triangle’.
Vers la même époque, je fus introduit auprès d'un agent littéraire. Je pensai qu'il allait m'offrir le travail de lire et de commenter les manuscrits dactylographiés des auteurs, mais non, il connaissait un peu mon histoire et, tout à fait contre mon gré, je dus me laisser persuader d'écrire un livre. On ne peut faire trop le difficile quand la famine est au coin de la rue, vous savez, et la famine n'était plus seulement au coin de la rue, elle frappait lourdement à ma porte.
J'écrivis donc un livre, mais alors certains auteurs qui étaient jaloux de mes connaissances sur le Tibet essayèrent de me localiser. Ils eurent recours à toutes sortes d'agences de détectives, et l'une de ces agences alla jusqu'à passer une annonce dans The Times ou The Telegraph de Londres, priant Lobsang Rampa d'écrire à telle ou telle adresse où l'attendait quelque chose de très bien.
Je savais qu'il s'agissait d'un piège, et j'en parlai donc avec mon agent, Mr Cyrus Brooks. Il fit téléphoner son gendre pour voir de quoi il retournait. Oui, c'était vraiment un traquenard. Un auteur en Allemagne était extrêmement irrité que j'aie écrit sur le Tibet, estimant que c'était son propre territoire privé inviolable, et il essaya donc de me localiser afin de pouvoir décider de l'action à entreprendre contre moi.
À peu près au même moment, des gens liés avec la jeune femme qui vivait avec nous me prirent en grippe, pensant que je l'avais détournée du droit chemin — ce qui était faux — et eux aussi engagèrent un détective privé pour enquêter sur moi. Mais ce pauvre type — eh bien, j'ai l'impression qu'il n'était pas très brillant, il n'essaya même jamais de prendre contact avec moi. Je me demande s'il avait peur ou quoi ? Mais au lieu de s'informer auprès de moi carrément, comme un homme, il s'en remit à des preuves par ouï-dire, et comme chacun sait, la preuve par ouï-dire n'est pas une preuve légale, n'est-ce pas ? Mais les deux camps se réunirent et allèrent trouver un journaliste qui n'était pas très populaire auprès de ses collègues. Ils essayèrent quelques pièges dont je ne fus pas dupe, mais quand plus tard nous étions installés en Irlande, ces gens montèrent une grande campagne de presse contre moi, m'accusant de me livrer à des rites de magie noire dans le sous-sol de ma maison, disant que j'avais un temple secret, que j'étais coupable de toutes sortes d'orgies sexuelles, etc., et qu'à un certain moment de ma carrière j'avais eu des ennuis avec la police. Voilà qui était facile : j'avais toujours eu des ennuis avec la police, mais je ne fus jamais inculpé de quoi que ce soit, et jamais je ne fis la moindre chose qui vaille l'attention de la police. Il est toutefois inutile de remuer les vieux problèmes et de ranimer des cendres qui devraient être éteintes, mais je tiens ici à rendre témoignage au mari de la jeune femme. Il fut, et il est, un gentleman, une très bonne personne, qui est demeuré notre ami, et comme il le savait très bien et, en réalité, comme il en a témoigné, les affirmations faites à mon sujet étaient complètement, complètement mensongères.
Non, je n'en dirai pas plus sur ce sujet, rien sur la Presse, rien sur les proches de la jeune femme. Elle est toujours avec nous, toujours avec nous comme notre fille bien-aimée. Voilà, c'est tout.
Quand tout ceci se produisit nous avions déménagé en Irlande, et une chose après l'autre avaient conspiré à ruiner ma santé. Je fus atteint d'un infarctus du myocarde et l'on pensa que j'allais en mourir, mais la presse nous rendit la vie si insupportable que nous dûmes quitter l'Irlande, ce que nous fîmes avec une extrême réticence. J'avais beaucoup d'amis là-bas, et j'ai toujours ces mêmes amis.
Quittant l'Irlande, nous partîmes pour le Canada où nous sommes actuellement. Nous nous sommes beaucoup déplacés à travers le Canada, nous fixant dans différentes villes, dans différentes provinces. Mais finalement nous reçûmes une lettre par la poste qui nous faisait une offre très alléchante.
Il s'agissait d'une enveloppe assez volumineuse. Les timbres venaient d'un pays que je connaissais remarquablement peu, à ce moment-là. C'était l'Uruguay, ce pays situé en Amérique du Sud entre l'Argentine et le Brésil.
La lettre était intéressante. Elle disait que l'expéditeur était à la tête d'une grande entreprise où l'on faisait l'impression, l'édition de livres — tout. On m'invitait à venir à Montevideo aux frais de cette entreprise, et je pourrais continuer là-bas mon travail ; on me fournirait secrétaires, dactylos et services de traduction — en fait, tout ce dont je pouvais avoir besoin. L'expéditeur joignait une photo assez impressionnante de lui-même assis derrière un grand bureau avec une machine à écrire IBM devant lui, une grande quantité de livres derrière lui et, je pense, un dictaphone Philips en plus.
Nous en discutâmes, ‘nous’ étant ma femme et notre fille adoptive, et ayant réfléchi longuement, l'idée nous sembla séduisante. Commencèrent alors les formalités nécessaires qui prirent un assez long temps et, un jour, nous montâmes dans un train à Fort Érié, en Ontario, au Canada, qui nous emmena à New York. On nous dit que nous allions être passagers à bord d'un cargo Moore McCormack qui transportait normalement douze passagers.
À New York, ce fut l'agitation classique. Après une nuit passée dans un des grands hôtels de la ville, nous nous rendîmes au matin au dock Moore McCormack, et je fus grandement amusé de découvrir que ce dock était juste en face de celui où j'avais fait mon plongeon tant d'années plus tôt, me sembla-t-il. Mais je n'en parlai pas, parce que cela ne sert pas à grand-chose de remuer d'amers souvenirs, mais j'avoue que je surveillai attentivement la police fluviale.
Nous montâmes à bord du bateau et nous installâmes dans nos cabines, et c'est ainsi que tard cette nuit-là, avec quatre locomotives chargées à bord sur le pont, nous partîmes tout d'abord vers Vittoria, au Brésil. Là, nous longeâmes un long bras de mer avant d'arriver à une petite communauté, très pittoresque, très chaude, notre première escale. Puis nous descendîmes vers un endroit à proximité afin que les locomotives — des locomotives diesel destinées aux chemins de fer brésiliens — puissent être déchargées.
Il y eut deux ou trois escales de plus au Brésil avant de pouvoir repartir pour Montevideo, en Uruguay. Mais comme nous approchions de Montevideo — nous étions en fait à Punta del Este (Uruguay — NdT) — le capitaine fut informé par radio qu'il ne serait pas possible d'y débarquer en raison d'une grève des dockers, et c'est ainsi que nous repartîmes d'abord pour Buenos Aires (Argentine — NdT) où nous passâmes environ une semaine dans ce port. Le port connaissait une grande activité, et nous vîmes entrer énormément de bateaux étrangers. Les bateaux allemands semblaient les plus populaires, et un grand nombre de bateaux, semblait-il, remontaient directement la rivière qui formait la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay. On nous dit qu'à quelques milles (km) plus haut il y avait une grande usine d'emballage de viande, l'usine Fray Bentos.
Enfin, nous fûmes autorisés à quitter le port et après avoir suivi le Rio de la Plata, nous finîmes par arriver à Montevideo, notre destination. Nous entrâmes dans l'avant-port et le bateau dû jeter l'ancre. Il y avait eu une grève et toute une flotte de bateaux était assemblée, les premiers arrivés, premiers servis, et nous dûmes rester à bord du bateau pendant environ une semaine. Le bateau fut finalement autorisé à entrer au port et nous pûmes descendre à terre.
Nos espoirs ne durèrent pas, car nous devions découvrir bien vite que la prétendue énorme affaire, à la tête de laquelle était notre homme, était loin d'avoir cette importance. Nous dirons, pour ne pas être trop désobligeant, que c'était un homme dont les idées voyaient rarement le jour.
La vie était très chère à Montevideo. Il semblait y avoir là cette idée particulière que tout devait être payé en dollars américains, ce qui fait que, prenant en considération le taux de change, il nous fallait payer de fantastiques sommes même pour les produits de première nécessité. Toutefois, nous passâmes là un an et demi, puis, las des grèves et des restrictions croissantes imposées aux étrangers, nous décidâmes de partir.
Il est extrêmement regrettable que nous ayons dû partir, parce que Montevideo était vraiment un bon endroit. Les gens, pour la plupart — à part les grévistes ! — étaient très plaisants, très courtois, et on se croyait dans une ville européenne. C'était une belle ville avec un port merveilleux et des plages splendides. Pendant une très courte période de temps nous habitâmes un endroit appelé Carrasco, tout près de l'aéroport. Le seul ennui, mais un ennui vraiment considérable, c'était le vent qui soufflait toujours le sable fin des immenses plages dans les maisons. Ce qui, au bout de peu de temps, nous contraignit à partir et à nous rapprocher du centre de la ville, dont d'ailleurs nous étions trop éloignés. Notre choix se porta sur un appartement situé dans un immeuble dominant le phare.
À quelques milles (km) des approches du port, il y avait un bateau naufragé qui, en son temps, avait été un assez gros paquebot. Pour une quelconque raison, le navire avait été coulé tout près de l'entrée principale et y était resté. À marée basse, on pouvait voir le pont principal et, à marée haute, la passerelle de commande était encore au-dessus de l'eau. Nous vîmes pas mal de contrebande s'y faire, car le bateau servait de ‘dépôt de livraison’ aux contrebandiers.
Il y avait de nombreux sites magnifiques à Montevideo, y compris une haute colline juste de l'autre côté du port. On l'appelait ‘la Montagne’, et tout au sommet il y avait une sorte de fort qui était une attraction touristique locale.
Les Anglais avaient fait beaucoup pour moderniser Montevideo. Ils avaient démarré son service d'autobus, et ils avaient également démarré des travaux d'installation du gaz, et l'un des avantages était que nombre de gens avaient quelques connaissances de la langue anglaise.
Un jour, alors que nous avions à nouveau déménagé dans un autre appartement plus près du centre-ville, le ciel soudain devint noir et pendant un moment, il se mit à faire très froid. Nous allions vivre un cyclone. Tandis que nous luttions à trois pour essayer de fermer notre fenêtre demeurée ouverte, et tandis que nous étions rassemblés là, poussant fermement nos épaules contre la fenêtre, nous fûmes témoins d'un spectacle stupéfiant. Nous vîmes le toit de la station d'autobus située au-dessous de nous disparaître littéralement, toutes les feuilles de tôle ondulée s'envolant dans les airs comme si elles étaient faites de papier-mouchoir. En regardant plus bas nous vîmes tous les bus sur place et les travailleurs qui observaient la scène bouche bée et yeux écarquillés.
Un spectacle vraiment drôle, pour nous, fut celui des poules — qu'on garde sur les toits des maisons qui, à Montevideo, sont plats — qui furent simplement emportées dans l'espace, traversant rue après rue, dans ce qui était probablement le seul vol de leur vie. C'est vraiment quelque chose d'étonnant que de voir des poules s'envoler, leurs ailes solidement collées au corps !
Autre chose qui m'amusa beaucoup fut de voir toute une corde à linge chargée de vêtements fraîchement lavés partir dans les airs. La corde était aussi tendue et aussi rigide qu'une barre de fer, et les draps comme la ‘lingerie délicate’ pendaient tout droit comme s'ils se trouvaient dans l'air immobile. J'ai déjà assisté à pas mal de cyclones, tornades, etc., mais ceci, de mon point de vue, fut franchement le plus amusant.
Mais Montevideo perdait son charme à cause des divers groupes de Communistes qui causaient des problèmes, aussi nous décidâmes de retourner au Canada. À bien des égards, je le regrettais, car je préférerais vivre en Uruguay plutôt que dans la plupart des autres pays. La mentalité y est différente et il se surnomme lui-même la République Orientale de l'Uruguay. C'est un pays pauvre avec des idéaux merveilleux, mais des idéaux si idéalistes qu'ils en sont inapplicables.
Nous rentrâmes au Canada par mer, et ensuite il y eut la question de gagner de quoi vivre, aussi je dus écrire un autre livre. Ma santé se détériorait beaucoup, et c'était la seule chose que je pouvais faire.
Je découvris qu'en mon absence quelqu'un avait pondu un livre en se servant du matériel que j'avais écrit, quelques années auparavant, pour un magazine anglais. L'homme était un personnage bien curieux qui, dès qu'il se sentait menacé pour quelque illégalité, se réfugiait derrière la formule pratique de la faillite, ses amis ou ses parents ‘rachetaient’ l'affaire — et de ce fait, il n'y avait plus aucun recours.
Un de mes gros ennuis, depuis la parution du ‘Troisième Œil’, a été le nombre de gens qui apposent les mots ‘Approuvé par Lobsang Rampa’ sur les produits qu'ils fournissent. C'est tout à fait mensonger : je n'‘approuve’ aucune chose. Beaucoup de gens, également, se sont fait passer pour moi et, en fait, à plusieurs reprises, j'ai dû appeler la police. Il y eut, par exemple, un homme de Miami qui écrivit à un libraire de San Francisco en mon nom, en signant même mon nom. Il écrivait un paquet de ‘bigoteries’, chose que je ne fais jamais, et commanda une quantité de livres à lui être expédiés. Tout à fait par hasard, j'écrivais de Vancouver au libraire en question au même moment, et il fut si surpris de recevoir une lettre de moi apparemment de la Colombie-Britannique, qu'il m'écrivit en me demandant comment je me déplaçais si rapidement. Il fut donc découvert que ce type commandait depuis un certain temps des marchandises en mon nom, sans les payer. Comme j'ai déjà dit, si quelqu'un a été assez fou pour croire que tout le charabia écrit par ce bonhomme était de ‘moi’, ce quelqu'un méritait bien de se faire prendre. Il y en a eu d'autres encore, comme ce type qui, s'étant isolé dans une grotte de montagne, assis à demi nu, jambes croisées, prétendait être moi. Il conseillait aux adolescents d'user du sexe et de la drogue, leur disant que c'était bon pour eux. La presse, bien sûr, s'est jetée sur de tels incidents avec avidité et même quand il était prouvé qu'il s'agissait d'imposteurs, la presse ne m'a jamais rendu justice publiquement. Je suis totalement, totalement, totalement contre le suicide. Je suis totalement, totalement contre les drogues, et je suis totalement, totalement contre la presse. Je pense que le journaliste moyen n'est pas qualifié pour faire rapport sur la métaphysique ou sur l'occulte ; les journalistes n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la spiritualité et, à mon avis, ils n'ont tout simplement pas l'intelligence.
Après un temps à Fort Érié, où nous sommes revenus après l'Amérique du Sud, nous allâmes à Prescott, en Ontario, où nous nous installâmes dans un petit hôtel. Le Directeur de cet hôtel était vraiment un homme extrêmement bien. Nous y sommes restés pendant un an, et pendant toute cette année il n'y eut jamais, à aucun moment, le moindre désaccord ou le moindre manque d'harmonie entre la ‘direction’ et nous. Cet homme, un vrai gentleman, s'appelait Ivan Miller et je souhaiterais connaître son adresse actuelle pour lui exprimer de nouveau ma reconnaissance pour tous ses efforts. C'était un homme grand et fort, énorme en fait ; il avait été lutteur et pourtant, il pouvait être plus doux que la plupart des femmes.
Chapitre Onze
Il était bon d'être de retour au Canada pour avoir ce qui était alors un service postal fiable. Nous avions connu tant d'ennuis dans ce domaine en Uruguay — et, entre autres, un incident qui me rendit fou de fureur. Je recevais, en tant qu'auteur, un important courrier que je me vis refuser, pour la raison suivante. J'avais deux noms : celui que j'avais adopté, et celui de Lobsang Rampa, sous lequel j'écris. Les responsables de la poste à Montevideo furent intransigeants et se refusèrent à me laisser prendre possession du courrier adressé à mes deux noms. De leur point de vue, tout être éprouvant le besoin d'avoir deux noms ne pouvait être qu'un filou. Réfléchissant soigneusement à la question, et décidant que j'étais beaucoup plus connu sous le nom de Lobsang Rampa, je me rendis à la poste, les priant de me remettre le courrier à ce nom — et de retourner le reste.
Mais, bien sûr, ils demandèrent à voir mes papiers — qui, portant le mauvais nom, ne me permirent pas d'entrer en possession de mon courrier. Je finis par m'adresser à un avocat, un ‘abogado’, qui rédigea un Acte de Changement de Nom. Ce devait être fait légalement, et le document dûment couvert des timbres et cachets officiels, il fallut encore annoncer ce changement dans un journal juridique uruguayen. Je pouvais désormais recevoir mon courrier, mais seulement celui au nom de Lobsang Rampa — mon autre nom n'étant pas reconnu.
Maintenant, bien sûr, mon nom a été également changé légalement au Canada pour celui de T. Lobsang Rampa, et tandis que nous sommes sur le sujet de l'administration, de la bureaucratie, etc. — je suis maintenant un citoyen Canadien. J'ai pris la nationalité canadienne et, là encore, les formalités ont été vraiment incroyables. Mais il semble y avoir des formalités dans tout, de nos jours. J'ai essayé d'obtenir la Pension de Vieillesse, à laquelle j'ai droit, mais la bureaucratie est telle, qu'apparemment je ne pourrai pas l'avoir — du moins, d'après les fonctionnaires — à moins de fournir les adresses exactes et les dates d'arrivée et de départ exactes de chaque endroit où j'ai vécu au Canada. Eh bien, j'ai séjourné dans un grand nombre d'endroits depuis Windsor jusqu'à Prescott, Montréal, Saint John, Nouveau-Brunswick, Halifax, la traversée du pays jusqu'à Vancouver, retour vers Calgary, etc., et j'aurais cru être un citoyen Canadien suffisamment connu, avec un passeport, etc., mais apparemment cela ne convenait pas aux fonctionnaires ‘fous de bureaucratie’. Ainsi, l'affaire est toujours ‘en suspens’. Ça me paraît une histoire de pomme pourrie plus qu'autre chose, n'est-ce pas ?
La nuit dernière j'étais vraiment très souffrant et, tard dans la nuit, je m'éveillai après avoir sommeillé quelque peu, pour me trouver entouré d'un groupe de ceux qui étaient mes collègues, des lamas du Tibet. Ils étaient dans l'astral, s'agitant pour me voir sortir du corps, afin que je vienne discuter de certaines choses avec eux. "Que vous arrive-t-il à vous tous ? leur demandai-je. Si je devais me sentir un peu plus mal encore, je ne tarderais pas à être là-bas de façon permanente." Le Lama Mingyar Dondup eut un sourire et dit : "C'est justement ce dont nous avons peur. Nous voulons que tu fasses d'abord quelque chose d'autre."
Quand on est, comme je le suis, un habitué du voyage astral, ce n'est plus rien que de quitter son corps, c'est plus facile que de sortir du lit, aussi, je glissai tout simplement hors de ce corps et entrai dans l'astral. Nous marchâmes ensemble au bord d'un lac sur lequel jouaient de nombreux oiseaux aquatiques. Dans l'astral, vous savez, les créatures n'ont aucune peur de l'Homme, ainsi ces oiseaux s'amusaient tout simplement dans l'eau. Nous asseyant sur la rive recouverte de mousse, mon Guide me dit alors : "Tu sais, Lobsang, tu n'as pas parlé de façon assez détaillée de la transmigration. Nous voudrions que tu dises quelque chose à propos des gens qui ont utilisé la transmigration." Ne voulant pas gâcher, en faisant le grincheux, un moment si plaisant, je promis de me remettre à écrire le lendemain avant que le livre ne se termine.
C'était très agréable, toutefois, d'être dans l'astral, à l'abri de la douleur, à l'abri des soucis et de tout le reste. Mais, comme je me le rappelai, les gens ne vont pas sur Terre pour leur plaisir, mais parce qu'ils ont quelque chose à apprendre ou quelque chose à enseigner.
Ainsi, aujourd'hui est un autre jour, le jour où il me faut écrire quelque chose de plus sur la transmigration.
Au temps de l'Atlantide — oh oui ! — l'Atlantide a réellement existé ; il ne s'agit pas simplement du produit de l'imagination d'un écrivain : l'Atlantide était réelle. Au temps de l'Atlantide, donc, il y avait une civilisation vraiment très avancée. Les gens ‘marchaient avec les Dieux’. Les Jardiniers de la Terre ne cessaient d'observer les développements en Atlantide. Mais ceux qu'on observe sont prudents à l'égard des observateurs, et c'est ainsi que les Jardiniers de la Terre utilisèrent le processus de la transmigration afin de pouvoir se livrer à une forme plus subtile d'observation.
Un certain nombre de corps aux vibrations appropriées furent utilisés par les esprits des Jardiniers, et ils purent ainsi se mêler aux humains et savoir exactement ce qu'ils pensaient réellement d'eux et s'ils complotaient.
Les Jardiniers de la Terre qui s'occupaient de cette mystérieuse civilisation dite Sumérienne avaient également des tuteurs venant sur la Terre par la transmigration. C'était vraiment trop lent de traverser l'espace dans d'immenses vaisseaux en prenant autant de temps. Par la transmigration, ce pouvait être fait en quelques secondes.
Les Égyptiens, aussi, étaient largement contrôlés et entièrement instruits par des Entités supérieures qui pénétraient dans des corps spécialement cultivés, et quand ces corps n'étaient pas en fait employés par les Entités, ils étaient nettoyés avec soin, enveloppés, et mis de côté dans des boîtes de pierre. Les ignorants indigènes Égyptiens ayant jeté des coups d'œil fureteurs aux cérémonies en arrivèrent à la conclusion que les Jardiniers préservaient les corps, et c'est ainsi que ceux qui avaient été témoins de ces procédés se précipitèrent chez leurs prêtres pour les informer de tout ce qu'ils avaient vu.
Les prêtres, alors, songèrent à imiter la chose, et quand une personne d'assez haut rang mourait, ils l'enveloppaient alors de bandelettes, la recouvraient d'épices, et tout le reste, mais ils s'aperçurent que les corps se décomposaient. Ils en vinrent alors à la conclusion que c'était les intestins, le cœur, le foie et les poumons qui causaient la décomposition, et donc toutes ces parties furent enlevées et mises dans des vases séparés. Il est heureux qu'ils ne préparaient pas les hôtes pour les esprits entrants, parce que les hôtes auraient très certainement manqué de tripes, n'est-ce pas ?!
Bien sûr, certains embaumements — soi-disant — se faisaient quand un homme, ou une femme, de l'espace qui était tombé malade était mis en état d'animation suspendue afin de pouvoir être évacué vers un vaisseau spatial et emmené ailleurs pour y être traité.
Un grand nombre de leaders célèbres sur cette Terre étaient des Entités transmigrées dans des corps terrestres : Abraham, Moïse, Gautama, le Christ, et puis ce bien connu génie d'entre les génies, Léonard de Vinci. Les inventions de Léonard de Vinci sont légendaires, et il accrut énormément les connaissances de ce monde. Il possédait, comme je suppose que chacun reconnaîtra, des capacités et des sciences dépassant de très loin les connaissances des gens de la Terre. La personne connue sous le nom de Léonard de Vinci était un enfant illégitime sans aucun avantage particulier. Qui sait ? Il aurait même pu être le fils d'un plombier ! Le corps de la personne qui devint Léonard de Vinci était d'une telle intensité de vibrations qu'une Entité très supérieure pouvait en prendre le relais et faire toutes ces choses qu'aucun humain n'aurait pu faire.
Le plus sérieusement du monde, je dis que si les gens de ce monde voulaient seulement écouter ceux qui sont réellement aptes à effectuer la transmigration, il y aurait une merveilleuse chance d'exploration spatiale. Pensez à tous les mondes qui existent. Pensez au fait de pouvoir vous rendre sur un monde en quelques secondes. Certains de ces mondes ne pourront jamais être visités par des humains ‘orthodoxes’ pour des raisons d'atmosphère, de climat, ou de gravité qui ne conviennent pas. Mais quand une personne effectue la transmigration, elle peut prendre le relais du corps d'un natif de la planète, et peut ainsi explorer la planète sans la moindre difficulté.
Les humains, bien versés dans la science de la transmigration, pourraient entrer dans le corps des animaux afin d'être en mesure de les étudier efficacement. Cela s'est déjà fait, cela a souvent été fait auparavant, et à cause d'une mémoire raciale, il existe certaines fausses croyances que les humains renaissent sous la forme d'animaux. Ce n'est jamais le cas. De même, les animaux ne naissent pas sous une forme humaine. Les animaux ne sont pas non plus inférieurs aux humains. Mais à cause d'une mémoire raciale des Jardiniers de la Terre reprenant les corps de certains animaux, la connaissance de ce fait a persisté sous une forme dénaturée. C'est ainsi que les bonnes religions sont dégradées.
Nous avons beaucoup voyagé au Canada. Nous sommes allés de Windsor, en Ontario, à Fort Érié, puis à Prescott, pour ensuite nous rendre à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Pour un temps, comme vous pouvez le lire dans mes autres livres, nous avons été très heureux au Nouveau-Brunswick, dans une ville très plaisante, près de la mer. Mais, comme dit mon comptable, un écrivain doit voyager, aussi nous avons déménagé à Montréal et avons vécu à Habitat pendant un certain temps. Habitat est cette drôle de collection d'appartements empilés les uns sur les autres comme un jeu de cubes pour enfants. Quoi qu'il en soit, c'était un endroit très plaisant où vivre, et en fait nous l'avons tellement aimé, qu'après l'avoir laissé nous y sommes revenus plus tard. Ici encore, à Montréal, il y avait toujours des grèves, et il y avait également le problème de langage, parce que les Canadiens français n'étaient pas du tout amicaux avec ceux qui ne parlaient pas français, et ma ferme conviction personnelle a toujours été que le Canada était un pays anglophone et je refusai de parler le français.
Arriva bientôt le moment où nous déménageâmes de nouveau, cette fois à Vancouver, en Colombie-Britannique, où nous nous installâmes dans un hôtel, en réalité un hôtel qui avait également des appartements. Vancouver a beaucoup décliné récemment sous ce que je considère comme une forme parfaitement horrible de gouvernement. Et une autre plainte contre Vancouver, ce sont les inscriptions ‘Pas d'animaux’ que l'on voit partout, et comme disait un jour un hôtelier, les animaux n'ont jamais gêné son commerce, mais les enfants le font, tout comme les ivrognes et les gens qui, fumant au lit, provoquent des incendies.
J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai beaucoup appris, et j'aurais un certain nombre de ‘souhaits’ à formuler —
Je souhaite, par exemple, qu'il puisse y avoir une censure de la presse, parce que j'ai vu tant de souffrances causées par des rapports de presse inexacts. Je suis heureux de constater que de très nombreuses personnes sont maintenant d'accord avec moi à ce sujet, parce que l'exactitude de la presse est souvent mise en doute de nos jours.
Les prédictions faites à mon sujet il y a tant et tant d'années ont été parfaitement exactes. Il avait été prédit que même mon propre peuple se retournerait contre moi. Eh bien, c'est ce qui est arrivé — bel et bien arrivé, puisque quand j'ai eu des problèmes, personne ne s'est porté à mon secours ni ne s'est présenté pour attester de la vérité de mon histoire, de cette histoire vraie.
J'avais de si grands espoirs d'aider le Tibet. Je pensais, par exemple, qu'en étant reconnu je serais en mesure de parler en faveur du Tibet devant les Nations Unies. J'espérais qu'en étant reconnu je pourrais avoir un programme de radio sur le Tibet libre ; mais non, aucune aide d'aucune sorte ne m'a été apportée par les gens du Tibet qui ont quitté ce pays. Fort malheureusement, c'est autant leur perte que la mienne. Tant de bien aurait pu être fait. Mon nom est largement connu, on m'accordera que je peux écrire, et on m'accordera également que je peux parler. Je voulais mettre ma plume et ma parole au service du Tibet, pourtant ils n'ont pas été du tout désireux de me reconnaître, tout comme dans le passé un Dalaï-Lama ne voulait pas reconnaître le Panchen Lama et vice versa. C'est tout comme, nous dirons, un chef politique qui ignore l'existence de l'autre. Mais je reçois une multitude de lettres ; aujourd'hui, par exemple, j'en ai reçu cent trois. J'en ai souvent reçu beaucoup plus, et les lettres viennent de tous les coins du monde. J'apprends des choses qui sont ignorées de beaucoup, et on m'a dit, à tort ou à raison, que les gens actuels qui ont fui le Tibet ne peuvent pas me ‘reconnaître’ parce qu'une autre faction religieuse qui leur vient en aide serait en colère. J'ai toutes les preuves qu'il en est bel et bien ainsi, en fait. Mais — eh bien — il est inutile de commencer une guerre religieuse en miniature, n'est-ce pas ?
Ce sont principalement les classes inférieures de réfugiés qui semblent m'être opposées. J'ai reçu, il y a quelques mois, une lettre d'un homme important qui est allé rendre visite au Dalaï-Lama et qui lui a parlé de moi. Le Dalaï-Lama, me fut-il rapporté, m'invitait à retourner au Potala quand il serait libéré de l'agression des Communistes.
Et il y a quelques semaines seulement, notre fille adoptive (nous ne ‘mentionnons pas de noms’, vous vous souvenez ?) recevait une lettre disant que le Dalaï-lama était très inquiet au sujet de la santé du Dr Rampa, et qu'il priait pour lui chaque jour. Cette lettre est maintenant entre les mains de mes éditeurs.
Un autre de mes ‘souhaits’ est celui-ci : il existe un grand nombre de groupes occultes, certains d'entre eux se prétendant très très anciens, même s'il n'y a que quelques années qu'ils ont été ressuscités par un certain publiciste. Mais je me plains de ceci : si tous ces gens étaient si saints — si bons — si consacrés à l'illumination spirituelle, pourquoi ne pouvons-nous alors tous nous réunir, parce que s'ils étaient vraiment authentiques, ils se rendraient compte que tous les chemins mènent à la ‘Maison’.
Un certain nombre d'étudiants de ces écoles de cultes m'ont demandé pourquoi je n'étais pas entré en contact avec le Groupe ceci ou le Groupe cela, et la réponse est que je l'ai fait et que j'ai reçu de ces groupes des répliques extrêmement insultantes, tout cela parce qu'ils étaient jaloux, ou parce qu'ils avaient absorbé le poison de la presse. Eh bien, je ne vois pas du tout les choses de cette façon. Je maintiens que peu importe la religion à laquelle on appartient, peu importe la façon dont on étudie l'occulte, si les gens sont sincères, ils devraient pouvoir travailler ensemble.
Il y a quelques années, je fus contacté par un homme qui était le fondateur d'une soi-disant Science Tibétaine. Il m'écrivit en me suggérant que nous pourrions faire beaucoup d'argent si je me joignais à lui pour qu'il puisse utiliser mon nom. Eh bien, je ne fais pas ce genre de choses, je ne pratique pas ce travail comme un truc lucratif. Mes croyances sont mes croyances quotidiennes et je vis selon le code qui m'a été enseigné.
J'aimerais que beaucoup de ces prétendus Ordres ou sociétés métaphysiques ne soient autorisés qu'après un examen minutieux. Tant d'entre eux sont des imposteurs qui ne visent qu'à faire de l'argent. Je connais un groupe en particulier qui reconnaît franchement que ses membres prennent ce qu'ils considèrent le meilleur des ouvrages d'une quantité d'auteurs et concoctent quelque chose de tout à fait différent. Eh bien, c'est de la malhonnêteté.
Ceci est une bonne occasion de vous dire une nouvelle fois — au cas où vous lisiez ce livre en commençant par la fin, comme beaucoup le font — que tous mes livres sont absolument vrais. Je peux faire chacune des expériences métaphysiques à propos desquelles j'écris, et c'est mon vœu le plus sincère que vienne le jour où les gens finissent par reconnaître la vérité de mes livres, parce que j'ai encore beaucoup de choses à leur enseigner. À l'heure actuelle, à cause des mensonges propagés par la presse, on m'a traité comme un lépreux ou un paria. De nombreuses personnes ‘puisent’ dans mes livres et écrivent ensuite des choses en les présentant comme leurs propres idées. Il y a quelque temps, j'étais très heureux d'écouter sur les ondes courtes un long extrait d'un de mes livres quand, à la fin de la lecture, je fus estomaqué d'entendre que l'on en attribuait l'œuvre à une femme qui peut à peine signer son nom !
Ainsi, croyez-moi, tous mes livres sont vrais, et je crois avoir le système par lequel les gens de ce monde peuvent visiter les autres mondes en toute sécurité.
**********
Je tiens à remercier Mrs Sheelagh M. Rouse qui a tapé quinze de ces livres. J'ai tapé le premier. Elle les a également tapés sans la moindre plainte.
Une autre chose susceptible de vous intéresser : Mrs Rampa a maintenant presque terminé un livre dans lequel elle donne sa version de toute cette affaire. Si vous voulez en savoir plus — eh bien, il vous faudra attendre les publicités, n'est-ce pas ? ou bien, vous pouvez écrire à :
Mr E.Z. Sowter,
A. Touchstone Ltd,
33, Ashby Road,
Loughborough Leics,
England.
(Précisons que, depuis le temps, cette adresse n'est plus valide — NdT)
Ainsi se termine le Quatrième Livre
Comme il en est Maintenant !