T. LOBSANG RAMPA
DOCTEUR DE LHASSA
Titre original : Doctor from Lhasa
(Édition : 22/04/2020,
paru précédemment sous le titre
Lama Médecin)
Docteur de Lhassa — (Initialement publié en 1959) Le récit se poursuit avec Lobsang quittant Lhassa et vivant à Chongqing, en Chine. Ici, il approfondit ses connaissances médicales, apprit à piloter un avion, pour finalement être capturé et torturé par les Japonais. Lobsang fut longtemps emprisonné dans des camps de concentration et dû même servir d'officier médical officiel jusqu'au jour où il put s'échapper. Lobsang fut l'une des rares personnes à survivre à la première bombe atomique larguée sur Hiroshima. Il nous apprend dans ce livre comment utiliser une boule de cristal et nous enseigne des exercices respiratoires pour améliorer notre santé.
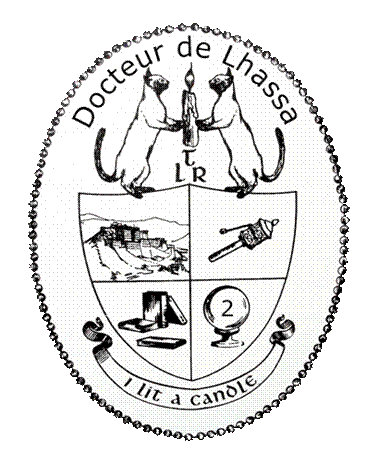
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
Table des matières
Chapitre Trois À la faculté de médecine
(L'Aura et le corps éthérique)
Chapitre Quatre Je deviens aviateur
Chapitre Cinq De l'autre côté de la mort
Chapitre Sept Missions de secours
Chapitre Huit Aux premiers jours du monde
(Les cavernes secrètes du Potala)
Chapitre Neuf Prisonnier des japonais
(Visite aux Hautes-Terres de Chang Tang)
Chapitre Dix Comment il faut respirer
Note de l'éditeur
Quand le premier livre de Lobsang Rampa intitulé Le Troisième Œil a été publié, une controverse des plus échauffées a surgi et est toujours en cours. L'affirmation de l'auteur de ce qu'un lama Tibétain écrivait sa vie ‘à travers’ lui et qu'il avait, en fait, entièrement occupé son corps suite à une commotion accidentelle, n'en était pas une à laquelle plusieurs lecteurs de l'Occident étaient susceptibles d'ajouter foi. Certains, se souvenant de cas semblables dans le passé, bien que non au Tibet, ont préféré garder un esprit ouvert. D'autres, et il semble que ce soit la majorité, se sont montrés ouvertement sceptiques. Plusieurs d'entre eux, toutefois, qu'ils aient été des spécialistes de l'Extrême-Orient ou des lecteurs ordinaires qui apprécient un livre peu commun, ont été confondus par l'évidente maîtrise que l'auteur a de son sujet, ouvrant toute grande une porte sur une partie du monde fascinante et très peu connue, et par l'absence de toute références précédentes de son talent littéraire. Il est certain que personne n'a été en mesure d'en réfuter les faits.
Les Éditeurs actuels croient que, quel que puisse être la vérité de l'affaire (si jamais elle peut être vérifiable), il est juste que Le Troisième Œil et maintenant Lama Médecin puissent être disponibles au public, ne fût-ce que pour le mérite qu'ont ces livres d'être extrêmement agréables à lire. Quant aux questions plus grandes, plus fondamentales qu'ils soulèvent, chaque lecteur doit en venir à une décision personnelle. Lama Médecin est tel que Lobsang Rampa l'a écrit. Il doit parler pour lui-même.
Préface de l'auteur
C'est au cours de mon séjour en Angleterre que j'ai écrit le Troisième Œil, ouvrage qui a suscité d'âpres controverses bien qu'il fût véridique. Des lettres ont afflué de tous les coins du monde ; c'est pour y répondre que j'ai écrit ce nouveau livre.
Mes expériences, dont on lira le récit dans un troisième volume, ont dépassé de très loin celles du commun des mortels. D'ailleurs, l'Histoire n'offre que très peu d'exemples qui leur soient comparables. Mais tel n'est pas le sujet de ce livre dans lequel le lecteur voudra bien trouver la suite de mon autobiographie.
Je suis un lama tibétain venu en Occident pour se conformer à son destin, parce que ce voyage avait été prédit comme avaient été prédites toutes les épreuves que j'ai endurées. Malheureusement, les gens n'ont vu en moi qu'une curiosité exotique, un spécimen zoologique bon à être exhibé dans une cage comme un monstre venu de l'Inconnu.
Qu'adviendrait-il donc, je me le demande, de mes vieux amis, les Yétis (du tibétain yeh : animal inconnu, et teh : région rocailleuse — c'est le nom donné par les Népalais à l'Abominable Homme des neiges — NdT), si les Occidentaux réussissaient à les capturer, comme ils s'efforcent de le faire. À coup sûr, ils seraient abattus, empaillés et relégués dans un musée ! Ce qui n'empêcherait pas les gens de discuter de leur existence et... de la nier ! Pour moi, il me paraît curieux, voire incompréhensible que ceux-là mêmes qui croient à la télévision et aux fusées sidérales qui reviennent sur la Terre après avoir fait le tour de la Lune, refusent de croire aux Yétis ou aux Objets Volants, et, en fait, à tout ce que leurs mains ne peuvent toucher ou démonter, pièce par pièce, pour en découvrir le mécanisme.
Mais me voici devant la tâche redoutable de condenser en quelques pages ce qu'il m'a fallu un livre entier pour raconter : l'histoire de ma première enfance.
Je suis issu d'une très noble famille, l'une des plus influentes de Lhassa, la capitale du Tibet. Mes parents jouaient un rôle de tout premier plan dans les affaires du pays, et ma haute naissance me valut de recevoir une éducation très stricte qui devait, pensait-on, me préparer à tenir mon rang. Juste avant mon septième anniversaire, on consulta, selon la tradition, les prêtres astrologues du Tibet sur ma carrière. Il fallut des jours et des jours pour préparer cette cérémonie et la grandiose réception au cours de laquelle mon destin serait révélé aux dirigeants et notables de Lhassa.
Le jour de la Prophétie arriva enfin. Une foule de gens se pressait dans notre propriété. Les astrologues étaient venus armés de parchemins, de cartes et de tout l'attirail nécessaire à l'exercice de leur profession. Puis, au moment favorable, une fois les esprits amenés à un suprême degré de surexcitation, le chef astrologue dévoila ses conclusions. Il fut solennellement proclamé qu'à l'âge de sept ans j'entrerais dans une lamaserie pour y recevoir la formation d'un lama chirurgien. De nombreuses prédictions furent faites concernant ma vie, dont pratiquement tout le cours fut tracé. À mon grand chagrin, tout ce qui fut alors prédit devait se réaliser. Je dis ‘à mon grand chagrin’ parce que ma vie a surtout été riche de misères, de tourments et de souffrances et que connaître ses maux à l'avance n'aide guère à les supporter.
À l'âge de sept ans, je suivis, solitaire, la route qui menait à la lamaserie de Chakpori. À l'entrée où l'on m'arrêta, je dus me soumettre à une épreuve destinée à montrer si j'étais assez solide et assez résistant pour commencer mon apprentissage. Ce n'est qu'après l'avoir subie avec succès que je fus admis à l'intérieur.
Entré complètement ignare, je gravis tous les échelons et finis par devenir lama et abbé. J'étais particulièrement doué pour la médecine et la chirurgie. J'étudiais ces disciplines avec passion et on me donna toutes facilités pour disséquer des cadavres. On pense souvent dans les pays occidentaux que les lamas du Tibet se refusent à toucher les corps humains dès qu'il est question de les inciser. On semble croire que la science médicale tibétaine est rudimentaire puisqu'elle ne soigne que l'extérieur en négligeant l'intérieur. C'est absolument faux. Je reconnais qu'en principe un lama n'ouvre jamais un corps humain, car ce serait aller à l'encontre de ses croyances. Mais il y avait un groupe spécial de lamas, dont j'ai fait partie, à qui l'on apprenait à pratiquer des opérations, et des opérations que des savants occidentaux eussent peut-être été incapables de mener à bien.
Soit dit en passant, on se figure aussi que la médecine tibétaine enseigne que l'homme a le cœur d'un côté et la femme de l'autre. Rien n'est plus stupide. De telles idées ont été répandues par des gens aux connaissances superficielles, puisque les tableaux auxquels ils se réfèrent représentent des corps célestes ! Mais "ceci est une autre histoire", qui n'a rien à voir avec ce livre.
Mon instruction fut très poussée car, en plus de la médecine et de la chirurgie qui étaient mes spécialités, je devais aussi étudier les Écritures. Il me fallait en effet devenir non seulement lama médecin, mais lama tout court, c'est-à-dire un prêtre dont la formation fût complète. Je fus donc obligé d'étudier dans deux directions à la fois et, par conséquent, de travailler deux fois plus qu'un étudiant ordinaire. À l'époque, cette obligation ne m'enchantait guère.
Il va de soi que tout mon temps n'était pas consacré à d'austères devoirs. Je fis de nombreux voyages dans les hautes régions du Tibet — Lhassa est à 12 000 pieds (3 657 m) au-dessus du niveau de la mer — pour y cueillir des herbes, qui sont à la base de notre thérapeutique en raison de leurs vertus curatives.
C'est ainsi qu'au Chakpori, nous en avions toujours au moins six mille variétés en réserve dans nos magasins.
Nous autres Tibétains sommes convaincus d'en savoir plus sur les simples qu'aucun autre peuple. Et maintenant que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, j'en suis encore plus sûr !
Plusieurs fois, au cours de voyages sur les Hautes-Terres du Tibet, j'ai volé sur des cerfs-volants capables de porter des hommes ; alors, planant au-dessus des pics déchiquetés, je pouvais contempler le paysage sur des milles et des milles (km) à la ronde. J'ai pris également part à une célèbre expédition dans une partie presque inaccessible du Tibet, la région la plus élevée des Hautes-Terres de Chang Tang. Notre expédition devait y découvrir une vallée très écartée et profondément encaissée entre d'énormes précipices. Elle était chauffée, et si bien chauffée par les feux éternels de la Terre que des sources d'eaux chaudes y jaillissaient, qui allaient ensuite se perdre dans une rivière. Nous découvrîmes aussi une ville importante dont une moitié était exposée au souffle chaud de la vallée secrète, tandis que l'autre était recouverte par un glacier à la glace transparente. Cette glace était si claire qu'on y voyait la ville comme au travers d'une eau très limpide. La partie de la ville qui avait échappé au gel était pour ainsi dire intacte. En vérité, les années s'étaient montrées clémentes envers les maisons. L'air parfaitement immobile et l'absence de vent les avaient préservées des ravages du temps. Nous parcourûmes les rues, premiers humains à en fouler le sol depuis des milliers et des milliers d'années. Les maisons que nous visitâmes longuement semblaient attendre l'arrivée de leurs propriétaires, mais la présence d'étranges squelettes, de squelettes pétrifiés, nous rappela que nous nous trouvions dans une cité morte. Quant aux installations extraordinaires qui s'y trouvaient, elles prouvaient clairement que cette vallée secrète avait été autrefois le centre d'une civilisation supérieure à toutes celles que nous connaissons actuellement. Ainsi nous eûmes la preuve irréfutable que, comparés aux gens de cet âge révolu, nous ne sommes que des sauvages. Mais, dans ce livre, mon deuxième, je reviendrai sur ce sujet.
Alors que je n'étais encore qu'un tout jeune enfant, on me fit subir une opération spéciale, l'Ouverture du Troisième Œil. Elle consista à insérer au milieu de mon front, un éclat de bois dur préalablement trempé dans des solutions à base d'herbes, qui devait, en agissant sur une glande, stimuler mes dons de voyance.
J'étais né avec des dons indéniables, mais après l'opération, mes pouvoirs de voyance devinrent presque anormaux. C'est ainsi qu'il me suffisait de regarder les gens pour les voir avec leurs Auras, des couronnes de flammes aux couleurs changeantes. Ces Auras me permettaient de deviner leurs pensées, et aussi leurs maux, leurs espoirs et leurs craintes. Depuis mon départ du Tibet, j'essaie d'intéresser des médecins occidentaux à une machine qui permettrait à n'importe quel docteur ou chirurgien de voir les Auras humaines telles qu'elles sont, c'est-à-dire colorées. Je sais que s'ils en étaient capables, la cause exacte des maladies leur apparaîtrait clairement. Il suffirait au spécialiste d'observer les couleurs et le contour mouvant des bandes lumineuses d'une Aura pour diagnostiquer exactement la maladie d'un patient. De plus, ce diagnostic pourrait être fait avant l'apparition du moindre symptôme, car l'Aura révèle la présence du cancer, de la tuberculose et des autres maladies, bien des mois avant que le corps physique ne soit attaqué.
Ainsi, le docteur, averti longtemps à l'avance du développement de la maladie, pourrait la soigner et la guérir à coup sûr. Mais à ma grande consternation et à mon vif chagrin, les médecins occidentaux se désintéressent complètement de ce projet. Ils semblent croire que mon idée relève de la magie alors qu'il ne s'agit que du bon sens le plus élémentaire. N'importe quel ingénieur sait que les fils à haute tension sont entourés d'une sorte de couronne. Il en va de même pour le corps humain. Tout ce que je veux montrer aux spécialistes est un phénomène physique banal et ils s'y refusent ! C'est tragique ! Mais on finira par y venir. Le malheur de l'affaire, c'est qu'en attendant une foule de gens devront souffrir et mourir bien inutilement.
Le Dalaï-Lama (le 13e) qui m'avait pris sous sa protection, avait donné l'ordre de tout mettre en œuvre pour m'aider dans mes études théoriques et pratiques. Il voulait que j'apprenne tout ce qu'il serait possible de me faire entrer dans le crâne, aussi mon instruction se fit-elle par le système oral ordinaire d'abord, par hypnotisme ensuite et enfin par d'autres méthodes qu'il n'y a pas lieu de mentionner ici.
Certaines sont décrites soit dans le Troisième Œil, soit dans ce livre. Pour les autres, elles sont si ‘révolutionnaires’, si incroyables que l'heure n'est pas encore venue de les exposer.
Mes dons de voyance me permirent en maintes occasions de rendre des services éminents au Très-Profond. Je me tenais caché dans la salle des audiences afin de pouvoir interpréter les véritables pensées et les intentions des visiteurs d'après leurs Auras. Il fallait savoir si leurs discours étaient sincères, problème particulièrement important quand il s'agit de diplomates étrangers ! J'assistai en observateur invisible à la réception d'une délégation chinoise par le Grand Treizième. J'assistai également, toujours en observateur invisible, à l'audience que le Dalaï-Lama accorda à un Anglais mais en cette occasion, je faillis manquer à mes devoirs tant son extraordinaire façon de s'habiller me frappa d'étonnement. C'était la première fois que je voyais un costume européen !
Mon apprentissage fut long et pénible. Au temple, je devait assister aux services de nuit comme de jour.
Point de lits moelleux pour nous : nous dormions à même le sol, enroulés dans une seule et unique couverture. Nos maîtres étaient très sévères et nous ne devions rien oublier de leur enseignement. Nous ne tenions aucun cahier, tout était affaire de mémoire.
J'étudiai également la métaphysique à fond : voyance, déplacements par projection astrale, télépathie, et tout ce qui s'ensuit. Lors d'une phase de mon initiation, je visitai sous le Potala les grottes et les tunnels secrets dont le commun des mortels ignore jusqu'à l'existence.
Là, se trouvent les vestiges d'une antique civilisation, une civilisation dont ni notre mémoire ni celle même du genre humain n'ont gardé le moindre souvenir ; sur les parois, j'ai vu des dessins qui témoignaient qu'autrefois il y avait des ‘choses’ qui volaient dans les airs, et d'autres qui circulaient sous terre. Lors d'une autre phase, j'ai vu des corps de géants mesurant dix et quinze pieds (3 et 4 m 57) de longueur soigneusement conservés.
Je fus aussi envoyé de l'autre côté de la mort afin de comprendre qu'elle n'existe pas et c'est à mon retour, que je devins ‘Incarnation Reconnue’ avec le rang d'abbé. Mais je n'avais pas envie d'être confiné dans une lamaserie, même en qualité d'abbé. Je voulais être lama, libre d'aller et venir, libre surtout d'aider mon prochain, comme il avait été annoncé dans la Prédiction.
Aussi, ce fut le Dalaï-Lama lui-même qui me confirma dans mon rang de lama, en m'attachant au Potala à Lhassa.
Même alors mon instruction se poursuivit et on m'enseigna certaines sciences occidentales, telles que l'optique et d'autres disciplines annexes. Mais un beau jour, le Dalaï-Lama me convoqua pour me donner ses ordres.
Il me dit qu'ayant appris tout ce qui pouvait s'apprendre au Tibet, je devais partir, quitter tous ceux que j'aimais et tout ce qui m'était cher. Il me dit aussi qu'on avait spécialement dépêché des messagers à Chongqing, en Chine, pour m'inscrire à la Faculté de médecine et de chirurgie.
En quittant le Très-Profond pour aller apprendre à mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, ce qui avait été décidé, j'avais le cœur lourd. Je me rendis ensuite chez mes parents pour les mettre au courant et leur annoncer mon prochain départ. Les jours passèrent vite et l'heure vint de quitter le Chakpori, de voir pour la dernière fois Mingyar Dondup dans son être de chair et de m'éloigner de la Cité Sainte pour gagner les défilés de hautes montagnes. En me retournant vers Lhassa, la dernière chose que je vis fut pour moi comme un symbole : un cerf-volant solitaire, en effet, volait au-dessus des toits dorés du Potala.
Chapitre Un
Vers l'inconnu
DE MA VIE, je ne m'étais senti si glacé, si désemparé, si misérable. Même dans les solitudes désolées des Hautes-Terres de Chang Tang, à plus de 20 000 pieds (6 000 m) d'altitude, alors que les vents glacés chargés de sable nous cinglaient et sillonnaient de traînées sanglantes tous les endroits de nos corps laissés à découvert, je n'avais eu aussi froid ; car ce froid était moins mordant, moins terrifiant que l'angoisse qui me tordait le cœur. Je m'éloignais de Lhassa, ma ville bien-aimée !
En jetant un regard en arrière, j'aperçus des silhouettes minuscules sur les toits dorés du Potala ; au-dessus d'elles, un cerf-volant solitaire évoluait au gré d'une douce brise... Il dansait dans les airs comme pour me dire :
"Adieu, fini le temps de voler dans les cerfs-volants, au tour maintenant des affaires sérieuses !..."
Ce cerf-volant perdu dans l'immensité du ciel bleu, qu'une mince corde suffisait à rattacher à la terre, me parut être un symbole ; moi aussi, voyageur en partance pour le grand monde qui m'attendait aux frontières du Tibet, j'étais retenu par une corde : mon fervent amour pour Lhassa. Au-delà de ma paisible patrie, c'était un univers terrible et étrange que j'allais affronter ! Ah ! que mon cœur était lourd quand je tournai le dos à ma maison et qu'avec mes compagnons je commençai la chevauchée qui allait nous conduire vers le Grand Inconnu. Eux aussi étaient malheureux, encore qu'ils eussent la consolation de savoir qu'après m'avoir quitté à Chongqing, 1 000 milles (1 600 km) plus loin, ils pourraient rentrer chez eux. Ils reviendraient à Lhassa et lors du voyage de retour, chaque pas, en les rapprochant de leur foyer, leur infuserait des forces nouvelles. Pour moi, il me faudrait poursuivre mon voyage interminable vers des pays et des populations étranges et connaître des expériences plus étranges encore...
Dans la Prophétie, faite lors de mon septième anniversaire, il avait été annoncé que j'entrerais dans une lamaserie pour y recevoir d'abord la formation d'un chela, puis celle d'un trappa, et ainsi de suite jusqu'au moment où après les délais normaux, je pourrais passer l'examen de lama. Après quoi, selon les dires des astrologues, je devrais quitter le Tibet, quitter mon foyer, quitter tous ceux qui m'étaient chers et gagner ce que nous appelions la barbare Chine. Il était entendu que je me rendrais à Chongqing pour y étudier la médecine et la chirurgie.
D'après les Prêtres Astrologues, je devais être mêlé à des guerres et fait prisonnier par d'étranges gens ; il me faudrait aussi surmonter maintes tentations et maintes souffrances pour venir en aide à tous ceux qui réclameraient ma protection. Ils avaient prédit que ma vie serait difficile et que la souffrance, la peine et l'ingratitude seraient mes fidèles compagnons. Comme ils avaient eu raison !
C'est en ruminant ces pensées — et elles n'étaient guère réconfortantes — que je donnai le signal du départ. Par mesure de précaution, dès que nous fûmes hors de vue de Lhassa, nous mîmes pied à terre. Il fallait, en effet, nous assurer que nos harnachements ne gênaient pas nos bêtes, que les sangles de nos selles n'étaient ni trop serrées ni trop lâches. Nos chevaux allaient être par force d'inséparables compagnons pendant tout le voyage ; aussi était-il sage de prendre soin d'eux autant que de nos propres personnes.
Cette affaire réglée, nous enfourchâmes nos montures et, consolés de savoir que nos bêtes au moins n'étaient pas trop malheureuses, nous poursuivîmes notre chemin, les yeux fixés résolument devant nous.
C'est dans les premiers mois de 1927 que nous quittâmes Lhassa pour gagner à allure très lente Cho-tang, sur le fleuve Brahmapoutre. Après avoir beaucoup discuté sur le choix de notre itinéraire, nous étions tombés d'accord pour reconnaître que le meilleur était celui qui passait par le fleuve et la ville de Kanting. Je connais bien le Brahmapoutre pour avoir survolé une de ses sources située dans une chaîne de montagnes de l'Himalaya, à l'époque où j'avais le bonheur de voler dans un grand cerf-volant. Si nous autres Tibétains avons pour ce fleuve une grande vénération, elle n'est rien en comparaison de celle qu'il inspire au peuple indien. Là où son cours tumultueux atteint le golfe du Bengale, à des centaines de milles (km) de l'endroit où nous nous trouvions, on le tient pour un fleuve sacré, aussi sacré ou presque que la ville de Bénarès. C'était lui qui — nous avait-on appris — avait donné naissance au golfe du Bengale, car aux premiers jours du monde son cours était rapide et profond. Aussi en dévalant des montagnes presque en ligne droite, avait-il affouillé la terre molle et formé cette baie aussi merveilleuse que célèbre.
Longeant le fleuve, nous arrivâmes aux défilés qui commandaient l'entrée du Sikang. Dans l'ancien temps, le bon vieux temps, alors que je n'étais qu'un petit enfant, le Sikang faisait partie du Tibet, dont il était en fait une province. Puis les Anglais occupèrent Lhassa. Après quoi, on incita les Chinois à envahir le Sikang. Assoiffés de sang, ils occupèrent cette partie de notre pays, tuant, violant et pillant, avant de finalement l'annexer. Des fonctionnaires chinois, en général ceux qui avaient cessé de plaire, y furent envoyés en disgrâce. Malheureusement pour eux, le gouvernement chinois ne les soutint pas ; aussi étaient-ils obligés de se débrouiller de leur mieux. En réalité, ces fonctionnaires n'étaient que des pantins, des faibles, des incapables dont les Tibétains se gaussaient. Bien évidemment, il nous arrivait de faire semblant de leur obéir mais c'était par pure politesse. Aussitôt qu'ils avaient le dos tourné, nous n'en faisions qu'à notre tête.
Notre voyage se poursuivit pendant des jours et des jours ; nous nous arrangions pour faire étape près d'une lamaserie afin d'y passer la nuit. Comme j'étais un lama, et surtout un abbé et une Incarnation Reconnue, les moines s'ingéniaient à nous recevoir le mieux possible. En outre, la protection personnelle du Dalaï-Lama pesait beaucoup dans la balance !
Puis ce fut Kanting, ville marchande réputée, bien connue pour son marché à yaks mais célèbre surtout comme centre d'exportation des briquettes de thé qui font les délices des Tibétains. Ce thé n'était pas importé de Chine en feuilles mais sous la forme d'une mixture chimique composée de thé, bien sûr, mais aussi de brindilles, de soude, de salpêtre et autres ingrédients. Au Tibet, en effet, la nourriture n'est pas aussi abondante ni aussi facile à se procurer que dans d'autres pays, de sorte que notre thé devait servir à la fois de soupe et de breuvage. C'est à Kanting qu'il était mélangé et qu'on lui donnait la forme de blocs, ou plutôt de briquettes, comme on les appelle en général.
Leur forme et leur poids permettaient de les charger sur des chevaux d'abord, des yaks ensuite, qui les acheminaient par les hauts défilés de montagne jusqu'à Lhassa où elles étaient vendues sur le marché puis expédiées aux quatre coins du Tibet.
Ces briquettes, préparées par paquets de dix, d'une forme et d'une dimension standard, devaient être transportées dans un emballage spécial pour ne pas risquer d'être abîmées par l'eau au cas où un cheval viendrait à perdre pied dans un gué. Aussi, ces briquettes étaient-elles empaquetées dans une ‘peau verte’, ou comme on l'appelle parfois une peau crue, qui était aussitôt après plongée dans de l'eau. Après quoi, elles étaient exposées au soleil sur des rochers. En séchant, elles rétrécissaient de façon prodigieuse de sorte que leur contenu était comprimé sous un très faible volume. Ces peaux après avoir viré au roux devenaient aussi dures que de la bakélite tout en étant infiniment plus résistantes. Une fois ainsi préparées, elles pouvaient dévaler le flanc d'une montagne et arriver en bas sans le moindre dommage, ou être laissées à tremper dans une rivière jusqu'à deux jours ! Il suffisait de les retirer et de les faire sécher pour constater qu'elles étaient intactes et que rien n'était abîmé puisque l'eau n'avait pu pénétrer à l'intérieur. Nos briquettes de thé dans leurs enveloppes de peaux séchées constituaient sûrement un des empaquetages les plus hygiéniques du monde ! Soit dit en passant, le thé servait souvent de monnaie. Un marchand démuni d'argent pouvait toujours briser une briquette de thé et s'en servir comme monnaie d'échange. Point n'était besoin d'argent pour qui possédait de ces briquettes !
Kanting nous impressionna vivement par sa vie commerciale tumultueuse. En fait de ville, nous ne connaissions que ‘notre’ Lhassa alors que Kanting fourmillait de gens de toutes nationalités ; ceux qui étaient venus d'aussi loin que le Japon, les Indes, ou Burma y côtoyaient les nomades d'au-delà les montagnes du Takla. Nous flânâmes sur le marché, nous mêlant aux vendeurs, au milieu d'un brouhaha de voix bizarres et de langues étrangères. Nous coudoyions des moines de toutes religions, des membres de la secte Zen et bien d'autres. Puis, toujours sous le charme de ces choses si nouvelles, nous nous rendîmes à une petite lamaserie située à la sortie de Kanting. On nous y attendait. A vrai dire l'inquiétude commençait même à gagner nos hôtes. Mais bien vite, nous leur racontâmes comment nous nous étions attardés sur le marché en faisant nos délices des potins locaux. Après nous avoir fait un accueil chaleureux, l'abbé de la lamaserie écouta avec une vive curiosité nos récits et les nouvelles que nous lui apportions du Tibet. N'arrivions-nous pas du Potala, le Centre de la Sagesse, et n'étions-nous pas les fameux voyageurs qui avaient vu toutes sortes de merveilles sur les Hautes-Terres de Chang Tang ? En vérité, notre renommée nous avait précédés.
Le lendemain à l'aube, après avoir assisté au service célébré dans le temple, nous repartions, non sans emporter avec nous une petite provision de tsampa. La route n'était qu'une piste de montagne serpentant entre les parois d'une gorge. Au-dessous de nous des arbres — jamais nous n'en avions vu en si grand nombre — envahissaient les pentes. Certains étaient partiellement masqués par la brume qui s'élevait au-dessus d'une chute d'eau. Des rhododendrons géants dissimulaient la gorge et le sol n'était qu'un tapis de fleurs aux mille couleurs, des petites fleurs de montagne qui chargeaient l'air de leurs parfums et coloraient vivement le paysage. Pourtant, nous nous sentions oppressés et tristes, tristes de quitter notre pays et oppressés par la densité de l'air. Nous ne cessions de descendre et notre respiration devenait de plus en plus difficile. Nous avions aussi d'autres ennuis ; au Tibet où l'air est raréfié, l'eau bout à basse température et, sur les hauteurs, le thé peut se boire littéralement bouillant. On le laissait sur le feu jusqu'au moment où des bulles nous avertissaient qu'il était prêt. Or, dans ces basses régions, nous nous trompions sur le degré de chaleur de l'eau, et cela nous valut, au début, de terribles brûlures aux lèvres. Nous avions tellement l'habitude de boire le thé aussitôt après l'avoir retiré du feu, et il le fallait bien sinon toute sa chaleur eût été absorbée par le froid glacial ! Nous ignorions alors que la température d'ébullition varie avec la densité de l'air et que nous pouvions attendre que l'eau bouillante se refroidisse un peu, puisqu'elle ne pouvait pas geler.
Plus nous avions du mal à respirer, par suite de la pression de l'air sur nos poitrines et nos poumons, et plus notre appréhension grandissait. D'abord, nous l'attribuâmes à l'émotion d'avoir quitté notre Tibet bien-aimé, mais plus tard nous comprîmes que c'était l'air qui nous faisait suffoquer, qui nous asphyxiait.
Aucun de nous n'était jamais descendu au-dessous de 10 000 pieds (3 000 m). Lhassa elle-même se trouve à une altitude de 12 000 pieds (3 657 m). Il nous arrivait fréquemment de vivre à des altitudes supérieures, comme lors de notre expédition sur les Hautes-Terres de Chang Tang qui dépassent 20 000 pieds (6 000 m).
Il existait de nombreuses histoires sur des Tibétains qui, après avoir abandonné Lhassa pour chercher fortune dans les basses terres, étaient morts après des mois de souffrances, les poumons éclatés. Une mort affreuse attendait tous ceux qui quittaient Lhassa pour se rendre dans les basses terres : tel était un des thèmes favoris des commères de la Cité Sainte ! Pour moi, je n'y croyais pas puisque mes parents étaient allés à Shanghaï où ils possédaient de grands biens, et en étaient revenus sains et saufs.
J'avais peu de rapports avec eux car leurs occupations et leur haute position ne leur laissaient guère le temps de s'occuper de leurs enfants. Ce que j'en savais, je l'avais appris de la bouche des domestiques. Il n'en restait pas moins que les sensations que nous éprouvions alors m'inquiétaient sérieusement : nous avions l'impression d'avoir les poumons à vif et que des cercles de fer autour de nos poitrines bloquaient notre respiration. Respirer demandait un tel effort que nous en avions des frissons ; dès que nous pressions l'allure, notre corps était traversé de douleurs comparables à des pointes de feu. Plus nous descendions, plus l'air s'alourdissait et plus la température montait. Quel terrible climat ! À Lhassa, au Tibet, s'il faisait très froid, il s'agissait d'un froid sec et sain, de sorte que la température avait peu d'importance ; dans le cas présent, au contraire, l'air était si dense et si chargé d'humidité que nous étions presque incapables de continuer notre route. À un moment donné, mes compagnons essayèrent de me convaincre de rebrousser chemin sous prétexte que nous allions tous à une mort certaine. Mais je refusai net car je me souvenais des Prophéties et nous poursuivîmes notre route.
Au fur et à mesure que la température montait, des étourdissements nous gagnaient ; atteints de troubles de vision, nous étions comme ivres. Notre vue était moins puissante que d'habitude, moins nette, et notre appréciation des distances toujours inexacte. Ce n'est que bien plus tard que j'en compris la raison. L'air du Tibet est le plus pur et le plus propre du monde, au point que la vue s'étend jusqu'à 50 milles (80 km) et au-delà, et qu'on distingue les choses aussi clairement que si elles étaient à 10 milles (16 km) à peine ; là où nous étions, au contraire, dans ces basses terres où l'air était si lourd, notre vision était non seulement limitée mais encore déformée par la densité de l'air et ses impuretés.
Pendant des jours et des jours, notre voyage se poursuivit à une altitude toujours plus basse ; nous traversions des forêts où poussaient une profusion d'arbres dont aucun de nous n'avait jamais rêvé qu'elle pût exister. Le bois n'est guère abondant au Tibet, car les arbres y sont rares. Aussi les premiers jours, incapables de résister à la tentation, nous mettions pied à terre et courions vers toutes ces espèces si différentes pour les toucher et en respirer les odeurs.
Elles nous paraissaient si étranges et il y en avait tellement ! Bien entendu, les rhododendrons nous étaient familiers car ils abondent au Tibet, où leurs fleurs constituent un véritable mets de luxe quand elles sont bien préparées. Nous allions de l'avant, émerveillés de tout ce qui se présentait à nos yeux et de tout ce qui nous changeait si profondément de notre pays. Il m'est impossible de dire la durée de ce voyage, en jours ou en heures, ce genre de calcul n'ayant pour nous aucun intérêt. Nous avions tout notre temps ; la bousculade effrénée de la vie civilisée nous était inconnue, et l'eussions-nous connue que nous nous serions gardés de l'imiter.
Nous faisions des étapes quotidiennes de huit à dix heures et passions la nuit dans des lamaseries. Elles n'étaient pas toutes de notre confession bouddhiste, mais cela importait peu et nous étions toujours les bienvenus. Chez nous, les vrais bouddhistes de l'Orient, les rivalités, les rancœurs n'existent pas : un voyageur reçoit toujours un accueil chaleureux.
Pendant nos séjours, nous prenions part à tous les services ainsi que le veut la coutume. Nous ne perdions aucune occasion de bavarder avec les moines qui montraient tant d'empressement à nous recevoir.
Que d'histoires étranges nous entendîmes sur l'évolution de la vie en Chine ! Ils nous racontèrent comment le vieil ordre pacifique des choses subissait des transformations et comment les Russes, ‘les hommes de l'ours’, tentaient d'inculquer aux Chinois un idéal politique qui nous paraissait totalement erroné.
Les Japonais aussi, nous dit-on, faisaient de l'agitation dans diverses régions de la Chine. Question de surpopulation apparemment. S'ils faisaient trop d'enfants, ils ne produisaient pas assez de nourriture ; aussi cherchaient-ils à envahir les pays pacifiques pour s'emparer de leurs richesses comme s'ils étaient les seuls à avoir le droit de vivre.
Enfin, nous passâmes la frontière qui séparait le Sikang du Sseu-tchouan. Encore quelques jours de route et en fin d'après-midi, nous faisions halte dans un petit village situé au bord du Yangtsé. Nous nous étions arrêtés, non parce que nous avions projeté d'y faire étape mais parce qu'une foule importante assistant à une sorte de meeting nous barrait le chemin. En nous faufilant, nous arrivâmes sans peine aux premiers rangs de l'assistance, nos fortes carrures ayant suffi à nous frayer un passage. Un homme blanc à la haute stature, debout sur un char à bœufs, gesticulait en expliquant les merveilles du communisme et en exhortant les paysans à se soulever et à massacrer les propriétaires. Il agitait des gravures représentant un homme barbu aux traits fortement accusés qu'il appelait le Sauveur du Monde. Mais ni ce portrait de Lénine ni ces discours ne nous impressionnèrent ; aussi, lui tournant le dos, nous parcourûmes les quelques milles (km) qui nous séparaient de la lamaserie où nous devions passer la nuit.
Dans certaines parties de la Chine, on trouvait autant de lamaseries que de monastères et de temples chinois. Certaines populations en effet, surtout dans le Sikang, le Sseu-tchouan ou le Tching-hai, préfèrent la forme tibétaine du bouddhisme ; de sorte que nous y avions des lamaseries pour dispenser l'enseignement nécessaire à ceux qui en avaient besoin. Nous ne cherchions jamais à faire des conversions ni ne demandions à qui que ce fût d'être des nôtres car pour nous, tout homme doit être libre de son choix. Les missionnaires qui vont partout en tonnant que quiconque veut être sauvé doit se convertir à telle ou telle religion, ne nous inspiraient guère de tendresse. Nous savions que si un homme voulait devenir lamaïste, il le deviendrait sans qu'aucune pression de notre part fût nécessaire.
Nous savions aussi de quelles moqueries étaient gratifiés les missionnaires venus au Tibet ou en Chine. Une de nos plaisanteries classiques ridiculisait tous ceux qui se convertissaient uniquement pour bénéficier des cadeaux et autres avantages — ou prétendus tels — dont les missionnaires comblaient les néophytes. Un mot encore sur ce sujet. Les Tibétains et les Chinois de l'ancien temps étaient gens fort polis ; aussi s'efforçaient-ils de réconforter les missionnaires en leur faisant croire qu'ils remportaient quelques succès, mais jamais au grand jamais nos peuples ne crurent ce qu'ils leur racontaient. Nous savions qu'ils avaient leur foi, mais nous préférions garder la nôtre.
Nous continuâmes notre route en suivant le cours du Yangtsé — fleuve que je devais connaître si bien par la suite, car cet itinéraire était des plus agréables. Le spectacle des bateaux nous fascinait. Nous n'en avions encore jamais vu, si ce n'est pour quelques-uns d'entre nous dans des livres et que, pour ma part, un bateau à vapeur m'était apparu une fois, lors d'une séance spéciale de voyance tenue sous la direction de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup. Mais je reviendrai plus loin sur cette séance.
Au Tibet, on se servait d'un genre de canot composé d'une carcasse très légère recouverte de peaux de yaks, et pouvant transporter quatre ou cinq passagers en plus du batelier. Il arrivait souvent qu'y prenne également place un passager non payant, une chèvre, l'animal favori du batelier. Mais à terre, celle-ci se rendait utile en transportant sur son dos les affaires personnelles de son maître, son baluchon et ses couvertures tandis que lui-même, le canot sur le dos, grimpait sur les rochers pour éviter les rapides sur lesquels son embarcation se serait fracassée. Parfois un paysan, pour passer un fleuve, se servait d'une peau de bouc ou de yak dont les emplacements des pattes et autres ouvertures avaient été bouchées avec soin et qu'il employait à peu près comme les Occidentaux utilisent un flotteur. Mais alors, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir voir de vrais bateaux, avec de vraies voiles, des voiles latines, claquant au vent.
Un jour, nous fîmes halte près d'un gué, fort intrigués par le manège de deux hommes qui marchaient dans le fleuve, un filet tendu entre eux. Devant eux, deux autres hommes frappaient l'eau à grands coups en poussant des cris effrayants, des fous sans doute que les premiers cherchaient à capturer à l'aide de leur filet. Nous regardions la scène lorsqu'à un signal donné, les cris cessèrent et les poursuivants s'avancèrent de façon à se couper mutuellement le chemin.
Ensuite, tirant à les rompre sur les deux bouts du filet, ils le ramenèrent sur la berge, où, une fois en sécurité sur la rive sablonneuse, ils le vidèrent : des livres et des livres (kg) de poissons brillants tombèrent sur le sol où ils se mirent à s'agiter furieusement. Nous qui ne tuions jamais, parce que notre religion enseigne qu'enlever la vie à un être vivant quel qu'il soit est une mauvaise action, nous étions scandalisés. Au Tibet, les poissons de nos rivières viennent toucher la main qu'on leur tend dans l'eau et mangent volontiers la nourriture qui leur est offerte. Les hommes dont ils sont souvent les familiers ne leur inspirent aucune méfiance. Mais en Chine, les poissons sont juste bons à passer à la casserole. Comment ces Chinois pouvaient-ils se dire bouddhistes alors qu'ils tuaient ces poissons à des fins manifestement égoïstes ?
Nous nous étions mis trop en retard, en restant assis au bord du fleuve pendant une heure, sinon deux, pour arriver à une lamaserie avant la nuit. Avec un haussement d'épaules, nous nous résignions à camper près de la piste quand nous remarquâmes un peu sur la gauche un bosquet d'arbres planté des deux côtés de l'eau. Nous décidâmes d'y passer la nuit. Après avoir mis pied à terre, nous attachâmes nos chevaux de telle sorte qu'ils puissent paître dans ce qui était — en tout cas à nos yeux ! — de luxuriants herbages. Ramasser quelques branchages, allumer le feu, préparer le thé et manger notre tsampa furent vite fait. Après quoi, assis autour du feu, nous parlâmes quelque temps du Tibet, de ce que nous avions vu au cours de notre voyage et des pensées que nous inspirait l'avenir. Puis, l'un après l'autre, mes compagnons se mirent à bâiller et s'endormirent, enroulés dans leurs couvertures. Enfin les braises rougeoyantes s'évanouirent dans les ténèbres.
À mon tour, je m'enroulai dans ma couverture et m'étendis sur le sol mais sans trouver le sommeil. Je songeai à toutes les dures épreuves que j'avais subies, à mon départ de la maison à l'âge de sept ans, à mon entrée dans la lamaserie, à mes difficultés et à mon éducation rigoureuse. Je songeai à mes expéditions sur les Hauts Plateaux, et plus au nord sur les Hautes-Terres de Chang Tang. Je songeai aussi au Très Profond comme nous appelons le Dalaï-Lama et bien sûr à mon Guide bien-aimé, le Lama Mingyar Dondup.
Je me sentais malade d'appréhension, et j'avais le cœur bien lourd lorsqu'il me parut que le paysage s'embrasait comme sous les rayons du soleil de midi. Stupéfait, j'écarquillai les yeux : mon Guide était debout devant moi.
— Lobsang, Lobsang, s'exclama-t-il, pourquoi perdre courage ? As-tu donc oublié ? Le minerai peut se croire inutilement torturé quand il est porté au rouge mais la lame d'acier trempé quand elle regarde en arrière est plus sage. Tu as déjà connu de durs moments, Lobsang, mais tout ce qui t'est arrivé sert le même haut dessein. Ce monde, nous en avons souvent discuté ensemble, n'est qu'un monde d'illusions, un monde de rêve. Il te faudra encore passer par de dures épreuves, mais tu en triompheras, tu les surmonteras et tu viendras à bout de la tâche que tu t'es fixée.
Je me frottai les yeux... puis je compris que bien évidemment le Lama Mingyar Dondup m'avait rejoint par la voie astrale. Certes, j'avais moi-même beaucoup voyagé de cette façon mais son apparition était tellement inattendue ! Elle me prouvait en tout cas que sa pensée ne me quittait pas, et qu'il l'utilisait pour me venir en aide.
Pendant quelques instants, nous évoquâmes le passé, mes faiblesses d'abord, mais aussi, et cela suffit pour m'éclairer le cœur d'une fugitive lueur de joie, les nombreux instants de bonheur du temps où nous étions ensemble comme père et fils. Il me fit voir à l'aide d'images mentales, certaines des difficultés qui m'attendaient, et — perspective plus heureuse — les succès que je finirais par connaître en dépit de tous les obstacles. Un temps impossible à déterminer s'écoula.
Puis après que mon Guide m'eut prodigué une fois encore des paroles d'encouragement et d'espoir, la lueur dorée s'évanouit. L'esprit tout occupé d'elles, je me tournai sur le côté et finis par m'endormir sous les étoiles qui brillaient dans la nuit glaciale.
Le lendemain, après un réveil matinal, et la préparation du petit déjeuner, je dirigeai en ma qualité de haut dignitaire le traditionnel office du matin avant de donner le signal du départ.
Vers midi, nous étions arrivés à un endroit où la piste s'écartait du fleuve qui coulait vers la droite. En la suivant, nous débouchâmes sur ce qui nous parut être une route très large. En réalité, je sais aujourd'hui qu'il ne s'agissait que d'une voie d'intérêt secondaire, mais à l'époque nous n'avions encore jamais vu de route ouverte par la main de l'homme ! Nous la suivîmes à cheval en en admirant l'empierrement et tout à fait ravis de n'avoir plus rien à craindre des racines et des trous. Quel confort ! Nous allions notre petit bonhomme de chemin en songeant que, dans deux ou trois jours, nous serions à Chongqing, quand quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose d'indéfinissable, nous fit échanger des regards inquiets. L'un d'entre nous leva les yeux vers l'horizon lointain. Aussitôt, la peur le fit se dresser sur ses étriers.
— Regardez, cria-t-il en gesticulant, l'air hagard, une tempête de sable !
De sa main tendue, il nous indiqua au loin un nuage gris noir qui, effectivement, avançait à toute vitesse.
Au Tibet soufflent des tempêtes de sable qui se déplacent à quatre-vingts milles (128 km) à l'heure ou davantage et dont tous, sauf les yaks, doivent se protéger. Leur épaisse toison de laine, en effet, permet aux yaks de n'avoir rien à craindre, mais toutes les autres créatures et surtout les êtres humains, sont littéralement déchiquetés par les rafales de sable qui déchirent le visage et les mains. Notre surprise fut grande, car c'était la première tempête de ce genre depuis notre départ du Tibet. Autour de nous, point d'abri qui pût nous convenir. Quand il fut évident que le nuage se déplaçait accompagné du bruit le plus étrange que nous eussions jamais entendu, notre consternation fut à son comble. On eût dit qu'un débutant privé de tout sens musical s'était mis à souffler dans une trompette de temple ou, pire encore, pensions-nous sans joie, que les légions du diable nous couraient sus. Broum, broum, broum... Très vite le grondement augmenta d'intensité et devint de plus en plus bizarre, puisqu'il s'accompagnait de crépitements et de bruits de ferraille.
La peur nous rendait presque incapables d'agir et de réfléchir. La vitesse du nuage augmentait sans cesse. Nous étions terrifiés, presque paralysés de frayeur. Nous pensâmes évidemment aux tourbillons de poussière du Tibet, mais il était certain que jamais tourbillon ne s'était ainsi précipité vers nous en rugissant.
Pris de panique, nous cherchâmes de nouveau un abri, un endroit quelconque où nous serions protégés de cette terrible tempête qui allait s'abattre sur nos têtes. Nos chevaux furent plus prompts à se décider ; rompant les rangs, ils se mirent à ruer et à se cabrer.
J'entrevis des sabots battant l'air, mon cheval poussa un hennissement féroce et sembla se plier en deux par le milieu. Il y eut un étrange tiraillement, et j'eus l'impression que quelque chose en moi s'était brisé.
‘Ma jambe est arrachée’, pensai-je, au moment où nous prenions congé l'un de l'autre, mon cheval et moi. Après avoir décrit une parabole dans l'air, j'atterris sur le dos près du bord de la route où je restai assommé. Très vite, le tourbillon fut sur moi et, en son centre, j'aperçus le Diable lui-même, sous la forme d'un monstre noir poussant des rugissements et agité de tremblements convulsifs. Il disparut aussi vite qu'il était venu. C'est ainsi que, couché sur le dos et la tête à l'envers, je vis pour la première fois une voiture auto-mobile, un vieux camion tout démantibulé, d'origine américaine, qu'un Chinois souriant conduisait au maximum de sa vitesse et avec un maximum de bruit !
Et quelle odeur infecte ! L'haleine du diable, à notre avis, ne pouvait être pire que ce mélange d'essence, d'huile et de fumier ! Le camion dansait tellement sur la route qu'une partie de son chargement de fumier passa par-dessus bord et vint s'écraser près de moi. Le camion était passé à toute vitesse dans un tintamarre assourdissant, laissant derrière lui des nuages de poussière suffocante et un panache de fumée noire sortie du tuyau d'échappement. Très vite, il ne fut plus qu'un point à l'horizon, qui zigzaguait d'un côté de la route à l'autre, le bruit diminua et ce fut le silence.
C'est au milieu de ce silence que je regardai autour de moi. Mes compagnons étaient invisibles et, fait plus grave encore peut-être, mon cheval l'était également !
J'étais toujours en train d'essayer de dégager mes jambes du bout de sangle qui les entortillait, quand ils apparurent, un à un, l'air honteux et le visage crispé par la crainte de voir surgir un autre démon rugissant.
Nous ne savions pas encore très bien ce que nous avions vu. Tout s'était passé trop rapidement et les nuages de poussière nous avaient caché une bonne partie des choses. Mes compagnons, tout penauds, mirent pied à terre et m'aidèrent à brosser mes vêtements couverts de poussière. Enfin, je fus de nouveau présentable — mais où donc pouvait être mon cheval ?
Les autres s'étaient éparpillés dans toutes les directions et pourtant aucun ne l'avait vu. Nous partîmes à sa recherche, nous l'appelâmes, mais en vain ! Quant à la route, elle était vierge d'empreintes de sabots. C'était à croire que le pauvre animal avait sauté dans le camion pour disparaître avec lui. Non vraiment, le retrouver n'était pas possible ; aussi nous nous assîmes au bord de la route pour discuter de ce qu'il fallait faire. Quelqu'un m'offrit son cheval et me proposa d'attendre dans une cabane toute proche que ses camarades repassent le prendre une fois qu'ils m'auraient laissé à Chongqing. Mais je m'y refusai formellement. Je savais aussi bien que lui qu'il voulait tout simplement se reposer et, de plus, sa proposition n'éclaircissait pas le mystère du cheval disparu.
C'est alors que les autres chevaux se mirent à hennir et que d'une cabane de paysan qui se trouvait près de là, un cheval leur répondit. Quand son hennissement fut brutalement interrompu — quelqu'un devait avoir couvert ses naseaux — la lumière se fit dans notre esprit.
Aussi, en nous consultant du regard, nous nous préparâmes à agir immédiatement. Comment expliquer la présence d'un cheval dans une masure aussi misérable ?
Comme s'il était possible que le propriétaire d'une telle cabane à lapins possédât un cheval ! D'un bond, nous fûmes sur pied pour chercher de solides gourdins.
Faute d'en trouver sur le sol qui pussent nous servir d'armes, nous coupâmes des branches aux arbres voisins ; après quoi, notre groupe se dirigea d'un pas résolu vers la cabane, non sans nous douter de ce qui allait se passer. La porte fixée par des lanières de cuir en guise de gonds était délabrée. À notre courtoise façon de frapper, il ne fut pas répondu. Le silence était total ; pas le moindre bruit. Des coups grossiers n'obtinrent pas plus de succès. Pourtant, peu de temps auparavant, un cheval avait henni et quelqu'un avait étouffé ce hennissement. Il ne nous restait plus qu'à nous ruer sur la porte. Pendant un court instant, elle nous résista, puis au moment où, les gonds de cuir donnant des signes de faiblesse, la porte parut être sur le point de s'effondrer, elle s'ouvrit brusquement devant un Chinois à la peau desséchée et au visage convulsé par la peur. L'intérieur, un taudis misérable, était d'une saleté repoussante ; quant à son propriétaire, c'était un pauvre homme vêtu de haillons. Mais ce qui nous intéressa davantage, ce fut d'apercevoir notre cheval, le museau bâillonné à l'aide d'un sac. Nous n'étions pas du tout contents de ce paysan chinois et nous le lui fîmes clairement comprendre ! Pressé de questions, il reconnut qu'il avait essayé de nous voler.
Des moines riches comme nous l'étions, dit-il, pouvaient se permettre de perdre un cheval ou deux alors qu'il n'était, lui, qu'un pauvre paysan. Visiblement, il se figurait que nous allions le tuer. À croire que notre air devait être féroce ! Il est vrai qu'après un voyage de peut-être huit cents milles (1 287 km), nous étions marqués par la fatigue. Nous ne nourrissions toutefois aucun méchant dessein à son sujet. En mettant en commun nos connaissances de chinois, nous parvînmes à lui faire comprendre notre opinion sur son acte, sur la fin qu'il connaîtrait probablement dans cette vie et sur le sort qui l'attendait certainement dans l'autre monde !
Une fois ce poids enlevé de notre esprit pour, selon toute vraisemblance, être transféré sur le sien, le cheval fut sellé avec un soin particulier, l'attache de la sangle vérifiée, et nous repartîmes en direction de Chongqing.
La nuit venue, nous fîmes halte dans une petite, très petite lamaserie. Six moines seulement y vivaient mais leur hospitalité fut parfaite. La nuit suivante devait être la dernière de notre long voyage. Nous la passâmes dans une lamaserie où, en notre qualité de représentants du Très Profond, nous fûmes accueillis avec la courtoisie que nous finissions par considérer comme nous étant due. Une fois de plus, logis et couvert furent mis à notre disposition ; nous prîmes part aux services du temple et jusqu'à une heure avancée de la nuit, la conversation porta sur les événements du Tibet, nos expéditions dans les Hautes-Terres du Nord et le Dalaï-Lama. J'eus le grand plaisir de constater que même dans cette lointaine lamaserie, mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, était fort bien connu. Enfin, une conversation que j'eus avec un moine japonais qui avait étudié à Lhassa notre forme du bouddhisme, si différente du bouddhisme Zen, m'intéressa énormément.
On nous parla beaucoup des changements imminents en Chine, de révolution, et de l'établissement d'un nouvel ordre selon lequel les gros propriétaires seraient chassés et remplacés par des paysans illettrés. Le pays grouillait d'agents russes qui promettaient monts et merveilles mais ne faisaient rien de constructif.
L'encens consumé fut renouvelé. Il devait l'être souvent avant que notre conversation prenne fin. Les néfastes changements qui prenaient place nous inspiraient de sombres pressentiments. L'échelle des valeurs humaines était bouleversée, les choses de l'âme n'intéressaient plus personne : seule comptait la force éphémère. Oui, pensions-nous, le monde était bien malade.
Très haut, les étoiles se mirent à rouler dans le ciel. Nous continuâmes à parler puis, les uns après les autres, nous gagnâmes nos couches pour dormir. Le lendemain matin verrait la fin de notre voyage, nous le savions. Pour moi, ce ne serait qu'un arrêt, tandis que mes compagnons retourneraient au Tibet, en m'abandonnant seul dans un monde étrange et hostile où la force primait le droit. Cette nuit-là, le sommeil fut lent à venir.
Au matin, après avoir assisté comme d'habitude aux services du temple et pris une excellente collation, nous repartions vers Chongqing, montés sur des chevaux bien reposés. La circulation était plus intense. Camions et toutes sortes de véhicules à roues étaient si nombreux que nos chevaux apeurés se montraient nerveux. Ils n'étaient pas habitués à ce vacarme, et l'odeur de l'essence brûlée les surexcitait. Rester sur nos hautes selles pointues exigeait vraiment toute notre attention.
Nous observions avec intérêt les paysans travaillant les champs, des champs en terrasses pour lesquels ils utilisaient des excréments humains en guise d'engrais. Ces gens, tous âgés et fatigués, semblait-il, portaient des vêtements ‘bleu de Chine’. Ils se déplaçaient avec une sorte d'indifférence apathique, comme si la vie était un fardeau trop lourd et qu'ils fussent trop accablés pour avoir encore des raisons de vivre et de travailler. Mêlés aux hommes, des enfants et des femmes travaillaient avec eux. Nous poussâmes en avant, suivant le cours du fleuve que nous avions rejoint depuis quelques milles (km). Enfin, les hautes collines sur lesquelles avait été bâtie l'antique cité de Chongqing apparurent à nos yeux, la première ville d'importance que nous rencontrions depuis notre départ du Tibet. Arrêtés net, nous la contemplâmes absolument fascinés... Mais mon regard devait être lourd d'appréhension car je pensais à la vie nouvelle qui m'attendait.
Au Tibet, ma naissance, mes succès personnels et mes rapports étroits avec le Dalaï-Lama m'avaient permis de jouir d'une grande influence. À Chongqing, je ne serais qu'un étudiant travaillant dans une ville étrangère. Cela ne me rappelait que trop les épreuves de ma première enfance. Aussi n'avais-je pas le cœur particulièrement joyeux en contemplant ce paysage. Chongqing n'allait être, je le savais, qu'une étape. Et elle serait longue, très longue, la route qui devait me mener jusqu'à l'Occident, ce monde dont le seul dieu est l'or, et que je ne connaîtrai qu'après avoir subi bien des tourments et traversé des pays encore plus étranges que la Chine.
Devant nous le paysage élevait vers le ciel d'innombrables champs en terrasses périlleusement accrochés à des flancs escarpés. Au sommet poussaient tellement d'arbres, que nous crûmes qu'il s'agissait d'une forêt. Il est vrai que jusque récemment, nous n'en avions jamais tant vu ! Là aussi, des silhouettes vêtues de bleu travaillaient dans les champs, avançant du même pas lourd que leurs lointains ancêtres. Des charrettes à une roue, tirées par de petits poneys et chargées de produits potagers roulaient à grand fracas en direction du marché de Chongqing. Quels étranges véhicules ! La roue tournait au centre de la charrette, laissant de chaque côté un espace libre pour les marchandises. L'une d'elles transportait une vieille, perchée en équilibre d'un côté de la roue et deux petits enfants de l'autre.
Chongqing ! Là où mes compagnons terminaient leur voyage, je commençais le mien, en commençant aussi une nouvelle vie. "Hélas, pensais-je, tout en observant les torrents tumultueux qui coulaient au fond des gorges à pic, elle ne m'inspire aucun enthousiasme !" La ville était bâtie sur de hautes falaises que de nombreuses habitations recouvraient comme d'un épais tissu. De notre point d'observation, elle ressemblait à une île, mais nous n'étions pas dupes. Nous savions qu'il n'en était rien, puisque les eaux du Yangtsé et du Kialing ne baignent que trois côtés de la cité. Au pied des falaises s'étendait un banc de sable très long et très large à l'extrémité duquel les deux fleuves n'en formaient plus qu'un. C'était un endroit qui devait me devenir très familier par la suite. Nous avançâmes avec lenteur. En nous approchant, nous remarquâmes qu'il y avait beaucoup d'escaliers dans la ville et un bref accès de nostalgie nous poignarda le cœur dans la ‘rue aux Marches’ qui en compte sept cent quatre-vingts. Elle nous rappelait en effet le Potala. C'est ainsi que nous fîmes notre entrée dans Chongqing.
Chapitre Deux
Chongqing
Les vitrines des magasins, brillamment illuminées, étaient pleines de tissus et de marchandises comme nous n'en avions jamais vu si ce n'est dans certains magazines importés à Lhassa des États-Unis, ce pays fabuleux, via les Indes et les chaînes de l'Himalaya. Tout à coup, un jeune Chinois fonça vers nous tel un bolide ; il était monté sur un engin extraordinairement bizarre, une sorte de cadre de fer posé sur deux roues, fixées l'une derrière l'autre. Il nous regardait sans pouvoir détourner ses yeux, aussi perdit-il le contrôle de sa machine ; la roue avant heurta une pierre, l'engin fit un écart et, après un plongeon par-dessus sa roue, le Chinois se retrouva à terre, les quatre fers en l'air. Une vieille dame qu'il avait failli renverser tança alors vertement ce pauvre garçon qui, pensions-nous, avait déjà assez pâti de l'affaire. Il se releva, l'air penaud, et ramassa son cadre dont la roue avait été tordue. Puis, ayant chargé le tout sur ses épaules, il se mit à descendre la rue aux Marches. La conduite de tous ces gens était si bizarre que nous eûmes l'impression de nous trouver dans le royaume des fous. Notre petit groupe continua cependant à avancer à pas lents, nous admirions les marchandises dans les boutiques, tout en essayant d'en deviner le prix et l'utilité ; car si nous avions pris plaisir à regarder les reproductions des magazines, nous n'y avions rien compris !
Un peu plus loin se dressait l'Université où je devais étudier. Mes compagnons firent halte, et j'entrai signaler mon arrivée. J'ai des amis encore aux mains des Communistes et je n'ai aucunement l'intention de donner des renseignements qui pourraient les identifier, parce que j'ai été très intimement lié au Mouvement de Résistance des Jeunes Tibétains. Nous avons résisté de façon extrêmement active aux Communistes au Tibet. Après avoir monté trois marches, je me trouvai dans une pièce où un jeune Chinois était assis derrière un bureau sur une planche de bois des plus ridicules, posée sur quatre piquets, tandis que son dos s'appuyait sur une autre planche transversale maintenue par deux autres piquets.
"Que voilà une façon paresseuse de s'asseoir, pensai-je, jamais je ne m'y ferai !"
Ce jeune homme avait l'air sympathique. Vêtu de toile bleue comme la plupart des Chinois, il portait au revers de sa veste l'insigne des employés de l'Université. À ma vue, ses yeux s'ouvrirent tout grands et il resta un moment à me regarder, bouche bée. Puis il se leva et, les mains jointes, s'inclina très bas.
— Je suis un des nouveaux étudiants, dis-je. J'arrive de Lhassa au Tibet et j'apporte une lettre de l'Abbé de la lamaserie du Potala.
Je lui tendis alors la grande enveloppe que j'avais mis tous mes soins à protéger des vicissitudes du voyage. Il la prit et s'inclina par trois fois.
— Vénérable Abbé, dit-il, veuillez vous asseoir jusqu'à ce que je revienne.
— Merci, j'ai tout mon temps, répondis-je en m'asseyant sur le sol dans la position du lotus.
L'air gêné, il tira nerveusement sur le bout de ses doigts tout en se dandinant sur ses pieds.
— Vénérable Abbé, dit-il, après avoir avalé sa salive, en toute humilité et avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous conseiller de vous habituer à ces chaises, car elles sont en usage dans cette université ?
Me relevant, je m'assis avec mille précautions sur l'un de ces abominables engins. Je me disais — et je suis toujours de cet avis — qu'il faut tout essayer au moins une fois, encore que cette chose ressemblât fâcheusement à un instrument de torture... Resté seul, je n'arrivai pas à tenir en place sur ma chaise. Bien vite, j'eus mal au dos, puis je sentis mon cou se raidir... et je me mis à haïr le monde entier ! "Eh quoi, me demandai-je, serait-il défendu dans ce malheureux pays de s'asseoir confortablement comme au Tibet et faut-il vraiment se percher dans les airs ?" Je voulus changer de position mais la chaise craqua, gémit et se mit à vaciller. Après quoi, je n'osai plus bouger de peur qu'elle ne s'écroulât.
Le jeune homme revint, et s'inclina de nouveau.
— Le Principal va vous recevoir, Vénérable Abbé, dit-il. Par ici, s'il vous plaît.
D'un geste, il me fit signe de passer devant lui.
— Non, dis-je, conduisez-moi, je ne connais pas le chemin.
Après un autre salut, il passa le premier. "Les étrangers sont parfois stupides, pensais-je. D'abord, ils disent qu'ils vont vous montrer le chemin et ensuite ils veulent que vous marchiez devant eux ! Comment peut-on ouvrir la marche quand on ignore tout du chemin à suivre ?" Telle était mon opinion et je n'en ai pas changé. Le jeune homme en bleu me fit suivre un corridor au bout duquel il ouvrit une porte non sans y avoir préalablement frappé.
— Le Vénérable Abbé Lobsang Rampa ! dit-il, en me gratifiant d'un autre salut.
Sur ces mots, il ferma la porte et je me trouvai dans un bureau, où un vieillard au visage avenant, un Chinois au crâne chauve et à la courte barbe, se tenait près de la fenêtre. Chose étrange, il avait adopté pour s'habiller cet horrible style que je connaissais déjà, le style occidental. Sa veste et son pantalon bleus étaient sillonnés de haut en bas de fines rayures blanches. Au cou, il avait un col et une cravate de couleur et je pensai en moi-même qu'il était bien triste qu'un vieux monsieur aussi distingué dût être ainsi fagoté.
— Ainsi, vous êtes Lobsang Rampa, dit-il. J'ai beaucoup entendu parler de vous et c'est pour moi un honneur que de vous compter parmi nos étudiants. Outre la lettre que vous m'avez apportée, j'en ai reçu une autre à votre sujet et je puis vous assurer que la formation que vous avez reçue vous sera d'un grand secours. Votre Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'a écrit. Je l'ai bien connu, à Shanghaï, il y a quelques années, avant mon départ pour l'Amérique. Je m'appelle Lee et je suis Principal du collège.
Il me fit asseoir et je dus répondre à toutes sortes de questions destinées à l'éclairer sur mes connaissances classiques et anatomiques. Mais des Écritures, la science la plus importante, tout au moins à mes yeux, il ne fut pas question.
— Vos connaissances sont très satisfaisantes, dit-il. Toutefois vous aurez à travailler avec acharnement, car en plus de la médecine chinoise, notre enseignement porte sur les méthodes américaines de médecine et de chirurgie. Aussi vous faudra-t-il apprendre un certain nombre de matières qui n'étaient pas inscrites jusqu'ici à votre programme. J'ai un diplôme des États-Unis d'Amérique et le conseil d'administration m'a confié la charge de former un certain nombre de jeunes gens selon les dernières techniques américaines, tout en adaptant celles-ci aux conditions spécifiquement chinoises.
Pendant un long moment, il m'entretint des merveilles de la médecine et de la chirurgie américaines, ainsi que de leurs méthodes pour établir les diagnostics.
— L'électricité, le magnétisme, la chaleur, la lumière et le son, poursuivit-il, sont autant de matières que vous aurez à approfondir, et qui viendront s'ajouter à la profonde culture que votre Guide vous a donnée.
Je lui jetai un regard horrifié. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. L'électricité et le magnétisme ? Deux mots dont je ne connaissais pas le sens. "Tandis que la chaleur, la lumière et le son, me disais-je, n'importe quel imbécile sait de quoi il retourne : la chaleur ? on s'en sert pour chauffer le thé ; la lumière sert à y voir clair et le son à prononcer les mots. Que restait-il donc à apprendre de plus ?"
— Je vais, reprit-il, vous donner un conseil ; puisque vous avez l'habitude du travail intensif, pourquoi n'étudieriez-vous pas deux fois plus que les autres ? Suivez donc deux séries de cours à la fois, ceux que nous appelons les cours de médecine préparatoire et les cours de médecine proprement dits. Avec toutes vos années d'études derrière vous, vous devriez y arriver. Dans deux jours commencent les cours de médecine pour nouveaux étudiants.
Il se retourna et se mit à fouiller dans ses papiers. Puis, prenant ce que d'après les reproductions des magazines je reconnus être un stylo plume — le premier que je voyais de ma vie — il écrivit en se parlant à lui-même à voix basse : "Lobsang Rampa, études spéciales en électricité et magnétisme. En parler avec M. Wu. Veiller à ce qu'on le suive de près."
Il posa son stylo plume, sécha avec soin ce qu'il avait écrit et se leva. Le voir se servir de papier pour sécher l'encre ne manqua pas de me frapper car, au Tibet, on utilise du sable bien sec. Mais il était debout devant moi.
— En certaines matières, vous êtes très avancé, dit-il. À en juger d'après notre conversation, j'irais même jusqu'à dire que vous êtes en avance sur certains de nos médecins. Il vous faudra cependant étudier ces deux sujets dont actuellement vous ignorez jusqu'au premier mot. (Il appuya sur une sonnette en ajoutant :) Je vais vous faire visiter l'Université, et chacune de ses facultés, pour que vous emportiez quelques impressions de cette première journée. S'il vous vient quelques doutes, si vous vous sentez indécis, venez me voir, car j'ai promis au Lama Mingyar Dondup de vous aider autant qu'il sera en mon pouvoir de le faire.
Il s'inclina et je le saluai à mon tour, la main posée sur le cœur. Quand le jeune homme en bleu entra, le Principal s'adressa à lui en langue mandarine puis se retourna vers moi.
— Ayez l'amabilité d'accompagner Ah Fu ; il vous fera visiter le collège et répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser.
Le jeune homme fit demi-tour et cette fois sortit le premier.
— Nous devons d'abord passer au secrétariat, me dit-il dans le corridor après avoir refermé doucement la porte du Principal, vous y signerez votre nom sur le registre.
À sa suite, je traversai une grande salle au parquet ciré qui donnait sur un autre corridor. Quelques pas nous suffirent pour arriver dans une pièce où régnait une grande activité. Des secrétaires étaient occupés à dresser ce qui me parut être des listes d'étudiants, tandis que des jeunes gens debout devant de petites tables inscrivaient leur nom sur de gros registres. Le secrétaire qui me servait de guide dit quelques mots à l'oreille d'un homme qui disparut dans un bureau contigu à la grande pièce. Quelques minutes après, un Chinois petit et trapu en sortit, l'air enchanté. Il portait des verres très épais et était habillé lui aussi à l'occidentale.
— Ah, dit-il, Lobsang Rampa... J'ai tellement entendu parler de vous...
Il tendit sa main vers moi. Je la regardai, me demandant ce qu'il désirait que j'y mette. "Peut-être veut-il de l'argent", me dis-je.
— Allons, donnez-lui une poignée de main occidentale, me souffla le jeune homme en bleu.
— Oui, répéta le petit Chinois, donnez-moi une poignée de main occidentale. C'est un système que nous allons adopter ici.
Je lui pris donc la main et la serrai.
— Aïe ! s'écria-t-il, vous m'écrasez les os !
— Ma foi, dis-je, je ne sais comment m'y prendre. Au Tibet, nous mettons la main sur notre cœur comme ceci.
Et je joignis le geste à la parole.
— Oui, certes, répondit-il, mais les temps changent, et ici nous utilisons le système occidental. Allons, serrez-moi la main correctement, je vais vous faire une démonstration.
Il me tendit donc la main et je la secouai non sans penser que ces manières de faire étaient complètement stupides.
— Maintenant, reprit-il, signez votre nom pour qu'il soit bien entendu que vous êtes un de nos étudiants.
D'un geste brusque, il écarta deux ou trois jeunes gens qui se tenaient debout devant les registres, puis d'un doigt et d'un pouce humides tourna quelques pages.
— Voilà, dit-il, veuillez indiquer ici vos nom, prénoms et qualités.
Je pris une plume chinoise et apposai ma signature au haut de la page. J'écrivis : Mardi Lobsang Rampa, lama tibétain. Prêtre-chirurgien de la lamaserie du Chakpori. Incarnation Reconnue. Abbé désigné. Élève du Lama Mingyar Dondup.
— Très bien, fit le petit Chinois corpulent en se penchant pour lire ce que j'avais écrit. Très bien. Passons à autre chose. Vous allez maintenant tout visiter. Je veux que vous ayez une idée de toutes les merveilles de la science occidentale que nous avons rassemblées ici. À bientôt.
Là-dessus, il dit quelques mots au jeune homme qui se tourna vers moi.
— Suivez-moi, voulez-vous, dit-il, nous allons commencer par les laboratoires de science.
Nous sortîmes du bureau et, d'un pas vif, il me conduisit dans un autre bâtiment très long, rempli d'objets en verre : flacons, tubes, bouteilles, bref, tout un matériel qu'auparavant je n'avais vu que sur des photos. Il se dirigea vers un coin de la salle.
— Tenez, s'écria-t-il, regardez ceci, ça en vaut la peine. (Il tripota un tube métallique au bout duquel il plaça une lame de verre.) Regardez, dit-il.
Je regardai... et je vis la culture d'un microbe. Mon compagnon me jeta un regard anxieux.
— Quoi, dit-il, vous ne trouvez pas cela stupéfiant ?
— Pas du tout, répondis-je, nous avions un excellent instrument de ce genre à la lamaserie du Potala, un cadeau du gouvernement des Indes au Dalaï-Lama. Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, pouvait en disposer à sa guise et je m'en suis souvent servi.
— Oh, fit-il, l'air déçu. Dans ces conditions, je vais vous montrer autre chose.
Il me fit sortir du bâtiment et passer dans un autre.
— Vous logerez à la lamaserie de la Colline, dit-il, mais j'ai pensé que vous aimeriez vous rendre compte du confort ultra-moderne mis à la disposition de ceux qui habiteront à l'Université.
Il ouvrit une porte. Tout d'abord, je ne vis que des murs blanchis à la chaux puis mes yeux furent irrésistiblement attirés par une sorte de cadre de fer noir plein de fils de fer tordus, tendus entre les côtés.
— Qu'est-ce que c'est que ça ? m'écriai-je. Je n'ai jamais rien vu de pareil.
— Ça, me répondit-il, d'une voix gonflée d'orgueil, c'est un lit. Il y en a six comme celui-là dans ce bâtiment, tous ultra-modernes.
Je regardai de tous mes yeux. Vraiment, je n'avais jamais rien vu de semblable.
— Un lit, dis-je. À quoi cela sert-il ?
— À dormir, répondit-il. On y est vraiment très bien. Allongez-vous dessus et faites-en l'expérience.
Je le regardai. Je regardai le lit, puis je regardai de nouveau mon compagnon. "Ma foi, pensai-je, je ne peux vraiment pas faire preuve de couardise devant un de ces secrétaires chinois...", et je m'assis sur le lit. J'entendis sous moi des craquements, des grincements, le lit se creusa et j'eus l'impression que j'allais tomber sur le plancher. D'un bond, je fus debout.
— Je pèse trop lourd, dis-je.
Le jeune homme pouvait à peine dissimuler son hilarité.
— Oh, répliqua-t-il, c'est tout à fait normal. Ce sont des lits à ressorts, vous comprenez...
Il se jeta de tout son long sur le lit où il rebondit aussitôt. "Non, pensais-je, il ne saurait être question de l'imiter, ce spectacle est trop affreux. J'ai toujours dormi sur le sol et le sol est bien assez bon pour moi." Il recommença son manège mais en bondissant, crac, il tomba du lit et atterrit sur le plancher les quatre fers en l'air. "Ça lui apprendra", me dis-je, en l'aidant à se relever.
— J'ai encore autre chose à vous faire voir, dit-il. Venez par ici.
Il me conduisit à l'autre bout de la pièce où contre un mur était placée une petite cuvette qui aurait pu servir à préparer la tsampa pour au moins une demi-douzaine de moines.
— Regardez-moi ça, dit-il, n'est-ce pas une merveille ?
J'observai la chose qui me parut non seulement incompréhensible mais inutilisable puisqu'il y avait un trou au fond.
— Pas la peine, dis-je. Ce machin-là est troué. On ne pourrait même pas y faire du thé.
Il se mit à rire, fort égayé de ma remarque.
— Il s'agit, dit-il, de quelque chose d'encore plus moderne que le lit. Regardez bien !
Il posa la main sur un bout de métal qui sortait d'un des côtés de la cuvette blanche, et... et à mon immense stupéfaction, de l'eau jaillit. De l'eau !
— C'est de l'eau froide, très froide, dit-il. (Et mettant sa main dans la cuvette, il ajouta :) Rendez-vous compte.
Je me rendis compte. C'était de l'eau, de l'eau pareille à celle d'une rivière. Peut-être son odeur était-elle un peu plus fade... oui, elle l'était mais c'était de l'eau, de l'eau qui sortait d'un morceau de métal ! J'en croyais à peine mes yeux ! Il avança la main et prit un objet noir qu'il fixa dans le trou au fond de la cuvette. Le doux murmure de l'eau continua ; bientôt la cuvette fut remplie mais elle ne déborda pas. L'eau devait sans doute s'écouler par un trou quelconque car elle ne se répandait pas sur le plancher. De nouveau, il manipula la pièce de métal et l'eau cessa de couler. Il mit les deux mains dans la cuvette et en remua le contenu.
— Admirez, dit-il, comme elle est belle. Avec ce système, on n'a plus besoin de sortir et de la tirer d'un puits.
À mon tour, je plongeai mes mains dans la cuvette, et je les agitai dans l'eau. Qu'il était donc agréable de n'avoir plus à se mettre à quatre pattes pour se laver dans une rivière ! Le jeune homme tira alors sur une chaîne et l'eau s'écoula brusquement en gargouillant comme un vieillard qui va rendre le dernier soupir. Puis, il prit derrière lui ce qui me parut être une courte pèlerine.
— Tenez, dit-il, servez-vous de ceci.
Je le regardai puis abaissai les yeux sur le bout de tissu qu'il me tendait.
— Que voulez-vous que j'en fasse ?... demandai-je. Je n'ai pas besoin d'autre vêtement.
De nouveau, il se mit à rire.
— C'est simplement pour vous essuyer les mains... Comme cela..., dit-il, en me montrant comment s'y prendre. Maintenant, à votre tour... Séchez-les bien.
Je m'exécutai, mais j'étais rempli d'émerveillement : je me souvenais des dernières femmes tibétaines que j'avais vues. Comme elles auraient été contentes de tirer de ce bout d'étoffe quelque chose d'utile, alors que dans cette université, il n'était bon qu'à servir d'essuie-mains ! Qu'aurait dit ma mère en me voyant !
De l'eau sortant d'un bout de métal ! Des bassins qui étaient utiles bien qu'ils fussent percés ! Cette fois, j'étais vraiment impressionné et mon guide s'en montra ravi. Par un petit escalier, il me conduisit à une salle située au sous-sol.
— C'est ici, dit-il, que l'on garde les corps, ceux des hommes comme ceux des femmes.
Par la porte ouverte, j'aperçus des cadavres, allongés sur des tables de pierre, attendant d'être disséqués. L'air était fortement imprégné de l'odeur des étranges produits chimiques qui les empêchaient de se putréfier. À l'époque, je n'avais pas la moindre idée de leur nature car au Tibet, le climat froid et sec protège longtemps les corps de la décomposition. Dans la chaleur étouffante de Chongqing, au contraire, il fallait pratiquer des injections aussitôt après la mort si l'on voulait garder les cadavres quelques mois à la disposition des étudiants.
Il ouvrit la porte d'une petite armoire à tiroirs.
— Regardez, dit-il, ce sont les plus récents modèles du matériel chirurgical américain. Tout ce qu'il faut pour disséquer des cadavres et couper bras et jambes. Regardez bien !
Je jetai les yeux sur tous ces objets de métal brillant, sur tout ce verre et tout ce chromium... "Eh bien, me dis-je, cela m'étonnerait beaucoup que les Américains obtiennent de meilleurs résultats que les Tibétains."
Après m'être promené dans les bâtiments du collège pendant près de trois heures, je m'en retournai vers mes compagnons qui, assis dans la cour, m'attendaient non sans inquiétude. Je leur fis part de ce que j'avais vu et de ce que j'avais fait, puis je leur dis :
— Allons faire un tour en ville pour voir de quoi elle a l'air. Pour moi, elle me paraît bien barbare, avec son odeur infecte et son vacarme assourdissant.
Nous remontâmes en selle et nous nous éloignâmes du collège pour aller jeter un coup d'œil aux boutiques de la rue aux Marches. Très vite, nous mettions pied à terre pour voir de plus près toutes les marchandises extraordinaires qui y étaient exposées. Ensuite, en regardant les rues en pente, nous en remarquâmes une qui semblait s'arrêter au bord d'une falaise, comme si elle donnait sur le vide. Intrigués, nous la suivîmes : en fait, elle descendait à pic, jusqu'à des marches aboutissant aux quais en contrebas. Sous nos yeux, dansaient sur l'eau de gros cargos à l'étrave orgueilleuse, et des jonques avec leurs voiles latines, que la brise qui jouait au pied de la falaise rabattait mollement sur les mâts. L'on voyait des coolies, portant sur leurs épaules de longues perches de bambou, monter à leur bord à petits pas saccadés ; des paniers attachés au bout des perches contenaient le chargement. Il faisait une chaleur accablante et nous étions en nage. L'air étouffant de Chongqing est célèbre. Nous avancions, tenant nos chevaux par la bride, lorsqu'une sorte de brume descendit des nuages jusqu'au fleuve, d'où elle remonta jusqu'à nous, nous forçant à marcher à tâtons, comme en pleine nuit. Chongqing est une ville altière, d'un aspect plutôt angoissant, une cité bâtie sur des rochers à pic et comptant près de deux millions d'habitants. Les rues sont très escarpées, si escarpées que certaines maisons ressemblent à des cavernes creusées dans la montagne, tandis que d'autres semblent avoir été construites juste au-dessus des abîmes. Chaque parcelle de terre, cultivée avec un soin extrême, était l'objet d'une surveillance rigoureuse. Ici, c'étaient des rizières ; là, une rangée de haricots ou quelques plants de maïs, mais pas un pouce de terrain n'était laissé en friche. Partout des silhouettes vêtues de bleu étaient penchées sur la terre comme si ces hommes étaient nés le dos courbé, destinés de toute éternité à arracher les mauvaises herbes de leurs doigts fatigués. La haute bourgeoisie, elle, habitait dans la vallée de Kialing, un faubourg de Chongqing, où, tout au moins d'après les normes chinoises si différentes des nôtres, l'air était plus salubre. On y trouvait des boutiques mieux achalandées et la terre, avec ses arbres fournis et ses rivières ombragées, était meilleure. Ce faubourg interdit aux coolies était réservé aux hommes d'affaires prospères, aux cadres supérieurs, et à tous ceux qui possédaient une fortune personnelle. C'est là qu'habitaient le mandarin et les familles aristocratiques. Oui, Chongqing était une ville puissante et la plus grande que nous eussions jamais vue, et pourtant elle ne nous impressionnait pas !
Tout à coup, nos estomacs vides se rappelèrent à notre souvenir de façon pressante. Nos provisions étant épuisées, nous fûmes obligés de nous mettre en quête d'un restaurant. Une grossière enseigne attira nos regards. Elle assurait les clients éventuels qu'à l'intérieur il était possible de manger la meilleure cuisine de la ville, servie dans les délais les plus rapides. Nous entrâmes donc et un homme vêtu de bleu vint à notre table prendre la commande.
— Avez-vous de la tsampa ? demandai-je.
— Non, répondit-il... C'est un plat occidental, n'est-ce pas ? Ici, on ne fait que de la cuisine chinoise...
— Eh bien, que peut-on manger ?
— Du riz, des nouilles, des ailerons de requin et des œufs.
— Parfait, dis-je, nous prendrons des boulettes de riz, des nouilles, un aileron et des pousses de bambou. Faites vite.
Il s'éloigna à grands pas et revint presque aussitôt avec ce que nous avions commandé. Autour de nous, d'autres clients étaient attablés, faisant claquer très fort leurs mâchoires, et parlant plus fort encore. Nous étions vraiment scandalisés car, dans les lamaseries du Tibet, il est une règle inviolable : aucune conversation n'est permise à table, parler serait offenser la nourriture et celle-ci pouvait facilement se venger en provoquant de bizarres douleurs intestinales. Aussi, à chaque repas, un moine était chargé de nous lire les Écritures et nous devions l'écouter en silence. Dans ce restaurant, les conversations allaient bon train et elles étaient des plus frivoles. Pendant tout le déjeuner, scandalisés et écœurés de la conduite de la clientèle chinoise, nous mangeâmes, le nez sur notre assiette, respectueux des règles de notre ordre. Toutefois, nos voisins n'abordèrent pas que des sujets badins ; il y eut de nombreux conciliabules sur les Japonais et les troubles qu'ils venaient de fomenter dans diverses parties de la Chine. À cette époque, j'étais parfaitement ignorant de la situation. Néanmoins, rien de ce qui touchait ce restaurant ou même Chongqing ne nous impressionnait. Quant à ce repas, sa seule originalité fut de m'obliger à payer une addition pour la première fois de ma vie ! Le déjeuner terminé, nous trouvâmes à l'intérieur d'un bâtiment municipal une cour où il nous fut possible de nous asseoir pour bavarder à l'aise. Nous avions laissé nos chevaux à l'écurie pour qu'ils soient nourris et abreuvés ; il fallait aussi les laisser prendre un repos bien gagné car, le lendemain matin, mes compagnons devaient se remettre en route, mais cette fois en direction du Tibet, leur patrie. Comme tous les touristes du monde, ils se demandaient quoi rapporter à leurs amis de Lhassa et moi-même, je cherchais ce que je pourrais bien envoyer au Lama Mingyar Dondup. Après force discussions, nous nous dirigeâmes d'un commun accord vers les magasins pour y faire nos emplettes. Après quoi, notre troupe entra dans un petit jardin où elle entama une conversation qui devait durer jusqu'au crépuscule. Au-dessus de nous, les étoiles se mirent timidement à briller à travers la légère brume qui avait succédé au brouillard. Alors, nous relevant, nous partîmes de nouveau à la recherche d'un restaurant. Des crustacés étaient au menu. C'était la première fois que nous en goûtions et leur saveur nous parut bizarre, désagréable même. Mais ils eurent au moins le mérite de nous remplir l'estomac et lorsqu'on est affamé comme nous l'étions, on ne demande rien de plus ! Après le dîner, nous regagnâmes l'écurie où nous avions laissé nos chevaux. À en juger par leurs hennissements de plaisir, on eût dit qu'ils nous attendaient. Ils paraissaient très frais, et ils l'étaient, hélas ! Je dis hélas, car n'ayant jamais été bon cavalier, un cheval fatigué m'a toujours paru plus sympathique qu'un cheval trop dynamique ! Après avoir quitté l'écurie, nous prîmes la route de Kialing.
Nous sortîmes de Chongqing par la route qui, passant par les faubourgs, devait nous mener à la lamaserie où mes compagnons ne passeraient qu'une nuit, mais qui allait devenir mon domicile. Sur la droite, un chemin escaladant le flanc d'une colline boisée nous permit d'arriver au sommet. La lamaserie appartenait à mon ordre ; lorsque j'entrai dans le temple, juste à temps pour l'office du soir, ce fut un peu comme si je rentrais chez moi. Les fumées d'encens déroulaient leurs volutes au-dessus de ma tête ; quant aux voix graves des vieux moines, et à celles plus hautes des acolytes, il me suffit de les entendre pour ressentir un sentiment poignant de nostalgie. Les autres durent deviner ce que je ressentais car ils ne m'adressèrent pas la parole et me laissèrent seul avec mes pensées. Je restai à ma place bien après que l'office eut pris fin. Plongé dans une profonde méditation, je songeai au temps où le cœur plein d'une tristesse mortelle et... le ventre vide, j'avais franchi le seuil d'un temple pour la première fois après avoir subi une dure épreuve d'endurance. Mais cette nuit-là, mon âme était plus malade encore. Jeune, j'ignorais à peu près tout de l'existence ; à cet instant, au contraire, j'avais l'impression de ne connaître que trop bien, et la vie et la mort. Quelques instants s'écoulèrent.
— Mon frère, me dit le vieil Abbé qui dirigeait la lamaserie et qui s'était approché de moi à pas feutrés, il n'est pas bon de s'attarder sur les choses du passé, quand on a tout l'avenir devant soi. L'office est terminé, mon frère, et bientôt viendra l'heure d'un autre office. Gagnez votre couche, je vous prie, car vous aurez fort à faire demain.
Sans mot dire, je me levai et il me conduisit là où je devais dormir. Mes compagnons étaient déjà couchés, roulés dans leurs couvertures. Je passai devant leurs formes immobiles. Dormaient-ils ? Peut-être. Qui aurait pu le dire ? Peut-être rêvaient-ils du voyage qu'ils allaient entreprendre et de la joie qu'ils auraient à retrouver leur famille au terme de leur chevauchée. Je m'enroulai, moi aussi, dans ma couverture et m'allongeai sur le sol. Les ombres de la lune devaient beaucoup voyager dans le ciel avant que je pusse trouver le sommeil.
Les trompettes et les gongs du temple me réveillèrent. L'heure était venue de se lever et d'assister de nouveau à un office. J'avais grand faim en me rendant au service du matin qui précède obligatoirement le petit déjeuner. Pourtant, quand après l'office on m'apporta à manger, je n'avais plus d'appétit. Je me contentai d'une très légère collation, car mon cœur était trop triste. Mes compagnons, eux, firent preuve d'un appétit qui me parut répugnant ; il est vrai qu'ils devaient prendre des forces en prévision du long voyage qu'ils allaient entreprendre. Aucun de nous ne parla beaucoup. Toute parole semblait inutile. Finalement, je m'adressai à eux.
— Remettez cette lettre et ce présent à mon Guide, le Lama Mingyar Dondup. Dites-lui que je lui écrirai souvent. Dites-lui que vous avez pu voir à quel point son enseignement et sa compagnie me manquent... Quant à ceci, repris-je, en retirant un paquet de ma robe, je le destine au Très-Profond. Remettez-le à mon Guide, il s'arrangera pour le faire parvenir au Dalaï-Lama.
Ils prirent lettre et paquets de mes mains et je détournai la tête, en proie à une forte émotion dont je ne voulus pas leur donner le spectacle ; un haut lama comme moi se devait de dissimuler une telle faiblesse. Fort heureusement, leur chagrin était aussi très réel car une sincère amitié s'était créée entre nous en dépit — si l'on tient compte de nos coutumes — du fossé qui nous séparait socialement. Il leur était pénible de me quitter, de me laisser seul dans ce monde bizarre qu'ils haïssaient et de retourner sans moi à Lhassa, leur ville bien-aimée. Nous nous promenâmes quelque temps au milieu des arbres, regardant les petites fleurs qui tapissaient le sol, écoutant les oiseaux qui chantaient dans les branches, observant les nuages légers au-dessus de nos têtes. Puis l'heure du départ arriva. Nous revînmes ensemble à la vieille lamaserie chinoise, nichée parmi des arbres au sommet d'une colline qui dominait la ville et les fleuves. Il n'y avait ni grand-chose à dire ni grand-chose à faire. Nous étions à la fois nerveux et tristes. Arrivés aux écuries, mes compagnons sellèrent lentement leurs chevaux et prirent la bride du mien, cette brave bête qui m'avait transporté si fidèlement de Lhassa à Chongqing, et qui maintenant — ô animal fortuné — allait revenir au Tibet. Nous échangeâmes quelques mots, quelques pauvres mots, puis ils montèrent en selle et prirent le chemin du retour, tandis que laissé seul, je les regardais s'éloigner. Leurs silhouettes diminuaient à vue d'œil ; bientôt un tournant les dissimula à ma vue. Le petit nuage de poussière soulevé par leur passage se dissipa et le clic-clac des sabots de leurs chevaux s'évanouit dans le lointain. Je restai planté là, songeant au passé et redoutant l'avenir. Je ne sais depuis combien de temps j'étais ainsi plongé dans une muette détresse lorsqu'une voix agréable me tira de mes sombres rêveries.
— Honorable Lama, de grâce rappelez-vous qu'il y a en Chine des gens qui seront de vos amis... Je suis à votre disposition, Honorable Lama du Tibet, camarade étudiant à Chongqing.
Lentement, je me retournai : un jeune moine chinois au visage sympathique se tenait à quelques pas de moi. Je crois qu'il était assez inquiet sur la façon dont j'allais traiter ses avances. N'étais-je pas un abbé et un grand lama et lui un simple moine ? Mais je fus heureux de le voir. Il s'appelait Huang, et c'était un homme dont, par la suite, je devais être fier d'être l'ami. Nous fîmes rapidement connaissance et je fus ravi d'apprendre qu'il était comme moi inscrit à la Faculté de Médecine dont les cours allaient commencer le lendemain. Lui aussi allait étudier ces deux matières extraordinaires, l'électricité et le magnétisme. En fait, nous devions faire partie du même groupe d'étudiants, et ainsi devenir très liés. En sa compagnie, je revins vers la lamaserie, et nous franchissions la porte quand un autre moine s'avança vers nous.
— Nous devons nous présenter au collège, dit-il, et signer un registre.
— Oh, m'écriai-je, c'est déjà fait. Je m'en suis occupé hier.
— Oui, Honorable Lama, répondit-il, mais il ne s'agit pas du registre des étudiants que vous avez signé hier, il s'agit de celui de la Confrérie universitaire. Au collège, en effet, nous serons tous frères comme dans les collèges américains.
Tous les trois, nous fîmes demi-tour et par le sentier de la lamaserie, un sentier tapissé de fleurs et bordé d'arbres, nous rejoignîmes la grand-route qui va de Kialing à Chongqing. En compagnie de ces jeunes gens qui avaient à peu près le même âge que moi, le trajet jusqu'aux bâtiments où nous allions passer nos journées me parut moins long et moins triste que la veille. Le jeune secrétaire aux vêtements de toile bleue parut sincèrement enchanté de nous voir.
— J'espérais votre visite... dit-il. Il y a ici un journaliste américain qui parle chinois. Il serait enchanté de faire la connaissance d'un grand lama du Tibet.
Une nouvelle fois, il nous fit suivre le corridor jusqu'à une pièce que je ne connaissais pas. Ce devait être une sorte de salle de réception car un grand nombre de jeunes gens y étaient assis, en grande conversation avec des jeunes femmes, ce que je trouvai plutôt choquant. À l'époque, j'étais très ignorant de l'autre sexe. Un grand jeune homme, à qui je donnai une trentaine d'années, avait pris place sur une chaise très basse. Dès qu'il nous vit entrer, il se leva et porta la main à son cœur, à l'orientale. Naturellement, je le saluai de même. Quand on nous présenta cependant, il crut bon de me tendre la main. Cette fois, je ne fus pas pris au dépourvu. Je saisis sa dextre et la broyai selon toutes les règles de l'art.
— Ah, fit-il en riant, je vois que vous assimilez très bien les manières occidentales qu'on cherche à introduire à Chongqing.
— Oui, répondis-je, j'en suis arrivé au point où je peux m'asseoir sur ces horribles chaises et donner des poignées de main.
C'était un garçon charmant, mort à Chongqing, il y a quelques années, dont je n'ai jamais oublié le nom. Nous nous promenâmes dans les jardins où, assis sur une murette de pierre, nous eûmes une longue conversation. Je lui parlai du Tibet, de nos coutumes, et lui racontai en détail ce qu'avait été ma vie dans ma patrie. En retour, il me parla de l'Amérique. Je lui demandai ce qui le retenait à Chongqing et comment un homme de son intelligence pouvait vivre dans une ville aussi étouffante, alors que rien ne semblait l'y obliger. Il me répondit qu'il préparait une série d'articles pour un magazine américain fort connu.
Il me demanda alors la permission de parler de moi dans ses articles.
— À vrai dire, lui répondis-je, je préférerais que vous n'en fassiez rien. Ma présence ici a un but précis : étudier et faire des progrès. Chongqing doit ultérieurement me servir de tremplin en vue d'autres voyages en Occident. Je préférerais attendre d'avoir à mon crédit quelque chose qui fût digne d'être signalé. Alors, je me mettrai en rapport avec vous et je vous accorderai cette interview à laquelle vous tenez.
Étant un honnête homme, il comprit très bien mon point de vue. Nos relations devinrent vite amicales ; il parlait passablement le chinois et nous n'avions guère de difficultés à nous comprendre. Quand nous repartîmes pour la lamaserie, il fit avec nous un bout de chemin.
— Si cela peut se faire un jour, dit-il, j'aimerais beaucoup visiter le temple et assister à un office. Votre religion n'est pas la mienne mais je la respecte et je voudrais lui rendre hommage.
— Très bien, répondis-je, vous assisterez à un office dans notre temple et vous y serez le bienvenu, je vous en donne ma parole.
Sur quoi, nous nous séparâmes car j'avais beaucoup à faire en prévision du lendemain, ce jour où j'allais commencer une nouvelle carrière d'étudiant... comme si, jusqu'alors, je n'avais consacré tout mon temps à l'étude ! Rentré à la lamaserie, je dus mettre de l'ordre dans mes affaires et m'occuper de mes robes qui s'étaient salies pendant le voyage. C'était à moi de les laver parce que la coutume de notre pays veut que nous nous occupions nous-mêmes de nos vêtements, de nos robes et de toutes nos affaires personnelles, sans confier ces tâches rebutantes à des serviteurs. Par la suite, je devais m'habiller en bleu comme les étudiants chinois, parce que mes robes de lama attiraient trop l'attention ; je voulais avant tout étudier en paix, et pour cela, il me fallait fuir toute publicité ! En plus de nos tâches quotidiennes, telles que le blanchissage, par exemple, nous avions nos propres offices ; mon rang dans la hiérarchie religieuse m'obligeait de plus à prendre personnellement part à la célébration de ces services car si, pendant le jour, je n'étais qu'un étudiant, à la lamaserie j'étais toujours un haut dignitaire ecclésiastique, qui ne pouvait se dérober à ses nombreuses obligations.
Et c'est ainsi que cette journée se termina, alors que je pensais qu'elle ne finirait jamais, cette journée qui devait me voir pour la première fois de ma vie, complètement et irrémédiablement coupé de mes compatriotes.
Le lendemain, par une matinée chaude et ensoleillée, Huang et moi, nous nous mîmes en route vers notre nouvelle vie d'étudiants en médecine. Nous eûmes vite fait d'effectuer le trajet et d'arriver au collège où des centaines d'étudiants se pressaient déjà devant un gigantesque tableau. Un examen attentif de toutes les communications affichées sur celui-ci nous permit de voir que nos noms figuraient sur la même liste, de sorte que nous assisterions toujours ensemble aux mêmes cours. Après quoi, nous nous rendîmes dans la salle qui nous avait été assignée, en nous frayant un passage à travers la masse des étudiants qui continuaient à examiner le tableau. En nous asseyant, nous étions remplis d'étonnement, moi du moins, devant l'étrangeté de l'installation, les pupitres, enfin tout. Après ce qui nous parut être une éternité, d'autres jeunes gens entrèrent par petits groupes et prirent leur place. Enfin, quelqu'un donna un coup de gong et un Chinois entra en disant :
— Bonjour, messieurs...
Toute la classe se leva pour obéir aux signes extérieurs de politesse stipulés par les règlements et répondit d'une seule voix :
— Bonjour, monsieur.
Le Chinois commença par nous annoncer qu'il allait nous faire passer un examen par écrit, en soulignant que nos insuffisances ne devaient pas nous décourager, parce que son rôle était de découvrir ce que nous ignorions et non ce que nous savions. Tant qu'il n'aurait pas une idée exacte du niveau intellectuel de chacun, dit-il, il ne serait pas en mesure de nous aider. Cet examen, au cours duquel nous devions répondre aux questions les plus diverses, portant sur tous les sujets possibles et imaginables, allait être un véritable brouet chinois d'arithmétique, de physique, d'anatomie, de tout ce qui avait trait à la médecine, à la chirurgie et aux sciences, et aux matières dont la connaissance était indispensable à quiconque voulait réellement approfondir ces trois dernières disciplines. Il nous fit clairement comprendre que si nous étions incapables de répondre à une question, nous devions indiquer que sur ce point nos études n'avaient pas été poussées aussi loin, et donner, dans la mesure du possible, toutes précisions lui permettant d'avoir une idée exacte de nos connaissances. Après quoi, il agita une sonnette et la porte s'ouvrit sur deux appariteurs chargés de ce qui me parut être des livres, et qu'ils se mirent en devoir de nous distribuer. En fait, ils ne nous remirent pas des livres, mais des feuilles où étaient inscrites les questions ainsi que du papier blanc pour écrire nos réponses. Puis on nous donna des crayons, car en cette occasion nous n'allions pas nous servir de pinceaux. Nous nous mîmes donc au travail, lisant les questions et y répondant de notre mieux. D'après son Aura, il était visible, tout au moins pour moi, que le maître de conférences était un homme intègre qui ne cherchait qu'à nous aider.
J'avais reçu de mon Guide et tuteur, le Lama Mingyar Dondup, une instruction extrêmement spécialisée. Les résultats de l'examen proclamés au bout de deux jours montrèrent que si dans de nombreuses matières, j'étais très en avance sur mes camarades, mes connaissances en électricité et en magnétisme étaient nulles. Environ une semaine après, je me trouvais dans un laboratoire avec un groupe d'étudiants qui, tout comme moi, ignoraient la signification de ces deux mots aux sonorités si menaçantes, quand arrivé à la fin de son cours sur l'électricité, le professeur nous dit :
— Passons maintenant à la pratique... Au moyen d'une expérience tout à fait inoffensive, je vais vous montrer les effets de l'électricité...
Il me tendit alors deux fils.
— Tenez-les bien, s'il vous plaît, me dit-il, serrez-les dans vos mains jusqu'à ce que je vous dise de les lâcher.
Croyant qu'il me demandait de l'aider dans son expérience — et la suite devait prouver que je ne me trompais pas ! — j'obéis, mais sans enthousiasme. Son Aura, en effet, révélait que ses desseins étaient troubles. "Allons, me dis-je, peut-être suis-je en train de me montrer injuste, tout simplement parce qu'il ne m'est pas sympathique." Après avoir fait demi-tour, il regagna à pas rapides sa place d'où il appuya sur un bouton. Quand un éclair jaillit du fil, l'Aura du professeur fut celle d'un homme absolument stupéfait. L'ébahissement, du reste, se lisait sur son visage.
— Serrez-les plus fort, dit-il.
Je m'exécutai et serrai les fils de toutes mes forces. Le professeur me regarda en se frottant les yeux. Il était abasourdi et tous s'en rendirent compte, même ceux qui ne pouvaient voir son Aura. Pour la classe entière, il fut évident qu'il n'avait, de sa vie, éprouvé pareille surprise. Mes camarades regardaient la scène, bouche bée, incapables de comprendre ce qui se passait, et ce que le maître avait voulu démontrer.
Celui-ci, après avoir coupé le courant, revint près de moi et me prit les fils des mains.
— Il y a quelque chose qui ne marche pas, dit-il, un mauvais contact sans doute.
Il retourna à sa table, un fil dans chaque main, puis, sans les lâcher, rétablit le courant... et se mit immédiatement à crier.
— Aïe ! Coupez, coupez, vous allez me tuer !
Son corps était secoué de convulsions et on eût dit que tous ses muscles étaient noués et paralysés. Pendant qu'il hurlait, je remarquai que son Aura ressemblait à un soleil couchant. "Extrêmement intéressant, pensai-je, je n'ai jamais vu d'Aura si joliment colorée !"
Ses vociférations prolongées firent bientôt accourir du monde. Après lui avoir jeté un regard, un homme bondit jusqu'à la table et coupa le courant. Le pauvre professeur s'affala sur le sol, tremblant de tout son corps et suant à grosses gouttes. Il n'était pas beau à voir avec son visage d'une pâleur verdâtre. Enfin, il réussit à se relever en s'agrippant au rebord du bureau.
— C'est vous le coupable, cria-t-il.
— Moi, me récriai-je, je n'ai rien fait du tout. Vous m'avez demandé de tenir les fils et je les ai tenus. Ensuite, quand vous me les avez repris des mains, nous avons cru que vous alliez mourir.
— Je n'y comprends rien, dit-il, rien du tout...
— Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? J'ai tenu ces machins-là dans mes mains, n'est-ce pas ?... alors, que voulez-vous dire ?
Il me regarda dans les yeux.
— Vous n'avez vraiment rien senti ? demanda-t-il. Un picotement ou quelque chose comme cela ?
— Ma foi, lui dis-je, j'ai éprouvé une légère sensation de chaleur qui était agréable mais rien de plus. Pourquoi ? Qu'aurais-je dû ressentir ?
Le professeur qui avait coupé le courant prit la parole.
— Accepteriez-vous de recommencer ? demanda-t-il.
— Bien sûr, lui répondis-je, aussi souvent que vous voudrez.
Il me tendit les fils.
— Je vais mettre le courant, dit-il en appuyant sur le bouton, et vous me ferez part de vos impressions... Voyons, que ressentez-vous ?
— Eh bien, tout au plus une agréable sensation de chaleur... Pas de quoi en faire une histoire : C'est exactement comme si j'approchais mes mains d'un feu...
— Serrez-les plus fort, dit-il.
J'obéis avec une telle bonne volonté que les veines de mes mains se mirent à gonfler.
Les deux professeurs échangèrent un regard puis, après avoir coupé le courant, l'un d'eux se saisit des fils, les enveloppa d'un chiffon et les garda en main.
— Mettez le contact, dit-il à son collègue.
Le courant fut remis et immédiatement le maître qui tenait les fils les laissa échapper.
— Oh ! s'écria-t-il, le courant passe toujours.
En tombant, les deux fils sortirent du chiffon et entrèrent en contact. Aussitôt, jaillit une étincelle d'un bleu vif cependant qu'une petite boule de métal fondu se détachait de l'extrémité de l'un d'entre eux.
— Voilà les plombs qui sautent maintenant, dit un maître, en sortant pour effectuer les réparations nécessaires.
Le courant rétabli, le cours d'électricité continua. Les professeurs nous expliquèrent qu'ils avaient voulu me faire passer un courant de 250 volts dans les mains pour que la secousse que j'éprouverais serve de démonstration au reste de la classe. Or, j'ai la peau particulièrement sèche et 250 volts ne me dérangent aucunement. C'est ainsi que je peux poser mes mains sur des colonnes montantes sans pouvoir dire si le courant passe ou non... Malheureusement pour lui, le pauvre professeur n'était pas comme moi, il était au contraire extrêmement sensible au courant électrique.
— En Amérique, nous dit-on ce même jour, lorsqu'un homme a commis un crime, ou qu'il est reconnu coupable d'un meurtre, il est électrocuté. On l'attache à une chaise au moyen de courroies, un courant passe dans son corps et il meurt.
"Comme c'est intéressant... me dis-je. Que pourraient-ils faire avec moi, je me le demande... Il est vrai que je n'ai nulle envie d'en faire l'expérience..."
Chapitre Trois
À la faculté de médecine
Un brouillard grisâtre et humide tombait des collines dominant Chongqing ; il masquait les maisons, le fleuve, les mâts des navires amarrés dans le port, transformant les lumières des boutiques en de vagues masses d'un jaune orange, et étouffant les bruits ; grâce à lui, une partie de la ville y gagnait en beauté. J'entendis des pas feutrés : la vague silhouette d'un vieillard tout voûté surgit du brouillard l'espace d'une seconde, et disparut aussitôt. Un étrange silence, troublé seulement par des bruits assourdis, planait sur la ville qui semblait recouverte d'un épais manteau. Ce jour-là, nous n'avions, Huang et moi, plus de cours à suivre et la soirée était bien avancée. Nous nous étions évadés des salles de dissection pour prendre un peu l'air, mais ce temps nous avait déçus. J'avais faim et apparemment Huang aussi. L'humidité nous avait pénétrés jusqu'à la moelle des os et nous étions glacés.
— Si nous allions manger un morceau, dit Huang. Je connais un bon endroit.
— Entendu, répondis-je. Je suis toujours prêt à faire des expériences intéressantes. Que voulez-vous me montrer ?
— Tout simplement que, malgré vos dires, on peut vivre confortablement à Chongqing.
Nous nous mîmes donc en route, mais à tâtons comme des aveugles. Enfin, nous arrivâmes dans une rue dont il nous fut possible de repérer les boutiques. Un peu en contrebas de la colline, Huang me fit entrer dans ce qui me parut être une caverne creusée dans le flanc d'une montagne. À l'intérieur, l'air était encore plus épais qu'au-dehors. La salle était pleine de fumeurs qui vomissaient de gros nuages nauséabonds. C'était pour ainsi dire la première fois que je voyais une aussi grande assemblée de fumeurs ; aussi était-ce un spectacle nouveau — encore qu'écœurant — que celui de ces hommes qui, un tison enflammé à la bouche, faisaient sortir de petits nuages de fumée par leurs narines. Un homme qui soufflait la fumée non seulement par ses narines mais par ses oreilles attira particulièrement mon attention. Il me fascinait tellement que du doigt, je le montrai à Huang.
— Oh ! celui-là, dit-il, il est sourd comme un pot... On lui a crevé les tympans et ça lui sert beaucoup en société, car sans tympans, il peut faire sortir la fumée par ses oreilles. Il aborde un étranger et lui dit : "Donnez-moi une cigarette, et je vous ferai voir quelque chose que vous ne savez pas faire !..." Ainsi, il ne manque jamais de tabac... Mais trêve de plaisanterie, il est temps de penser à manger. Je vais commander le repas... Je suis très connu ici, et nous aurons ce qu'il y a de mieux au meilleur prix...
Sa proposition me convenait d'autant mieux que, depuis plusieurs jours, j'avais fort mal mangé... tout me paraissait tellement étrange, à commencer par la cuisine. Après qu'Huang se fut adressé à un garçon qui prit quelques notes sur son bloc, nous nous assîmes et commençâmes à bavarder. La nourriture constituait pour moi un problème. Je ne pouvais me procurer les plats auxquels j'étais habitué et force m'était donc de manger, entre autres choses, de la viande et du poisson. Pour moi, lama du Tibet, c'était là des pratiques révoltantes, bien que mes supérieurs au Potala m'eussent ordonné de m'habituer à la cuisine étrangère et absous à l'avance pour le genre de nourriture que je serais obligé de prendre. Au Tibet, les prêtres ne mangent jamais de viande — mais je n'étais pas au Tibet et il me fallait bien vivre si je voulais accomplir la tâche qui m'avait été fixée. Faute de pouvoir me procurer des aliments ‘convenables’, je devais avaler les infâmes ratatouilles qu'on me servait et faire semblant de les trouver à mon goût.
On nous apporta notre repas : une demi-tortue aux cornichons de mer, suivie de grenouilles au curry, garnies de feuilles de choux. Tout cela était fort bon mais combien je regrettais ma tsampa ! Enfin, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, je fis honneur aux grenouilles ainsi qu'à un bon plat de nouilles et de riz. Comme boisson, nous prîmes du thé. Une chose dont je me suis toujours abstenu, en dépit des nombreuses invites des étrangers, c'est l'alcool. Jamais, au grand jamais, je n'en ai bu. Pour les gens de notre foi, il n'est rien de plus dangereux que les boissons alcoolisées, et rien de pire que les ivrognes. L'ivresse est pour nous le plus terrible des péchés, car, lorsque le corps est imbibé d'alcool, le véhicule astral — qui est la partie la plus spirituelle de l'individu — est chassé du corps physique et devient ainsi une proie offerte aux entités qui rôdent. La vie que nous connaissons n'est pas toute la vie ; le corps physique n'en est qu'une manifestation particulière, la plus basse ; plus on boit et plus on nuit à son être dans les autres plans de l'existence. Il est bien connu que les ivrognes voient des ‘éléphants roses’ et de nombreuses choses curieuses qui ne correspondent à rien de réel. Ces formes, croyons-nous, sont celles qu'empruntent les entités malveillantes, pour pousser le corps physique à faire le mal. Tout le monde sait qu'un homme saoul n'est pas ‘en possession de toutes ses faculté’. Aussi n'ai-je jamais bu de spiritueux, pas même de l'eau-de-vie de grain ou du vin de riz.
Le canard laqué est un mets des plus délicats — du moins pour ceux qui aiment les volailles. Pour ma part, je préférais de beaucoup les pousses de bambou, qu'il est naturellement impossible de se procurer en Occident. Ce qui s'en rapproche le plus est une espèce de céleri qu'on cultive dans un certain pays de l'Europe. Le céleri d'Angleterre, tout à fait différent, me convient moins. Puisque nous en sommes au chapitre de la cuisine, il intéressera peut-être le lecteur de savoir que le chop suey n'est pas un plat. Chop suey n'est qu'un nom, un vocable générique pour désigner la nourriture chinoise, quelle qu'elle soit. Si l'on veut vraiment manger à la chinoise, le mieux est de se rendre dans un restaurant chinois de premier ordre et de commander d'abord un ragoût de champignons et de pousses de bambou, puis une soupe de poissons et enfin un camard laqué. On ne vous donnera pas de couteau dans un vrai restaurant chinois, mais le garçon, à l'aide d'une hachette découpera le canard en tranches de l'épaisseur voulue. Après qu'il vous aura fait approuver son travail, elles seront placées avec des oignons nouveaux entre deux tranches de pain azyme. Il est d'usage de ne faire qu'une bouchée de ces petits sandwichs. On terminera le repas avec des feuilles de lotus ou, si l'on veut, des racines de lotus. Certains préfèrent le lotus en grains mais, en tout état de cause, on aura besoin d'une quantité suffisante de thé chinois. Tel était le genre de repas qu'on servait dans ce restaurant qu'Huang connaissait si bien. À ma vive surprise, l'addition fut des plus raisonnables ; aussi est-ce avec un délicieux sentiment d'euphorie, que, l'estomac bien calé, nous nous levâmes de table pour affronter le brouillard. Nous remontâmes la rue jusqu'à la route de Kialing où, arrivés à mi-chemin, nous tournâmes à droite pour emprunter le sentier menant à notre temple. Nous arrivâmes pour l'office. Les Bannières, qu'aucune brise n'agitait, pendaient mollement sur leurs mâts et les nuages d'encens semblaient immobiles. Ces Bannières, faites d'une étoffe rouge sur laquelle sont brodés en or des idéogrammes chinois, étaient les Bannières des Ancêtres, et elles servaient à commémorer le souvenir des morts, comme les pierres tombales des Occidentaux. Après nous être prosternés devant Ho Tai et Kuan Yin, Dieu de la Vie Parfaite et Déesse de la Pitié, nous avançâmes dans le temple faiblement éclairé pour assister au service. Celui-ci terminé, nous étions si incapables d'affronter le repas du soir que nous nous enroulâmes sans plus attendre dans nos couvertures pour bientôt glisser dans le sommeil.
Pour nos travaux de dissection, nous n'étions jamais à court de cadavres, car c'était une marchandise facile à se procurer dans le Chongqing de cette époque ! Plus tard, quand la guerre éclata, nous devions n'en avoir que trop à notre disposition !
Ceux que nous disséquions étaient gardés dans une salle souterraine convenablement réfrigérée. Dès qu'il nous en parvenait un nouveau, ramassé dans la rue ou fourni par un hôpital, nous lui injections dans l'aine une solution d'un désinfectant puissant pour le maintenir pendant quelques mois dans un bon état de conservation. Il était très intéressant de descendre au sous-sol où ces corps, tous d'une maigreur extrême, étaient étendus sur des dalles de pierre. Chacun voulait le cadavre le plus maigre et cela donnait lieu à de violentes disputes. Disséquer un corps trop gras donne beaucoup de mal et les résultats ne correspondent pas aux efforts fournis. Il peut arriver qu'après avoir coupé et coupé, puis détaché un nerf ou une artère, on soit obligé de disséquer couche après couche de tissus adipeux. Nous ne manquions certes pas de cadavres. Très souvent, nous en avions tellement en réserve que nous les mettions dans de grands bassins, ‘en conserve’ selon l'argot des étudiants. Bien entendu, il n'était pas toujours facile d'introduire subrepticement un cadavre dans l'hôpital car les parents du défunt pouvaient avoir des opinions très arrêtées à ce sujet. À cette époque, les bébés qui mouraient et les adultes dont les familles étaient trop pauvres pour assumer les frais d'un enterrement convenable étaient abandonnés dans les rues à la faveur de la nuit. Les étudiants en médecine, dont j'étais, sortaient donc très souvent de bonne heure ramasser les corps les plus ‘sympathiques’, c'est-à-dire les plus décharnés. Nous aurions pu avoir un cadavre chacun mais en général nous travaillions à deux, l'un s'occupant de la tête et l'autre des jambes. On se sentait ainsi moins seul ! Nous prenions assez souvent notre déjeuner dans la salle de dissection, surtout en période d'examens. Il n'était pas rare de voir un étudiant, son déjeuner posé à même le ventre d'un cadavre, lire un manuel calé contre l'une de ses cuisses. Il ne nous serait alors jamais venu à l'esprit qu'au contact de ces corps nous pouvions contracter un tas de maladies bizarres.
Notre Principal, le Dr Lee, était partisan des méthodes américaines les plus modernes. Sur certains points, cela tournait presque à la manie, mais peu importait car c'était un excellent homme, un des Chinois les plus brillants que j'aie eu l'occasion de rencontrer, et avec lequel étudier devenait un plaisir. J'ai acquis de solides connaissances et passé de nombreux examens. Toutefois, je reste convaincu qu'au point de vue de l'anatomie pathologique, j'ai plus appris avec les Briseurs de Corps du Tibet que partout ailleurs.
Notre collège et l'hôpital qui lui était rattaché étaient situés à quelque distance des quais, dans le prolongement de la rue aux Marches. Par beau temps, nous jouissions d'une très belle vue sur la rivière et sur les champs en terrasses, en raison de la situation élevée du collège, qui en faisait du reste un bâtiment facile à repérer. Du côté du port, dans la partie la plus commerçante de la rue, il y avait une vieille, très vieille boutique qui paraissait dans un état de délabrement avancé. Les boiseries étaient vermoulues et la peinture des planches toute écaillée. La porte était branlante. Une silhouette de tigre découpée dans du bois et badigeonnée de couleurs criardes était placée juste au-dessus, de sorte que pour entrer dans la boutique, il fallait passer sous son dos arqué. Sa gueule grande ouverte sur ses crocs pointus et ses griffes terrifiantes avaient été traités dans un style suffisamment réaliste pour effrayer n'importe qui. Ce tigre, selon la vieille tradition chinoise, représentait la virilité. Cette échoppe attirait les hommes épuisés et tous ceux qui cherchaient à assouvir pleinement leurs passions. Des femmes aussi venaient dans cette boutique se procurer des poudres, de l'extrait de tigre ou de racine de ginseng, quand elles voulaient des enfants, sans réussir à en avoir. Ces extraits sont extrêmement riches en substances d'un grand secours pour les hommes et les femmes en proie à ce genre de difficultés, substances dont la récente découverte par les savants de l'Occident a été saluée par eux comme un des triomphes de la science moderne. Les Chinois et les Tibétains, très ignorants, il est vrai, de tout ce qui touche la recherche scientifique, n'employaient ces extraits que depuis trois ou quatre mille ans et ils n'en ont jamais tiré vanité ! Il est de fait que l'Occident aurait beaucoup à apprendre de l'Orient s'il était animé d'un esprit plus ouvert. Mais revenons à notre vieille boutique avec son féroce tigre sculpté et bariolé, ses vitrines pleines de poudres étranges, ses momies et ses bouteilles de liquides colorés. Elle appartenait à un médecin de la vieille école, qui vendait aussi du crapaud en poudre, des cornes d'antilope pulvérisées servant d'aphrodisiaque, et bien d'autres mixtures curieuses. Dans ces quartiers pauvres, il était rare qu'un malade se présente au pavillon de chirurgie de l'hôpital pour se faire soigner. Il préférait entrer dans cette vieille échoppe crasseuse, tout comme l'avaient fait son père et, selon toute vraisemblance, le père de son père. Il confiait ses difficultés au médecin, qui, assis derrière une barrière de bois foncé, ressemblait fort, avec ses lunettes épaisses, à un vieux hibou. Après avoir discuté de son cas et des symptômes, le vieux docteur, opinant de la tête d'un air solennel et les mains jointes, prescrivait les médicaments nécessaires d'un ton sentencieux. La tradition voulait que chaque médicament eût sa couleur propre, qui était déterminée selon un code spécial. C'était là une convention dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Aux malades qui souffraient de l'estomac était prescrite une médecine jaune, tandis que ceux qui étaient atteints d'une maladie de cœur ou du sang prenaient un remède de couleur rouge. Pour les bilieux, les hépatiques, ou même les grands colériques, le vert s'imposait, et les affections de la vue se traitaient avec une lotion bleue. Les organes internes posaient de grands problèmes quant au choix des couleurs. Pour une douleur attribuée à un mauvais fonctionnement des intestins, il était prescrit une préparation légèrement brune. Il suffisait à une femme qui attendait un enfant — du moins c'est ce qu'on lui affirmait — d'avaler de la chair de tortue pulvérisée pour que l'accouchement se fit sans douleurs, sans complications, sans même qu'elle s'en rendît compte, et, en tout cas, sans que son travail en fût troublé.
— Rentre chez toi, lui disait-on, noue un tablier autour de ta taille en le passant entre les jambes pour que l'enfant ne tombe pas à terre, et avale un peu de cette poudre de tortue...
Le vieux médecin chinois, non inscrit à la Faculté, avait le droit de faire de la réclame et celle-ci prenait des formes spectaculaires. Une immense enseigne bariolée, placée en permanence au-dessus de sa maison, proclamait son merveilleux talent de guérisseur. Ce n'était pas tout. Dans le salon d'attente et la salle de consultation, se trouvaient des médailles et des écussons, témoignages de la reconnaissance de riches clients — qu'il avait terrifiés — pour la façon miraculeuse dont son talent, ses poudres, ses lotions et autres médicaments colorés les avaient guéris de leurs mystérieuses maladies...
Le pauvre dentiste, un praticien également de la vieille école, n'était pas aussi fortuné. N'ayant pas le plus souvent de maison où recevoir ses patients, il les soignait dans la rue. La victime assise sur une caisse, il procédait à l'examen de sa denture, tâtant ici, sondant par là, sous les regards attentifs du public. Puis, à grand renfort de gesticulations et de mystérieuses manipulations, ‘il se mettait en devoir’ d'extraire la mauvaise dent. Je dis qu'il ‘se mettait en devoir’ car souvent l'extraction n'allait pas sans peine, soit que le patient eût très peur, soit qu'il protestât trop bruyamment, auquel cas le dentiste n'hésitait pas à demander aux badauds de maintenir la victime récalcitrante. Aucun anesthésique n'était employé. Pour sa publicité, le dentiste n'utilisait pas des enseignes, des médailles ou des écussons comme les médecins, il se contentait de porter au cou un collier fait avec les dents qu'il avait arrachées. Dès qu'il en avait extrait une, il la nettoyait soigneusement, la perçait d'un trou et la joignait à son collier, un témoignage de plus de son habileté !
Nous étions fort mécontents quand des malades que nous avions soignés de notre mieux, en leur faisant suivre les traitements les plus modernes et en leur administrant les remèdes les plus coûteux, se rendaient en cachette chez le vieux docteur chinois, pour lui demander ses soins. Nous prétendions les avoir guéris, le charlatan en faisait autant, mais les responsables de nos disputes, trop heureux d'être débarrassés de leur mal, se gardaient bien de prendre position.
Quand nos études furent plus avancées, il nous arriva de plus en plus souvent d'accompagner un docteur diplômé dans ses visites à domicile et d'assister aux opérations. Parfois, il nous fallait gagner en bas des falaises, des endroits difficiles d'accès, où, à la suite d'une chute, un pauvre diable gisait, les os fracassés, le corps ensanglanté, sans qu'il fût possible de rien faire pour lui. Nous visitions aussi ceux qui vivaient sur le fleuve Kialing, dans des maisons-bateaux, ou des petites huttes bâties sur des radeaux de bambou couverts de nattes. Ces habitations se balançaient au gré du courant et si l'on ne faisait pas attention, il était très facile, surtout la nuit, de faire un faux pas ou de prendre appui sur un morceau de bambou, lequel s'enfonçait dans l'eau ! Aventure dont on n'était guère consolé par l'hilarité des jeunes garçons que pareil spectacle attirait immanquablement. La capacité d'endurance à la douleur des vieux paysans chinois était stupéfiante. Sans jamais se plaindre, ils étaient toujours reconnaissants de ce que nous réussissions à faire pour eux. Nous cherchions à leur rendre service de toutes les manières, ne fût-ce qu'en les aidant à mettre un peu d'ordre dans leurs petites huttes ou en préparant leurs repas, mais nos rapports avec les jeunes étaient plus délicats. Ils s'agitaient de plus en plus, sous l'influence des idées modernes. Les hommes de Moscou s'infiltraient parmi eux, et les préparaient à l'avènement du communisme. Nous le savions, sans pouvoir faire autre chose, hélas, qu'assister, impuissants, à toute cette agitation.
Avant d'acquérir nos diplômes, il nous fallut énormément travailler et consacrer jusqu'à quatorze heures par jour à l'étude de sujets très divers, dont le magnétisme et l'électricité, pour n'en citer que deux. Je me souviens fort bien de mon premier cours de magnétisme, science qui m'était alors quasiment inconnue. En un sens, ce cours fut peut-être aussi intéressant que ma première leçon sur l'électricité. Le professeur n'était guère sympathique mais voyons ce qui se passa.
Huang avait réussi, en se frayant un chemin à travers la foule des étudiants, à parvenir au tableau sur lequel était affiché notre emploi du temps.
— Hé, Lobsang, me lança-t-il, cet après-midi, cours sur le magnétisme...
Nous étions très contents d'apprendre que nous ferions partie de la même classe, car il s'était noué entre nous une amitié très sincère. Après avoir traversé la cour, nous entrâmes dans une salle contiguë à la salle d'électricité. À l'intérieur, se trouvait tout un matériel qui nous parut très semblable à celui qui était utilisé en électricité : bobines de fil, pièces de métal bizarres ressemblant beaucoup à des fers à cheval, tiges noires, tiges en verre et différentes boîtes transparentes contenant ce qui semblait être de l'eau, enfin des morceaux de bois et de plomb. Nous nous assîmes à nos places, et le professeur fit son entrée et gagna sa chaire à pas pesants. C'était un homme épais, physiquement et intellectuellement, qui avait de ses capacités une opinion extrêmement flatteuse, qu'en tout cas la très grande majorité de ses collègues ne partageait pas. Lui aussi était allé en Amérique mais alors que certains maîtres en étaient revenus conscients des limites de leur savoir, il avait ramené de ce voyage la conviction qu'il savait tout et que son cerveau était infaillible. Dès qu'il fut installé à sa chaire, il éprouva le besoin de frapper sur son bureau à l'aide d'un marteau de bois.
— Taisez-vous, rugit-il, bien que le silence fût total.
Nous allons étudier le magnétisme. Pour certains d'entre vous, ce sera certainement leur première leçon sur ce sujet passionnant.
Il prit un des barreaux de métal auquel on avait donné la forme d'un fer à cheval.
— Ce barreau, dit-il, est entouré d'un champ.
Immédiatement, j'imaginai des chevaux en train de paître.
— Je vais vous montrer, continua-t-il, comment délimiter le champ de cet aimant avec de la limaille de fer. Le magnétisme, en effet, ‘activera’ chaque particule de cette limaille, laquelle épousera exactement la forme de la force qui s'exerce sur elle.
— N'importe quel imbécile peut voir ce champ, glissai-je imprudemment à l'oreille d'Huang assis à côté de moi. Pourquoi tant de chichis ?
Le professeur bondit, hors de lui.
— Oh, dit-il, c'est le grand lama du Tibet... Il ne connaît pas un traître mot sur le magnétisme ou l'électricité, mais il peut voir un champ magnétique !...
Il pointa vers moi un doigt menaçant.
— Ainsi donc, grand lama, vous pouvez le voir de vos propres yeux... vraiment ? Alors, vous êtes le seul homme sur Terre à en être capable, acheva-t-il en ricanant.
— Oui, Honorable Maître, répondis-je en me levant. Je le vois très bien, ainsi que les lumières autour de ces fils.
De son marteau de bois, il fit pleuvoir une grêle de coups furieux sur son bureau.
— Vous mentez, s'écria-t-il, ce champ est invisible. Mais puisque vous êtes si malin, venez donc le dessiner au tableau, nous allons bien nous amuser.
Avec un soupir d'ennui, je m'approchai du tableau, muni de l'aimant et d'un bout de craie. En maintenant le fer à cheval sur le tableau, je dessinai la forme exacte du champ que j'avais sous les yeux, ainsi que celle de la lumière bleuâtre qui s'en dégageait. Je dessinai aussi les stries plus légères qui se trouvaient à l'intérieur du champ même. Rien ne m'était plus facile, j'avais reçu ce don à ma naissance et plusieurs opérations l'avaient développé. Quand j'eus fini, je me tournai vers la classe : le silence était absolu. Le professeur, les yeux lui sortant littéralement de la tête, ne me quittait pas du regard.
— C'est une supercherie, dit-il, vous avez déjà étudié cette question !
— Honorable Maître, répondis-je, jusqu'à ce jour je n'avais pas vu d'aimant.
— Ma foi, dit-il, j'ignore comment vous vous y prenez ! Votre champ est correctement dessiné ; je persiste cependant à croire que c'est une supercherie... et qu'au Tibet vous n'avez appris que des trucs de ce genre... Je n'y comprends rien.
Il m'arracha l'aimant des mains, le recouvrit d'une mince feuille de papier qu'il saupoudra d'une fine limaille de fer. Du doigt, il imprima au papier de légères secousses et la poudre reproduisit exactement le dessin que j'avais fait sur le tableau. Son regard après être allé de l'aimant au tableau revint se poser sur la limaille de fer.
— Homme du Tibet, s'écria-t-il, je refuse de vous croire. Je maintiens que c'est une mystification.
Il s'assit d'un air las, pris sa tête entre ses mains, puis éclatant de fureur, bondit sur ses pieds et fit de nouveau un geste menaçant.
— Vous !... Vous soutenez que vous pouvez voir le champ de cet aimant ainsi que la lumière autour de ces fils ?
— Parfaitement, répliquai-je. Rien n'est plus facile.
— Très bien, hurla-t-il, je vais vous prouver que vous n'êtes qu'un farceur !
Il était tellement en colère qu'en se retournant il renversa sa chaise. Il se dirigea à pas rapides vers un coin de la salle, se baissa et ramassa en grognant une boîte d'où sortaient des fils enroulés en spirale. Puis, il se redressa et la plaça sur une table devant moi.
— Voilà, dit-il en me regardant dans les yeux comme s'il me lançait un défi, une boîte très intéressante, qu'on appelle boîte à haute fréquence. Dessinez-moi son champ et je vous croirai. Allez-y.
— Très bien, lui répondis-je, ce n'est pas compliqué. Approchons cependant la table du tableau, autrement je serais obligé de dessiner de mémoire.
Il prit un bout de la table, je pris l'autre et, à nous deux, nous la portâmes près du tableau.
Je pris un morceau de craie et j'allais commencer mon dessin, quand je m'aperçus que le champ avait disparu. J'étais vraiment stupéfait de n'avoir plus que des fils sous les yeux. En me retournant vers le maître, je vis qu'il avait la main posée sur un commutateur. Il avait évidemment coupé le courant et la plus grande stupéfaction se lisait sur son visage.
— C'est donc vrai, dit-il, que vous pouvez voir les champs. C'est prodigieux ! (Il mit le contact de nouveau et me dit :) Tournez-moi le dos... vous me direz quand le courant sera coupé et quand il sera branché.
J'obéis et je n'eus aucune difficulté à annoncer : le courant est coupé, branché, coupé, etc. Le maître s'arrêta vite et s'assit sur sa chaise dans l'attitude d'un homme dont la foi vient d'être irrémédiablement ébranlée.
— Vous pouvez sortir, le cours est terminé, dit-il brusquement. Quant à vous, restez, ajouta-t-il, en se tournant vers moi.
Des murmures de mécontentement s'élevèrent parmi les étudiants. Ils étaient venus assister à un cours qui les intéressait et voilà qu'on les mettait dehors ! Mais le professeur les fit déguerpir, en en poussant même un ou deux par les épaules pour qu'ils partent plus vite. Il était le maître dans sa classe.
— Maintenant expliquez-vous, me dit-il, une fois que la salle fut vide. De quel truc s'agit-il ?
— Il ne s'agit pas d'un truc, lui répondis-je. C'est un don que j'ai reçu à ma naissance et qu'une opération a considérablement développé. Je peux voir les Auras des hommes... la vôtre, par exemple, montre que vous refusez de croire que quelqu'un puisse posséder un don que vous n'avez pas. Vous voulez me prendre en faute.
— Non, répondit-il, je veux seulement prouver que mes connaissances sont exactes. Or, si vous pouvez voir cette Aura, tout ce qu'on m'a appris est faux.
— Pas du tout, répliquai-je. J'affirme que tout l'enseignement qu'on vous a donné en prouve l'existence. Le peu d'électricité que j'ai déjà pu apprendre dans ce collège me fait penser, en effet, que l'électricité est l'agent moteur du corps humain.
— Inepties que tout cela, s'écria-t-il en bondissant sur ses pieds. C'est de l'hérésie... Venez avec moi chez le Principal, nous allons régler cette affaire !...
Le Dr Lee était assis à son bureau, plongé dans ses paperasses. À notre entrée, il leva ses yeux pleins de douceur par-dessus ses lunettes, qu'il enleva ensuite pour mieux nous voir.
— Vénéré Principal, brailla le professeur, ce garçon, cet individu du Tibet prétend qu'il peut voir les Auras et que nous en avons tous une. Il veut me faire croire qu'il en sait plus long que moi, moi qui suis le professeur d'électricité et de magnétisme !
Très calmement, le Dr Lee nous invita à nous asseoir.
— Voyons, dit-il, de quoi s'agit-il exactement ? Lobsang Rampa peut voir les Auras ? Je le savais déjà. De quoi vous plaignez-vous ?
— Mais Vénéré Principal, s'écria le professeur après être resté un instant bouche bée, est-il possible que VOUS accordiez créance à ces stupidités, à cette hérésie, à tous ces trucs ?
— Très certainement, répondit le Dr Lee, car Lobsang Rampa vient d'une très grande famille du Tibet et les plus hautes personnalités m'ont parlé de lui.
À ces mots, Po Chu, le professeur, prit un air penaud.
(L'Aura et le corps éthérique)
— Lobsang Rampa, reprit le Principal en se tournant vers moi, j'aimerais que vous nous parliez de l'Aura. Expliquez-nous ce sujet comme si nous n'y connaissions rien du tout. Faites-le pour que nous puissions comprendre votre expérience si particulière et peut-être en tirer profit.
Ma foi, la question se présentait sous un tout autre jour. J'aimais bien le Dr Lee et sa façon de régler les problèmes.
— Docteur Lee, commençai-je, je suis né avec le pouvoir de voir les gens tels qu'ils sont réellement. Il flotte autour d'eux une Aura qui révèle chaque nuance de leur pensée, chaque modification de leur état physiologique, mental ou spirituel. Cette Aura est une lumière dont la source est l'âme. Pendant les deux premières années de ma vie, je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais mais j'ai vite compris qu'il n'en était rien. Comme vous le savez déjà, je suis entré dans une lamaserie, à l'âge de sept ans, pour y être initié. Là, on me fit subir une opération spéciale, qui eut pour effet de me faire voir plus clairement ce que je voyais déjà et, par surcroît, de me donner certains pouvoirs. Au temps où l'histoire n'avait pas encore commencé, continuai-je, l'homme avait un Troisième Œil, que plus tard sa propre folie lui a fait perdre. Me rendre l'usage de ce Troisième Œil, tel était le but de la formation qui m'a été donnée à la lamaserie de Lhassa. (Je leur jetai un regard : tous deux buvaient mes paroles.) Docteur Lee, poursuivis-je, le corps humain baigne d'abord dans une lumière bleuâtre, d'un ou deux pouces (2,5 ou 5 cm) d'épaisseur. Cette lumière recouvre tout le corps physique, dont elle ne se sépare jamais. C'est ‘le corps éthérique’, le plus bas de tous, et il sert de lien entre le monde physique et le monde astral. L'intensité du bleu varie selon l'état de santé. Puis, au-delà du corps physique et du corps éthérique, il y a l'Aura dont les dimensions varient selon le degré d'évolution, le niveau de l'instruction et la nature des pensées. La vôtre, dis-je au Principal, se trouve à une distance de vous égale à la taille d'un homme, c'est l'Aura d'un homme évolué. Quelles que soient ses dimensions, l'Aura humaine est composée d'un tourbillon de bandes de couleur, qui ressemblent à des nuages colorés glissant dans le ciel du soir. Elles s'altèrent selon les pensées. Sur le corps, il existe des zones particulières qui produisent leur propres variétés de bandes colorées. Hier, continuai-je, en travaillant à la bibliothèque, j'ai vu des gravures dans un livre consacré à certaines croyances religieuses de l'Occident. Certaines représentaient des personnages dont la tête était entourée d'une Aura. Faut-il en conclure que les Occidentaux que j'ai toujours crus moins évolués que nous peuvent voir les Auras, et que nous en sommes incapables, nous autres peuples de l'Orient ? Sur ces images, seule la tête était entourée d'une Aura ; mais l'Aura que je vois entoure non seulement la tête mais le corps tout entier, y compris les mains, les doigts et les pieds. Et ce que je vois, je l'ai toujours vu.
Le Principal se tourna vers Po Chu.
— Ce que vous venez d'apprendre, dit-il, je le savais déjà. Je savais que Rampa était doué de ce pouvoir, et qu'il l'avait utilisé au service des dirigeants tibétains. Vous comprenez maintenant pourquoi il poursuit ses études dans ce collège. Nous espérons qu'il pourra nous aider à mettre au point un appareil qui rendra d'énormes services à l'humanité entière en facilitant le diagnostic et le traitement des maladies. Qu'est-ce qui a motivé votre visite aujourd'hui ?
Le professeur avait l'air absorbé dans ses pensées.
— Nous venions de commencer l'étude des applications pratiques du magnétisme, répondit-il. Avant même d'avoir procédé à la première expérience, et à peine avais-je ouvert la bouche pour aborder la question des champs magnétiques que cet homme a déclaré qu'il pouvait voir le champ d'un aimant, ce que je savais être absolument impossible, fantastique. Je l'ai donc prié de venir au tableau. À mon grand étonnement, il a été capable de dessiner le champ d'un aimant ainsi que celui d'un transformateur à haute fréquence. Et dès que je coupai le contact, il ne voyait plus rien. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une mystification, ajouta-t-il en regardant le Principal d'un air de défi.
— Non, lui répondit le Dr Lee, il ne s'agissait pas d'une mystification, loin de là. Je sais que Lobsang Rampa disait la vérité. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance de son Guide, le Lama Mingyar Dondup, un des hommes les plus brillants du Tibet, qui, par pure bonté d'âme et par amitié pour moi, s'est soumis à une série d'expériences, qui démontrèrent qu'il avait les mêmes pouvoirs que Lobsang Rampa. Nous — c'est-à-dire un petit groupe de spécialistes — fûmes à même de faire des recherches très poussées sur le sujet. Malheureusement, les préjugés, l'esprit de routine et la jalousie nous ont empêchés de publier nos conclusions. Je n'ai jamais cessé de le regretter.
Un long silence s'ensuivit. "C'est bien aimable de la part du Principal d'avoir foi en moi", pensai-je. Quant au professeur, il semblait d'humeur sombre, comme sous le coup d'une déception inattendue.
— Si vous possédez ce pouvoir, demanda-t-il, pourquoi étudier la médecine ?
— Je veux étudier la médecine et aussi les sciences, répondis-je, pour être en mesure d'aider ceux qui construiront un appareil comme celui que j'ai vu sur les Hautes-Terres de Chang Tang au Tibet.
Le Principal m'interrompit.
— Oui, dit-il, je sais que vous avez fait partie de cette expérience. J'aimerais être mieux renseigné sur cet appareil.
— Il y a quelque temps, commençai-je, un petit groupe des nôtres s'est rendu sur les instructions du Dalaï-Lama dans une vallée cachée entre les chaînes de montagnes des Hautes-Terres de Chang Tang. Nous devions y découvrir une ville fondée bien avant les débuts de l'histoire et qui avait été habitée par une race d'homme aujourd'hui disparue. Une partie de la ville était enfouie sous un glacier mais partout dans la vallée secrète où la glace avait fondu et où il faisait chaud, les maisons et leurs installations étaient intactes. C'est là que j'ai vu un appareil qui avait la forme d'une boîte. Il suffisait d'y approcher l'œil pour que les Auras deviennent visibles et c'est en examinant l'Aura d'une personne, avec ses couleurs, que les anciens habitants de cette ville pouvaient connaître son état de santé. Bien plus, il leur était possible de prévoir les maladies puisque l'Aura en indiquait le degré de probabilité, avant l'apparition des premiers symptômes. Ainsi les microbes du coryza sont visibles sur une Aura, même s'ils n'ont pas encore manifesté leur présence par un rhume. La guérison d'un malade est beaucoup plus facile quand on n'a pas attendu pour le soigner que la maladie se soit déclarée. De cette façon, le mal pourrait être neutralisé avant même d'avoir eu le temps de s'installer dans l'organisme.
— Très intéressant, dit le Principal, en m'approuvant d'un signe de tête, continuez, je vous prie...
— J'imagine, dis-je, une version moderne de cet appareil et je voudrais participer à sa mise au point. Dans mon esprit, il devrait permettre aux médecins et aux chirurgiens les moins doués pour la voyance, de voir ‘en couleurs’ les Auras de leurs malades. À l'aide de cartes spéciales, indiquant la nature du mal, ils pourraient ainsi établir facilement et sans risque d'erreur un diagnostic exact.
— Mais, dit le professeur, vous venez trop tard. Nous avons déjà les rayons X !
— Les rayons X ! dit le Dr Lee. Mais mon pauvre ami, à quoi nous serviraient-ils dans cette affaire, puisqu'ils ne nous montrent que l'ombre grisâtre des os ? Ce n'est pas les os que Lobsang Rampa veut rendre visibles mais le force vitale du corps. Je comprends parfaitement ce qu'il a en vue, et je suis persuadé que les plus grandes difficultés qu'il aura à surmonter proviendront des préjugés et de la jalousie professionnelle. Mais, ajouta-t-il, en se retournant vers moi, comment arriverez-vous à soulager les troubles mentaux avec votre appareil ?
— Vénéré Principal, répondis-je, si une personne souffre d'un dédoublement de la personnalité, son Aura l'indiquera très nettement parce qu'elle sera dédoublée elle-même... Et je soutiens qu'à l'aide d'un appareil approprié, il sera possible de rapprocher ces deux Auras, peut-être au moyen d'un courant électrique à haute fréquence.
Au moment où j'écris ces pages, je constate que ce genre de questions intéresse beaucoup d'Occidentaux. De nombreux médecins parmi les plus éminents se sont penchés sur le problème, mais tous sans exception m'ont prié de taire leur nom pour ne pas compromettre leur réputation !
Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter quelques remarques. Avez-vous jamais observé des fils électriques par temps de brume ? Vous avez alors pu constater que, surtout dans les régions montagneuses, ces fils sont entourés d'une faible lumière ayant la forme d'une couronne. Si vous avez de bons yeux, vous avez pu voir cette lumière clignoter, décroître puis croître en intensité puis décroître et croître encore, et ainsi de suite selon les changements de polarité du courant. C'est à peu près ce qui se passe dans l'Aura humaine. Il est manifeste que nos aïeux, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents pouvaient voir les Auras ou les auréoles puisqu'ils furent capables de les peindre sur les portraits des saints. On ne peut mettre cela sur le seul compte de leur imagination ; sinon comment expliquerait-on qu'elles aient été peintes autour de la tête de ces personnages, c'est-à-dire là où précisément brille une lumière ? La science moderne permet de mesurer l'intensité des ondes du cerveau et de la force électrique contenue dans le corps humain. En fait, il y a quelques années, on a procédé dans un hôpital très connu à des recherches sur les rayons X. Les chercheurs s'aperçurent qu'ils avaient obtenu des clichés de l'Aura humaine, mais ils n'y comprirent rien et s'en soucièrent moins encore. Ce qui les intéressait, c'était de photographier les os et non les couleurs qui enveloppent le corps, de sorte que cette Aura ne faisait que les ‘embêter’ ! Tout ce qui concernait la photographie des Auras fut malheureusement abandonné, tandis que de grands progrès étaient réalisés dans le domaine des rayons X, ce qui, je le dis humblement mais fermement, revient à mettre la charrue avant les bœufs ! J'ai l'intime conviction que quelques recherches devraient suffire pour doter les médecins et les chirurgiens du plus merveilleux instrument de guérison qui soit. J'imagine très bien — comme je l'imaginais il y a tant d'années déjà — un appareil spécial que n'importe quel docteur transporterait dans sa poche. Il l'utiliserait pour examiner le patient à peu près comme on se sert d'un verre fumé pour regarder le Soleil. À l'aide de cet appareil, il lui serait possible de voir l'Aura d'un malade et d'après la couleur des stries ou l'irrégularité des contours, de diagnostiquer exactement la nature des troubles. Ce n'est pas là ce qui importe le plus, car il ne suffit pas de connaître les maux dont les gens souffrent, il faut encore savoir les guérir. Or, l'appareil auquel je pense permettrait des guérisons faciles, spécialement dans le cas des maladies mentales.
Chapitre Quatre
Je deviens aviateur
La soirée était chaude et étouffante, avec à peine un semblant de brise. À deux cents pieds (60 m) environ au-dessus de la falaise où nous nous promenions, les masses menaçantes des nuages prenaient parfois des formes fantastiques qui me rappelaient le Tibet. Huang et moi avions passé une journée très dure dans les salles de dissection, où des cadavres qui y étaient restés trop longtemps dégageaient une puanteur insupportable, qui, jointe à toutes les autres odeurs dont celle des antiseptiques, nous avait donné une terrible migraine. "Pourquoi, me demandai-je, avait-il donc fallu que je quitte le Tibet où la pureté de l'air n'a d'égale que celle des pensées ?" Fatigués de toutes ces odeurs, nous étions venus nous promener sur cette falaise après avoir fait un brin de toilette. Qu'il était bon de flâner le soir en contemplant la nature ! Mais d'autres spectacles que celui de la nature retenaient aussi notre attention ; car de l'endroit où nous étions, il nous suffisait de nous pencher pour voir l'intense activité qui régnait sur le fleuve. Des coolies chargeaient inlassablement des bateaux, portant sur leurs épaules de longues perches de bambou au bout desquelles étaient suspendues des hottes contenant chacune quatre-vingt-dix livres (40 kg) de marchandises. Ces hottes pesaient cinq livres (2 kg) chacune, de sorte que le coolie coltinait tout au long de sa journée des fardeaux dont le poids n'était pas inférieur à cent quatre-vingt-dix livres (86 kg). Leur vie était un enfer, et ils ne s'arrêtaient de travailler que pour mourir complètement épuisés, bien qu'encore dans la fleur de l'âge. Véritables bêtes de somme humaines, ils étaient plus maltraités que les animaux. Et lorsque, usés à la tâche, la mort les surprenait, ils se rendaient utiles une ultime fois dans nos salles de dissection en fournissant à nos apprentis docteurs et chirurgiens le matériel de base qui leur était nécessaire pour apprendre à soigner les vivants.
Quand nous quittâmes le bord de la falaise, une très légère brise chargée du doux parfum des arbres et des fleurs nous rafraîchit le visage. Presque en face de nous se trouvait un petit bosquet d'arbres et nous décidâmes de nous y rendre. Mais à quelques verges de la falaise (m) nous nous arrêtâmes, les nerfs tendus, envahis d'un trouble inexplicable, comme si nous ressentions l'approche d'une catastrophe. Nous nous interrogeâmes du regard.
— Ce ne peut être le tonnerre, fit Huang, sans être autrement convaincu de ce qu'il disait.
— Bien entendu, ce n'est pas le tonnerre, répondis-je. Il s'agit de quelque chose de très étrange, de quelque chose que nous ne connaissons sûrement pas.
Peu rassurés, nous écoutâmes, la tête penchée, puis ayant examiné le paysage autour de nous, la terre et les arbres, nos yeux se portèrent enfin sur les nuages. C'était du ciel que venait le bruit, une sorte de broum, broum, broum régulier, sans cesse plus fort et plus strident. Enfin, une forme sombre ailée apparut l'espace d'un éclair dans une déchirure des nuages... avant même que nous eussions pris conscience de sa réalité, elle avait disparu dans un autre nuage.
— Huang ! criai-je, un des dieux du ciel vient nous enlever !
Que faire sinon rester immobiles, en essayant d'imaginer ce qui allait suivre. Ce bruit semblable au tonnerre, jamais nous n'en avions entendu de tel. La grande forme sombre apparut au-dessus de nos têtes ; elle laissait derrière elle des petites traînées de nuages comme si elle ne pouvait souffrir d'être retardée dans sa marche. Tout à coup, elle jaillit du ciel, passa au ras de nos têtes, et disparut au-dessous de la falaise dans un vacarme épouvantable et un violent tourbillon d'air. Après quoi, le silence fut total. Médusés, transis de peur, Huang et moi restions cloués sur place, échangeant des regards lourds d'appréhension. Puis, d'un même élan nous fîmes demi-tour et nous courûmes vers le bord de la falaise pour voir ce qui était arrivé à cette chose surgie du ciel, cette forme sombre si bizarre et si bruyante. Couchés à plat ventre, tout près du bord, nous jetâmes prudemment un coup œil sur l'eau scintillante du fleuve. Près de la berge, l'étrange monstre ailé reposait sur un banc de sable. Pendant que nous l'observions, il cracha quelques flammèches dans un crépitement de fumée noire. Cela suffit à nous faire sursauter, et nous devînmes pâles comme la mort. Mais ce qui suivit fut plus étrange encore. Quels ne furent pas notre étonnement, notre stupéfaction, quand d'un panneau qui s'était ouvert sur le côté du monstre, sortirent deux hommes. Je n'avais jamais rien vu d'aussi merveilleux, j'en étais sûr, mais... nous perdions notre temps perchés sur cette falaise ! D'un bond, nous fûmes sur pied et nous prîmes au pas de course la direction du sentier menant au fleuve. Dans la rue aux Marches, notre course devint frénétique, au mépris des règles de la circulation et même de la politesse la plus élémentaire, tant nous étions follement pressés d'arriver sur la berge.
Une fois en bas, notre déception fut si forte que nous aurions pu trépigner de colère : pas un seul bateau en vue, ni un seul batelier. Tous s'étaient rués de l'autre côté du fleuve, là justement où nous mourions d'envie d'aller. Mais si ! C'était bien une barque là-bas, derrière un rocher. Nous galopions vers elle avec l'intention de la mettre à l'eau, quand un vieillard chargé de filets descendit d'un chemin escarpé.
— Hé, grand-père, cria Huang, fais-nous traverser !
— Ma foi, répondit le vieillard, cela ne me sourit guère. Combien seriez-vous prêts à payer ?
Jetant ses filets, il s'adossa au flanc de sa barque, une vieille pipe culottée à la bouche, les jambes croisées, comme quelqu'un à qui il ne déplairait pas de passer la nuit à bavarder. Nous bouillions d'impatience.
— Allons, voyons, grand-père... Quel est ton prix ?
La somme qu'il indiqua était si fantastique, qu'à notre avis elle aurait pu suffire à l'acquisition de son vieux bateau pourri.
Mais notre surexcitation était telle que nous aurions tout donné pour nous trouver de l'autre côté du fleuve. Huang voulut marchander.
— Assez de temps perdu, lui dis-je, donnons-lui la moitié de ce qu'il demande...
Le vieillard sauta sur l'occasion car il n'espérait pas le dixième de cette somme. Le marché conclu, nous bondîmes vers sa barque.
— Doucement, jeunes gens, du calme, dit-il. Vous allez me l'abîmer !
— Oh ! ça va, grand-père, répliqua Huang. Fais vite, on n'y voit plus bien clair.
Sans se presser, le vieux bonhomme monta à bord en grognant contre ses rhumatismes. Puis, à l'aide d'une longue perche il poussa lentement sa barque dans le fleuve. Incapables de tenir en place, nous cherchâmes vainement un moyen de le faire aller plus vite, mais le bonhomme refusa de forcer l'allure. À mi-chemin, au milieu du courant, le bateau fut pris dans un tourbillon et il fallut que le batelier le remette dans la bonne direction. Pour gagner du temps, j'avais préparé l'argent que je lui mis dans la main avant même d'arriver. Le vieux pêcheur ne se fit certainement pas prier pour l'accepter. Après quoi, sans attendre que le bateau ait atteint l'autre rive, nous sautâmes par-dessus bord et de l'eau jusqu'aux genoux nous remontâmes la berge à toutes jambes.
L'incroyable, la merveilleuse machine qui était descendue du ciel avec des hommes à son bord était devant nous. Nous la contemplions avec un respect mêlé de crainte en nous étonnant nous-mêmes de notre témérité d'oser la regarder de si près. D'autres gens étaient là aussi, se tenant à une distance respectueuse. Nous nous approchâmes, plus près, encore plus près... jusqu'au moment où, glissés sous l'appareil, nous examinâmes les pneus des roues en leur donnant de petits coups. À l'arrière, il n'y avait pas de roue mais une barre de métal flexible dont l'extrémité avait la forme d'un sabot.
— Ah ! m'écriai-je, ce doit être un patin pour réduire la vitesse au moment de l'atterrissage. Nous avions un truc comme ça sur nos cerfs-volants.
Pas rassurés du tout, nous promenions nos doigts sur les flancs de la machine avec mille précautions, quand nous fûmes fort surpris de voir qu'il s'agissait simplement d'une sorte de toile tendue sur un cadre de bois et grossièrement peinte. Ça, c'était vraiment quelque chose d'inouï ! À peu près à égale distance des ailes et de la queue, nos doigts rencontrèrent un panneau. Quand il s'ouvrit devant un homme qui, d'un bond léger, sauta sur le sol, notre saisissement fut tel que nous faillîmes nous évanouir.
— Eh bien, dit-il, cet avion semble vous intéresser !
— Pour sûr, répondis-je. Au Tibet, j'ai volé dans une machine qui lui ressemblait mais elle ne faisait pas de bruit.
Il me regarda, les yeux écarquillés.
— Au Tibet, dites-vous ? demanda-t-il.
— Parfaitement, dis-je.
Huang intervint.
— Mon ami, dit-il, est une Incarnation Vivante du Bouddha et un lama. Il étudie présentement à Chongqing. Il a souvent volé dans des cerfs-volants.
L'homme de la machine volante eut l'air très intéressé.
— C'est passionnant, s'écria-t-il. Venez donc, je vous prie, vous asseoir à l'intérieur, nous pourrons bavarder.
Faisant demi-tour, il rentra dans l'appareil. "Ma foi, pensai-je, ma vie a toujours été pleine d'aventures les plus diverses et si cet homme n'a pas peur de pénétrer dans cette machine, je ne vois pas pourquoi je serais moins courageux que lui." J'entrai donc, et Huang me suivit. Sur les Hautes-Terres du Tibet, j'avais déjà vu un engin plus grand que celui-là, l'engin dans lequel les Dieux du Ciel avaient quitté le monde. Il y avait entre eux une grande différence cependant : la machine des dieux était silencieuse et n'inspirait pas la terreur alors que celle-ci sautait dans l'air et le déchirait de ses vrombissements.
À l'intérieur, l'homme nous fit prendre place sur des sièges fort confortables ma foi, puis se mit à m'assaillir de questions, à mon avis stupides, sur le Tibet, sujet banal, du moins pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cet homme, qui se trouvait dans la plus merveilleuse machine du monde, tenait tellement à me parler de mon pays. Finalement, à force de temps et au prix de bien des efforts, nous réussîmes à obtenir de lui quelques renseignements. Sa machine, qu'il appelait un aéroplane, était munie de moteurs grâce auxquels elle pouvait se mouvoir dans le ciel et c'étaient ces moteurs, dit-il, qui faisaient tant de bruit. Cet aéroplane, d'origine américaine, avait été acheté par une firme chinoise de Shanghaï qui voulait ouvrir une ligne aérienne entre cette ville et Chongqing. Quant aux trois hommes que nous avions vus, il s'agissait du pilote, du navigateur et du mécanicien qui accomplissaient un vol d'essai. Le pilote, car c'était lui, continua :
— Nous sommes chargés de donner le baptême de l'air à un certain nombre de hauts personnages de la ville, dans l'espoir qu'ils soutiendront notre projet.
Nous l'écoutâmes, à la fois captivés par ce qu'il disait et tristes de ne point figurer parmi les personnalités qui auraient une chance de voler.
— Vous qui venez du Tibet, continua-t-il, vous êtes une notabilité. Aimeriez-vous nous accompagner dans un vol ?
— Mon Dieu, m'écriai-je, j'en meurs d'envie !
Il se tourna vers Huang à qui il demanda de descendre de l'appareil, car il ne pouvait l'emmener aussi.
— Pas du tout, dis-je, s'il s'en va, je m'en vais aussi.
Huang fut donc autorisé à rester, autorisation dont par la suite il ne me sut aucun gré ! Les deux hommes qui étaient descendus au sol revinrent vers l'appareil et échangèrent un grand nombre de signaux avec le pilote. Après quoi, ils se livrèrent à des manœuvres à l'avant de l'appareil, dont certaines provoquèrent un énorme grondement. Un fracas épouvantable, accompagné de terribles vibrations, éclata tout à coup. Huang se cramponna à moi ; nous étions l'un et l'autre persuadés qu'il s'était produit un accident et que nous allions être mis en pièces.
— Tenez-vous bien, dit l'homme. Nous allons décoller.
"Remarque superflue, pensai-je, nous ne pourrions pas nous cramponner avec plus d'énergie." À ce moment, commença une terrifiante série de heurts, de secousses et de cahots violents, qui me rappelèrent — en infiniment pire — mon premier vol en cerf-volant. Le bruit qui était abominable rendait les secousses encore plus pénibles. Après un dernier choc qui faillit me faire rentrer la tête dans les épaules, j'eus l'impression que quelqu'un placé derrière moi me poussait de toutes ses forces tout en me soulevant. Je réussis à lever la tête et à regarder par une sorte de hublot. Nous étions en plein ciel et nous prenions de la hauteur. Le fleuve serpentait tel un fil d'argent jusqu'à un confluent. Les sampans et les jonques n'étaient plus que des jouets minuscules qui flottaient sur l'eau comme de petits copeaux de bois. Puis, nous aperçûmes Chongqing avec ses rues escarpées que nous avions escaladées si péniblement. Vues de cette hauteur, les rues semblaient plates mais on distinguait facilement les champs en terrasses qui s'accrochaient au flanc de la colline au-dessus d'une pente terriblement abrupte. Au loin, les paysans travaillaient la terre, sans se soucier de nous. Tout à coup, nous entrâmes dans un nuage, tout fut blanc autour de nous, et il me sembla que le bruit des moteurs était étouffé. Pendant quelques minutes, des lambeaux de nuages défilèrent devant les hublots, puis la visibilité devint meilleure, et finalement l'avion déboucha dans l'azur du ciel que le Soleil colorait de ses rayons dorés. Sous nos yeux s'étalait une mer de neige immobile, scintillant de mille feux éblouissants dont la réverbération nous faisait mal aux yeux. Nous continuions à prendre de l'altitude quand je m'aperçus que le pilote me parlait.
— Vous n'êtes certainement jamais monté aussi haut, dit-il.
— Ce n'est pas exact, répliquai-je, lors de mes premiers vols en cerf-volant, le décollage se faisait d'un point situé à dix-sept mille pieds (5 180 m) d'altitude.
Cette réponse l'étonna. Tournant son regard vers un hublot latéral, il fit basculer l'appareil, amorçant ainsi une glissade sur l'aile qui se termina en un piqué strident. Le visage d'Huang prit une horrible couleur verdâtre et il lui arriva des choses innommables. Les jambes flageolantes, il se leva de son siège et s'écroula, la face contre le plancher. Le spectacle qu'il offrait n'était guère plaisant mais ce qui lui arrivait ne l'était pas davantage. Et moi ?... Eh bien, je n'ai jamais été sensible au mal de l'air, de sorte que je pus même prendre du plaisir aux évolutions qui indisposaient si terriblement mon ami. À l'atterrissage, le pauvre n'était plus qu'une masse gélatineuse d'où s'élevaient des gémissements spasmodiques ! Non, Huang n'était pas du bois dont on fait les bons aviateurs ! Avant d'atterrir, le pilote avait coupé les moteurs et l'avion volant en vol plané avait perdu graduellement de l'altitude. Seuls le bruit soyeux du vent contre les ailes et les claquements des empennages nous rappelaient que nous étions à bord d'une machine fabriquée par des hommes. Nous étions tout près du sol lorsque, tout à coup, l'homme remit les gaz et, à nouveau, le bruit assourdissant de plusieurs centaines de chevaux-vapeur nous déchira les oreilles. Après avoir décrit un cercle, l'avion prit son terrain et finalement atterrit. Il y eut un choc violent, la béquille racla le sol en gémissant et l'appareil s'immobilisa dans un fracas infernal. Les moteurs à nouveau coupés, le pilote et moi nous nous levâmes pour sauter à terre. Le pauvre Huang, lui, n'était guère en état de nous suivre. Il nous fallut le porter et le coucher sur le sable pour lui permettre de reprendre ses esprits.
Je ne me montai guère charitable, il faut le reconnaître. Huang était allongé, la face contre le sable doré de la langue de terre où nous avions atterri, située au milieu d'une boucle du fleuve et large d'un mille (1,6 km). De curieux gargouillements sortaient de son corps agité de petites secousses et ma foi, j'étais content qu'il fût incapable de se mettre debout puisqu'ainsi j'avais l'occasion de m'entretenir avec le pilote. Et pour bavarder, nous ne nous en privâmes point. Malheureusement, il ne s'intéressait qu'au Tibet. Le pays se prêtait-il à l'aviation ? Pouvait-on y atterrir facilement ? Pouvait-on y parachuter de l'infanterie ? À vrai dire, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un parachute, mais je répondis : ‘Non’, pour plus de sûreté. Nous finîmes par arriver à un arrangement. Je lui parlai du Tibet, il me parla d'aviation.
— Je serais très honoré, finit-il par me dire, si vous consentiez à rencontrer quelques-uns de mes amis qui, eux aussi, s'intéressent aux mystères tibétains.
Ma foi, je ne voyais pas, quant à moi, l'utilité d'une telle rencontre. Je n'étais qu'un simple étudiant qu'attirait la science aéronautique et voilà que cet homme ne pensait qu'au côté mondain de l'affaire ! Au Tibet, j'avais été un des rares hommes à voler. J'avais volé au-dessus des montagnes dans un cerf-volant, j'avais éprouvé de merveilleuses sensations, la douceur apaisante du silence, par exemple, mais le cerf-volant était prisonnier de la Terre. S'il pouvait s'enlever dans les airs, il ne pouvait se déplacer au gré de son pilote. Il n'était pas plus libre qu'un yak dans son pâturage. Je voulais en savoir davantage sur cet appareil vrombissant qui circulait dans les airs comme j'avais rêvé de le faire, qui pouvait aller partout dans le monde ainsi que me l'avait assuré le pilote, ce pilote qui n'avait que le Tibet en tête !
La situation pendant un long moment sembla sans issue. Nous étions assis sur le sable l'un en face de l'autre tandis que près de nous, le pauvre Huang gémissait sans exciter le moins du monde notre pitié. Enfin, nous tombâmes d'accord. Il fut convenu que je rencontrerais ses amis, que je leur parlerais du Tibet et de ses mystères, et que je ferais même quelques conférences. En contrepartie, il me ferait monter de nouveau dans la carlingue pour m'expliquer le fonctionnement de l'appareil. Sans attendre, nous fîmes le tour de l'appareil et il m'en montra les organes essentiels : les volets, l'empennage, le gouvernail de profondeur et ainsi de suite. Puis, nous montâmes dans le poste de pilotage où nous nous assîmes l'un à côté de l'autre. Devant chacun de nous, il y avait une sorte de bâton surmonté d'une moitié de roue, qui pouvait tourner à droite ou à gauche, tandis que le bâton pouvait être manœuvré longitudinalement. Il suffisait de le tirer pour que l'avion s'élève, me dit-il, et de le pousser pour que celui-ci perde de la hauteur ; il me dit aussi qu'une rotation du volant suffisait à faire tourner l'appareil. Il m'expliqua le rôle des différents boutons et des manettes. Ensuite, il mit les trois moteurs en marche et sur les cadrans protégés par un verre, je vis des aiguilles tremblotantes changer de position selon le régime qu'il adoptait. Il me garda longtemps près de lui, jouant très bien son rôle d'instructeur et me fournissant tous les éclaircissements nécessaires. Enfin, les moteurs arrêtés, nous sautâmes à terre, où soulevant quelques volets de protection, il me fit comprendre l'utilité de certaines pièces, comme les carburateurs et les bougies.
Le soir même, fidèle à ma promesse, je rencontrai ses amis, des Chinois bien entendu, qui appartenaient tous à l'armée. L'un d'entre eux me dit qu'il connaissait bien Chiang Kaï-Shek : "— Le généralissime, ajouta-t-il, cherche à former une petite armée de techniciens en vue de relever le niveau général des forces chinoises. Dans deux ou trois jours, me confia-t-il, deux avions, de moyenne puissance, achetés aux Américains doivent arriver à Chongqing."
Après cette conversation, je n'eus plus qu'une idée en tête : voler. Comment pourrais-je monter à bord d'un de ces avions ? Comment les pilotait-on ? Comment pourrais-je apprendre à piloter ?
Quelques jours plus tard, nous sortions Huang et moi de l'hôpital quand juste au-dessus de nos têtes surgirent d'une masse de gros nuages deux formes argentées ; c'étaient les deux monoplaces de chasse qui arrivaient de Shanghaï. Ils tournèrent plusieurs fois au-dessus de Chongqing, puis, ayant repéré sans doute le terrain d'atterrissage, ils piquèrent dessus, l'un derrière l'autre. Sans perdre une minute, nous dévalâmes la rue aux Marches et arrivâmes à la langue de sable. À coups de chiffon vigoureux, deux pilotes chinois effaçaient sur leurs appareils les marques laissées par les nuages au cours du vol. Huang et moi nous approchâmes d'eux et nous fîmes connaître du chef, un certain capitaine Po Ku. Huang m'avait fait très nettement comprendre qu'après son premier — et dernier — vol où il avait cru trouver la mort, il ne remonterait pour rien au monde dans un avion.
— J'ai entendu parler de vous, me dit le capitaine Po Ku. En fait, je me demandais comment entrer en rapport avec vous.
Ces paroles, je l'avoue, ne laissèrent pas de me flatter. Au cours de notre entretien, il m'expliqua ce qui différenciait son appareil, un monoplace monomoteur, du trimoteur commercial que je connaissais déjà. Nous n'eûmes guère le temps de prolonger notre conversation, car il nous restait des malades à visiter et à notre grand regret, nous dûmes prendre congé.
Le lendemain, nous avions une demi-journée de libre ; aussi nous nous rendîmes aussi tôt que possible sur le terrain d'aviation. Je demandai au capitaine quand il allait m'apprendre à piloter comme on me l'avait promis.
— Cela m'est impossible, me répondit-il. Chiang Kaï-Shek ne nous a envoyés ici que pour faire des vols de démonstration.
Je le harcelai toute la journée. Le lendemain, en me voyant, il me dit :
— Vous pouvez prendre place aux commandes, si le cœur vous en dit. Cela vous amusera. Montez, je vais vous expliquer leur fonctionnement.
Debout sur l'empennage, il me fit voir comment on s'en servait. Elles ressemblaient beaucoup à celles du trimoteur, tout en étant plus simples, bien entendu.
Ce même soir, le capitaine et son compagnon nous accompagnèrent au temple qui nous servait de domicile, après avoir laissé les avions sous la garde de la police. J'eus beau les presser, ils refusèrent absolument de s'engager à me donner des leçons de pilotage.
— Vous aurez peut-être à attendre longtemps, me dit le capitaine. L'entraînement dure des mois et des mois. Ne croyez pas que l'on pilote un avion comme ça. Il faut suivre des cours au sol, s'entraîner dans un avion double commande, et avoir de nombreuses heures de vol à son actif avant de se voir confier un appareil comme les nôtres.
Le lendemain, en fin d'après-midi, Huang et moi traversions de nouveau le fleuve pour rejoindre nos amis. Les deux Chinois étaient seuls avec leurs appareils posés assez loin l'un de l'autre. Apparemment, il y avait quelque chose de détraqué dans l'avion de l'ami de Po Ku, car le capot avait été enlevé et des outils jonchaient le sol. Po Ku de son côté avait mis le sien en marche pour en régler le régime. Il l'arrêta, ajusta quelque chose, et le remit en marche. Un feut-feut-feut irrégulier se produisit. Debout sur l'aile, fort occupé à tripoter son moteur, il avait complètement oublié notre présence. Puis, quand le moteur, tel un chat satisfait, se mit à ronronner, il se redressa et s'essuya les mains à l'aide d'un chiffon graisseux. L'air rayonnant, il allait nous adresser la parole quand son compagnon lui cria de venir à son aide. Po Ku voulut couper les gaz, mais l'autre pilote lui fit des signes si désespérés qu'il sauta à terre et courut le rejoindre.
Je me tournai vers Huang.
— Ah, ah, fis-je, il m'a bien dit que je pouvais m'asseoir à l'intérieur de l'avion, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne vais pas m'en priver !
— Lobsang, me dit Huang, vous n'allez pas faire de bêtises, n'est-ce pas ?
— Pas question, répondis-je, quoique je pourrais très bien piloter cet avion... Il n'a pas de secrets pour moi.
— Vous vous tueriez, c'est tout.
— Allons donc ! J'ai déjà volé dans des cerfs-volants, et je n'ai jamais été malade. Alors ?
À ces mots, le pauvre Huang prit un air penaud car il connaissait ses limites en tant qu'aviateur !
Les deux Chinois étaient trop absorbés par leur travail pour me prêter la moindre attention. À genoux sur le sable, ils concentraient toute leur attention sur une pièce du moteur. Aux alentours, personne si ce n'était Huang. Aussi je me dirigeai vers l'avion, et comme j'avais vu les autres le faire, je déplaçai d'un coup de pied les cales des roues et sautai prestement dans l'avion au moment où il commença à rouler. On m'avait bien expliqué le fonctionnement des commandes, je savais où était la manette au gaz et ce qu'il fallait faire. Je la poussai donc à fond et avec une telle force que je faillis me fouler le poignet. Le moteur tournant à plein régime se mit à rugir comme s'il voulait se détacher de la carlingue. Aussitôt après, l'avion roulait à grande vitesse sur la langue de sable doré. Dans un éclair, l'endroit où le sable rejoignait l'eau et qui formait comme une ligne apparut devant mes yeux. J'eus une seconde de panique, puis je me souvins de la manœuvre et je tirai sur le manche à balai. Je tirai de toutes mes forces, le nez de l'avion se leva, les roues heurtèrent la surface de l'eau, un tourbillon d'écume jaillit, j'avais décollé. Décollé ? N'étais-je pas plutôt projeté dans le ciel par la main puissante d'un géant ? Le moteur grondait. "Attention à ne pas le laisser tourner trop vite, pensai-je, il faut réduire sa puissance sinon l'avion va éclater en morceaux." Je ramenai donc la manette en arrière et le bruit du moteur diminua. Jetant un regard par-dessus bord, je fus horrifié de voir, très loin sous moi, les blanches falaises de Chongqing. Je volais si haut que j'avais peine à me repérer. Les blanches falaises de Chongqing — ... où donc étaient-elles ? "Grand Dieu, pensai-je, si je monte encore plus haut, je vais être entraîné en dehors du monde !" À ce moment-là, l'appareil fut secoué de terribles vibrations et j'eus l'impression que mon corps se cassait en mille morceaux. Le manche à balai fut arraché de mes mains, et je me sentis projeté contre le flanc de l'appareil, qui se pencha sur le côté, bascula et se mit en vrille. Pendant quelques secondes, j'éprouvai une peur mortelle. "Lobsang, mon garçon, me dis-je, cette fois, tu as gagné. Tu t'es cru trop malin. Dans quelques secondes, tu t'écrabouilleras contre un rocher. Oh, pourquoi as-tu quitté le Tibet ?"
Je pensai alors à tout ce qu'on m'avait appris et à mon expérience des cerfs-volants. "Puisque je suis en vrille, et que les commandes ne répondent plus, me dis-je, il faut donc mettre tous les gaz pour tenter de reprendre le contrôle de l'avion." Aussitôt, je poussai la manette à fond et le moteur se mit de nouveau à rugir. Je réussis à ressaisir le manche à balai et je me calai solidement contre le dossier de mon siège. Après quoi, en m'aidant de mes mains et de mes genoux tremblants, je le poussai en avant de toutes mes forces. Le nez de l'avion bascula d'un seul coup comme si une trappe s'était soudainement ouverte sous lui. N'ayant pas de ceinture, j'aurais certainement été projeté hors de l'appareil si je ne m'étais cramponné aux commandes. J'avais l'impression que mes veines charriaient de la glace et qu'on me faisait couler de la neige le long du dos, tandis que je ressentais une étrange faiblesse dans les genoux. Le moteur vrombissait et un sifflement de plus en plus strident remplissait mes oreilles. Si je n'avais été chauve, je suis sûr que mes cheveux se seraient dressés sur ma tête malgré la résistance de l'air.
"Aïe, la vitesse est bien suffisante", me dis-je, et je redressai le levier de commande avec une infinie douceur pour éviter qu'il se casse. L'appareil se redressa petit à petit avec une lenteur désespérante, mais dans mon affolement j'oubliai de le maintenir à l'horizontale de sorte que son nez continua à monter. Il continua tellement à monter que lorsque je jetai un coup d'œil vers le bas... où était-ce vers le haut, la Terre se trouvait au-dessus de ma tête ! Éberlué, je cherchais à m'expliquer ce phénomène lorsque l'avion fit une embardée, et amorça un autre piqué avec ce résultat que la Terre et le monde hostile d'en bas se trouvaient juste devant l'hélice. J'avais fait un looping, et volé la tête en bas, moi qui étais sans ceinture, et qui ne me maintenais dans la carlingue qu'à l'aide de mes mains et de mes pieds, sans grand espoir de m'en tirer, je dois le dire. Je reconnais que j'étais mort de peur quand j'eus une idée : "Si je peux me tenir sur un cheval, me dis-je, pourquoi n'arriverais-je pas à rester dans un avion ?" Je laissai donc l'avion piquer encore une fois du nez, puis tirai progressivement le manche en arrière. De nouveau, j'eus l'impression d'être poussé par une main d'une force extraordinaire, mais cette fois, je redressai l'avion très lentement et en surveillant le sol, de sorte que je réussis à reprendre un vol horizontal. Pendant quelques instants, je restai dans la carlingue, trop ému encore pour pouvoir faire autre chose que d'essuyer la sueur qui coulait sur mon front... J'étais tombé comme une pierre, j'étais remonté comme une flèche, j'avais volé la tête en bas... et voilà que je me retrouvais Dieu seul savait où !
Jetant un coup d'œil par-dessus la carlingue, je regardai la terre, mais j'eus beau tourner la tête dans toutes les directions, je ne réussis pas à m'orienter. J'aurais pu tout aussi bien me trouver dans le désert de Gobi. Enfin, au moment même où j'allais abandonner tout espoir, une idée me frappa — ne l'avais-je déjà pas été par presque tout ce qui se trouvait dans la carlingue ?... Le fleuve ! Où était le fleuve ? "Il est évident, pensai-je, que si je le repère, que je vole ensuite en aval ou en amont, je finirai bien par arriver quelque part." Je fis donc décrire lentement un cercle à l'appareil tout en examinant l'horizon, où finalement apparut un mince fil argenté, sur lequel je mis le cap, à toute vitesse d'abord, tant j'étais pressé, puis à petite allure pour ne pas abîmer le moteur qui faisait un bruit affreux. J'étais loin alors de me sentir à l'aise ! Je me rendis compte à cet instant que je ne faisais qu'aller d'un extrême à un autre, tantôt marchant à pleins gaz et alors le nez de l'appareil se relevait de façon inquiétante, tantôt au ralenti et alors il retombait à une vitesse encore plus effrayante. Je pris donc la résolution de piloter avec plus de douceur.
En arrivant à la verticale du fleuve, je changeai de cap pour le remonter à la recherche des falaises de Chongqing... qui restèrent invisibles ! C'était à en perdre la tête ! Je décidai donc de me rapprocher du sol, et me mis à décrire des cercles de plus en plus bas, cherchant désespérément ces falaises blanches avec leurs pentes vertigineuses et leurs champs en terrasses. Il me fallut longtemps pour les trouver. Finalement, je compris que tous ces petits points sur le fleuve ne pouvaient être que des embarcations, des bateaux à aubes, des sampans et des jonques naviguant autour de Chongqing. En volant plus bas, je finis par apercevoir une mince bande de sable. Je continuai à descendre, tournant dans le ciel comme un épervier en quête de sa proie. La langue de sable grandit de plus en plus et j'aperçus alors trois hommes, Po Ku, son ami et Huang, qui regardaient le ciel, pétrifiés d'horreur, et persuadés, comme ils me l'avouèrent par la suite, que l'avion était perdu. Quant à moi, j'étais confiant, trop confiant. J'avais décollé, j'avais volé la tête en bas, et j'avais retrouvé Chongqing, j'étais vraiment le meilleur pilote du monde. Juste à cet instant, je ressentis une démangeaison à ma jambe gauche, là où dans ma jeunesse une brûlure avait laissé une vilaine cicatrice. Sans doute remuai-je alors la jambe sans m'en rendre compte : l'avion tangua, une rafale de vent souffleta ma joue gauche, le nez de l'appareil piqua, l'aile bascula et je fus emporté dans une glissade sur l'aile qui fit grincer les commandes. Une fois de plus je poussai la manette à fond et, avec mille précautions, tirai sur le manche à balai. L'avion se mit à trembler, et les ailes à tellement vibrer que je crus qu'elles allaient se détacher ! Par miracle, elles tinrent bon. L'avion se cabra comme un cheval furieux et se remit à l'horizontale. L'effort et la frayeur faisaient battre mon cœur à tout rompre. Je décrivis un nouveau cercle au-dessus de la petite langue de sable. "Ce n'est pas tout ça, me dis-je, il faut atterrir. Comment vais-je m'y prendre ?" Le fleuve était large d'un mille (1,6 km), mais vu d'où j'étais, cette largeur paraissait pouvoir être comptée en pouces (cm). Quant à l'endroit où je devais me poser, il me parut vraiment tout petit. Je continuai à tourner, en me demandant que faire. Puis, je me souvins de ce qu'on m'avait expliqué, et je cherchai une fumée pour connaître la direction du vent puisqu'il me fallait atterrir face à lui. Il soufflait vers l'amont du fleuve à en juger d'après un feu de joie qui brûlait sur la rive. Ayant fait demi-tour, je remontai le fleuve pendant plusieurs milles (km) et je fis volte-face pour descendre vers l'aval avec le vent debout. En me rapprochant de Chongqing, je réduisis graduellement le régime du moteur afin de perdre vitesse et hauteur. À un moment donné, je réduisis tellement les gaz que le moteur cala et que l'appareil tangua et tomba comme une pierre... Je crus vraiment que mon cœur et mon estomac restaient accrochés aux nuages ! Sans perdre une seconde, je remis les gaz et tirai sur le manche mais j'étais de nouveau obligé de remonter le fleuve et de recommencer toute la manœuvre ! Je commençais à en avoir assez et à me reprocher de m'être lancé dans cette aventure. "Décoller, c'est bien, pensai-je, mais atterrir — sans dégâts — c'est une autre histoire !"
Le vrombissement du moteur devenait fastidieux ; aussi fus-je heureux de voir Chongqing surgir à l'horizon. Je survolai alors le fleuve à petite vitesse et à très basse altitude, passant entre les hautes collines, d'ordinaire blanches, mais à qui les rayons obliques du soleil donnaient alors une teinte noire verdâtre. Comme j'approchais de la langue de sable — pas assez large à mon goût — qui s'étendait au milieu du fleuve, j'aperçus trois silhouettes qui sautillaient d'énervement. Je fus si intéressé par leur manège que j'en oubliai l'atterrissage ! Quand j'y pensai de nouveau, les roues et la béquille avaient déjà dépassé le terrain. Il ne me restait plus qu'à remettre ces sacrés gaz, ce que je fis — non sans pousser un gros soupir. Je dois dire que lorsque je me retrouvai face au fleuve, après avoir repris de la hauteur, j'en avais par-dessus la tête du paysage, de Chongqing et de tout !
Une fois de plus, je volai vers l'aval, par vent debout ; à ma droite, un magnifique spectacle s'offrit à ma vue : le Soleil, un Soleil énorme d'un rouge extraordinaire, descendait à l'horizon. Il avait la chance de descendre, lui ! Je l'enviais, car il me rappelait que moi aussi je devais descendre, c'est-à-dire m'écraser au sol et mourir... Pourtant, je ne me sentais pas encore prêt à regagner le royaume des dieux, il me restait tant de choses à faire ! À cet instant, je me souvins de la Prophétie et je compris que je n'avais rien à craindre. La Prophétie ! Comment, à sa lumière, ne pas être sûr d'atterrir sain et sauf et que tout irait bien ?
Perdu dans mes pensées, je faillis une fois de plus manquer Chongqing, qui se trouvait presque au-dessous de l'aile gauche. Je manœuvrai doucement le palonnier pour placer l'appareil exactement dans l'axe de la langue de sable. Je diminuai de plus en plus la vitesse, et l'avion perdit peu à peu de l'altitude. Je coupai les gaz ; lorsque le moteur s'arrêta, j'étais à dix pieds (3 m) au-dessus du fleuve. Pour éviter l'incendie au cas d'un atterrissage brutal, je coupai également l'allumage. Ensuite, je poussai le manche avec une douceur infinie pour me rapprocher du sol. Juste devant le moteur, j'avais l'eau et le sable comme au bout d'une ligne de mire. Tout doucement, je tirai sur le manche, il y eut un choc, un arrêt sec, un petit rebond, et à nouveau un grincement, un arrêt sec et un petit rebond suivi cette fois d'un craquement infernal qui me fit penser que tout allait voler en éclats. J'avais touché terre où, à vrai dire, l'avion s'était posé tout seul. Pendant quelques instants, je restai immobile sur mon siège, ayant peine à croire que j'étais au bout de mes peines et que le bruit du moteur que j'entendais toujours dans mes oreilles n'était que le fruit de mon imagination. Jetant un regard autour de moi, j'aperçus Po Ku, son compagnon et Huang qui couraient vers moi à toutes jambes, essoufflés et congestionnés par l'effort. Ils s'arrêtèrent pile près de l'appareil. Po Ku me regarda, puis regarda son avion et me regarda à nouveau. Il devint ensuite d'une pâleur extrême, sous l'effet sans doute de l'émotion et du soulagement, lequel fut si vif qu'il en oublia sa colère. Après un très long silence, Po Ku finit par me dire :
— La question est maintenant réglée. Si vous ne vous engagez pas dans l'année de l'Air, j'aurai de graves ennuis.
— Entendu, dis-je, cela fait parfaitement mon affaire. À la vérité, piloter n'est pas difficile mais j'aimerais cependant apprendre à voler selon les règles !
Po Ku rougit, puis se mit à rire.
— Vous êtes un pilote-né, Lobsang Rampa, dit-il. Vous aurez votre chance !
Et c'est ainsi que je fis le premier pas sur le chemin qui allait m'éloigner de Chongqing. À la fois médecin et pilote, mes services seraient un jour fort utiles ailleurs.
Un peu plus tard, alors que nous parlions de mon aventure, je demandai à Po Ku pourquoi, inquiet comme il l'était, il n'avait pas emprunté l'autre avion pour aller me chercher.
— J'y ai bien pensé, dit-il, mais comment l'aurais-je pu ? Vous étiez parti avec le starter !
Huang naturellement ne manqua pas de raconter l'histoire, ainsi du reste que Po Ku et son compagnon, de sorte que pendant plusieurs jours, je fus, à mon grand dépit, le sujet de toutes les conversations au collège et à l'hôpital. Le Dr Lee me fit appeler pour m'infliger officiellement un blâme, et me présenter officieusement ses félicitations. Il m'avoua qu'il aurait aimé vivre une telle aventure dans sa jeunesse mais qu'à cette époque les avions n'existaient pas. Force était de se déplacer à pied ou à cheval. Dire qu'il avait fallu un Tibétain barbare pour lui faire éprouver la sensation la plus forte de toutes ces dernières années ! — Mais dites-moi, ajouta-t-il, à quoi ressemblaient les Auras de vos amis quand vous voliez au-dessus de leurs têtes et qu'ils pensaient que vous alliez vous écraser au sol ? Je lui répondis qu'ils avaient l'air terrifié et que leurs Auras s'étaient rétrécies jusqu'à ne plus former qu'une petite tache bleue pâle, striée de filets rouge foncé, et il ne put s'empêcher de rire. D'ailleurs, lui dis-je, j'étais bien content que personne ne pût voir mon Aura, car elle devait être épouvantable, à en juger par ce que je ressentais.
Peu de temps après, un représentant du généralissime Chiang Kaï-Shek me proposa de suivre un véritable cours de pilotage, qui me permettrait ensuite d'être nommé officier dans les Forces chinoises.
— Si nous disposons d'assez de temps avant l'invasion japonaise, me dit cet officier, nous voudrions former un groupe d'aviateurs-médecins, chargé de soigner les blessés intransportables.
C'est ainsi que mes études débordèrent le domaine de la médecine. J'en vins à étudier la circulation de l'essence comme celle du sang, la structure d'un avion comme le squelette humain, sujets qui m'intéressaient également et qui présentaient de nombreux points communs.
Les années s'écoulèrent ; je finis par obtenir le diplôme de docteur et mon brevet de pilote. Expert en l'un et l'autre domaine, je consacrai mon temps à l'hôpital et mes loisirs à l'aviation. Huang ne me suivit pas dans cette voie. L'aviation ne l'intéressait pas et l'idée seule d'un avion le faisait pâlir. Par contre, Po Ku resta avec moi car on avait reconnu que nous nous entendions bien, et il est vrai que nous formions une bonne équipe.
Voler procure de merveilleuses sensations. Il était grisant de couper les moteurs à haute altitude et de glisser dans les airs comme un oiseau. Cela me rappelait beaucoup les voyages astraux, dont j'ai une grande habitude et qui sont à la portée de quiconque a le cœur raisonnablement solide et ne manque pas de patience.
Vous qui me lisez, savez-VOUS ce qu'est un voyage astral ? Le plaisir que l'on éprouve à se laisser flotter au-dessus des maisons et à se rendre dans quelque pays lointain, de l'autre côté peut-être de l'océan ; cela ne VOUS dit rien ? Ces voyages sont à la portée de tous, puisqu'il suffit à la partie spirituelle du corps de se débarrasser de son enveloppe physique pour se trouver dans une autre dimension, libre de courir le monde au bout de sa Corde d'Argent. Il n'y a rien de magique ou de répréhensible dans ce phénomène parfaitement naturel et sain. Au temps jadis, les hommes se déplaçaient par la voie astrale, le plus naturellement du monde. De nos jours encore, les Adeptes du Tibet et certains Adeptes de l'Inde utilisent cette façon de voyager qui est parfaitement normale. Dans les livres religieux de tous les pays, et dans les bibles de toutes les religions, il est question de la Corde d'Argent et de la Coupe d'Or. Ce qu'on appelle la Corde d'Argent est, en fait, une sorte de fuseau d'énergie capable de s'étirer à l'infini, mais ce n'est pas une corde ‘matérielle’ comme sont matériels un muscle, une artère ou un bout de ficelle. Elle est la Vie elle-même, l'énergie qui relie le corps physique au corps astral.
L'homme a de nombreux corps. Présentement, nous ne parlerons que du corps physique et du corps astral. Vous vous imaginez peut-être que dans sa forme astrale le corps est capable de traverser murs et planchers. Cela est vrai mais il en rencontre d'autres qui sont évidemment d'une densité différente. Au niveau astral, les choses de ce monde ne font plus obstacle à notre passage. Les portes ne peuvent plus permettre ou refuser l'entrée des maisons. Mais dans le monde astral il existe des portes et des murs qui sont, pour les corps astraux, aussi solides que le sont pour nous les portes et les murs du monde physique.
Avez-VOUS jamais vu un fantôme ? Si oui, il s'agissait probablement d'une entité astrale, peut-être la projection astrale d'une personne de votre connaissance, ou de quelqu'un d'un autre monde venu vous rendre visite. Il vous est arrivé peut-être de faire un rêve particulièrement saisissant, au cours duquel vous flottiez très haut dans le ciel, tel un ballon au bout de sa ficelle ou de sa corde. De cette hauteur, du bout de ce fil, vous avez abaissé les yeux sur votre corps, il était figé dans une rigidité blafarde. Si ce spectacle déconcertant ne vous a pas fait perdre votre sang-froid, vous avez pu vous sentir flotter comme un duvet de chardon qu'entraîne la brise. Un peu plus tard, vous êtes peut-être arrivé dans un pays ou une région lointaine que vous reconnaissiez. Le lendemain matin, en y repensant, vous avez tout mis sur le compte des rêves. Or, il s'agissait d'un voyage astral.
Faites donc l'expérience suivante : un soir, au moment de vous endormir, pensez fortement que vous allez rendre visite à quelqu'un que vous connaissez bien. Imaginez cette visite à cette personne, qui, s'il se trouve, habite dans la même ville que vous. C'est fait ? Bon ! Maintenant il s'agit de rester immobile, détendu et calme. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en train de vous envoler de votre lit, et que vous gagnez la rue en passant par la fenêtre, assuré que vous ne risquez rien, et que vous ne pouvez tomber. Suivez alors en esprit, rue par rue, le chemin qui va vous mener à la maison où vous voulez aller. Après quoi, imaginez votre entrée. Rappelez-vous que les portes ne peuvent vous arrêter, et que vous n'avez nul besoin de frapper. Alors, vous verrez votre ami, la personne à qui vous êtes venu rendre visite, à condition toutefois que vos intentions soient pures. Rien n'est plus facile ni moins dangereux. Il n'y a qu'une règle : vos intentions doivent être pures.
Au risque de me répéter, je vais expliquer cette expérience d'une autre façon, afin que vous compreniez combien elle est simple. Vous êtes étendu sur votre lit, votre porte est fermée pour que personne ne vous dérange, et vous êtes parfaitement calme. Imaginez que vous vous dégagez tout doucement de votre corps. Il n'y a aucun danger, vous ne risquez rien. Imaginez de petits grincements et de légères secousses : votre force spirituelle est en train de quitter votre enveloppe physique et elle va se solidifier au-dessus d'elle.
Imaginez qu'au-dessus de votre corps physique flotte maintenant un autre corps qui est la réplique exacte du premier, mais une réplique libérée de la pesanteur. Vous serez comme balancé, secoué légèrement de haut en bas. C'est là un phénomène naturel, anodin, qui ne doit pas vous effrayer, ni même vous inquiéter. Si vous restez calme, vous constaterez que votre esprit désormais libre s'est éloigné de quelques pieds (m) et qu'il reste en suspension dans l'air. Alors, vous pourrez vous pencher sur votre corps physique. Vous remarquerez qu'il est relié à votre corps astral par une brillante corde d'argent, aux reflets bleutés ; les ondes vitales qui la parcourent sont les pensées qui vont et viennent entre les deux corps. Tant que vos pensées resteront pures, vous ne courrez aucun danger.
À peu près tout le monde possède une expérience des voyages par voie astrale. Essayez de vous souvenir... Ne vous est-il jamais arrivé, en dormant, d'avoir l'impression de faire une chute vertigineuse et de vous être réveillé juste au moment où vous alliez vous écraser sur le sol ? Le cauchemar était tout simplement un voyage astral mais mal préparé... et pénible à supporter !
Rien ne vous oblige à supporter ces désagréments, provoqués par une différence de vibrations entre le corps physique et le corps astral. Il se peut qu'après le voyage, au moment de réintégrer votre enveloppe, un bruit, un courant d'air, un phénomène quelconque, ait provoqué un changement dans la position réciproque des deux corps, de sorte que le corps astral n'a pu retrouver sa place exacte, d'où une secousse... comme si vous étiez descendu d'un autobus en marche. Supposons que l'autobus — le corps astral — roule à dix milles (16 km) à l'heure. Le sol — le corps physique — est bien entendu immobile. Entre le moment où l'on quitte l'autobus et celui où on arrive sur le sol, il faut ralentir sous peine de ressentir un choc. Si vous avez éprouvé cette sensation de chute, c'est que vous avez déjà voyagé astralement mais sans le savoir ; de plus, le choc dû à ce ‘mauvais atterrissage’ a balayé de votre mémoire tout souvenir de ce que vous avez fait ou vu. Enfin, n'étant pas entraîné, vous étiez sûrement endormi lors de ce voyage astral, de sorte que vous avez pensé qu'il ne s'agissait que d'un rêve. "La nuit dernière, j'ai rêvé que je me promenais à tel endroit et que j'y rencontrais un tel." Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase ? Ce n'était qu'un rêve... Mais l'était-ce vraiment ? Avec un peu de pratique, vous arriverez à faire des voyages astraux en état de veille et vous n'oublierez rien de ce qui vous sera arrivé. Le gros inconvénient de ces voyages est que l'on ne peut rien emporter ni ramener avec soi. Aussi ne vous imaginez pas qu'ils simplifieraient votre existence puisque l'esprit voyage seul, sans argent ni même un mouchoir !
Les voyages astraux sont dangereux pour les gens au cœur fragile. Par contre, ceux qui ont le cœur sain ne risquent rien. Si vos intentions sont pures, si vous n'êtes pas inspiré par la vengeance ou la cupidité, rien de fâcheux ne saurait vous arriver.
Aimeriez-vous voyager astralement ? Si oui, voici la méthode la plus simple. Avant tout, gardez toujours présente à l'esprit la première loi de la psychologie, à savoir que dans tous ses conflits avec la volonté, l'imagination l'emporte toujours. Aussi, si vous voulez faire quelque chose, persuadez-vous que vous en êtes capable ; si votre imagination est assez forte, vous y arriverez. Rien ne pourra vous arrêter. Je m'explique :
Ce que votre imagination vous représente comme possible sera toujours possible, même s'il s'agit d'une chose que tout le monde juge impossible. Inversement, quelle que soit la force de votre volonté, vous ne réussirez rien contre votre imagination. Prenons un exemple. Supposons 2 maisons hautes de trente-cinq pieds (10 m), séparées par une distance de dix pieds (3 m) et reliées au niveau des toits par une planche de deux pieds (60 cm) de large. Si vous voulez passer sur cette planche pour aller d'une maison à l'autre, votre imagination vous dépeindra les dangers qui vous menacent, depuis le vent qui vous fera perdre l'équilibre, jusqu'au défaut de la planche sur laquelle vous trébucherez, à moins tout simplement que vous ne soyez victime du vertige. Bref, elle vous persuadera que vous ne pouvez manquer de vous fracasser le crâne. Eh bien, vous aurez beau essayer, une fois que votre imagination se sera prononcée, cette petite promenade sur une planche restera toujours pour vous du domaine de l'impossible. Seriez-vous doué d'une volonté de fer que vous ne réussiriez pas à éviter un accident. Pourtant si cette planche était posée à même le sol, vous la parcourriez d'un bout à l'autre sans la moindre hésitation. Qui donc l'emporte dans ce cas ? La volonté ou l'imagination ? Par contre, si vous pensez en être capable, vous passerez facilement d'une maison à l'autre, même si le vent souffle, même si la planche vacille, puisque votre imagination vous en a persuadé. Certains acrobates arrivent non seulement à marcher sur des cordes raides, mais encore à rouler dessus, perchés sur une bicyclette. Questions de volonté ? Non, d'imagination !
Il est bien regrettable que nous soyons obligés d'utiliser le mot ‘imagination’, car en Occident surtout, ce mot suggère quelque chose d'irréel et d'incroyable, alors qu'il s'agit de la force la plus puissante du monde ! Cette imagination, ou plutôt cette ‘imagination contrôlée’ comme on devrait la nommer, peut persuader un homme qu'il est amoureux et ainsi l'amour devient-il la deuxième force du monde. Mais de quelque nom que nous la nommions, un fait reste certain : lorsqu'il y a un conflit entre elle et la volonté, c'est TOUJOURS l'imagination qui l'emporte. En Orient, nous ne nous préoccupons guère de la volonté, sachant qu'elle est un piège, une illusion qui retient les hommes prisonniers de la Terre. Nous faisons confiance à l'‘imagination contrôlée’ et nous obtenons de bons résultats.
Si vous devez vous faire arracher une dent, vous vous imaginez les mille souffrances et les terreurs qui vous attendent, vous vous représentez tous les détails de l'extraction : la piqûre, votre sursaut au moment où l'anesthésique pénètre dans les gencives, et enfin l'examen minutieux pratiqué par le dentiste. Vous vous voyez perdre connaissance, vous entendez vos cris, à moins que vous vous imaginiez saigné jusqu'à la mort... toutes choses absurdes, bien entendu, mais qui pour vous sont réelles... aussi vous suffit-il de prendre place dans le fauteuil du dentiste pour éprouver — bien inutilement — toutes sortes de douleurs. Ce cas est un exemple du mauvais usage de l'imagination. Car cette imagination n'est pas contrôlée, mais déréglée, et personne ne devrait la laisser vagabonder ainsi.
On raconte souvent aux femmes des histoires affreuses sur les douleurs et les dangers de l'enfantement. Au moment de l'accouchement, la future mère, pensant à ces douleurs inévitables, se raidit, tous muscles tendus, ce qui suffit déjà à la faire souffrir. Convaincue alors de l'exactitude de ce qu'on lui a prédit, elle se raidit encore plus, ce qui augmente ses peines, de sorte qu'en fin de compte, elle souffre comme une damnée. En Orient, il en va tout autrement. Les femmes ne pensent pas qu'avoir un enfant soit difficile ou douloureux ; aussi enfantent-elles sans douleur. Parce qu'elles ont appris à contrôler leur imagination, elles peuvent vaquer à leurs occupations quelques heures après avoir accouché.
Vous avez entendu parler du ‘lavage de cerveau’ que pratiquent les Japonais et les Russes, et qui consiste, en s'emparant de l'imagination d'un individu, à le forcer à ‘imaginer’ ce qu'on veut lui mettre dans la tête. C'est grâce à ce procédé qu'un geôlier peut ‘contrôler’ l'imagination d'un prisonnier, lequel finit par avouer n'importe quoi, cela dût-il lui coûter la vie. L'‘imagination contrôlée’ permet de résister au ‘lavage de cerveau’ et même à la torture, parce que la victime, en orientant son imagination vers d'autres pensées, souffre moins, et ne s'avoue pas vaincue.
Avez-vous réfléchi au mécanisme de la douleur ? Prenez une aiguille et approchez-la de votre doigt. Que se passe-t-il ? Dès que la pointe touche votre peau, vous ne pouvez vous empêcher d'attendre avec beaucoup d'appréhension le moment où en s'enfonçant dans votre chair, elle fera jaillir une gouttelette de sang. Toute votre attention est fixée sur cette piqûre, au point que si vous aviez mal au pied, vous n'en auriez pas conscience. Votre imagination est concentrée sur ce doigt, sur cette aiguille, de sorte que votre esprit est exclusivement occupé de la douleur qu'elle vous cause. Un Oriental lui, avec la formation qu'il a reçue, ne s'attarde pas à contempler son doigt et cette piqûre, il fera littéralement circuler son imagination — son ‘imagination contrôlée’ — dans son corps de sorte que la sensation créée par la piqûre, étant pour ainsi dire diluée, il ne sera plus sensible à une douleur aussi faible. J'ai vu des gens qui, le corps traversé d'une baïonnette, ne s'évanouissaient pas, ne criaient même pas, car en voyant partir le coup, ils avaient concentré leur esprit sur d'autres pensées — encore un exemple d'‘imagination contrôlée’ — et que leurs souffrances s'étaient réparties dans leur corps au lieu d'être localisées. Ainsi réussissaient-ils à survivre à leurs blessures.
L'hypnotisme fournit un autre exemple du pouvoir de l'imagination. Dans ce cas, la personne hypnotisée soumet son imagination au pouvoir de l'hypnotiseur. Convaincu qu'il subit l'influence de ce dernier, le sujet s'imagine que le sommeil le gagne et qu'il ne peut résister à une volonté plus forte que la sienne. Il suffit alors d'un minimum de persuasion pour que le sujet — son imagination étant conquise — abdique tout pouvoir de décision et obéisse aux ordres qui lui sont donnés. C'est là tout le secret de l'hypnotisme. De la même manière, si une personne pratique l'auto-hypnose, elle ne fait qu'imaginer qu'elle tombe sous l'influence de — ELLE-MÊME ! Et ainsi, elle devient en fait contrôlée par son Moi Supérieur. C'est l'imagination bien entendu qui est à la base des guérisons miraculeuses ; les gens se montent la tête et se figurent qu'en allant à tel ou tel endroit, ou qu'en se faisant soigner par tel ou tel médecin, ils seront instantanément guéris. L'imagination, dans ces cas particuliers, donne en fait des ordres au corps, la guérison s'ensuit et se maintient tant que l'imagination reste la plus forte et qu'aucun doute ne l'assiège.
Cette question de l'‘imagination contrôlée’ est d'une importance capitale. D'elle dépend le succès ou l'échec, la santé ou la maladie. Aussi pour vous aider à la bien comprendre, voici un autre exemple très simple. Sans doute vous est-il arrivé, en roulant à bicyclette sur une route parfaitement droite, d'apercevoir un gros caillou à quelques pieds (m) à peine de votre roue avant. Peut-être avez-vous alors pensé : "Je vais passer dessus..." et bien entendu vous n'y avez pas manqué. Votre roue avant s'est mise à zigzaguer et, malgré vos efforts, elle a heurté le caillou, comme un vulgaire morceau de fer attiré par un aimant. La plus forte volonté du monde ne vous aurait pas permis d'éviter cet obstacle. Et pourtant ! Et pourtant, pour éviter ce caillou il vous aurait suffi de penser que rien n'était plus facile. Là où votre volonté était impuissante, votre imagination vous aurait sauvé ! Souvenez-vous de cette règle très importante qui peut transformer votre vie. Si vous vous entêtez à vouloir faire une chose contre votre imagination, vous risquez une dépression nerveuse. De nombreuses maladies mentales n'ont pas d'autres causes. La vie moderne pose de grands problèmes. Chacun cherche en exerçant sa volonté à dominer son imagination — au lieu de la contrôler. Il en résulte des conflits, qui peuvent provoquer des dépressions nerveuses, la neurasthénie ou même la folie. Les maisons de santé regorgent de malades qui se sont acharnés à réaliser des projets auxquels leur imagination s'opposait. Or, rien n'est plus simple ni plus facile que de contrôler son imagination et de s'en faire une alliée. C'est l'‘imagination contrôlée’ qui permet aux hommes d'escalader des pics inaccessibles, de piloter des avions ultra rapides, de battre des records et en général d'accomplir tous ces exploits dont les journaux sont remplis. Grâce à l'‘imagination contrôlée’, on se convainc qu'on peut faire ceci ou cela, et on y arrive. L'imagination ‘imagine’ et ensuite la volonté ‘veut’. C'est le succès. Aussi, si vous voulez que votre vie suive un cours agréable, comme celle des Orientaux, faites fi de la volonté qui n'est qu'un piège, une douce illusion. Ne pensez qu'à l'‘imagination contrôlée’. Ce que vous imaginez, vous pouvez le faire. L'imagination et la foi ne sont-elles pas une seule et même chose ?
Chapitre Cinq
De l'autre côté de la mort
Le vieux Tsong-tai était mort. Pelotonné sur lui-même, il paraissait dormir. Nous avions le cœur lourd. Toute la salle de l'hôpital observait un silence attristé. Certes, nous connaissions bien la mort pour avoir lutté contre elle pendant des jours et des nuits... Il n'en restait pas moins que le vieux Tsong-tai n'était plus.
Je regardai son visage jaune couvert de rides ; sa peau était tirée sur ses os comme le parchemin d'un vieux livre ou la toile d'un cerf-volant bourdonnant dans les airs. "Tsong-tai était un vieux monsieur digne de Respect", pensai-je, en observant son fin visage, sa noble tête et sa barbe parsemée de poils blancs. Bien des années auparavant, il occupait de hautes fonctions au palais impérial, mais la révolution et la guerre civile avec ses troubles et ses combats l'avaient obligé à quitter Pékin. Réfugié à Chongqing, il s'était établi maraîcher, repartant de rien, et obligé de travailler dur pour tirer du sol juste de quoi ne pas mourir de faim. C'était un homme cultivé dont la conversation était délicieuse. Et voilà que sa voix s'était tue à jamais, alors que nous avions tant lutté pour le sauver de la mort.
La dure existence qu'il menait avait fini par avoir raison de sa santé. Un jour qu'il travaillait dans son champ, il s'était écroulé et pendant des heures et des heures était resté sur place, trop mal en point pour bouger ou appeler à l'aide. Quand finalement, on était venu nous chercher, il était trop tard. Nous l'avions transporté à l'hôpital et je m'étais personnellement occupé de cet ami très cher. Mais à cette heure, je ne pouvais plus rien pour lui si ce n'est de le faire enterrer selon sa foi et de veiller à ce que sa vieille femme ne manquât de rien.
Avec tendresse, je lui fermai les yeux, ces yeux dont la lueur amusée ne se poserait plus jamais sur moi comme au temps où je le pressais de questions. Je m'assurai que sa mentonnière était convenablement fixée. Je ne voulais pas que s'affaisse cette bouche qui m'avait tant encouragé, et donné tant de leçons d'histoire et de langue chinoise. J'avais en effet l'habitude de lui rendre visite le soir ; je lui apportais quelques douceurs et nous parlions à cœur ouvert. Je ramenai le drap sur lui et je le quittai. Le jour tirait à sa fin. J'aurais dû quitter l'hôpital depuis longtemps déjà, car je venais d'y passer plus de dix-sept heures en service, essayant d'aider, essayant de guérir.
Je gravis la colline, après être passé devant les boutiques brillamment éclairées dans la nuit tombante. Quand je sortis de la ville, le ciel était couvert de nuages. Dans le port en contrebas, l'eau montait à l'assaut des quais et les bateaux à l'ancre tanguaient et roulaient.
Tout en cheminant sur la route de la lamaserie, j'entendais gémir et soupirer les branches des pins. Sans savoir au juste pourquoi, je me mis à frissonner. Une angoisse atroce m'oppressait et je ne réussissais pas à chasser l'obsession de la mort. Pourquoi fallait-il qu'elle fût parfois si douloureuse ? Au-dessus de ma tête, les nuages courant dans le ciel comme des gens pressés d'aller à leurs affaires passaient devant la lune, dont certains rayons cependant venaient frapper la cime obscure des pins. Ensuite les nuages se regroupaient, le clair de lune disparaissait et tout redevenait sombre, sinistre, et menaçant. À nouveau un frisson me parcourut.
Mes pas lourds soulevèrent tout à coup un écho sur la route comme si quelqu'un m'avait emboîté le pas. Me sentant de plus en plus angoissé, et frissonnant de tout mon corps, je serrai ma robe contre moi. "Je dois couver quelque maladie, pensai-je. Vraiment je me sens tout drôle... De quoi puis-je bien être atteint ?"
J'arrivai alors à l'entrée du petit sentier qui, courant à travers les arbres, menait à la lamaserie. Je quittai donc la grand-route pour le suivre et, après quelques minutes de marche, je passai devant une petite clairière où en tombant un arbre en avait entraîné plusieurs autres dans sa chute. Un tronc gisait sur le sol, tandis que les branches des autres étaient curieusement enchevêtrées. "Asseyons-nous une minute, me dis-je. Ce qui m'arrive est étrange..."
Je pénétrai dans la clairière et cherchai sur le tronc d'arbre un endroit propre où m'asseoir. Une fois installé, je serrai ma robe autour de mes jambes pour les protéger du vent frais de la nuit. Le paysage était fantastique. J'étais entouré de frémissements, de craquements et de bruissements, bref, de tous les bruits de la nuit. Juste à ce moment les nuages vagabonds s'entrouvrirent et les rayons de la lune inondèrent la clairière d'une lumière si vive qu'on y voyait comme en plein jour. Cette lumière et ce clair de lune dont l'éclat rivalisait avec le soleil le plus resplendissant, tout cela était bien étrange. J'étais en train de frissonner quand tout à coup j'eus si peur que je fis un bond : un homme venait d'apparaître à l'autre bout de la clairière et il avançait dans ma direction. Je le regardai sans pouvoir en croire mes yeux : c'était un lama tibétain ! Du sang coulait de sa poitrine, ses robes en étaient tachées et des gouttes écarlates dégoulinaient de ses mains. Il s'approchait de moi... Je reculai et un tronc d'arbre faillit me faire perdre l'équilibre. Je me laissai tomber sur le sol, cloué sur place par la terreur.
— Lobsang, Lobsang, aurais-tu peur de MOI ? me demanda une voix qui m'était familière.
Immédiatement, je me remis debout, et me frottant encore les yeux, je voulus courir vers l'apparition.
— Arrête, me dit la voix, tu ne peux me toucher. Je suis venu te faire mes adieux, car aujourd'hui le cours de ma vie est arrivé à son terme et je suis sur le point de quitter la Terre. Asseyons-nous, veux-tu, et parlons.
Sans mot dire, je m'assis de nouveau sur le tronc d'arbre, le cœur brisé et la tête pleine de pensées désordonnées. Dans le ciel, les nuages tournoyaient, j'entendais le bruissement des feuilles des arbres. Un oiseau en quête d'une proie fendit l'air ; il était trop occupé pour se soucier de notre présence ou de nos affaires personnelles. Du bout du tronc où nous avions pris place, nous parvint un crissement étouffé. Un petit animal nocturne cherchait sa pâture dans un amas de feuilles pourries. C'est au milieu de cette sinistre clairière, désolée et balayée par les vents, que prit place ma conversation avec une ombre, l'ombre de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, revenu de l'Au-delà pour s'entretenir avec moi.
Il s'assit à côté de moi comme il s'était assis tant de fois à mon côté au temps de Lhassa. Il s'assit pour ne pas me toucher, à peut-être trois verges (2,7 m) de distance.
— Avant de nous quitter, me dit-il, tu m'avais demandé de te prévenir de la fin de mon existence terrestre. Eh bien, l'heure est venue et me voici.
Je regardai cet homme, l'être du monde le plus proche de mon cœur. Je le regardai sans arriver à croire malgré ma grande expérience qu'il était esprit et non plus être de chair, que dans son cas la Corde d'Argent avait été tranchée et la Coupe d'Or pulvérisée. Avec ses robes, sa soutane rouge brique et son mantelet doré, il me paraissait intact, solide, tel que je l'avais toujours connu. Pourtant, il avait l'air las des gens qui reviennent d'un voyage long et pénible. Je compris en le voyant qu'il avait cessé depuis longtemps de penser à lui pour se consacrer entièrement à son prochain. "Comme il est pâle !" pensai-je. Quand il se tourna légèrement de côté dans une position qui lui était familière, je vis qu'il avait un poignard planté dans le dos. Il haussa légèrement les épaules, et s'installa plus confortablement en face de moi. Quelle ne fut pas mon horreur lorsque je m'aperçus que la pointe sortait de sa poitrine et que sa robe dorée était imprégnée de sang. Auparavant tout m'avait paru vague, je n'avais rien remarqué de précis, si ce n'est que sa poitrine et ses mains étaient ensanglantées. Je l'observai avec plus d'attention. Quand je compris que c'est parce qu'il les avait portées à sa blessure que ses mains s'étaient ainsi souillées, mon sang se gela dans mes veines et je frissonnai. Il dut remarquer l'expression de mon regard et l'horreur qui était peinte sur mon visage, car il me dit :
— C'est à dessein que je suis venu dans cet état, Lobsang... Il fallait que tu saches ce qui m'est arrivé. Maintenant que tu m'as vu ainsi blessé, regarde-moi tel que je suis vraiment.
La forme ensanglantée disparut dans un éclair de lumière dorée et à sa place m'apparut une vision d'une beauté et d'une pureté incomparables : un Être bien avancé dans la voie de l'Évolution, un Être qui avait atteint l'état du Bouddha.
C'est alors que, aussi limpide que la cloche d'un temple, parvint non pas à mes oreilles de chair mais à ma conscience profonde, le son de sa voix, une voix merveilleuse, à la sonorité admirable dans laquelle résonnait toute la force de la Vie Supérieure.
— Je n'ai que peu de temps, Lobsang, dit-il, car il me faut aller rejoindre ceux qui m'attendent. Mais j'ai voulu te voir d'abord, toi, mon ami, mon compagnon de tant d'aventures, pour te réconforter, te rassurer et te faire temporairement mes adieux. Nous avons beaucoup parlé de ces choses autrefois. Je te le redis, Lobsang, ta voie sera longue, pénible et semée d'embûches. Mais tu connaîtras le succès en dépit de tous les obstacles que dressera devant toi la jalousie des Occidentaux.
Nous eûmes une longue conversation, portant sur des sujets trop personnels pour être évoqués ici. J'éprouvais un délicieux sentiment de bien-être ; la clairière baignait dans une lumière dorée plus éclatante que le soleil le plus vif et il faisait chaud comme en plein été à l'heure de midi. Mon cœur débordait du plus pur amour. Tout à coup, mon Guide bien-aimé se mit debout, bien que ses pieds ne touchassent pas le sol. Il tendit la main au-dessus de ma tête et me bénit.
— Je veillerai sur toi, Lobsang, me dit-il, et je te viendrai en aide autant qu'il sera en mon pouvoir. Mais le chemin est pénible, et le sort t'accablera de ses coups. Aujourd'hui même, je te le dis, avant la fin du jour, tu seras encore une fois durement frappé. Il faudra le supporter, Lobsang, comme tu as tout supporté jusqu'ici. Béni sois-tu !
Je levai les yeux ; sa forme pâlit et disparut, la lumière dorée s'évanouit complètement, et les ombres de la nuit s'abattirent sur la clairière qui fut balayée d'un vent glacial. Dans le ciel, les nuages roulaient avec furie leurs masses menaçantes. Les petits animaux nocturnes firent crisser les feuilles mortes, et trouant la nuit, j'entendis le cri d'agonie d'une bête succombant à un assaut mortel.
Je demeurai là, frappé de stupeur, puis, me laissant tomber près du tronc d'arbre, j'enfonçai mes ongles dans la mousse. Pendant un moment, je perdis toute dignité en dépit de ma formation et de tout ce que j'avais appris. Alors, il me sembla entendre au fond de moi la voix si chère de mon Guide.
— Courage, mon cher Lobsang, courage, car rien n'est fini ; ce pour quoi nous luttons mérite nos efforts et sera réalisé. Tout continue.
En chancelant, je me remis sur pied et ayant repris mes esprits, j'époussetai ma robe et je nettoyai mes mains salies par la mousse.
D'un pas lent, je repris le sentier qui montait jusqu'à la lamaserie. "La mort... Je suis allé de l'autre côté de la mort moi-même, me dis-je, et j'en suis revenu. Mais là où mon Guide est parti, je ne peux le rejoindre. Il a disparu et me voici seul, désespérément seul !" C'est l'esprit agité de ces pensées que j'arrivai à l'entrée de la lamaserie en même temps qu'un petit groupe de moines revenus par un autre chemin. Je passai près d'eux sans les voir et me réfugiai dans l'ombre du temple sous le regard des saintes images dont les visages sculptés parurent m'accueillir avec compréhension et compassion. Je regardai les Bannières des Ancêtres, ces bannières rouges aux idéogrammes dorés et les volutes parfumées de l'encens sans cesse renouvelé qui flottaient comme des nuages paisibles entre le plancher et le plafond. M'étant dirigé vers un renfoncement très à l'écart et particulièrement sacré, j'entendis de nouveau Sa Voix.
— Courage, Lobsang, mon ami, car rien n'est fini. Ce pour quoi nous luttons mérite nos efforts et sera réalisé. Tout continue. Courage.
Assis dans la position du lotus, je réfléchis longuement au passé et au présent. Combien de temps restai-je ainsi ? Je ne saurais le dire. Le monde se décomposait. J'étais accablé d'épreuves. Mon Guide bien-aimé avait quitté ce monde et il m'avait dit :
— Rien n'est fini, et tout a sa justification.
Autour de moi les moines vaquaient à leurs occupations, nettoyant le temple, préparant et allumant l'encens frais, chantant des cantiques. Tous respectèrent mon chagrin.
La nuit s'avançait ; ce fut l'heure de préparer l'office. À la lumière clignotante des lampes à beurre, les moines chinois avec leurs robes noires et leurs crânes rasés où l'encens incandescent avait laissé des marques, ressemblaient à des fantômes. Le prêtre du temple coiffé de la tiare aux cinq visages du Bouddha fit son entrée en psalmodiant des chants accompagnés par les trompettes et les cloches d'argent. Lentement, je me levai et je m'en fus trouver l'Abbé. Après lui avoir appris ce qui s'était passé, je le priai de me dispenser du service de minuit en alléguant la tristesse de mon cœur et mon désir de ne pas étaler mon chagrin devant toute la lamaserie.
— Non, mon frère, me répondit-il, car vous avez tout lieu d'être joyeux. Vous êtes allé au-delà de la mort et vous en êtes revenu. Aujourd'hui votre Guide vous a parlé et vous avez pu voir de vos yeux qu'il a atteint l'état de Bouddha. Ne soyez pas triste, mon frère, car la séparation ne sera que momentanée. Assistez au service de minuit et réjouissez-vous au contraire de toutes ces merveilleuses révélations, car elles sont refusées au plus grand nombre.
"Ce n'est pas tout d'avoir reçu une bonne éducation, pensai-je. Je sais comme tout le monde que mourir, c'est naître à une Plus Grande Vie. Je sais que la mort n'existe pas, que l'Univers n'est qu'un monde d'illusions, que la vie réelle commence à la sortie de ce théâtre de cauchemar, et que cette Terre est une école où nous devons apprendre nos leçons. La mort ? Ce mot n'a pas de sens ! Alors pourquoi suis-je si découragé ?"
Je venais à peine de me poser la question que déjà je connaissais la réponse. Je me sens découragé parce que je suis égoïste, parce que j'ai perdu l'être que j'aimais, parce que l'objet de mon amour est maintenant inaccessible. Oui, c'est bien de l'égoïsme, car celui qui est parti est allé vers une vie glorieuse alors que moi, je reste, prisonnier des misères terrestres pour souffrir, pour travailler, pour accomplir la tâche que je me suis fixée, comme un étudiant qui ne doit pas ménager ses efforts tant qu'il n'a pas passé ses derniers examens. Son éducation terminée, cet étudiant se lance dans le monde pour recommencer à tout réapprendre dès le début. "En vérité, me dis-je, c'est faire preuve d'un grand égoïsme que de pleurer le départ de mon Guide bien-aimé de cette terrible vallée de larmes, alors que je devrais me réjouir de sa libération."
La Mort ? Elle n'a rien qui doive nous effrayer. C'est de la Vie que nous devrions avoir peur : elle est à la source de toutes nos erreurs.
Point n'est besoin de craindre la mort, ou le passage de cette vie à la Vie Supérieure. Point n'est besoin de craindre l'enfer : il n'existe pas, pas plus que n'existe le Jugement Dernier. L'Homme est son propre juge, et il ne peut y en avoir de plus sévère de ses défauts et de ses faiblesses lorsque, libéré de la vie sur cette Terre, il reconnaît la fausseté de son échelle des valeurs, et que la Vérité apparaît enfin devant ses yeux dessillés. Vous tous qui craignez la mort, entendez donc ma voix, c'est celle d'un homme qui est allé de l'autre côté de la mort et qui en est revenu. Soyez sans crainte. Il n'y a pas de Jugement Dernier, il n'y a que le jugement où vous serez à la fois le juge et l'accusé. L'enfer n'existe pas. Chacun, quelles que soient sa nature et ses actions, a sa chance. Personne n'est jamais détruit. Personne n'est jamais trop mauvais pour ne pas avoir une autre chance. La mort des êtres chers nous fait horreur parce qu'elle nous prive d'eux, et que nous sommes égoïstes ; de même nous avons peur de notre mort parce qu'elle représente un voyage dans l'Inconnu et que ce qui nous est inconnu ou incompréhensible nous épouvante. Mais la mort n'existe pas, elle n'est qu'une nouvelle naissance à une Vie Supérieure. Toutes les religions étaient primitivement fondées sur cet enseignement. Mais des générations et des générations de prêtres se sont succédées, et les vraies doctrines se sont altérées et corrompues, jusqu'à être remplacées par les menaces, la peur, les vapeurs de soufre et l'enfer. Ces prêtres ont agi ainsi pour affermir leur pouvoir et dire : "Nous sommes ceux qui détiennent les clefs du paradis. Obéissez-nous sinon vous irez en enfer". Or, nous autres lamas qui sommes allés de l'autre côté de la mort, nous connaissons la vérité. Nous savons qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Nos actions et le sentiment de culpabilité qui peut nous accabler importent peu. Ne nous décourageons donc jamais et espérons toujours !
L'Abbé de la lamaserie m'avait enjoint d'assister au service de minuit et de révéler ce qu'il m'avait été donné de voir ce jour-là. J'appréhendai cette terrible épreuve. Le cœur lourd et l'esprit mortellement accablé, je retournai vers ma solitude pour méditer. C'est ainsi que s'écoula cette soirée dont chaque minute me paraissait durer une heure, et chaque heure un jour, au point que je désespérais d'en voir jamais la fin. Autour de moi, dans le cœur du temple, les moines allaient et venaient ; mais je restai seul avec mes pensées, revivant le passé et craignant l'avenir.
Mais il était écrit que je n'assisterais pas au service de minuit. Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'avait prévenu que je serais frappé d'un coup cruel avant la fin du jour. Il était environ 11 heures. Autour de moi, tout était tranquille ; dans mon coin retiré, je méditais sur le passé et l'avenir lorsque j'aperçus une silhouette qui s'avançait vers moi. C'était un vieux, très vieux lama, appartenant à l'élite du temple de Lhassa, un Bouddha Reconnu dont les jours sur cette Terre étaient comptés. Au moment où il surgit de l'ombre épaisse où ne pénétraient pas les lueurs tremblotantes des lampes, je vis que son corps baignait dans un halo bleuté et que sa tête était entourée d'un nimbe doré. Il marchait les bras en avant et la paume de ses mains tournée vers le ciel.
— Mon fils, mon fils, me dit-il, je vous apporte de graves nouvelles. Le Très-Profond, le 13e Dalaï-Lama, le dernier de Sa lignée, est sur le point de quitter ce monde.
Il m'apprit que la fin d'un cycle étant imminente, le Dalaï-Lama allait prendre congé de la vie et me conseilla de rentrer à Lhassa en toute hâte pour qu'il me soit permis de Le voir avant qu'il ne fût trop tard.
— Ne perdez pas un instant, ajouta-t-il. Rentrez par n'importe quel moyen et mettez-vous en route dès ce soir, il le faut.
Sur quoi, après m'avoir jeté un dernier regard, il disparut soudainement dans les ténèbres. Quand je me relevai, son esprit avait rejoint son corps qui se trouvait pour lors au Jo-Kang (cathédrale de Lhassa — NdT) à Lhassa.
Tout allait trop vite. J'étais abasourdi par cette succession de tragédies. Mon éducation avait été vraiment sévère. Certes, on m'avait appris ce qu'il fallait penser de la vie et de la mort, et à masquer mes émotions, mais comment se comporter quand des amis bien-aimés se suivent dans la mort ? Doit-on rester de marbre, le visage impassible et le cœur insensible ou peut-on se laisser aller à des sentiments, hélas, trop humains ? Ces hommes, le vieux Tsong-tai, mon Guide, le Lama Mingyar Dondup et le 13e Dalaï-Lama, je les aimais et voilà qu'au cours d'une même journée, en quelques heures à peine, j'avais appris leur disparition. Deux d'entre eux n'étaient déjà plus ; quant au troisième, combien de temps lui restait-il ? Quelques jours peut-être... "Il me faut faire diligence", me dis-je. Je sortis du sanctuaire et entrai dans le bâtiment principal de la lamaserie. Je me dirigeai vers la cellule de l'Abbé quand, avant d'arriver à un coude du corridor dallé, j'entendis le bruit d'un choc suivi d'une chute. Je pressai l'allure.
Un lama, Jersi, Tibétain comme moi mais originaire du Chambdo, avait reçu lui aussi un message télépathique. On l'avait prié de quitter rapidement Chongqing et de rentrer avec moi, en qualité d'assistant. Il s'y connaissait fort bien en moteurs d'automobiles et autres moyens de transport. Mais il s'était trop pressé ; aussitôt le messager parti, il s'était précipité dans le corridor et s'était mis à courir vers la cellule de l'Abbé. En arrivant à un tournant, il avait glissé sur un morceau de beurre, tombé de la lampe d'un moine négligent, et dans sa chute il s'était cassé une jambe et un bras. Quand j'arrivai près de lui, il gisait sur le sol ; il gémissait et un bout d'os sortait de sa chair.
Attiré par le bruit, l'Abbé sortit de sa cellule et nous nous agenouillâmes tous deux près de notre frère en détresse. L'Abbé lui tint l'épaule pendant que je tirais sur son poignet pour remettre l'os en place. On m'apporta des attelles et des pansements et bientôt le bras et la jambe de Jersi furent proprement remis en place et bandés. Comme la fracture de sa jambe était ouverte, il fallut le transporter dans sa cellule pour pratiquer des tractions. Je le laissai ensuite à la garde d'un autre moine.
Dans la cellule de l'Abbé, je lui fis part du message apporté par le vieux moine de Lhassa et lui décrivis la vision que j'avais eue. Il en avait eu lui-même une semblable. Il fut donc décidé que je quitterais la lamaserie sur-le-champ. Sans perdre une minute, l'Abbé donna ses instructions à un messager qui gagna les écuries en courant et de là partit à Chongqing au triple galop. Je ne pris que le temps de me restaurer et de faire préparer quelques provisions. Après quoi, en emportant pour tout bagage des couvertures et une robe de rechange, je me mis en route. En descendant le sentier, je passai devant la clairière où un peu plus tôt, au cours d'une scène inoubliable, j'avais dit adieu à mon Guide, le Lama Mingyar Dondup. Mon cœur se serra mais, bien que je fusse violemment ému, je continuai ma marche, maîtrisant mon émotion à force de volonté. Lorsque je sortis du sentier, mon visage était calme, impassible, ainsi qu'il sied à un lama. Arrivé sur la route, il ne me restait plus qu'à attendre.
Derrière moi, au sommet de la colline, les notes graves des gongs allaient appeler les moines au temple. Le tintement des clochettes d'argent alternerait avec les répons que souligneraient les flûtes et les trompettes. Le halètement d'un moteur puissant traversa la nuit et des phares balayèrent de leurs faisceaux d'argent le sommet d'une colline. Peu après, une voiture arrivait à toute vitesse et s'arrêtait net devant moi, dans un crissement de pneus. Un homme sauta à terre.
— Voici votre voiture, Honorable Lobsang Rampa, dit-il. Désirez-vous que je fasse d'abord demi-tour ?
— Non, répondis-je, descendez la colline sur la gauche.
D'un bond, je m'assis auprès de lui dans la puissante voiture, une sorte de gigantesque monstre noir de marque américaine, que le messager de l'Abbé était allé commander en toute hâte à Chongqing. Les deux cents milles (321 km) qui nous séparaient de Chengdu furent couverts dans la nuit à une allure folle. Devant nous couraient les taches lumineuses des phares ; elles faisaient ressortir les dénivellations de la route et éclairaient les arbres au passage ; on eût dit que les ombres grotesques qu'elles créaient nous mettaient au défi de les rattraper et d'augmenter notre allure. Ejen, le chauffeur, était un pilote expérimenté et sûr ; il allait si vite que la route n'était plus qu'une ligne indécise. Pour moi, je me laissai aller à mes pensées.
J'évoquai la figure de mon Guide bien-aimé, le Lama Mingyar Dondup, tout ce qu'il m'avait appris et tout ce qu'il avait fait pour moi, lui qui m'était plus cher que mes propres parents. J'évoquai aussi la figure de mon seigneur bien-aimé, le 13e Dalaï-Lama, dernier de Sa lignée, puisque selon l'antique Prophétie, Sa mort devait provoquer l'établissement d'un nouvel ordre au Tibet. C'est en 1950 que les communistes chinois ont envahi mon pays mais leur Troisième Colonne était à l'œuvre depuis longtemps à Lhassa. Tout cela, je le savais dès 1933, était inéluctable. En fait, je le savais bien avant cette date car la Prophétie se vérifiait point par point.
C'est ainsi que les deux cents milles (321 km) qui nous séparaient de Chengdu furent couverts dans la nuit à une allure record. À Chengdu, nous fîmes halte pour faire le plein d'essence, nous dérouiller les jambes pendant une dizaine de minutes et manger un morceau. Puis, la voiture reprit sa course folle dans la nuit noire jusqu'à Ya-an, à cent milles (160 km) de là où nous arrivâmes à l'aube, au moment où les premières lueurs du jour illuminaient le ciel. Comme la route n'allait pas plus loin, la voiture ne m'était plus d'aucune utilité. Je me rendis à une lamaserie où mon arrivée avait été annoncée par télépathie. Un cheval m'y attendait. C'était une bête fougueuse qui ne demandait qu'à ruer et à se cabrer, mais les circonstances ne me laissaient guère le temps de l'apprivoiser. Je sautai en selle, je réussis à m'y maintenir et le cheval consentit à s'incliner devant mon autorité, comme s'il se rendait compte du caractère urgent de notre mission. Dès que le palefrenier eut lâché la bride, il partit comme une flèche en direction du Tibet. Le chauffeur, lui, devait rentrer à Chongqing, et il était assuré de faire un voyage rapide et confortable ; moi, hélas, perché sur de hautes selles de bois, j'allais poursuivre ma chevauchée, ne m'arrêtant au terme de longues étapes que pour changer de cheval, que je choisissais toujours parmi les plus frais : je n'avais pas de temps à perdre.
Je fais grâce aux lecteurs de mes difficultés et des épreuves que je dus surmonter pendant ma longue course solitaire. Il n'est pas nécessaire non plus de raconter ma traversée du Yangtsé ni ma progression jusqu'au Salween supérieur. Je galopai et je galopai. J'arrivai fourbu mais à temps. À la sortie d'un défilé de montagne, mes yeux se posèrent enfin sur les toits dorés du Potala ; en voyant les coupoles sous lesquelles reposaient les dépouilles mortelles des précédentes incarnations du Dalaï-Lama, je me demandai avec mélancolie combien de jours allaient se passer avant qu'une nouvelle coupole abritant un nouveau cadavre fût bâtie à côté des autres.
J'arrivai enfin au bord de la Rivière du Bonheur, dont le nom me parut alors bien ironique. Une fois passé de l'autre côté, j'étais arrivé à destination, et mon épuisante chevauchée n'avait pas été inutile puisque j'eus le temps d'assister à toutes les cérémonies et d'y prendre une part active. Cette période déjà triste fut encore assombrie par une rencontre désagréable. Il y avait à Lhassa un étranger qui estimait que tous les égards lui étaient dus, sans doute parce que nous n'étions que des ‘indigènes’. Aussi jouait-il au grand seigneur. C'est ainsi qu'il voulait toujours être placé au premier rang pour se faire voir de tout le monde. J'avais refusé de l'aider dans son petit manège, avec d'autant plus de fermeté qu'il avait eu le front d'essayer de nous acheter, un ami et moi, en nous offrant des bracelets-montres ! Ce fut assez pour le décider à me traiter en ennemi. Par la suite, il ne devait reculer devant aucun moyen, fût-il extrême, pour tenter de me nuire, à moi et aux miens. Mais cet incident n'a rien à voir avec mon récit si ce n'est qu'il me montra combien mes maîtres avaient eu raison de me mettre en garde contre la jalousie.
Pour nous tous, ces jours furent bien tristes ; et je n'ai aucunement l'intention de décrire le cérémonial funèbre qui fut alors observé. Qu'il me suffise de dire que le corps du Dalaï-Lama, embaumé selon un rite ancestral, fut placé dans la position assise, et face au midi ainsi que la tradition l'exigeait. Par la suite, il fut fréquemment constaté que sa tête se tournait en direction de l'est. Certains y virent un signe de l'au-delà, une sorte de mise en garde. Or, ce fut de l'est que les Chinois arrivèrent pour semer le désordre au Tibet. Il s'agissait donc bien d'un signe, d'un avertissement. Hélas, il ne fut pas écouté !
Je revins à la maison de mes parents. Le vieux Tzu était mort et la plupart des gens que j'avais connus avaient beaucoup changé. Que tout était donc devenu étrange dans cette maison ! Vraiment, je ne m'y sentais pas chez moi. Je n'étais qu'un visiteur, un étranger, un grand lama, un haut dignitaire du Temple revenu de Chine pour quelques jours. Mes parents me firent attendre. Quand enfin ils me reçurent, l'atmosphère était tendue et nous n'échangeâmes que des paroles gênées. Le fils de la maison était devenu un étranger. Pas un étranger ordinaire cependant, puisque mon père me conduisit dans ses appartements. Là, il retira notre Livre de Famille de sa cachette et me le présenta après l'avoir sorti avec précaution de son étui d'or. Sans dire un mot, j'y apposai ma signature pour la dernière fois. J'écrivis mon nom, mon rang, et mes titres de docteur-chirurgien. Après quoi, le Livre fut soigneusement enveloppé et replacé dans sa cachette. Ensemble, nous revînmes dans la pièce où ma mère et ma sœur étaient assises et je leur fis mes adieux. Dans la cour, je montai sur mon cheval que les palefreniers tenaient par la bride et je passai pour la dernière fois les grandes grilles de l'entrée. Mon cœur était lourd quand je pris la route de Lingkhor en direction de Menzekang, l'hôpital le plus important du Tibet. J'y avais travaillé et je voulais faire une visite de courtoisie à son directeur, un moine nommé Chinrobnobo, que je connaissais bien. C'était un aimable vieillard à l'énorme stature qui s'était révélé un excellent maître après ma sortie de l'école de médecine de la Montagne de Fer. Une fois dans son bureau, il me posa force questions sur la médecine chinoise.
— Les Chinois prétendent qu'ils ont été les premiers à pratiquer l'acupuncture et la moxibustion, lui dis-je, mais je sais qu'il n'en est rien. Des vieux documents en effet prouvent que ces deux thérapeutiques ont été introduites du Tibet en Chine, il y a très longtemps.
Son intérêt redoubla quand je lui appris que les Chinois, ainsi du reste que les Occidentaux, cherchaient à découvrir les raisons de leur indéniable efficacité. L'acupuncture consiste à introduire dans différentes parties du corps des aiguilles si fines que le patient ne ressent aucune douleur. Ces aiguilles ont pour effet de stimuler des réactions curatives. Si les pointes de radium, utilisées à notre époque, donnent d'excellents résultats, il ne faut cependant pas oublier que les Orientaux pratiquent l'acupuncture depuis des siècles avec beaucoup de succès. La moxibustion nous est également familière. Dans cette thérapeutique, l'extrémité d'un tube contenant certaines herbes est chauffée au rouge et approchée de la partie du corps à soigner. Grâce à la chaleur, les vertus curatives des herbes pénètrent directement dans les tissus et la guérison s'ensuit. Ces deux thérapeutiques ont donné de nombreuses preuves de leur efficacité bien qu'on n'ait jamais réussi à déterminer exactement le mécanisme de leur action.
J'allai jeter un coup d'œil sur les milliers de simples qui étaient gardés en réserve à l'entrepôt. Il y en avait plus de six mille espèces dont le plus grand nombre était inconnu en Chine et ailleurs, comme le tatura, par exemple, une racine d'arbre aux étonnantes propriétés anesthésiques. Administrée par un praticien compétent, elle permet de garder une personne sous anesthésie pendant douze heures d'affilée sans conséquences fâcheuses. Je me promenai dans l'hôpital où je ne trouvai rien à critiquer malgré les progrès réalisés en Chine et en Amérique. Vraiment, les vieux remèdes tibétains donnaient encore entière satisfaction.
Cette nuit-là, je couchai dans mon ancienne cellule et j'assistai à tous les offices comme au temps où j'étais écolier. Je me sentais reporté en arrière. Que de souvenirs me rappelait chacune de ces pierres ! Au petit jour, je montai au sommet de la Montagne de Fer pour avoir une bonne vue du Potala, du Parc au Serpent, et de Lhassa avec sa ceinture de pics neigeux. Je restai là un long moment, puis je retournai à l'école de médecine pour prendre congé et préparer mon sac de tsampa. Après quoi, je montai sur mon cheval et je descendis la colline avec pour tout bagage ma couverture et ma robe de rechange roulées au-devant de ma selle.
En bas du sentier, je pris la route et je traversais le village de Shö lorsque le soleil se cacha derrière un gros nuage noir. Une foule de pèlerins, venus des quatre coins du Tibet et aussi de pays plus lointains présenter leurs devoirs au Potala, se pressait sur la route. Des vendeurs d'horoscopes vantaient leurs marchandises à grands cris, et ceux qui débitaient des philtres et des amulettes faisaient des affaires d'or. Les dernières cérémonies funèbres avaient attiré sur la Route Sacrée force marchands, trafiquants, camelots et mendiants de tout acabit. Non loin de là, une caravane de yaks chargés de marchandises destinées aux marchés de Lhassa entrait par la Porte de l'Ouest. Je m'étais arrêté pour observer la scène quand je songeai que jamais plus je ne reverrais ces spectacles familiers. J'avais le cœur serré à l'idée de quitter mon pays.
— Bénissez-moi, Honorable Lama médecin, dit une voix.
Quand je me retournai, je reconnus un Briseur de corps, un de ceux qui m'avaient tant aidé à l'époque où sur les ordres du Dalaï-Lama, celui-là même dont je venais de voir la dépouille, j'étudiais sous leur direction. Quand on avait levé — en raison de la tâche qui m'avait été fixée — l'interdiction séculaire frappant la dissection, toutes facilités m'avaient été données en ce domaine et les conseils de cet homme m'avaient été particulièrement précieux. Je le bénis, tout heureux que quelqu'un appartenant à mon passé m'eût reconnu.
— Vous avez été pour moi un maître merveilleux, dis-je. J'ai plus appris avec vous qu'à l'école de médecine de Chongqing.
L'air ravi, il me tira la langue à la façon des serfs, puis reculant à petits pas, comme le veut la coutume, il se perdit dans la foule se pressant à la Porte de l'Ouest.
Pendant quelques moments encore, tenant mon cheval par la bride, je restai à regarder le Potala et la Montagne de Fer, et je me mis en route. Après avoir traversé le Kyi Chu, ou Fleuve Heureux, je rencontrai plusieurs parcs charmants, plantés d'une herbe très verte parce qu'abondamment arrosée. À douze mille huit cents pieds d'altitude (3 900 m) et entouré de cimes qui atteignaient six mille pieds (1 800 m), c'était un véritable paradis. Sur les montagnes étaient disséminées de nombreuses lamaseries grandes ou petites, et on apercevait également des ermitages solitaires, dangereusement perchés sur des pics inaccessibles. La route s'élevait graduellement vers les défilés de montagne. Mon cheval reposé, bien nourri et bien soigné, voulait forcer l'allure ; moi, j'avais envie de flâner. Je croisais sur mon chemin beaucoup de moines et de marchands ; certains me regardèrent avec curiosité, parce qu'en raison de ma hâte, je voyageais seul contre toute tradition. Mon père ne se serait jamais déplacé sans une suite nombreuse en rapport avec son rang, mais moi, j'étais de la génération moderne. Aussi les étrangers me jetaient-ils des regards intrigués, tandis que ceux que j'avais connus m'adressaient un salut amical. Enfin mon cheval — et moi ! — nous arrivâmes au sommet de la montée, à la hauteur du gigantesque chorten (sorte de monument à la forme symbolique — NdT) de pierres, le dernier endroit d'où Lhassa était visible. Sautant à terre, j'attachai ma monture, puis m'étant assis sur un rocher tout proche, je laissai longuement mon regard errer sur la vallée.
Dans le ciel qui était de ce bleu sombre qu'on ne voit qu'à de telles altitudes, flottaient paresseusement des nuages d'une blancheur de neige. Un corbeau curieux se laissa tomber près de moi et du bec se mit à explorer ma robe. Du coup, l'idée me vint d'ajouter ma pierre, comme l'exigeait la coutume, à l'immense pile de celles qu'avaient accumulées pendant des siècles les pèlerins désireux de marquer l'endroit d'où l'on pouvait regarder la Cité sainte pour la première ou la dernière fois.
Devant moi se dressait le Potala. Avec ses fenêtres aux lignes fuyantes vers le haut qui soulignaient l'inclinaison de ses puissantes murailles, il ressemblait à une bâtisse taillée en plein roc par les dieux. Mon Chakpori (monastère de Lhassa — NdT) s'élevait encore plus haut que le Potala sans toutefois le dominer. Un peu plus loin, j'apercevais les toits dorés du temple de Jo-Kang, vieux de treize cents ans, qu'entouraient des bâtiments administratifs. Au-delà s'étendaient le long ruban de la grand-route, le bosquet des saules, les marais, le Temple du Serpent, la magnifique tache colorée du Norbu Linga (célèbre parc de Lhassa — NdT), et enfin les jardins du Lama sur les bords du Kyi Chu. Les toits dorés du Potala resplendissaient sous les rayons d'un soleil éclatant, réfléchissant des rais d'une lumière rouge or, irisée de toutes les couleurs du spectre. C'était là, sous ces dômes, que reposaient les dépouilles mortelles des incarnations du Dalaï-Lama. Avec ses soixante-dix pieds de haut (21 m) — l'équivalent de trois étages — le monument funéraire du 13e Dalaï-Lama, pour lequel il avait fallu une tonne de l'or le plus pur, les dominait tous. À l'intérieur du sanctuaire, une véritable fortune faite d'ornements précieux, de joyaux, d'or et d'argent reposait près de la coque vide de Celui auquel elle avait appartenu. Et voilà que le Tibet était sans Dalaï-Lama, le dernier ayant quitté ce monde. Quant à celui qui Lui succéderait un jour, la Prophétie était formelle : il se mettrait au service de l'étranger, et deviendrait l'esclave des communistes.
Aux flancs de la vallée s'accrochaient les énormes lamaseries de Drepung, Sera et Ganden et, à demi cachée par un bosquet d'arbres, miroitait la blancheur dorée de Nechung, demeure de l'Oracle de Lhassa et de tout le Tibet. De vrai, Drepung (Drepung veut dire ‘Montagne de riz’ — NdT) ressemblait à un gros tas de riz dont la blancheur recouvrait le flanc de la montagne. Je contemplai Sera connue sous le nom de la Barrière aux Roses Sauvages et Ganden, la Joyeuse, évoquant les heures passées entre leurs murs et leurs enceintes fortifiées. Je regardai aussi les innombrables petites lamaseries nichées un peu partout, sur le flanc d'une montagne ou dans un bosquet d'arbres. Mon regard se posa également sur les ermitages, points minuscules perdus dans des endroits presque inaccessibles ; mes pensées allèrent vers les hommes qui y vivaient, cloîtrés pour toute leur vie peut-être, dans l'obscurité, sans le secours de la moindre lumière, ravitaillés une seule fois par jour, coupés à jamais de tout contact avec le monde physique et dont les esprits pourtant, grâce à un entraînement spécial, étaient capables de visiter le monde par la voie astrale. Des yeux, je suivis le cours de la Rivière du Bonheur qui serpentait entre les marécages, tantôt dissimulée par des bois et tantôt réapparaissant dans les échappées de terrain. Je repérai la vaste propriété de mes parents et leur maison dans laquelle je n'avais jamais trouvé un foyer. Sur la route se pressait la foule des pèlerins faisant la tournée des lieux saints. D'une lointaine lamaserie me parvint, porté par une douce brise, le son des gongs d'un temple et l'appel déchirant des trompettes. Ma gorge se serra et je ressentis un vif picotement à la racine du nez. C'en était trop pour moi. Il ne me restait plus qu'à tourner le dos à Lhassa, sauter en selle et partir pour l'inconnu.
À mesure que j'avançais, le paysage devenait de plus en plus sauvage. Aux riches pâturages, aux terres sablonneuses et aux petites fermes succédèrent des pitons rocheux et des gorges sauvages entre lesquelles coulaient des torrents impétueux qui remplissaient l'air d'un vacarme incessant et dont les embruns me trempaient jusqu'aux os. Je poursuivis mon voyage, passant encore mes nuits dans des lamaseries où cette fois j'étais doublement le bienvenu ; j'apportais en effet aux moines des nouvelles fraîches concernant les dernières cérémonies funèbres de Lhassa auxquelles j'avais officiellement participé. Tout le monde était d'accord : nous vivions la fin d'une époque et notre pays allait connaître des jours sombres. À chaque étape, je trouvai un ravitaillement abondant et des chevaux frais. Après quelques jours de voyage, j'étais de retour à Ya-an, où, à ma grande joie, je trouvai le chauffeur en train de m'attendre. Il m'avait été aimablement envoyé par le vieil Abbé de Chongqing qui avait appris que je m'étais mis en route pour le rejoindre. J'en fus fort content car j'étais sale et las, et de plus la selle m'avait écorché. C'est dire combien je fus heureux de revoir cette grosse voiture étincelante, ce produit d'une autre civilisation grâce auquel j'allais faire en quelques heures un trajet qui, autrement, m'eût demandé plusieurs jours. En m'y asseyant, je me félicitais d'être l'ami de l'Abbé de la lamaserie de Chongqing. N'avait-il pas pensé qu'il me serait agréable de faire un voyage confortable après cette pénible randonnée à cheval ? Peu après, nous roulions à vive allure en direction de Chengdu où nous passâmes la nuit, puisque rien ne nous obligeait à arriver à Chongqing aux premières heures du jour. Le lendemain matin, après avoir visité la ville et fait quelques achats, nous reprenions la route.
Vêtu seulement d'une culotte bleue, le jeune garçon à la figure rougeaude était encore à sa charrue que tirait un buffle massif. Ils pataugeaient dans la terre boueuse qu'il fallait retourner avant d'y planter du riz. Le chauffeur força l'allure ; au-dessus de nos têtes, des oiseaux s'appelaient entre eux et jouaient dans les airs, grisés du seul bonheur de vivre. Bientôt, nous approchions des faubourgs de Chongqing par une route bordée d'eucalyptus argentés, de tilleuls et de sapins verts. Je descendis de voiture près d'une petite route qui me permit de rejoindre le sentier menant à la lamaserie. En passant devant la clairière où se trouvait l'arbre couché sur le sol dans un enchevêtrement de branchages, je songeai aux événements si mémorables qui avaient suivi ma conversation avec mon Guide, le Lama Mingyar Dondup. Je m'arrêtai pour méditer quelques instants, puis reprenant mes affaires, je me remis en marche vers la lamaserie.
Le lendemain matin, je me rendis à Chongqing où la chaleur était si forte qu'elle était comme une chose vivante. On suffoquait, on étouffait ; les coolies des pousse-pousse et leurs clients paraissaient avachis, terrassés par la température. Pour moi, qui venais de respirer l'air frais du Tibet, j'avais l'impression d'être à moitié moribond, mais en tant que lama, je me devais de me tenir droit pour donner l'exemple. Dans la rue aux Sept-Étoiles, je tombai sur mon ami Huang en train de faire quelques emplettes et je le saluai avec joie car j'avais pour lui une amitié sincère.
— Qui sont tous ces gens ? lui demandai-je.
— Ma foi, Lobsang, répondit-il, ce sont des réfugiés de Shanghaï. Les Japonais font tant de difficultés là-bas, que les commerçants ferment leurs boutiques et viennent s'établir ici. Je me suis laissé dire que les universités songent à suivre leur exemple, ajouta-t-il. À propos, j'ai un message pour vous. Le général Feng Yu-hsiang (il est maréchal à l'heure qu'il est) désire vous voir. Il voudrait que vous lui rendiez visite dès votre retour.
— Entendu, répondis-je. Vous ne voudriez pas m'accompagner par hasard ?
Il accepta. Après avoir terminé tranquillement nos achats — il faisait vraiment trop chaud pour se presser — nous rentrâmes à la lamaserie. Une heure ou deux plus tard, nous arrivions au temple près duquel le général habitait. Quand je le vis, il me parla longuement des Japonais et des troubles qu'ils fomentaient à Shanghaï. Il me raconta comment la police, recrutée par la Concession Internationale, était composée de bandits et de voleurs qui se souciaient fort peu de rétablir l'ordre.
— La guerre n'est pas loin, Rampa, déclara-t-il, je vous le dis. Nous aurons un grand besoin de médecins et de médecins qui sachent piloter un avion. Il nous en faut à tout prix.
Il m'offrit donc de me nommer officier de l'armée chinoise et me laissa entendre que je pourrais voler aussi souvent que je le voudrais.
Le général était un colosse dépassant largement six pieds (1 m 83), à la tête énorme et aux larges épaules. Après avoir pris part à de nombreuses campagnes, il avait pensé, avant les difficultés avec les Japonais, que sa carrière militaire était terminée. C'était aussi un poète qui n'avait élu domicile près du temple que pour pouvoir contempler la lune à loisir. J'éprouvais une réelle sympathie pour cet homme intelligent avec qui il était facile de s'entendre. C'est par lui que j'appris que les Japonais, en quête d'un prétexte pour envahir la Chine, s'étaient livrés à une provocation. Un moine japonais ayant été tué accidentellement, les autorités de son pays avaient exigé du maire de Shanghaï l'arrêt du boycottage de leurs produits, la dissolution de l'Association de la libération nationale, l'arrestation des responsables du boycottage et des compensations pour la mort du moine. Le maire, soucieux de maintenir la paix et cédant devant la supériorité écrasante des Japonais, avait accepté les termes de cet ultimatum le 28 janvier 1932. Mais à 10 h 30 précises, le soir même du jour où il avait cédé à l'ultimatum, les fusiliers marins japonais occupaient certaines rues de la Concession internationale, ouvrant ainsi la voie à la guerre mondiale. Tout cela, je l'ignorais, puisque j'avais été absent.
Pendant que nous parlions, un moine vêtu d'une robe gris-noir entra pour nous annoncer la visite de l'Abbé Suprême T'ai Shu. Lors de notre entrevue, je lui donnai les dernières nouvelles du Tibet et je lui racontai les funérailles de mon bien-aimé Dalaï-Lama. De son côté, il me fit part des craintes qu'inspirait à un grand nombre de ses amis, ainsi qu'à lui-même, l'avenir de la Chine.
— Ce n'est pas l'issue du conflit que nous redoutons, dit-il, mais les destructions, les pertes en vies humaines et les souffrances qui en résulteront immanquablement.
Tous deux me pressèrent vivement d'accepter un grade dans l'armée chinoise et de me mettre, en tant que médecin, à leur disposition. C'est à ce moment que la bombe éclata.
— Il faut que vous alliez à Shanghaï, me dit le général. On y a grand besoin de vos services. Votre ami, Po Ku, pourrait vous accompagner. Tout est déjà prêt pour votre départ, mais c'est à vous et à lui d'en décider.
— Shanghaï ! répondis-je. C'est une ville terrible qui ne m'attire guère. Néanmoins, je sais que je dois y aller ; aussi, j'accepte.
Notre conversation se poursuivit longtemps. Quand, à la tombée du crépuscule, les ombres du soir nous entourèrent, il fallut nous séparer. Je me levai et sortis dans la cour où un palmier solitaire, dont les feuilles déjà roussies tombaient languissamment, dressait sa silhouette desséchée et rongée par la chaleur. Huang, assis immobile, m'attendait patiemment, inquiet tout de même de la durée de l'entretien. Quand il me vit, il se leva et en silence nous prîmes la direction de notre lamaserie, en passant par le petit pont de pierre jeté au-dessus d'un torrent impétueux.
À l'entrée de notre sentier se trouvait un énorme rocher que nous escaladâmes ; on y avait une excellente vue des fleuves qui étaient alors le siège d'une activité intense. Des petits bateaux remontaient leur cours en soufflant des langues de fumée que le vent, en les brassant aussitôt, transformait en longues bannières noires. Le trafic fluvial était incontestablement plus important qu'avant mon départ pour le Tibet. Chaque jour voyait un afflux plus grand de réfugiés, des gens qui pensaient à l'avenir et craignaient les terribles conséquences d'une invasion de la Chine. La ville déjà surpeuplée ne cessait de voir sa population s'accroître.
Au-dessus de nos têtes, de gros nuages s'accumulèrent dans le ciel de la nuit. Un orage allait éclater qui, tombant des montagnes sur la ville, l'inonderait sous une pluie torrentielle dans un vacarme assourdissant multiplié par l'écho. Se pouvait-il que cet orage fût un symbole des malheurs prêts à s'abattre sur la Chine ? L'air était si chargé d'électricité et d'angoisse qu'on pouvait le penser. Je crois me souvenir que tous deux, nous poussâmes en même temps un gros soupir à l'idée du sort réservé à ce pays qui nous était si cher. Cependant, la nuit était tombée et déjà de grosses gouttes annonciatrices de l'orage transperçaient nos vêtements. Faisant demi-tour, nous prîmes le chemin du temple ; l'Abbé nous y attendait car il était fort curieux de savoir ce qui s'était passé. Après une discussion cordiale consacrée à mes projets, il approuva ma décision et j'en fus fort heureux.
Nous parlâmes sans arrêt jusqu'à une heure avancée de la nuit dans le grondement assourdissant du tonnerre et le crépitement de la pluie sur le toit du temple. Quand finalement nous nous couchâmes, nous nous endormîmes aussitôt. Aux premières lueurs de l'aube, tout de suite après le premier office, nous fîmes nos préparatifs : devant moi s'ouvrait une autre phase de ma vie, une phase difficile et pénible.
Chapitre Six
Voyance
SHANGHAÏ ! J'étais sans illusions, je savais que j'y mènerais une existence vraiment très difficile. Néanmoins, je devais m'y rendre puisque le destin en avait ainsi décidé. Aussi Po Ku et moi fîmes nos préparatifs et, un peu plus tard dans la matinée, nous descendions la rue aux Marches jusqu'aux docks, et montions à bord du bateau qui allait descendre le fleuve jusqu'à Shanghaï.
Dans la cabine que nous partagions, j'évoquai le passé, étendu sur ma couchette. Je me souvins du jour où j'avais entendu parler de Shanghaï pour la première fois. C'était à l'époque où mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'initiait aux techniques les plus avancées de la voyance. Comme cette expérience peut intéresser mes lecteurs, et même leur être utile, je vais la raconter ici.
Cela s'était passé quelques années auparavant, alors que j'étudiais dans une des grandes lamaseries de Lhassa. J'étais dans une salle de classe avec d'autres étudiants qui, comme moi, attendaient impatiemment la fin du cours, un cours particulièrement ennuyeux car le professeur était une des nos pires ‘barbes’, et il était vraiment difficile de l'écouter sans céder au sommeil. Dehors, il faisait un chaud soleil et le ciel était traversé par de légers nuages qui passaient très haut. Tout nous incitait à sortir dans la chaleur et le soleil, loin des salles poussiéreuses et du ronronnement insipide de ce professeur. Soudain, il se produisit un remue-ménage : quelqu'un était entré dans la salle. Comme nous tournions le dos à notre maître, nous ne pouvions voir qui c'était et il n'était pas question de nous retourner car c'est LUI qui nous aurait vus ! Nous entendîmes un bruit de papier froissé, le professeur grommeler ‘qu'on dérangeait son cours’, puis un coup sec qui nous fit sursauter de frayeur : sa canne venait de s'abattre sur son bureau.
— Lobsang Rampa, viens ici, dit-il.
Je me levai plein d'appréhension, me retournai et fis les trois révérences d'usage. Qu'allait-on me reprocher ? L'Abbé m'aurait-il surpris à laisser tomber des cailloux sur les lamas en visite ? Quelqu'un m'avait-il vu quand j'avais ‘goûté’ ces bonnes noix confites ? Avais-je... mais la voix du maître me rassura vite :
— Lobsang Rampa, l'Honorable Lama Supérieur, Mingyar Dondup, ton Guide, te demande d'aller le retrouver. Va et sois plus attentif à ses paroles que tu ne l'es aux miennes !
Je sortis précipitamment.
Après avoir parcouru les couloirs et monté l'escalier à toute allure, je tournai à droite et pénétrai dans l'enceinte des lamas. "Marchons doucement par ici, pensai-je, gare à tous les vieux gâteux... Septième porte à gauche, bon, nous y sommes." Au moment précis où j'allais frapper, mon Guide me cria d'entrer.
— Tes dons de double vue ne te font jamais défaut quand il s'agit de manger, me dit le Lama Mingyar Dondup. J'ai justement du thé et des noix confites, tu arrives à temps.
Il ne m'attendait pas si tôt mais son accueil fut des plus chaleureux.
— J'ai décidé de t'enseigner l'art de lire dans les boules de cristal, en utilisant tous les procédés, me dit-il pendant que nous nous restaurions. Il faut que tu en aies une connaissance complète.
Après le thé, il me conduisit au grenier. On y gardait des instruments de toutes sortes, des planchettes, des tarots, des miroirs noirs, et un incroyable assortiment d'appareils. Tandis que nous les passions en revue, il m'expliqua leurs usages. Puis, se tournant vers moi, il me dit :
— Prends une boule de cristal avec laquelle tu te sentes en harmonie. Examine-les toutes et fais ton choix.
J'avais déjà remarqué une boule de cristal de roche véritable, une magnifique boule sans défaut et si grosse qu'il fallait les deux mains pour la tenir.
— Voilà celle que je veux, dis-je en la soulevant.
Mon Guide se mit à rire.
— Tu as naturellement choisi la plus ancienne et la plus précieuse. Si tu peux t'en servir, elle est à toi.
Cette boule, que je possède toujours, avait été trouvée dans un des profonds tunnels creusés sous le Potala. En ces jours d'obscurantisme, on l'avait baptisée ‘Boule magique’ et remise aux lamas médecins de la Colline de Fer car on pensait qu'elle pourrait leur être utile.
Un peu plus loin dans ce chapitre, je reviendrai sur les boules de verre, les miroirs noirs et les ballons d'eau ; pour l'instant, il intéressera peut-être le lecteur de savoir comment nous étions initiés à l'emploi du cristal et comment l'on nous entraînait à ne faire qu'un avec lui.
Il est évident que l'acuité visuelle est à son maximum lorsqu'on est en bonne santé et que l'on jouit d'un parfait équilibre, physique aussi bien que mental. Pour le Troisième Œil, il en va de même. Aussi nous faut-il être en parfaite condition avant d'essayer d'utiliser un de ces appareils. Ayant choisi ma boule de cristal, je commençai à l'examiner en la tenant entre les mains. Dans sa lourde sphère, se réfléchissait l'image renversée de la fenêtre, et d'un oiseau perché sur le rebord extérieur. En regardant de plus près, j'aperçus vaguement la silhouette du Lama Mingyar Dondup et — mais oui — ma propre image aussi.
— Tu regardes la boule, Lobsang, et ce n'est pas ainsi qu'on s'en sert. Couvre-la en attendant que je te montre comment t'y prendre.
Le lendemain matin, il me fallut, à mon premier repas, avaler des décoctions de plantes destinées à me purifier le sang, m'éclaircir l'esprit ou à me fortifier l'organisme. Je suivis ce régime, matin et soir, pendant deux semaines. Tous les après-midi, je me reposais pendant une heure et demie, les yeux et le haut de la tête couverts d'un épais linge noir. Pendant cette période, je dus m'astreindre à des exercices respiratoires spéciaux, pratiqués selon certains rythmes. Enfin, je devais apporter un soin scrupuleux à ma toilette.
Lorsque les semaines furent écoulées, je retournai auprès du Lama Mingyar Dondup.
— Allons dans cette pièce tranquille qui se trouve sur le toit, me dit-il. Tant que tu n'auras pas acquis une expérience suffisante de la voyance, un calme absolu te sera nécessaire.
Après avoir monté l'escalier, nous arrivâmes sur le toit plat. Sur un des côtés s'élevait la résidence où le Dalaï-Lama accordait ses audiences lorsqu'il venait au Chakpori pour la bénédiction annuelle des moines. C'était notre tour de nous en servir et c'était pour moi un insigne honneur car personne, en dehors de l'Abbé et du Lama Mingyar Dondup, ne pouvait y entrer. Une fois à l'intérieur, nous nous assîmes sur des coussins posés à même le sol. Derrière nous, dans l'embrasure d'une fenêtre, apparaissaient les lointaines montagnes, gardiennes vigilantes de notre paisible vallée. Le Potala était également visible, mais nous le connaissions trop bien pour qu'il retînt notre attention. Ce que je voulais voir, c'est ce que contenait la boule de cristal.
— Viens par ici, Lobsang, m'ordonna mon Guide. Regarde le cristal et préviens-moi quand tous les reflets auront disparu. Il faut éliminer toutes les taches de lumière qui n'ont aucun intérêt.
C'est là en effet un point capital : il est essentiel de supprimer toute lumière pouvant provoquer des reflets, car ceux-ci ne font que détourner l'attention. Notre méthode consistait à nous asseoir, le dos tourné à une fenêtre orientée au nord et d'obtenir une sorte de pénombre en la voilant d'une tenture suffisamment épaisse. Une fois les rideaux tirés, la boule de cristal que je tenais me parut soudain morte, inerte. Aucun reflet n'en troublait plus la surface.
Mon Guide prit place à mes côtés.
— Essuie le cristal avec ce chiffon humide, sèche-le, puis prends-le à l'aide de cette étoffe noire, en évitant surtout de le toucher avec les mains !
Suivant ses instructions à la lettre, j'essuyai soigneusement la boule, la fis sécher et la pris avec le linge noir plié en quatre. Je croisai ensuite les mains, les paumes vers le haut, de sorte que la boule reposait sur la paume de ma main gauche.
— Maintenant regarde DANS la boule. Il ne s'agit pas de la regarder, mais de regarder À L'INTÉRIEUR. Imagine son centre et laisse ton regard se vider. N'essaye pas de voir quelque chose ; fais simplement le vide dans ton esprit.
Pour ce qui était d'avoir l'esprit vide, rien ne m'était plus facile ; certains de mes professeurs pensaient même qu'il l'était tout le temps !
Je contemplai le cristal, en laissant mes pensées vagabonder. Soudain, la boule sembla grossir entre mes mains et je crus que j'allais tomber dedans. Je sursautai et l'illusion disparut. Je ne serrais plus entre mes paumes qu'une simple boule de cristal.
— Lobsang ! POURQUOI as-tu oublié tout ce que je t'ai dit ? Tu allais enfin ‘voir’ et ton sursaut de surprise a rompu le fil. Tu ne verras rien aujourd'hui.
Il faut regarder dans le cristal, en se concentrant sur un point quelconque à l'intérieur. À ce moment-là, on éprouve une sensation étrange, comme si l'on était sur le seuil d'un autre monde. À ce point de l'expérience, le moindre mouvement inspiré par la peur ou la surprise suffit à la faire échouer. Dans ce cas, si l'on n'est encore qu'un novice, il ne reste plus qu'à mettre la boule de côté, sans essayer de ‘voir’ avant d'avoir pris une bonne nuit de repos.
Le jour suivant, je fis une nouvelle tentative. Je m'assis comme la veille, le dos à la fenêtre, en prenant bien soin d'éliminer tout reflet de lumière. Normalement, j'aurais dû prendre la pose de la méditation, en lotus, mais une blessure à la jambe me rendait cette posture assez incommode. Or, il est essentiel d'être assis de la façon la plus confortable. Mieux vaut ne pas se tenir de façon orthodoxe et VOIR qu'adopter une position classique et ne rien voir. "Asseyez-vous comme vous voulez pourvu que vous soyez à l'aise", telle était notre règle, car toute gêne distrait l'attention.
Je plongeai mon regard dans la boule de cristal. Le Lama Mingyar Dondup était assis à côté de moi, très droit et si immobile qu'on eût dit une statue de pierre. Qu'allais-je voir ? Telle était mon unique pensée. Tout se passerait-il comme le jour où j'avais vu une Aura pour la première fois ? Le cristal était terne, sans vie. "Je ne verrai jamais rien là-dedans", me dis-je. C'était le soir, de sorte qu'aucun jeu de lumière ne pouvait créer d'ombres mouvantes, de même était-il impossible qu'un nuage se mît à jouer à cache-cache avec le soleil. Ni ombres ni rayons lumineux. Une semi-obscurité régnait dans la pièce et le linge noir placé entre mes mains et la boule m'empêchait d'apercevoir le moindre reflet sur sa surface. Mais c'est vers l'intérieur que je devais diriger mes regards.
Tout à coup, quelque chose bougea dans le centre du cristal où apparut un gros flocon qui donna naissance à des volutes de fumée blanche. On eût dit qu'une tornade faisait rage à l'intérieur, une tornade silencieuse. La fumée, tantôt plus épaisse et tantôt moins, finit pas recouvrir tout le globe d'une sorte de nuage, à croire que quelqu'un avait tiré un rideau pour m'empêcher de voir. Mentalement, je le pénétrai, m'efforçant d'aider mon esprit à traverser cet obstacle. La boule parut s'enfler et j'éprouvai l'horrible sensation de tomber la tête la première dans un vide sans fond. À cet instant précis, j'entendis éclater une sonnerie de trompette ; le rideau blanc se décomposa en flocons de neige qui se mirent à fondre comme sous l'effet du soleil de midi.
— Tu étais près de toucher au but, Lobsang, vraiment très près, me dit mon Guide.
— Oui, répondis-je, j'aurais vu quelque chose sans cette sonnerie de trompette. Elle m'a complètement dérouté.
— Une sonnerie de trompette ?... Tiens, tiens, tu es allé aussi loin ? C'est ton subconscient qui essayait de t'avertir que la voyance et la divination par les boules de cristal ne sont réservées qu'à un très petit nombre de privilégiés. Demain, nous irons plus loin.
Le lendemain, en fin d'après-midi, je m'assis pour la troisième fois auprès de mon Guide. De nouveau, il me rappela les règles. Ce soir-là, je fus plus heureux. Tenant la boule avec douceur, je me concentrai sur un point invisible à l'intérieur. Le tourbillon de fumée surgit presque instantanément et forma rapidement un rideau. Mon esprit s'efforça de le franchir. Je me répétai : "Je le traverse, je le traverse MAINTENANT !" J'éprouvai une fois encore cette affreuse sensation de chute, mais je m'y étais préparé. Je basculai lourdement d'une hauteur vertigineuse, piquant droit vers ce monde enveloppé de fumée qui grandissait avec une rapidité incroyable. Sans mon entraînement sévère, je n'aurais pu me retenir de hurler au moment où j'approchai à une vitesse folle de la surface blanche... que je traversai, indemne.
À l'intérieur, le soleil brillait. Je regardai autour de moi, ébahi. Il fallait que je sois mort pour me trouver dans un lieu aussi totalement inconnu... Quel endroit étrange ! De l'eau, de l'eau sombre s'étendait devant moi à perte de vue. Jamais je n'aurais cru qu'il pût tant y en avoir. À quelque distance de là, un monstre énorme, un poisson terrifiant, fendait vigoureusement la surface de l'eau. Il portait au milieu du corps un tuyau noir qui crachait vers le ciel une espèce de fumée que le vent rabattait. À ma grande stupéfaction, j'aperçus, marchant sur le dos du ‘poisson’, ce qui me parut être de minuscules personnages ! C'en était trop. Je me retournai, prêt à prendre la fuite... mais je restai cloué sur place. Cette fois, c'en était vraiment trop : de grandes maisons de pierre, hautes de plusieurs étages, me barraient le passage. À ce moment précis, un Chinois tirant un engin à deux roues me fila sous le nez ; ce devait être un porteur, car une femme était juchée sur la ‘chose à roues’. "Une infirme sans doute, pensais-je, qui serait intransportable autrement." Un homme se dirigeait vers moi, un lama tibétain. Je retins mon souffle, car il ressemblait à s'y méprendre au Lama Mingyar Dondup à l'époque où il était beaucoup plus jeune. Il marcha droit vers moi, passa à travers moi et... du coup, je fis un bond ! "Oh ! dis-je en gémissant, je suis aveugle." Il faisait noir, je n'y voyais rien.
— Tout va bien, Lobsang, tu fais des progrès, dit mon Guide. Attends, je vais ouvrir les rideaux.
La pâle lumière du soir envahit la pièce.
— Tu es certainement doué de très grands pouvoirs de voyance, reprit-il, il suffira de les guider. Par mégarde, j'ai touché le cristal et j'ai compris, d'après tes exclamations, que tu avais une vision de ce qui m'est arrivé, il y a fort longtemps, lorsque je me suis rendu à Shanghaï pour la première fois et que j'ai manqué de m'évanouir à la vue d'un bateau à vapeur et d'un pousse-pousse. C'est très bien.
J'étais encore en transe, toujours plongé dans le passé. Que tout était donc étrange et terrible à l'extérieur du Tibet ! Des poissons apprivoisés qui vomissaient de la fumée et sur lesquels on pouvait se promener ; des hommes qui traînaient des femmes sur des roues... j'avais peur d'y penser, et je frémissais à l'idée qu'un jour, il me faudrait à mon tour pénétrer dans ce monde bizarre.
— Maintenant, il te faut plonger la boule dans l'eau pour effacer toute trace de la scène que tu viens de voir. Trempe-la, laisse-la reposer sur un linge au fond du bol, puis reprends-la à l'aide d'un autre linge. Ne la touche pas.
C'est là, en effet, une règle importante qu'il faut observer lorsque l'on se sert d'une boule de cristal. Après chaque séance, il faut toujours la démagnétiser, car elle est rendue magnétique par la personne qui la tient tout comme un morceau de fer le devient au contact d'un aimant. Il suffit en général de donner quelques coups sur le morceau de fer pour lui faire perdre son aimantation ; une boule de cristal, elle, doit être plongée dans l'eau, faute de quoi les résultats deviendraient de plus en plus difficiles à interpréter. Les ‘émanations auriques’ qui se succèdent, s'accumulent et finissent par fausser complètement la lecture.
Une boule de cristal ne doit être maniée que par son propriétaire, sauf pour la ‘magnétiser’ en vue d'une lecture. Plus elle passe par des mains étrangères et plus sa sensibilité diminue. On nous enseignait qu'après avoir effectué un certain nombre de lectures au cours de la journée, il était bon de la garder à ses côtés pendant la nuit de façon à la magnétiser personnellement. On pourrait tout aussi bien obtenir un résultat similaire en la portant sur soi, mais on aurait bonne mine à se promener avec une boule de cristal !
Entre les séances de voyance, le cristal doit être recouvert d'une étoffe noire. Il ne doit JAMAIS être exposé aux rayons de soleil sous peine d'être rendu impropre aux usages ésotériques. De même ne faut-il jamais le laisser toucher par des gens qui ne sont que des amateurs. À cela, il y a une raison : un amateur de sensation ne s'intéresse pas vraiment à la voyance, il ne cherche que des distractions vulgaires ; à son contact, l'Aura du cristal s'altérerait. C'est un peu comme si on laissait un enfant jouer avec un appareil photographique ou une montre de prix pour lui permettre de satisfaire une vaine curiosité.
La plupart des gens pourraient se servir d'un cristal s'ils se donnaient la peine de chercher le modèle qui leur convient. Achètent-ils n'importe quelle paire de lunettes ? Or le choix d'une boule de cristal est tout aussi important. Certains ont une meilleure perception avec le cristal de roche, d'autres avec le verre ; mais le cristal de roche est le plus puissant des deux. Voici, en quelques mots, l'histoire du mien, telle qu'elle est consignée au Chakpori.
Il y a des millions d'années, les volcans se mirent à vomir des flammes et de la lave. Au plus profond de la Terre, différentes couches de sable furent brassées par les tremblements de terre et en quelque sorte vitrifiées par la chaleur volcanique. De nouvelles éruptions firent éclater ces formations de verre en cristaux qui se répandirent sur le flanc des montagnes et furent en grande partie recouverts de lave solidifiée.
Plus tard, des éboulements de rochers mirent à nu certains de ces cristaux, véritablement ‘de roche’. À l'aube de la vie humaine, les prêtres possédaient des pouvoirs occultes, ils pouvaient prédire l'avenir et connaître l'histoire d'un objet par psychométrie. Un de ces prêtres donc, ayant touché ce cristal, dut éprouver une impression assez forte puisqu'il décida de l'emporter chez lui, où, selon toute vraisemblance, un fragment particulièrement clair lui parut propice à la voyance. Aussi, aidé des autres, le tailla-t-il laborieusement pour lui donner la forme la plus commode, celle d'une sphère. Pendant des siècles et des siècles, des générations et des générations de prêtres se transmirent cette masse dure qu'ils avaient la mission de polir. Lentement la sphère devint de plus en plus parfaite et de plus en plus transparente. Il fut un temps où on l'adora comme l'Œil de Dieu. Pendant les Siècles de Lumière, elle fut considérée à juste titre comme un instrument permettant de sonder la Conscience Cosmique. Elle avait alors près de quatre pouces (10 cm) de diamètre et était aussi limpide que l'eau. Par la suite, elle devait être placée dans une petite cassette de pierre qui fut cachée dans un tunnel creusé sous le Potala.
Bien des siècles après, des moines explorateurs la découvrirent et déchiffrèrent l'inscription portée sur la cassette. "Ici se trouve la Fenêtre de l'Avenir, y lisait-on, le cristal qui permet à ceux qui en sont dignes de voir le passé et de connaître l'avenir. Le Grand Prêtre du Temple de la Médecine en avait la garde." C'est pour cette raison que le cristal fut porté au Chakpori, notre Temple de la Médecine, et mis de côté en attendant que vienne celui qui saurait l'utiliser. Cette personne, ce fut moi, et pour moi, il s'anima.
Il est rare de trouver des morceaux de cristal de roche d'une taille pareille, et encore plus rare qu'ils soient sans défaut. Tout le monde n'a pas le pouvoir de s'en servir car leur puissance risque d'être trop grande et de vous dominer. Il existe aussi des boules de verre grâce auxquelles un débutant peut acquérir l'expérience nécessaire. La taille n'a PAS la moindre importance : de trois à quatre pouces (7,6 à 10 cm) peuvent être considérés comme une bonne moyenne. Certains moines se servent d'un petit éclat de cristal enchâssé dans une grosse bague. Le principal est que le cristal soit sans défaut ou, du moins, que les défauts soient assez légers pour n'être pas visibles sous une lumière tamisée. Les boules de petite taille, qu'elles soient de cristal ou de verre, présentent l'avantage d'être légères ; et pour qui doit les tenir dans la main, cet avantage n'est pas négligeable.
À ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'une boule de cristal quelle qu'elle soit, je conseille de faire passer une annonce dans une revue de ‘métapsychisme’. Celles qui sont vendues dans certaines boutiques sont plutôt pour les prestidigitateurs et les illusionnistes. En général, elles ont des taches que l'on n'aperçoit qu'une fois rentré chez soi, l'acquisition faite. Il vaut donc mieux se faire envoyer l'objet pour l'essayer. Aussitôt déballé, lavez-le à l'eau courante. Séchez-le soigneusement et examinez-le en le tenant dans une étoffe noire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en le lavant, vous ferez disparaître toutes les empreintes que vous pourriez prendre pour des défauts, et qu'en le tenant ainsi, VOS propres empreintes ne risquent pas de vous induire en erreur.
Ne croyez pas qu'il vous suffira de vous asseoir, et de scruter le cristal pour ‘voir des images’, et ne mettez pas vos échecs sur son compte car il n'est après tout qu'un instrument. Vous en prendriez-vous à une longue-vue si vous n'obteniez que des images minuscules pour avoir placé votre œil au mauvais bout ?
Il existe des gens qui sont incapables d'utiliser une boule de cristal. Ceux-là devraient essayer un ‘miroir noir’, avant de s'avouer vaincus. Il est facile de s'en fabriquer un à peu de frais en achetant un gros verre de lampe dans un magasin d'accessoires automobiles. Le verre doit être concave, bien poli et complètement lisse. Les phares d'autos qui sont striés ne conviennent donc pas. En possession du verre idoine, vous placez sa face extérieure au-dessus de la flamme d'une bougie et vous la déplacez de façon à obtenir une couche uniforme de suie sur toute la face extérieure. Cette couche peut ensuite être fixée à l'aide d'une laque cellulosique analogue à celle qu'on met sur le cuivre pour qu'il ne devienne pas terne.
Une fois le miroir noir prêt, procédez comme avec une boule de cristal. Nous donnerons un peu plus loin dans ce chapitre quelques conseils pouvant s'appliquer à n'importe quel genre de ‘cristal’. Dans le cas du miroir noir, il faut regarder la surface INTERNE, en évitant soigneusement tous les reflets.
Il existe un autre genre de miroir noir que nous appelons le ‘null’ et qui est exactement le même que le précédent, sauf que la suie est à l'INTÉRIEUR, sur la face concave. Le gros inconvénient est qu'il est impossible de la ‘fixer’, étant donné que cela créerait une surface brillante. Ce type de miroir est à recommander à ceux dont l'esprit est facilement distrait par les reflets.
Certaines personnes utilisent un bol d'eau pour leurs expériences. Celui-ci doit être de couleur claire, sans le moindre motif décoratif. S'il est placé au-dessus d'un tissu noir, on peut s'en servir comme d'un cristal de verre. Au Tibet, il existe un lac dont la situation est telle que ses eaux tranquilles deviennent parfois complètement invisibles. Il s'agit d'un lac célèbre que les Oracles d'État consultent pour leurs prédictions les plus importantes. Ce lac, que nous appelons Chö-kor Gyal-ki Nam-tso (le Divin Lac de la Roue Triomphante des Religions), est situé à Tak-po, à une centaine de milles (160 km) de Lhassa, dans une région montagneuse, au milieu d'un massif de pics élevés. Son eau est habituellement d'un bleu vif bien que, parfois vue sous un angle favorable, cette masse bleue fasse place à un tourbillon blanchâtre, à croire qu'elle est mélangée avec du blanc de chaux. En tourbillonnant, l'eau forme une mer d'écume, puis tout à coup un trou noir se creuse au milieu du lac tandis que s'élèvent, juste au-dessus, d'épaisses nuées blanches. C'est entre ce trou et ces nuées qu'il est possible de ‘voir’ l'avenir.
Le Dalaï-Lama visite ce lieu une fois au moins dans Sa vie. Logé dans un pavillon proche du lac, Il observe la surface des eaux et y lit les événements importants qui Le concernent et, détail qui a son prix, la date de Sa mort et la façon dont Il quittera ce monde. Jamais le lac n'a été pris en défaut !
Si tout le monde ne peut se rendre sur les bords de ce lac, la grande majorité des gens peut consulter un cristal avec un peu de patience et de foi. Voici, pour le lecteur occidental, la méthode que je conseille, étant entendu que par ‘cristal’, j'entends aussi bien les boules de verre, les miroirs noirs et les bols d'eau, que le cristal de roche.
Pendant une semaine, surveillez de près votre santé. Évitez, autant que faire se peut dans ce monde troublé, de vous faire du mauvais sang ou de vous mettre en colère. Mangez peu, en évitant les sauces et les fritures. Touchez le cristal aussi souvent que possible, sans essayer de ‘voir’. Cela aura pour effet de lui transférer une partie de votre magnétisme personnel et de vous habituer à son contact. N'oubliez pas de le couvrir chaque fois que vous ne l'utilisez pas et rangez-le dans un coffre fermant à clef, si vous en avez un à votre disposition. Ainsi personne ne pourra jouer avec pendant votre absence. Enfin, je vous rappelle qu'il faut le soustraire aux rayons du soleil.
Les sept jours écoulés, installez-vous dans une pièce tranquille, orientée au nord autant que possible. Choisissez de préférence le soir pour éviter toute alternance d'ombre et de lumière causée par les nuages.
Asseyez-vous confortablement, la position importe peu pourvu que vous vous sentiez à l'aise, en tournant le dos à la lumière. Prenez le cristal dans vos mains et regardez si des reflets apparaissent à sa surface. Dans ce cas, supprimez-les en fermant les rideaux ou en changeant de place.
Cela étant fait, appuyez le cristal contre le centre de votre front pendant quelques secondes, puis éloignez-le lentement. Prenez-le ensuite dans le creux de vos mains qui reposeront sur vos genoux. Parcourez des yeux la surface du cristal, puis déplacez votre regard vers le centre, vers ce que vous devez imaginer comme une zone de néant. Ne pensez à rien. Ne vous efforcez pas de voir quelque chose, évitez toute émotion forte.
Dix minutes suffisent la première fois. Augmentez progressivement la durée de l'exercice pour parvenir à une demi-heure à la fin de la semaine.
La semaine suivante, faites le vide dans votre esprit le plus rapidement possible. Fixez seulement le néant à l'intérieur du cristal, dont les contours se mettront probablement à onduler. Il peut arriver que la sphère vous semble augmenter de volume ou que vous ayez l'impression de tomber en avant. C'est normal. Surtout que l'étonnement ne vous fasse PAS tressaillir, sinon vous ne ‘verrez’ rien ce soir-là. En général, les sujets qui ‘voient’ pour la première fois tressautent comme lorsqu'on bascule dans le sommeil.
Avec un peu d'expérience, vous constaterez que le volume du cristal semble devenir de plus en plus grand. Un beau soir, en le regardant, vous verrez tout à coup que l'intérieur est lumineux et rempli d'une fumée blanche. Tout finira par s'éclaircir — à condition toutefois que vous ne sursautiez pas — et ainsi vous aurez votre première vision (généralement) du passé. Il s'agira d'un événement qui vous concerne puisque vous aurez été le seul à manier la boule de cristal. Poursuivez votre effort, en ne voyant que ce qui vous intéresse directement. Quand vous serez capable de ‘voir’ à volonté, il vous sera possible d'obtenir du cristal la vision que vous désirez. La meilleur méthode consiste à se dire à soi-même d'une voix forte et ferme : "Je vais voir un tel ou un tel ce soir." Si vous y croyez vraiment, vous VERREZ ce que vous voulez. C'est aussi simple que cela.
Pour connaître l'avenir, il faut commencer par mettre les faits en ordre, en classant tous les renseignements que vous avez pu rassembler. Ensuite ‘consultez’ le cristal en vous persuadant vous-même que vous allez voir ce que vous cherchez.
Ici, un avertissement. On ne doit pas utiliser le cristal dans un but intéressé, pour prévoir le résultat des courses ou pour faire du mal. Il existe une loi occulte puissante qui fera que vos actes se retourneront contre vous si vous essayez d'exploiter le cristal. Cette loi est aussi inexorable que la marche du temps.
Vous devriez maintenant avoir acquis une grande expérience en ce qui concerne vos affaires personnelles. Aimeriez-vous appliquer cette expérience sur quelqu'un d'autre ? Plongez le cristal dans l'eau et séchez-le soigneusement sans y toucher. Tendez-le à cette autre personne en lui disant : "Prenez-le dans vos deux mains et PENSEZ à ce que vous désirez savoir. Ensuite, rendez-le-moi." Vous aurez, bien entendu, prévenu votre sujet qu'il ne doit ni parler ni vous déranger. Au début, il vaut mieux essayer avec un ami de longue date, car les étrangers ont souvent des réactions déconcertantes pour les débutants.
Lorsque votre interlocuteur vous rend le cristal, prenez-le entre vos mains, peu importe qu'elles soient nues ou couvertes de l'étoffe noire, puisqu'à ce stade vous l'avez ‘personnalisé’. Installez-vous confortablement, portez le cristal à votre front l'espace d'une seconde, puis reposez doucement vos mains sur vos genoux en tenant la boule de la manière qui vous fatigue le moins. Regardez À L'INTÉRIEUR et faites le vide complet, si possible, dans votre esprit ; mais ce premier essai risque d'être un peu difficile si vous manquez d'assurance.
Si vous avez suivi l'entraînement préconisé, vous verrez, une fois que vous vous serez concentré, soit des images, soit des symboles, soit encore ce que nous appelons des impressions. Ce sont des images réelles qu'il faut vous efforcer d'obtenir. Dans ce cas, les nuages qui ont rempli la boule de cristal se dissipent pour les laisser apparaître, et former sous vos yeux un vivant tableau de ce que vous désirez connaître. Leur interprétation n'offre aucune difficulté.
Certains, au lieu d'images, voient des symboles. Une rangée de X, par exemple, une main, un moulin ou bien un poignard. Mais quels qu'ils soient, vous apprendrez vite à les interpréter correctement.
Il y a enfin les impressions. Dans ce cas, rien n'est visible dans la boule si ce n'est des nuages qui tourbillonnent dans une faible luminescence, mais le contact du cristal vous fera ressentir ou même entendre des ‘impressions’ très nettes. Gardez-vous de tout parti pris car il est essentiel de ne pas essayer d'imposer au cristal ses opinions personnelles.
Le vrai voyant ne révèle jamais à qui que ce soit la date de sa mort ou ni même les chances qu'il a d'y échapper. Vous saurez, mais vous devrez TOUJOURS garder le silence. De même, vous n'annoncerez jamais à quelqu'un qu'il est menacé d'une maladie. Contentez-vous de dire : "Je vous conseille de prendre plus de précautions que d'habitude à telle ou telle date." Surtout, ne dites jamais : "Oui, votre mari est sorti avec une jeune femme qui..." etc. Si vous avez utilisé correctement le cristal, vous SAUREZ, bien entendu que c'est vrai, mais il se peut que ce soit pour affaires ! Qui vous dit que cette jeune femme n'est pas une parente ? Ne dites jamais, au grand JAMAIS, quoi que ce soit qui puisse briser un foyer ou faire de la peine. Ce serait un emploi abusif du cristal. Ne l'employez que pour le bien et il vous sera fait du bien en retour. Si vous ne voyez rien, dites-le et on vous respectera. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'‘inventer’ ce que vous prétendez voir, mais vous risquez alors de dire quelque chose que votre interlocuteur SAIT pertinemment être faux. Vous y perdrez votre prestige et votre réputation, sans parler du tort que vous ferez aux sciences occultes.
Votre lecture terminée, enveloppez soigneusement la boule de cristal et posez-la doucement. Après le départ du visiteur, il est recommandé de la plonger dans l'eau, de l'essuyer et de la manipuler pour la repersonnaliser en l'imprégnant de votre magnétisme. Plus vous la manipulerez et plus elle sera efficace. Évitez de l'érafler ; après toutes les séances, recouvrez-la de l'étoffe noire, et si possible, rangez-la dans un coffret qui ferme à clef. Il faut beaucoup se méfier des chats qui peuvent rester pendant des heures, le regard fixe, ‘en contemplation’. Vous ne tenez pas, je suppose, lors de la séance suivante, à être renseigné sur la vie et les rêves secrets d'un chat ! Cette expérience est parfaitement possible. Dans certaines lamaseries ‘occultistes’ du Tibet, on les interroge à l'aide d'un cristal lorsqu'ils sont relevés de leur faction auprès des pierres précieuses qu'ils sont chargés de garder. C'est ainsi que toute tentative de vol est portée à la connaissance des moines.
Je vous recommande instamment, avant de vous entraîner à la pratique de la voyance, de vous interroger très sérieusement sur vos intentions secrètes. L'occultisme est une arme à double tranchant et ceux qu'une vaine curiosité pousse à vouloir s'en ‘amuser’ risquent d'en être terriblement punis par des troubles mentaux ou nerveux. Cette science peut vous apporter la joie d'aider les autres, mais aussi vous révéler bien des choses affreuses que vous n'oublierez pas. Il est plus prudent de vous borner à la lecture de ce chapitre, si vous n'êtes pas absolument certain de la pureté de vos intentions.
Lorsque vous aurez adopté un cristal, n'en changez pas. Prenez l'habitude de le toucher tous les jours, ou tous les deux jours. Jadis, les Sarrasins ne montraient jamais une épée, fût-ce à un ami, s'il n'était pas question de faire couler du sang. Si, pour une raison ou une autre, ils DEVAIENT dégainer leur arme, ils se piquaient un doigt ‘pour que le sang ait coulé’. Il en va de même pour le cristal ; si vous le montrez à quelqu'un, FAITES UNE LECTURE, même si elle ne doit porter que sur vos propres affaires. Consultez-le ; rien ne vous oblige à raconter à qui que ce soit ce que vous faites ou ce que vous voyez. Consultez-le donc aussi souvent que possible, non pas pour obéir à une vaine superstition, mais pour vous entraîner. Un jour viendra où il vous suffira de regarder le cristal pour ‘voir’, sans avoir besoin de vous concentrer, ni même d'y penser.
Chapitre Sept
Missions de secours
Le bateau se glissa avec lenteur dans l'anse de Soochow : nous étions arrivés. Une horde de coolies chinois qui criaient et gesticulaient comme des fous monta à bord. Nos bagages furent rapidement débarqués et un rickshaw nous emmena à vive allure par le Bund à la ville chinoise, où se trouvait le temple qui devait provisoirement m'accueillir. Po Ku et moi observions, silencieux, ce monde de Babel. Shanghaï, normalement une ville extrêmement bruyante et affairée, connaissait alors une activité encore plus intense. Les Japonais en effet cherchaient l'occasion — et le prétexte — de livrer un assaut sans merci et, depuis quelque temps déjà, fouillaient les résidents étrangers passant par le pont de Marco-Polo. Leur fouille était tellement minutieuse qu'elle embarrassait beaucoup les Occidentaux qui n'ont aucune idée de l'absence de pudeur physique des Japonais et des Chinois. Un Oriental n'a jamais honte de son corps mais des pensées qu'il inspire aux autres. Aussi les Européens, quand ils étaient fouillés par les Japonais, pensaient-ils — et bien à tort — que ceux-ci cherchaient délibérément à les insulter.
Pendant quelque temps, j'eus une clientèle privée à Shanghaï, encore que pour un Oriental, le mot ‘temps’ n'ait guère de signification. Puisqu'elles sont toutes emportées par le même flot, à quoi bon parler de telle ou telle année ? Quoi qu'il en soit, j'avais ma clientèle dont je m'occupais tout en continuant mes travaux de médecine générale et de psychologie et que je voyais soit chez moi, soit à l'hôpital. De loisirs, point. Le peu de liberté que me laissaient mes obligations professionnelles était consacré à l'étude intensive de la navigation aérienne et des principes de l'aéronautique. La nuit tombée, je survolais pendant de longues heures la ville scintillante de lumières, et la campagne où je n'avais pour me guider que les faibles lueurs des chaumières.
Les années passèrent sans que je m'en rendisse compte ; j'avais trop à faire pour surveiller le calendrier. J'étais bien connu du conseil municipal de Shanghaï qui faisait constamment appel à mes services. J'avais un bon ami en la personne d'un Russe blanc, nommé Bogomoloff, que la Révolution avait chassé de Moscou. Ayant tout perdu pendant cette période tragique, il avait trouvé un emploi de fonctionnaire auprès du conseil municipal. C'est le premier homme blanc qu'il me fût permis de connaître et de connaître à fond ; et c'était un homme dans toute l'acception du terme.
Bogomoloff se rendait parfaitement compte que Shanghaï ne pourrait résister si elle était attaquée et, comme nous, il ne prévoyait que trop bien les horreurs qui devaient suivre.
Le 7 juillet 1937, il se produisit au pont de Marco-Polo un incident qui a déjà fait couler beaucoup trop d'encre. Je n'en parlerai donc pas ici, d'autant qu'il ne fut important que parce qu'il marqua le vrai début des hostilités entre la Chine et le Japon. Le pays était désormais sur le pied de guerre et les temps difficiles commençaient. Les Japonais faisaient de plus en plus preuve d'agressivité et d'arrogance. Un grand nombre de commerçants chinois et étrangers, mais surtout chinois, sentant venir les troubles, s'étaient dispersés avec leurs familles et leurs biens un peu partout dans la Chine, notamment dans les régions intérieures telles que Chongqing. Les paysans de la grande banlieue, pensant pour une raison ou pour une autre qu'ils y seraient plus en sûreté, avaient envahi la ville de Shanghaï — comme des moutons de Panurge que rassure leur nombre.
Dans les rues de la ville circulaient, jour et nuit, les camions de la Brigade internationale, transportant des mercenaires de toutes les nationalités qui étaient chargés de maintenir l'ordre. Malheureusement, ce n'étaient pour la plupart que des assassins qu'on avait recrutés pour leur brutalité. S'il advenait un incident qui n'avait pas l'heur de leur plaire, ils accouraient en force, puis sans avertir, sans même avoir été provoqués, ils ouvraient le feu avec leurs mitrailleuses, leurs fusils et leurs revolvers, tuant de pauvres civils innocents et le plus souvent laissant les coupables tranquilles. On disait couramment à Shanghaï qu'il valait mieux avoir affaire aux Japonais qu'à ces ‘barbares aux visages rubiconds’, car tel était le surnom que portaient certains mercenaires de la Police internationale.
M'étant spécialisé, pendant un certain temps, dans les maladies de femme, médecine et chirurgie, je m'étais fait une très bonne clientèle. J'acquis ainsi, durant cette période de guerre froide, une expérience qui devait m'être plus tard d'un grand secours.
Les incidents se multipliaient et chaque jour nous parvenaient de nouveaux rapports sur les atrocités japonaises. Leurs soldats déferlaient sur la Chine, maltraitant les paysans, pillant et violant comme à leur habitude. Vers la fin de l'année 1938, l'ennemi était aux portes de la ville ; les soldats chinois, mal armés, luttaient avec un réel courage, se faisant tuer sur place. Très peu reculèrent sous la pression des hordes japonaises. Tous, avant de succomber sous le poids du nombre, se battirent comme seuls peuvent se battre des hommes qui défendent leur patrie. Shanghaï fut proclamée ville ouverte dans l'espoir que les Japonais respecteraient les conventions internationales et s'abstiendraient de bombarder cette ville historique qui, sans canons ni armes, était incapable de se défendre. Les troupes se retirèrent. La ville vidée presque complètement de ses habitants regorgeait de réfugiés. Les universités, les centres intellectuels et culturels, les grosses maisons de commerce, les banques, etc., s'étaient repliés sur Chongqing et sur d'autres lieux éloignés. À leur place étaient arrivés des gens de toutes les nationalités et de tous les milieux, qui fuyaient devant les Japonais, espérant trouver leur salut en grossissant la foule des autres réfugiés. Les raids aériens se multiplièrent. La population, de plus en plus aguerrie, commençait à s'y habituer, lorsqu'une nuit les Japonais soumirent la ville à un bombardement de grande envergure, utilisant tous leurs avions disponibles, même des appareils de chasse qui transportaient des bombes attachées à leur fuselage. Quant aux pilotes, ils étaient munis de grenades qu'ils jetèrent par-dessus bord.
Ce soir-là, au-dessus de la ville sans défense, le ciel était obscurci par les formations serrées d'avions qui passaient comme des vols de sauterelles, et qui, comme les sauterelles, devaient tout détruire. Les bombes tombant un peu partout, au hasard, transformèrent Shanghaï en une mer de feu. Aucune défense n'était possible, car nous n'avions rien pour nous battre.
Vers minuit, en revenant d'apporter mes soins à une femme moribonde, je descendais une rue au plus fort du vacarme, quand une pluie de shrapnells m'obligea à chercher un abri. Tout à coup, j'entendis un léger sifflement, suivi d'une sorte de gémissement. C'était une bombe qui, en arrivant au sol, éclata avec un cri rauque qui me glaça le sang. J'eus l'impression d'être plongé dans un vide complet, un néant total où tous les bruits, toute la vie avaient cessé d'être. Je me sentis soulevé comme par une main géante, lancé en l'air où je tourbillonnai sur moi-même, puis plaqué violemment à terre. Je restai sur place quelques minutes, à moitié assommé, à peine capable de respirer, me demandant si j'étais déjà mort et me préparant à poursuivre ma route dans l'autre monde. M'étant remis sur pied en tremblant, je jetai un regard autour de moi. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je vis que la rue, où quelques instants auparavant je marchais entre deux rangées de très hautes maisons, n'était plus qu'une plaine désolée. À leur place, il n'y avait que des décombres fumants, recouverts d'une poussière fine éclaboussée de sang et sous lesquels étaient visibles des membres humains. L'énorme bombe qui s'était écrasée sur des maisons bourrées d'habitants était tombée si près de moi que, me trouvant dans une sorte de vide, j'avais eu la chance extraordinaire de m'en tirer sans la moindre égratignure. Le carnage était effrayant. Le lendemain matin, nous entassâmes les corps pour les brûler afin d'éviter la peste et les épidémies ; sous les rayons brûlants du soleil en effet, les cadavres gonflés et verdâtres commençaient déjà à se décomposer. Pendant des jours et des jours, nous creusâmes sous les ruines, pour sauver ceux qui respiraient encore.
Un jour, après avoir traversé un pont jeté de guingois au-dessus d'un canal, je me trouvai en fin d'après-midi dans un vieux quartier de Shanghaï. Sur ma droite, assis à leurs comptoirs sous un kiosque public, des astrologues et autres diseurs de bonne aventure prédisaient l'avenir. Ils ne manquaient pas de clients qui tous voulaient savoir si la guerre les épargnerait et si la situation s'améliorerait bientôt. Je les regardai, souriant sous cape de les voir si crédules. Les devins, après avoir écrit le nom d'un client sur un tableau couvert de caractères bizarres, le rassuraient sur l'issue de la guerre, en récitant une prédiction apprise par cœur ; quant aux femmes, leurs maris étaient sains et saufs, elles ne devaient pas en douter ! Un peu plus loin, d'autres astrologues — se reposant sans doute des fatigues de leur profession — servaient d'écrivains publics et rédigeaient les lettres qui allaient porter les nouvelles familiales aux quatre coins de la Chine. Leur clientèle, composée uniquement d'illettrés, ne leur assurait que de médiocres revenus. N'importe quel badaud pouvait connaître tous les secrets des familles, car en Chine, la vie privée n'existe pas. L'écrivain public avait l'habitude de crier d'une voix de stentor ce qu'il écrivait pour faire valoir auprès de sa clientèle éventuelle les beautés de son style. Poursuivant mon chemin vers l'hôpital où je devais faire quelques opérations, je passai devant la baraque des marchands d'encens et les éventaires des bouquinistes groupés au bord du fleuve comme dans toutes les grandes villes du monde. Plus loin, l'on voyait les marchands d'articles de piété, qui vendaient les statues du Ho Tai et de Kuan Yin, le Dieu de la Bonne Vie et la Déesse de la Compassion. Après avoir terminé mon travail à l'hôpital, je revins un peu plus tard par le même chemin. Les bombardiers japonais étaient passés par là : les kiosques et les éventaires des bouquinistes avaient disparu ; les marchands d'articles de piété et d'encens étaient invisibles. Hommes et marchandises étaient retournés à la poussière originelle. Le feu faisait rage, les maisons s'écroulaient. Une fois de plus les cendres s'ajoutaient aux cendres et la poussière à la poussière.
Mais Po Ku et moi avions mieux à faire que de rester à Shanghaï. Sur les instructions personnelles du général Chiang Kaï-Shek, nous avions été chargés d'organiser un service d'ambulance aérien. Je me souviens encore d'un de ces vols. Ce jour-là, il faisait frisquet et le ciel était parcouru de blancs nuages cotonneux. D'un point de l'horizon nous parvenait le broum, broum, broum monotone des bombes japonaises. De temps à autre, on entendait des moteurs d'avion qui bourdonnaient comme des abeilles par une chaude journée d'été. Nous étions assis sur le bord d'une route raboteuse et accidentée qui, comme les jours auparavant, était noire de monde. De longues files de paysans s'y traînaient, tâchant d'échapper à la cruauté insensée des Japonais que leur victoire grisait. Des paysans très vieux, arrivés presque au terme de leur vie, poussaient devant eux des brouettes où étaient entassés leurs biens terrestres. D'autres, ployés en deux jusqu'à terre, portaient sur leur dos tout ce qu'ils possédaient. Allant en sens contraire, des soldats à peine armés, dont l'équipement était chargé sur des chars à bœufs, marchaient aveuglément à la mort, pour essayer d'endiguer l'avance impitoyable de l'ennemi et protéger leur patrie et leurs foyers. Ils avançaient aveuglément sans savoir pourquoi ils devaient continuer, sans savoir ce qui avait causé la guerre.
Nous nous blottîmes sous l'aile d'un vieux trimoteur qui avait déjà fait son temps avant de tomber entre nos mains enthousiastes. Nous n'étions pas difficiles : l'enduit qui recouvrait la toile des ailes commençait à s'écailler et le large train d'atterrissage avait été renforcé à l'aide de bambous fendus en deux, tandis que le bout d'une vieille suspension d'automobile servait de sabot à la béquille. Le vieil Abie, comme nous l'appelions, ne nous avait encore jamais trahis. Ses moteurs tombaient parfois en panne, il est vrai, mais jamais tous en même temps. C'était un monoplan aux ailes très hautes, fabriqué par une firme américaine bien connue. Sa carcasse était en bois recouvert de toile : à l'époque de sa fabrication, le terme ‘aérodynamique’ était inconnu. Quand il volait à cent vingt milles (193 km) à l'heure — car telle était sa modeste vitesse limite — on avait l'impression qu'il en faisait le double : la toile claquait, les poutrelles en révolte gémissaient et le gros tuyau d'échappement à l'air libre ajoutait sa note au vacarme.
Si autrefois des croix rouges sur fond blanc avaient été visibles sur le flanc et les ailes, elles étaient alors zébrées de vilaines éraflures. L'huile giclant des moteurs avait fini par recouvrir l'avion d'une belle patine jaune ivoire qui lui donnait l'air d'une vieille sculpture chinoise. Avec les taches laissées par l'essence et les ‘reprises’ faites à l'empennage de temps à autre, le vieil appareil avait vraiment un drôle d'air !
Les explosions s'arrêtèrent. Le raid était terminé ; il était temps de nous mettre au travail. Une fois de plus, notre maigre équipement fut passé en revue ; scies : deux, une grande et une petite à l'extrémité acérée ; couteaux : quatre, dont un couteau à découper de boucher, un couteau à retoucher les photographies et deux authentiques scalpels. Un petit nombre de forceps ; deux seringues hypodermiques dont les aiguilles étaient lamentablement émoussées ; une seringue aspirante avec un tube à caoutchouc et un trocart de moyenne dimension ; et des courroies dont il fallait vérifier la solidité, car, faute d'anesthésiques, nous devions souvent attacher nos patients.
C'était au tour de Po Ku de piloter l'avion tandis qu'assis à l'arrière je devais signaler les avions de chasse japonais. À d'autres, le luxe de la phonie. L'observateur devait se servir d'une longue ficelle pour transmettre au pilote des messages très simples.
Je fis tourner les hélices avec une grande prudence car les retours de manivelle d'Abie ne manquaient pas de force. Les uns après les autres, les moteurs toussotèrent, puis, après avoir crachoté un filet de fumée noirâtre, ils commencèrent à tourner comme s'ils étaient animés d'une vie trépidante. Très vite réchauffés, ils adoptèrent un grondement bien rythmé. Une fois à bord, je me dirigeai vers l'arrière où nous avions pratiqué dans la toile une ouverture faisant office de poste d'observation. En tirant par deux fois sur la ficelle, je fis savoir à Po Ku que j'étais installé, c'est-à-dire accroupi sur le plancher, coincé entre les traverses et dans l'impossibilité de remuer le petit doigt. Le bruit des moteurs augmenta de volume, l'appareil vibra et se mit à rouler sur le terrain. J'entendais le train d'atterrissage racler le sol et les craquements des charpentes se tordant sous l'effort. À la moindre dénivellation, la queue sautait et retombait, et à chaque fois j'étais promené de haut en bas dans la carlingue. Je m'arrimai encore plus solidement, car j'avais l'impression d'être un pois dans sa cosse. Dans un dernier bruit de ferraille, la vieille machine s'élança dans les airs ; Po Ku réduisit les gaz et le vrombissement des moteurs diminua de volume. Une méchante embardée suivie d'une secousse, due à un courant ascendant qui nous prit juste au-dessus des arbres, faillit me faire passer la tête la première par le poste d'observation. Po Ku tira sèchement sur la corde plusieurs fois comme pour me dire :
— Eh bien, on a réussi une fois de plus à décoller. Vous êtes toujours là ? Pour lui répondre, je tirai moi aussi sur la ficelle en essayant de lui faire comprendre ce que je pensais de son décollage.
Po Ku pouvait voir où nous allions ; moi, je ne pouvais voir que ce que nous venions de survoler. Nous volions cette fois en direction de la région de Wuhu où un bombardement violent avait fait de très nombreuses victimes dans un village où il n'y avait personne pour soigner les blessés. Nous étions pilote et observateur à tour de rôle. Il y avait sur Abie beaucoup d'angles morts et les chasseurs japonais étaient très rapides. Souvent, ce fut leur vitesse même qui nous sauva la vie ; à condition de ne pas être trop chargés, nous pouvions en effet réduire la nôtre à cinquante milles (80 km) à l'heure et de plus, leurs pilotes étaient en général de piètres tireurs. Il vaut beaucoup mieux, disions-nous souvent, se trouver juste devant eux, puisque leur nez épaté les empêche de bien viser.
Je surveillai attentivement le ciel, guettant les maudites ‘taches de sang’, ainsi qu'étaient appelés avec beaucoup d'à-propos les appareils ennemis. Le fleuve Jaune défila sous la queue de notre appareil. En tirant sur la corde à trois reprises, Po Ku m'avertit que nous allions atterrir. La queue remonta, et au vrombissement des moteurs succéda le bruit agréable que font les hélices tournant librement dans l'air. Les gaz réduits au maximum, nous descendîmes en vol plané. Po Ku corrigea légèrement son cap et le gouvernail gémit. Je perçus le bruit des volets et la vibration de la toile de l'avion, qui faisait face à une forte brise. Un dernier grondement des moteurs et des grincements : l'appareil touchait terre et roulait sur la piste en dos d'âne. L'instant que le malheureux observateur tout recroquevillé dans la queue de l'appareil détestait le plus était arrivé : le sabot de la queue, en effet, allait, en labourant la terre desséchée, soulever des nuages chargés d'une poussière étouffante, ... et d'excréments humains, engrais traditionnel en Chine !
Ayant réussi à extirper mon énorme masse de son étroit logis, je me redressai, non sans pousser des grognements de douleur au fur et à mesure que mon sang se remettait à circuler dans mes membres. Je grimpai le long du fuselage vers la porte que Po Ku avait déjà ouverte et nous sautâmes sur le sol. Des silhouettes humaines avancèrent vers nous au pas de course.
— Venez vite, nous dit-on. Il y a beaucoup de blessés. Le général Tien a eu le corps traversé de part en part par une barre de métal.
Le général était assis droit comme un i dans l'affreux taudis qui servait d'hôpital. Son teint, normalement jaune, était devenu gris verdâtre sous l'effet de la douleur et de la fatigue. Juste au-dessus du canal inguinal gauche, sortait une barre d'acier brillant qui ressemblait à la tige d'un cric. Quoi qu'il en soit, elle était entrée dans son corps, soufflée par une bombe qui l'avait manqué de peu. Assurément, il était urgent de l'extraire le plus rapidement possible. Le bout de cette barre qui sortait du dos, juste au-dessus de la crête sacro-iliaque, était rond et lisse, et il me parut qu'elle était passée tout à côté du côlon.
Après avoir examiné très soigneusement le patient, j'emmenai Po Ku dehors où, à l'abri des indiscrétions, je le chargeai d'une commission insolite mais très importante. Pendant son absence, je nettoyai soigneusement les blessures du général ainsi que la barre de fer. Celui-ci était âgé et de petite stature mais son état général me parut bon. Je lui dis que nous n'avions pas d'anesthésiques mais que je m'efforcerais de le soigner avec le maximum de douceur.
— Malgré tous mes efforts, lui dis-je, vous aurez mal, mais je ferai de mon mieux.
— Allez-y, me répondit-il sans manifester la moindre inquiétude. Si on ne me soigne pas, je suis sûr de mourir. Aussi n'ai-je rien à perdre et tout à gagner.
Dans le couvercle d'une caisse, je découpai un carré d'environ dix-huit pouces (45 cm) de côté que je perçai d'un trou, ayant à peu près le même diamètre que la tige de métal. Pendant ce temps, Po Ku était allé chercher la vieille trousse contenant les outils de l'avion. Avec mille précautions, nous fîmes passer la barre par le trou de la plaque que Po Ku fut chargé de presser contre le blessé. Ensuite, je tirai très doucement sur la tige à l'aide d'une grosse clé à molette. Hélas, le résultat ne correspondit pas à nos efforts, car elle resta en place et le malheureux blessé devint pâle comme un linge.
"Diable, me dis-je, je ne peux laisser là cette maudite barre. C'est une question de vie ou de mort." Prenant appui sur le genou de Po Ku qui maintenait la plaque, j'empoignai à nouveau la barre et je la tirai très fort, en lui imprimant un léger mouvement de rotation. Elle sortit du corps avec un horrible bruit de succion et, perdant l'équilibre, je tombai à la renverse. Relevé d'un bond, je m'empressai d'étancher le sang qui coulait à flots. Après avoir examiné la blessure à l'aide d'une lampe électrique de poche et constaté qu'elle était relativement peu grave, nous la lavâmes aussi profondément que possible avant d'y pratiquer quelques points de suture. Pour lors, le général qui avait pris quelques stimulants, avait bien meilleure mine et — nous dit-il — se sentait rudement soulagé. Il pouvait se coucher sur le côté alors qu'auparavant, il était obligé de se tenir assis, raide comme un piquet, et de supporter le poids de la lourde barre de métal. Laissant à Po Ku le soin de finir le pansement, je passai au malade suivant, une femme dont la jambe droite avait été sectionnée juste au-dessus du genou par un éclat. On lui avait bien mis un tourniquet, mais il était trop serré et était resté en place trop longtemps : l'amputation ne pouvait plus être évitée.
À l'aide de courroies, nous liâmes solidement la femme sur une porte, arrachée de ses gonds sur notre ordre. D'un geste rapide, je fis dans la chair une incision en forme de V dont la pointe remontait vers le corps. Puis, je coupai l'os aussi haut que possible à l'aide d'une petite scie. Après avoir rabattu l'un sur l'autre les deux pans de chair, je les suturai de façon à entourer l'extrémité de l'os d'une sorte de coussin. Cela me prit un peu plus d'une demi-heure : une demi-heure de martyre pour la femme qui, cependant, resta calme pendant toute l'opération, sans crier ni défaillir ni même se plaindre. Sans doute savait-elle qu'elle était entre des mains amicales et que ce que nous faisions, nous le faisions pour son bien.
Il y avait d'autres blessés, plus ou moins gravement atteints. Quand nous eûmes fini de les soigner, il commençait à faire nuit. C'était le tour de Po Ku de piloter, mais je dus prendre sa place car la nuit il y voyait très mal.
Revenus à l'avion en toute hâte, nous rangeâmes amoureusement le matériel qui, une fois de plus, nous avait été si utile. Po Ku lança les hélices et mit les moteurs en marche. Du tuyau d'échappement jaillirent de longues flammes effilées d'un bleu teinté de rouge ; pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu un avion, le nôtre devait ressembler à un dragon se repaissant de feu. Une fois à bord, je me laissai tomber sur le siège du pilote, si fourbu que j'avais peine à garder les yeux ouverts. Po Ku qui titubait de fatigue entra derrière moi, ferma la porte, puis tomba assoupi sur le plancher. D'un geste, je fis signe aux hommes restés sur le terrain d'enlever les grosses pierres qui servaient de cales.
Dans l'obscurité grandissante, il était très difficile de distinguer les arbres. Essayant de me remémorer la topographie du terrain, je lançai le moteur droit pour faire demi-tour. Le vent était nul. Tourné dans la bonne direction — tout au moins, je l'espérais — je poussai à fond les trois manettes. Les moteurs rugirent et, s'ébranlant avec un bruit de ferraille, l'avion se mit à vibrer et à tanguer à mesure que nous prenions de la vitesse. Sans lumière, il m'était impossible de voir le tableau de bord, nous n'avions pas de phares... et je savais que l'endroit où le champ s'arrêtait était terriblement proche ! Je tirai sur le manche et l'avion s'éleva, sembla hésiter, perdit de la hauteur et s'éleva de nouveau : nous avions décollé. Virant sur l'aile, je décrivis un grand cercle tout en continuant à prendre de l'altitude. Arrivé au-dessous des nuages glacés de la nuit, je me mis en palier, cherchant du regard notre point de repère, le fleuve Jaune. Son faible éclat se détachait sur le fond sombre de la terre, très loin, sur notre gauche. Je scrutai le ciel, craignant d'y voir apparaître des avions ennemis contre lesquels nous aurions été incapables de nous défendre. Quant à Po Ku, il dormait trop bien pour faire le guet.
Tenant mon cap, je me laissai un peu aller sur mon siège. Que ces vols étaient donc exténuants ! Il fallait improviser sans cesse des moyens de soigner les pauvres blessés avec ce que nous avions sous la main. Je pensai aux fabuleux récits que j'avais entendus sur les hôpitaux anglais et américains qui disposaient, disait-on, d'un stock énorme de médicaments et d'instruments chirurgicaux. En Chine, nous étions obligés de nous débrouiller de notre mieux.
Atterrir dans une obscurité presque complète n'est guère facile. Seule brillait, au milieu de la masse plus sombre des arbres, la faible lueur des lampes à huile des chaumières. Mais il fallait bien ramener le vieil appareil et finalement je me posai, les oreilles cassées par le bruit terrible du train d'atterrissage et le crissement aigu de la béquille. Le repos de Po Ku, qui dormait à poings fermés, n'en fut pas troublé le moins du monde. Après avoir coupé les gaz, je sautai à terre, plaçai des cales devant et derrière les roues, puis je remontai dans l'avion, fermai la porte et m'endormis sur le plancher.
Des cris nous réveillèrent très tôt le lendemain matin. J'ouvris la porte et je vis une ordonnance qui m'apprit que nous n'aurions pas quartier libre pour la journée comme nous l'espérions. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avions été chargés de conduire un général dans une autre région où il devait s'entretenir avec le Général Chiang Kaï-Shek de la situation militaire sur le front de Nanking. Cet officier supérieur, qui avait été blessé et qui, théoriquement, était en convalescence, n'était qu'un misérable individu essayant probablement de tirer au flanc. Tout son état-major le détestait cordialement pour sa suffisance. Nous nous dirigeâmes vers nos cabanes pour faire un brin de toilette et changer d'uniforme car il ne badinait pas sur la tenue. Pendant que nous étions ainsi occupés, la pluie se mit à tomber à pleins seaux, le ciel se couvrit de plus en plus et notre moral, déjà mauvais, s'en ressentit. La pluie ! Nous en avions autant horreur que n'importe quel Chinois. Il faut avoir vu, en Chine, combien les soldats, hommes endurants et braves s'il en fut, peut-être les plus courageux du monde, peuvent détester la pluie pour le croire ! Là-bas, elle tombe à torrents, sans arrêt, dans un grondement de tonnerre, n'épargnant rien, s'infiltrant partout, et trempant jusqu'aux os tous ceux qui s'y trouvent exposés. Quand nous revînmes à l'avion, en nous abritant sous un parapluie, un détachement de soldats chinois arrivait sur le terrain. Ils marchaient en faisant gicler l'eau des flaques dont la route détrempée qui menait à l'aérodrome était couverte. La pluie, en ajoutant ses désagréments aux épreuves et aux souffrances qu'ils avaient déjà endurées, semblait les avoir complètement démoralisés. Ils avançaient l'air abattu, portant, en bandoulière, leurs fusils recouverts d'une housse de toile. Sur le dos, ils portaient dans des sacs entourés de cordes pour les protéger, leur maigre équipement, leurs provisions et toutes leurs affaires personnelles. Coiffés d'un chapeau de paille, ils s'abritaient de la pluie sous un parapluie fait d'un papier huilé jaunâtre et d'un manche de bambou qu'ils tenaient à la main droite. Spectacle amusant ? Peut-être maintenant, mais à l'époque, il était très courant de voir cinq ou six cents soldats marcher sur une route, en grelottant sous cinq ou six cents parapluies. Dès qu'il pleuvait, Po Ku et moi faisions comme eux pour traverser le terrain d'atterrissage.
En arrivant près de notre appareil, nous tombâmes sur un spectacle ahurissant. Cinq ou six soldats tenaient au-dessus de leur tête une espèce de dais de grosse toile pour protéger le général de la pluie. D'un geste impérieux, il nous fit signe de nous approcher.
— Lequel d'entre vous a le plus grand nombre d'heures de vol à son actif ? demanda-t-il.
— Moi, mon général, répondit Po Ku, non sans pousser un soupir de lassitude. Je pilote des avions depuis dix ans, mais mon camarade est bien meilleur pilote que moi et il a plus de métier.
— C'est à moi de décider lequel de vous est le meilleur, reprit le général. Vous piloterez ; quant à lui, je le charge de notre sécurité.
Po Ku alla donc s'installer dans la cabine du pilote pendant que je me dirigeais vers l'arrière. On essaya les moteurs. Par ma petite fenêtre, je vis le général et ses aides de camp monter à bord, cérémonie qui donna lieu à force chichis, signes de mains et courbettes. Puis une ordonnance ferma la porte, deux mécaniciens enlevèrent les cales. Sur un signe, Po Ku mit les gaz, non sans m'avertir à l'aide de notre corde que nous allions décoller.
Ce vol ne m'inspirait guère d'enthousiasme. Nous allions survoler les lignes japonaises et les Japonais se méfiaient beaucoup des avions qui survolaient leurs positions. Qui plus est, une escorte de trois appareils de chasse — pas un de plus — était censée nous protéger. Nous savions qu'ils ne manqueraient pas d'attirer l'attention de l'ennemi dont les chasseurs prendraient l'air pour voir de quoi il retournait. Pourquoi, en effet, un vieux trimoteur comme le nôtre devrait-il être ainsi escorté ? Mais, ainsi que le général lui-même l'avait déclaré de la façon la plus catégorique, c'était à l'officier ‘le plus ancien dans le grade le plus élevé’ — c'est-à-dire lui — de commander ! Notre appareil gagna lentement une des extrémités du champ. Le train d'atterrissage racla le sol. Un tourbillon de poussière s'éleva, l'avion pivota sur lui-même et, entraîné par ses trois moteurs tournant à plein régime, prit de la vitesse. D'un bond, il fut dans les airs en vrombissant. Po Ku prit de l'altitude en décrivant plusieurs cercles, ce qui était contraire à nos habitudes mais conforme aux ordres du général. Peu à peu l'avion atteignit cinq mille pieds (1 500 m), dix mille pieds (3 000 m), c'est-à-dire son plafond. Nous continuâmes à tourner au-dessus du terrain jusqu'au moment où les chasseurs, ayant décollé, se mirent à voler en groupe un peu au-dessus et derrière nous. Avec ces avions, pour attirer ainsi l'attention, j'eus l'impression d'être accroché au ciel... nu comme un ver. De temps à autre l'un d'eux apparaissait devant ma ‘fenêtre’, puis disparaissait peu à peu de mon champ de vision. Les voir ne me rassurait guère, car je craignais à tout instant de voir des avions japonais fondre sur nous.
Il semblait que le ronronnement des moteurs ne s'arrêterait jamais et que nous resterions toujours ainsi, suspendus entre ciel et terre. Parfois des trous d'air secouaient brutalement l'avion qui se mettait à trembler. Tout cela était si monotone que je me laissai aller à rêvasser. Je pensai à la guerre qui faisait rage au-dessous de nous, aux atrocités et aux horreurs dont le spectacle ne nous avait pas été épargné. Je pensai aussi à mon Tibet bien-aimé et combien il me serait agréable, en pilotant ne fût-ce que le vieil Abie, d'atterrir à Lhassa au pied du Potala. Tout à coup, j'entendis claquer une série de détonations et le ciel se remplit d'avions virevoltants dont les ailes portaient l'odieuse ‘tache de sang’. Ils piquaient sur nous, tiraient et s'enfuyaient avec la rapidité d'une flèche. Les balles traceuses sillonnaient le ciel et je voyais la fumée noire des mitrailleuses. Il était inutile que je tire sur la ficelle car Po Ku s'était certainement rendu compte tout seul que nous étions pris sous le feu ennemi. Le vieil Abie tanguait, piquait et se relevait. Un moment son nez se releva tellement que j'eus l'impression qu'il s'accrochait à la voûte céleste ! Les évolutions de Po Ku étaient si brusques que j'avais toutes les peines du monde à me maintenir en place dans la queue de la carlingue. Soudain des balles percèrent la toile en sifflant, juste devant mon front. À mes côtés, un câble se brisa en miaulant ; une de ses extrémités m'égratigna le visage, en manquant de peu mon œil gauche. Je me fis le plus petit possible. Un combat sans merci se déroulait directement sous mes yeux ; ma fenêtre, en effet, avait été découpée au ‘pointillé’ par les balles ainsi que plusieurs pieds (m) d'empennage, me laissant assis sur une carcasse de bois au beau milieu des nuages. Le combat connaissait des phases diverses lorsque retentit un formidable broum qui ébranla l'avion et lui fit piquer du nez. Affolé, j'examinai le ciel qui semblait rempli d'appareils japonais. Tout à coup, l'un d'entre eux entra en collision avec l'un des nôtres. Il y eut une grande explosion, et je vis apparaître une grande flamme rouge orange, suivie d'un nuage de fumée noirâtre ; les deux avions, entraînés dans un tourbillon mortel, piquèrent vers le sol. Les pilotes, éjectés de leur siège, tourbillonnaient aussi dans le ciel, les bras et les jambes en croix, tournant sur eux-mêmes comme des roues. Ce triste spectacle me rappela mes premières expériences de vol au Tibet, et particulièrement le jour où j'avais vu un lama tomber d'un cerf-volant, dégringoler dans les airs et s'écraser sur les rochers, plusieurs milliers de pieds (m) plus bas.
L'avion, une fois de plus secoué de violents tremblements, se mit à tomber comme une feuille morte. Je pensai que tout était fini. Tout à coup, la queue se releva si brutalement que je glissai le long du fuselage jusqu'à la cabine où m'attendait le plus horrible des spectacles. Le général était mort : autour de son cadavre gisant sur le plancher, j'aperçus les corps de ses aides de camp, éventrés par les obus et quasiment déchiquetés. Tous étaient morts ou moribonds. La cabine n'était que désolation et carnage. Quand d'une poussée j'ouvris la porte du poste de pilotage, je faillis m'évanouir : le corps décapité de Po Ku était affaissé sur les commandes et sa tête, ou ce qu'il en restait, avait éclaboussé le tableau de bord. Le pare-brise était recouvert d'une affreuse bouillie de sang et de cervelle si épaisse qu'elle cachait la vue. Sans perdre un instant, je saisis Po Ku par les épaules et le fis basculer de son siège où je pris place précipitamment. Les commandes battaient l'air, s'agitant en tous sens. Quand je voulus les saisir, elles étaient si gluantes de sang que c'est à grand-peine que je parvins à les tenir en main. Je tirai sur le manche pour redresser l'appareil. Ensuite, comme je ne voyais rien, je croisai les jambes par-dessus le manche et, frissonnant, je raclai de mes mains nues la cervelle et le sang qui recouvraient le pare-brise, dégageant ainsi un endroit qui me permit de regarder en dehors. À travers la buée vermeille laissée par le sang de Po Ku, je vis le sol se rapprocher de moi à toute vitesse. L'avion vibrait et l'air était déchiré par le sifflement aigu des moteurs que je n'arrivais plus à contrôler. Brusquement, le moteur gauche se détacha et peu après le droit explosa. Allégé de leur poids, le nez de l'avion se redressa légèrement et je tirai sur le manche aussi fort que je le pus. L'avion se releva mais il était trop tard, beaucoup trop tard : il ne répondait plus aux commandes. Certes, j'étais parvenu à réduire un peu sa vitesse, mais pas assez pour que je puisse effectuer un atterrissage acceptable. Le sol semblait monter vers moi ; les roues effleurèrent le sol, le nez piqua encore plus en avant et j'entendis un fracas épouvantable ; la carcasse de bois, broyée, volait en morceaux. J'eus l'impression que le monde se désintégrait autour de moi quand, sans quitter mon siège, je traversai le plancher de l'avion comme une balle pour me retrouver... dans un endroit qui sentait fort mauvais. Une douleur atroce traversa mes jambes, puis ce fut le néant pour un temps indéterminé.
Je ne pense pas être resté très longtemps inconscient, car je fus réveillé par le bruit des mitrailleuses. Levant les yeux, j'aperçus des avions japonais qui volaient à très basse altitude, crachant des éclairs rouges. Ils tiraient sur les débris du vieil Abie pour être sûrs de ne laisser aucun survivant à l'intérieur. Une flammèche de feu apparue à l'extrémité du dernier moteur, gagna rapidement la cabine dont la toile était imprégnée d'essence. Une longue flamme blanche coiffée d'une fumée noire jaillit : l'essence enflammée coulait sur le sol, comme une rivière de feu. Une explosion suivie d'une pluie de débris : Abie avait cessé d'exister. Satisfaits enfin, les avions japonais disparurent.
J'eus alors le temps d'examiner les lieux. À ma grande horreur, je me rendis compte que j'étais tombé dans une douve profonde servant à l'écoulement des eaux, une sorte d'égout à ciel ouvert comme il y en a tant en Chine. L'odeur était abominable, mais je me consolai vite puisque, après tout, cet égout m'avait préservé des mitrailleuses japonaises et que j'aurais très bien pu périr dans l'incendie de l'avion. Après m'être rapidement dégagé de ce qui restait du siège du pilote, je m'aperçus que j'avais les deux chevilles brisées. Au prix de grands efforts je réussis, cependant, en rampant à quatre pattes et ensuite en m'accrochant à la terre qui s'éboulait, à atteindre le haut de la douve et à échapper ainsi à la boue gluante de l'égout.
Arrivé au haut du fossé, non loin des flammes qui s'échappaient encore du sol imprégné d'essence, je m'évanouis une seconde fois sous l'effet de la souffrance et de la fatigue, mais des coups de pied violents dans les côtes eurent tôt fait de me faire reprendre connaissance. Des soldats japonais attirés par les flammes venaient de me découvrir.
— En voici un qui n'est pas mort, dit une voix.
Ouvrant les yeux, je vis un soldat japonais qui se préparait allégrement à me transpercer le cœur de sa baïonnette.
— Il fallait bien que je le fasse revenir à lui, dit-il à un de ses camarades, pour qu'il se rende compte qu'il va mourir.
Il allait me plonger son arme dans le corps lorsque, à ce moment précis, un officier arriva en courant.
— Arrêtez, hurla-t-il. Emmenez-le au camp. On lui fera dire qui était dans l'avion et pourquoi ils étaient si bien escortés. Emmenez-le, nous l'interrogerons là-bas.
Le soldat passa alors son arme à la bretelle et, me saisissant par le col, voulut me traîner par terre.
— Plutôt lourd, le copain !... Aide-moi donc un peu, dit-il à un de ses camarades. Celui-ci me prit par un bras et, ensemble, ils me traînèrent sur le sol rocailleux qui déchirait la peau de mes jambes. Par bonheur, l'officier qui tenait tellement à me faire interroger, revint.
— Portez-le, rugit-il, hors de lui.
Jetant un regard sur mon corps en sang et sur le rouge sillage que je laissais derrière moi, il gifla les deux soldats du revers de la main.
— S'il perd encore du sang, dit-il, il sera si faible qu'on ne pourra plus l'interroger. Vous en subirez les conséquences.
Durant quelques instants, je pus me reposer sur le sol pendant que l'un des soldats allait chercher un moyen quelconque de transport ; j'étais, en effet, grand et fort tandis qu'ils étaient petits et insignifiants.
Finalement, on me jeta comme un sac d'ordure sur une brouette et on me trimbala jusqu'au bâtiment qui leur servait de prison. Arrivé là, on me vida littéralement par terre, et on me traîna par le cou jusqu'à une cellule où je fus laissé seul. Après avoir claqué la porte, ils la verrouillèrent et la firent garder par des sentinelles. Au bout d'un moment, je réussis à remettre les os de mes chevilles en place ; en guise d'éclisses, j'utilisai de vieux morceaux de bois trouvés par hasard dans ma cellule qui avait dû servir autrefois d'entrepôt. Comme il me fallait des bandes pour les maintenir en place, je n'eus d'autres ressources que de déchirer mes vêtements.
Pendant des jours et des jours, je restai enfermé dans mon cachot avec pour seule compagnie, des rats et des araignées. Pour toute nourriture, on m'apportait une fois par jour un gobelet d'eau et les restes des Japonais, des restes qu'ils avaient peut-être crachés après les avoir mastiqués et trouvés peu à leur goût. Mais je n'avais rien d'autre à manger. Je devais être resté emprisonné depuis plus d'une semaine, à en juger d'après l'état de mes os qui se remettaient en place, quand un soir, peu après minuit, la porte s'ouvrit brusquement et des gardes firent une entrée bruyante. Après m'avoir remis debout — sans douceur — ils furent obligés de me soutenir car mes chevilles étaient encore trop faibles pour supporter le poids de mon corps. Ensuite, un officier entra et me gifla à toute volée.
— Ton nom ? dit-il.
— Je suis un officier de l'armée chinoise et prisonnier de guerre, répondis-je. Je n'ai rien à ajouter.
— Quand on est un HOMME, répliqua l'officier, on ne se laisse pas capturer. Les prisonniers sont de la racaille et ils n'ont aucun droit. Maintenant, parle.
Je ne répondis rien. Ils me frappèrent alors à la tête du plat de leurs sabres, et firent tomber sur moi une pluie de coups de poing, et de coups de pied, tout en me couvrant de crachats. Comme je ne répondais toujours pas, ils me brûlèrent le visage et le corps avec des cigarettes et me placèrent entre les doigts des allumettes enflammées. L'éducation que j'avais reçue ne m'avait pas été donnée en vain ; ils ne pouvaient pas me faire parler. Observant un mutisme absolu, je m'efforçai de concentrer mon esprit sur d'autres pensées, sachant parfaitement que c'était ce que j'avais de mieux à faire. Finalement, un garde me donna un coup de crosse sur le dos si violent qu'il me coupa le souffle et que je faillis m'évanouir. L'officier s'approcha de moi, me cracha à la figure et me frappa brutalement.
— Nous reviendrons, dit-il, et nous saurons te faire parler.
Je m'étais effondré comme une masse sur le sol et... j'y restai puisque aussi bien c'était le seul endroit où je pusse reposer. J'essayai de récupérer de mon mieux. Pendant la nuit, on me laissa tranquille et je ne vis personne ainsi que le lendemain, le surlendemain et le jour d'après. Pendant trois jours et quatre nuits, je restai sans boire, sans manger, et sans voir âme qui vive. Qu'allait-il m'arriver ? Laissé ainsi dans l'attente, j'eus tout le temps de me poser la question.
Le quatrième jour, un autre officier vint me voir. On allait me soigner, me dit-il, et je serais bien traité à condition de leur révéler tout ce que je savais sur les Chinois, l'armée chinoise et le général Chiang Kaï-Shek. Il ajouta qu'ils avaient appris que j'appartenais à la haute aristocratie du Tibet, pays dont ils recherchaient l'amitié. "Curieuse façon de témoigner son amitié", pensai-je. Sur quoi, après m'avoir salué, l'officier fit demi-tour et sortit de mon cachot.
Pendant une semaine, je ne fus pas trop mal traité. On me donnait à manger et à boire deux fois par jour. Certes, la nourriture et mes rations d'eau étaient insuffisantes mais au moins, on me laissait en paix. Puis un jour, trois Japonais vinrent me dire qu'ils allaient m'interroger et que je devrais répondre à leurs questions. Le docteur qu'ils avaient emmené avec eux déclara, après m'avoir examiné, que j'étais dans un piteux état mais capable cependant de pouvoir supporter un interrogatoire. Il examina mes chevilles et me dit que c'était un miracle que je pusse encore marcher. Après quoi, ils me saluèrent cérémonieusement, et après s'être salués mutuellement non moins cérémonieusement, ils quittèrent les lieux comme une bande d'écoliers. Une fois de plus la porte de mon cachot fut fermée à grand bruit et je restai seul avec mes pensées. "Ainsi, me dis-je, ils vont bientôt me faire subir un nouvel interrogatoire ? Eh bien, quoi qu'ils me fassent, je ne trahirai jamais les Chinois !"
Chapitre Huit
Aux premiers jours du monde
Le lendemain matin aux petites heures, bien avant que les premières lueurs de l'aube apparaissent dans le ciel, la porte de mon cachot, ouverte à toute volée, claqua à grand bruit contre le mur de pierre. Des gardes firent irruption dans ma cellule. Sans égards excessifs, ils m'obligèrent à me lever, ce qui leur permit de me secouer comme un prunier ! Après quoi, je fus conduit, les menottes aux mains, jusqu'à une pièce qui me parut être située à l'autre bout du monde. Les gardes me faisaient avancer en effet à grands coups de crosse, ce qui n'a rien de plaisant. Chaque coup était accompagné de jurons et de sottises :
— Tu vas répondre aux questions et en vitesse, ennemi de la paix. Pas de mensonges surtout, si tu ne veux pas en voir de toutes les couleurs. Tu es un ennemi de la paix et on te forcera à cracher la vérité.
Nous parvînmes enfin à la salle où avaient lieu les interrogatoires. Un groupe d'officiers à l'air féroce ou qui essayaient de paraître féroces y étaient assis en demi-cercle. En fait, ils ressemblaient plutôt à des écoliers à l'affût de plaisirs sadiques. Quand les gardes me firent entrer dans la salle, tous s'inclinèrent cérémonieusement. Ensuite, pour me convaincre de dire la vérité, un officier supérieur m'assura que le peuple japonais était un peuple amical qui n'aspirait qu'à la paix. Quant à moi, je devais être un ennemi des Japonais puisque je m'opposais à leur pénétration pacifique de la Chine. Selon lui, la Chine aurait dû être une colonie du Japon, parce que c'était un pays sans culture !
— Nous autres Japonais, continua-t-il, nous ne voulons que la paix. Aussi faut-il nous dire tout ce que vous savez sur les mouvements des troupes chinoises, sur leurs effectifs et nous rapporter vos conversations avec Chiang Kaï-Shek. Ainsi pourrons-nous écraser la rébellion en épargnant la vie de nos soldats.
— Je suis prisonnier de guerre, répondis-je, et j'exige qu'on me traite comme tel. Cela dit, je n'ai rien à ajouter.
— Notre devoir est d'établir la paix dans le monde, sous l'égide de notre Empereur. Nous allons étendre les limites de l'empire japonais. Il faut nous dire ce que vous savez.
Là-dessus, je fus interrogé sans... douceur. Pourquoi se seraient-ils montrés difficiles sur le choix des méthodes puisqu'ils voulaient me faire parler à tout prix ? Je m'y refusais. Très bien ! On m'assommait à coups de crosse sur la poitrine, le dos et les genoux. J'étais ensuite remis sur mes pieds pour qu'il fût possible de m'assommer de nouveau. Après de longues heures d'interrogatoire, au cours desquelles ils me brûlèrent avec des bouts de cigarettes allumées, on prit la décision de recourir à des moyens plus énergiques. Les gardes me lièrent les poings et les pieds, et me traînèrent dans un cachot souterrain, où je devais rester plusieurs jours. Les Japonais ont une façon de ligoter leurs prisonniers extrêmement douloureuse. On m'avait lié les poignets dans le dos, le bout de mes doigts tournés vers la nuque. Ensuite mes chevilles avaient été attachées à mes poignets, de façon que la plante de mes pieds fût aussi tournée vers ma nuque. Une corde, reliant ma cheville et mon poignet gauches à ma cheville et mon poignet droits m'entourait le cou, m'étranglant à moitié chaque fois que j'essayais de bouger tant soit peu. Il est extrêmement pénible de devoir rester ainsi, tendu comme un arc. De temps à autre, un garde japonais entrait dans mon cachot et me lançait un coup de pied pour voir si je réagissais.
Je restai dans cette position plusieurs jours, n'étant délivré de mes liens que pendant une demi-heure par jour. Pendant tout ce temps, on me harcela pour obtenir des informations. Je n'ouvris la bouche que pour répondre : "Je suis un officier de l'armée chinoise, et j'appartiens au personnel non combattant. Je suis un docteur et un prisonnier de guerre. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
Quand ils furent las de me poser des questions, ils firent apporter un tuyau de caoutchouc au moyen duquel de grandes quantités d'eau poivrée furent versées dans mes narines. J'eus l'impression que mon cerveau prenait feu, un feu que des diables auraient tisonné à l'intérieur de mon corps. Mais je ne parlai pas. Alors, ils m'administrèrent des solutions d'eau et de poivre de plus en plus concentrées, allant même jusqu'à y ajouter de la moutarde. La douleur était intolérable. Finalement un sang vermeil se mit à couler de ma bouche : le poivre avait brûlé les muqueuses de mon nez. Cela faisait dix jours que je leur résistais ; aussi dès qu'ils virent cette hémorragie me laissèrent-ils tranquille, comprenant, je suppose, qu'ils employaient une mauvaise méthode.
Deux ou trois jours plus tard, ils vinrent me chercher pour m'amener à la chambre des interrogatoires. Ils durent me porter car, malgré mes efforts, leurs coups de crosse et les piqûres de leurs baïonnettes, j'étais incapable de marcher. Mes mains et mes pieds étaient restés ligotés trop longtemps pour que je puisse m'en servir. Arrivé sur les lieux où devait se dérouler l'interrogatoire, on me laissa choir tout simplement sur le sol et les gardes — ils étaient quatre — qui m'avaient porté, se mirent au garde-à-vous devant les officiers assis en demi-cercle. Cette fois, ils avaient devant eux de nombreux instruments bizarres, qui ne pouvaient être, hélas ! que des instruments de torture.
— Il est temps de dire la vérité et de ne plus nous faire perdre de temps, déclara le colonel.
— Je vous ai dit la vérité. Je suis un officier de l'armée chinoise.
Ce fut tout ce que je répondis.
Cramoisis de colère, ils donnèrent l'ordre de m'attacher solidement sur une planche, les bras en croix. On m'introduisit sous les ongles de longs éclats de bambous auxquels on imprima un mouvement de rotation. Ce fut vraiment douloureux mais inefficace : je restai silencieux. D'un geste rapide, les gardes arrachèrent alors les éclats puis lentement, se mirent à me retourner les ongles un à un.
La douleur, déjà réellement diabolique, devint encore pire lorsque les Japonais versèrent de l'eau salée sur mes doigts saignants. Je savais que je ne devais pas parler ni trahir mes camarades. "Il est temps, pensais-je, de me souvenir des conseils de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup."
"Que ta pensée ne se porte pas à la source de ton mal, Lobsang, car si ton attention se concentre sur cet endroit, la douleur sera insupportable. Pense plutôt à autre chose. Contrôle le fonctionnement de ton esprit, occupe-le autrement et tu seras en mesure de supporter ce qui te fait mal même si tu dois en porter les traces. Ainsi seras-tu capable de reléguer la souffrance à l'arrière-plan."
Aussi, pour éviter de perdre la raison et de leur donner des noms ou des informations, j'occupai mon esprit à d'autres pensées. Je pensai à mon passé, à la maison de mes parents et à mon Guide. J'évoquai également l'origine du monde, telle qu'elle m'avait été révélée au Tibet.
(Les cavernes secrètes du Potala)
Il existe sous le Potala de mystérieux tunnels, où se trouve sans doute la clé de l'histoire du monde. Je m'y suis beaucoup intéressé, car ils me fascinaient. Le lecteur aimera peut-être que je raconte ici ce que j'y ai vu et appris, puisque les Occidentaux, semble-t-il, ignorent tout de ce sujet.
Je n'étais à l'époque qu'un très jeune moine faisant son noviciat. Le Très-Profond, le Dalaï-Lama, avait utilisé mes dons de voyance au Potala. En témoignage de Sa satisfaction et à titre de récompense, Il m'avait accordé la permission d'aller où bon me semblerait. Un jour, mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, me fit appeler.
— Lobsang, me dit-il, j'ai beaucoup pensé à ton développement et je suis arrivé à la conclusion que tu es assez grand et assez avancé pour venir étudier sous ma direction les textes cachés dans les cavernes souterraines. Allons-y !
Il se leva et, en sa compagnie, je sortis de sa chambre. Après avoir suivi un corridor, nous descendîmes un escalier qui n'en finissait pas, croisant sur notre passage des groupes de moines, chargés de l'administration intérieure du Potala, qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes.
Finalement, nous arrivâmes devant une petite pièce située à la droite du corridor et dont les fenêtres ne laissaient filtrer qu'une faible lumière. Au-dehors, les drapeaux rituels des prières claquaient dans le vent.
— Lobsang, me dit mon Guide, c'est ici que se trouvent les lampes avec lesquelles nous explorerons ces endroits où si peu de lamas ont la permission de se rendre.
Dans la petite pièce, nous prîmes sur une tablette deux lampes plus, par mesure de précaution, une lampe de rechange pour chacun de nous. Après en avoir rempli et allumé deux, nous nous engageâmes dans le corridor en pente, mon Guide ouvrant la marche pour me montrer le chemin. Après avoir longtemps marché, en descendant toujours plus bas, nous arrivâmes enfin devant une pièce, une sorte de resserre, me parut-il, et je crus que j'étais arrivé au terme de notre voyage. Il s'y trouvait des sculptures bizarres, des portraits, des objets sacrés, et des statuettes de dieux étranges ; bref, des cadeaux reçus des quatre coins du monde. C'était là que le Dalaï-Lama gardait les nombreux présents qu'Il recevait, du moins ceux dont Il ne savait que faire.
Je jetai autour de moi des regards pleins d'une curiosité intense. Que diable faisions-nous là ? J'avais pensé partir en exploration et voilà que je me trouvais dans une espèce de réserve.
— Très Illustre Maître, dis-je, ne nous sommes-nous pas trompés de chemin ?
Le lama, levant son regard vers moi, sourit avec bienveillance.
— Lobsang, Lobsang, me crois-tu vraiment capable de me perdre ?
Toujours souriant, il se dirigea vers un mur éloigné. Après avoir jeté un bref regard circulaire, il fit un geste. D'où j'étais, je crus le voir promener ses doigts sur une sorte de bas-relief dû probablement à un artiste disparu depuis longtemps. Peu après, j'entendis un grondement pareil à un éboulis de rocher. Alarmé, je me retournai, croyant à un écroulement du plafond ou à un effondrement du sol.
— Oh, Lobsang, me dit mon Guide en éclatant de rire, nous ne risquons rien, absolument rien ! Notre voyage va se poursuivre. C'est ici que nous entrons dans un autre monde... un monde connu seulement d'une petite élite. Suis-moi.
Frappé d'une terreur mystérieuse, je remarquai qu'un pan de mur, en glissant sur le côté, avait découvert l'entrée de ce qui me parut être un tunnel. Un sentier plongeait directement dans des ténèbres infernales. L'étonnement me figea sur place.
— Maître, m'écriai-je, il n'y avait pas la moindre porte visible à cet endroit. Que s'est-il donc passé ?
— Cette ouverture, me répondit-il en riant, a été pratiquée il y a bien des siècles, et a toujours été gardée secrète. Quiconque n'en connaît pas l'existence n'arrivera pas à ouvrir cette porte, puisqu'elle est totalement invisible. Mais assez sur ce sujet, Lobsang, nous ne sommes pas là pour discuter architecture. Assez de temps perdu. Tu auras souvent l'occasion de revenir ici.
Sur ce, faisant demi-tour, il s'engagea dans le mystérieux tunnel, en m'invitant à le suivre d'un geste impérieux. Je lui emboîtai le pas, fort impressionné. Il me laissa passer devant lui, puis se retournant, il mit sans doute un mécanisme en marche, car j'entendis un grondement sinistre mêlé de craquements et de grincements, cependant qu'un pan de roche vive glissant sous mes yeux ébahis venait boucher l'ouverture. Nous n'étions défendus contre l'obscurité que par la lumière clignotante de nos lampes à beurre qui projetaient une lueur dorée. Mon Guide passa devant moi et poursuivit sa marche. Le bruit de ses pas, tout étouffés qu'ils fussent, se répercutait à l'infini contre les parois rocheuses. Il marchait sans mot dire. À mon avis, nous avions parcouru plus d'un mille (1,6 km) quand, sans crier gare, il s'arrêta si brusquement que je me cognai contre lui, non sans pousser une exclamation.
— Nous allons remplir nos lampes ici, dit-il, et leur mettre des mèches plus grosses, car nous allons avoir besoin de lumière. Fais comme moi, après quoi, nous continuerons notre chemin.
Cela fait, nous disposions d'une lumière plus forte pour nous éclairer, et nous marchâmes longtemps, si longtemps que je sentis la fatigue et l'impatience me gagner. C'est alors que je remarquai que le passage gagnait en largeur et en hauteur, comme si nous avancions vers le gros bout d'un entonnoir. Nous tournâmes dans un couloir et là, je poussai un cri d'étonnement : devant mes yeux s'ouvrait une immense caverne. Du plafond et des parois jaillissaient de minuscules éclats de lumière dorée produits par la réverbération de nos lampes à beurre ; leur faible lueur soulignait l'immensité du lieu et l'épaisseur des ténèbres.
Mon Guide se dirigea vers une fissure sur le côté du sentier et en retira un gros cylindre de métal qui grinça sur le rocher. Ce cylindre me parut grand comme une moitié d'homme et il avait certainement la largeur d'une taille masculine. De forme ronde, il portait en son sommet une sorte de mécanisme qui ressemblait à un petit filet blanc et dont l'utilité m'échappait. Après l'avoir manipulé, le Lama Mingyar Dondup y approcha l'extrémité de sa lampe à beurre. Aussitôt jaillit une brillante flamme d'un blanc tirant sur le jaune, grâce à laquelle tout s'éclaira autour de moi. Cette lumière émettait un faible sifflement comme si elle sortait sous pression.
— Prenons cette lumière avec nous, déclara mon Guide en éteignant nos petites lampes, elle nous suffira amplement. Je veux que tu apprennes l'histoire des éons des anciens temps.
Là-dessus, il reprit la marche, tirant derrière lui la boîte qui dégageait une vive lumière sur une espèce de petit traîneau d'un maniement très facile. Nous descendions toujours plus bas. "Sûrement, me dis-je, nous allons arriver dans les entrailles de la Terre." Finalement, le Lama Mingyar Dondup s'arrêta. Devant moi, se dressait un mur noir où était encastré un panneau d'or décoré de centaines, de milliers de gravures. Je les regardai, puis tournai la tête de l'autre côté où je distinguai les miroitements d'une eau noire ; étais-je en face d'un grand lac ?
— Lobsang, me dit mon Guide, accorde-moi ton attention. Plus tard, je te dirai ce que c'est que cette eau. Pour l'instant je vais te raconter l'origine du Tibet. Bientôt, dans quelques années, tu pourras vérifier l'exactitude de mes paroles au cours d'une expédition que je prépare dès maintenant. Quand tu auras quitté notre pays, tu rencontreras des gens qui ne nous connaissent pas et pour lesquels les Tibétains sont des sauvages illettrés, adorant des diables et pratiquant des rites inavouables. Or, Lobsang, notre civilisation est bien plus ancienne que la plus ancienne des civilisations occidentales, comme le prouvent des témoignages vieux de plusieurs millénaires mis précieusement à l'abri dans des cachettes.
Se dirigeant vers le mur opposé, il attira mon attention sur différentes inscriptions, telles que des symboles et des dessins dont certains représentaient des hommes et des animaux inconnus de nos jours. Il me fit voir ensuite une carte du ciel qui n'était pas de notre époque — même moi, je pouvais m'en rendre compte — car les étoiles et les astres n'étaient pas identiques aux nôtres, ne fût-ce que par leur position. Il marqua un temps d'arrêt avant de se tourner vers moi.
— Je comprends ce langage, dit-il, car il m'a été enseigné. Maintenant, je vais lire pour toi cette vieille histoire dont le début remonte aux premiers jours du monde. Bientôt mes compagnons et moi t'enseignerons ce langage secret pour que tu puisses venir ici rédiger tes propres notes, classer tes documents et tirer tes propres conclusions. Il te faudra travailler, travailler encore et toujours. Tu devras explorer ces cavernes qui sont innombrables et qui s'étendent sur des milles (km) juste au-dessous de nous.
Il contempla les inscriptions pendant un bon moment, avant de commencer à lire un fragment de l'histoire du passé. Il est tout à fait impossible de rapporter, dans un ouvrage du genre de celui-ci, l'essentiel de ses paroles, et encore moins de l'enseignement qui me fut donné plus tard. Le lecteur moyen serait incrédule ; d'autre part, s'il me croyait, et s'il arrivait qu'il fût en possession de certains de nos secrets, il pourrait faire ce que d'autres ont fait avant lui : utiliser les engins que j'ai vus de mes propres yeux à des fins égoïstes, pour imposer sa domination sur les autres ou pour les détruire, ainsi que font de nos jours les pays qui se menacent mutuellement d'une destruction atomique. La bombe atomique n'est pas une découverte moderne ; elle fut inventée, en effet, il y a des milliers d'années et elle a déjà provoqué la destruction de la Terre comme elle ne manquera pas de le faire à notre époque si on ne met pas un terme à la folie des hommes.
Dans l'histoire de toutes les tribus, de toutes les nations et de toutes les religions, il est question du déluge au cours duquel les peuples périrent noyés, des continents disparurent cependant que d'autres apparaissaient et que la Terre était plongée dans le chaos. Tel est le récit que vous trouverez dans l'histoire des Incas, des Égyptiens, des Chrétiens — dans l'histoire de tous les peuples du monde. Or, nous savons que la catastrophe fut causée par une bombe. Mais laissez-moi vous raconter ce qui se passa, d'après le témoignage des inscriptions.
Mon Guide s'assit dans la position du lotus, juste en face des inscriptions du rocher ; la lumière brillante qu'il avait placée près de lui faisait briller les gravures millénaires d'un vif éclat doré. Il me fit signe de m'asseoir également. Je pris place à ses côtés, assez près du mur pour bien voir les détails qu'il m'indiquait. Quand je fus installé, il prit la parole. Voici ce qu'il me révéla :
— À l'aube des temps, la Terre n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Elle tournait beaucoup plus près du Soleil et en sens inverse. Dans son voisinage était une autre planète, en quelque sorte sa jumelle. Les jours étaient plus courts, aussi les hommes avaient-ils l'impression de vivre plus longtemps, pendant des siècles. Le climat était plus chaud et la flore d'une luxuriance tropicale. La faune très variée était riche d'animaux aux formes gigantesques. La pesanteur était plus faible que de nos jours en raison de la différente vitesse de rotation de la Terre. La taille de l'homme atteignait le double de sa taille actuelle, encore qu'il ne fût qu'un pygmée comparé aux gens d'une autre race qui vivaient à ses côtés, des super-intellectuels appartenant à une caste différente. Ces super-intellectuels gouvernaient la Terre et ils apprirent beaucoup aux hommes qui étaient alors comme des élèves soumis à l'autorité d'un maître bienveillant. Il arrivait souvent à ces énormes géants de monter à bord d'engins de métal brillant qui sillonnaient le ciel. L'homme, cette pauvre créature ignorante qui n'en était encore qu'aux premiers balbutiements de la raison raisonnante, était incapable de comprendre tout cela car son intelligence dépassait à peine celle des singes.
"Pendant des temps infinis, la vie sur la Terre suivit un cours paisible. La paix et l'harmonie régnaient entre tous. Les hommes communiquaient entre eux par télépathie, sans avoir recours à la parole, qui n'était utilisée que pour les dialectes locaux. Puis les super-intellectuels qui dominaient l'homme de leur haute taille, se prirent de querelle. Des factions se formèrent, qui ne pouvaient se mettre d'accord sur certaines questions, exactement comme les nations d'aujourd'hui. Un de ces groupes gagna une autre partie du monde où il essaya d'imposer sa domination. Une guerre éclata. Les surhommes s'entre-tuèrent en s'infligeant mutuellement de grosses pertes au cours de féroces batailles. L'homme, qui brûlait du désir de s'instruire, apprit l'art de la guerre, apprit à tuer. La Terre, où la paix avait régné jusqu'alors, devint un enfer. Pendant de longues années les surhommes travaillèrent en secret, les uns contre les autres. Un jour, une énorme explosion secoua la Terre et la déplaça de son orbite. Des flammes rougeoyantes traversèrent le ciel et la Terre fut entourée de fumée. Le tumulte cessa enfin, mais pendant de longs mois d'étranges signes qui frappaient les peuples de terreur apparurent dans le ciel. Venant des espaces infinis une planète s'approchait de la Terre ; chaque jour elle paraissait plus grande. Bientôt, il fut évident que la collision était inévitable. Des raz de marée déferlèrent sur la Terre, de grands vents s'élevèrent et les jours et les nuits furent remplis du hurlement des tempêtes furieuses. La planète remplit alors tout le ciel, comme si elle allait bientôt tomber droit sur la Terre. À mesure qu'elle s'approchait, de vastes étendues de terre ferme furent submergées sous les raz de marée. Des tremblements de terre secouèrent la surface du globe et, en un clin d'œil, des continents entiers furent engloutis. Alors, la race des surhommes oublia ses querelles ; tous coururent à leurs machines étincelantes et s'élancèrent dans le ciel pour fuir les cataclysmes ravageant le globe. Mais sur celui-ci, les tremblements continuaient ; des montagnes jaillissaient du sol, entraînant avec elles le fond des mers ; des terres en s'effondrant furent immédiatement recouvertes par les eaux. Les peuples fuyaient de tous côtés, éperdus de terreur, croyant que la fin du monde était arrivée. Pendant tout ce temps, les vents augmentaient de violence. Le tumulte devint de plus en plus intolérable, les nerfs des hommes cédèrent et la peur s'installa sur toute la surface du globe.
"La planète étrangère ne cessait de grandir et de se rapprocher, jusqu'au moment où elle fut très proche de la Terre. Alors, elle s'écrasa dans un bruit fracassant en même temps que jaillissait une étincelle électrique aveuglante. Des explosions se succédaient dans les cieux embrasés et des nuages d'un noir de suie transformèrent les jours en une interminable nuit d'épouvante. Le Soleil lui-même parut se figer d'horreur devant la catastrophe car, d'après les anciens écrits, son disque rouge se maintint immobile, dit-on, pendant de longs jours, cependant que de longues flammes jaillissaient de son centre. Les nuages noirs recouvrirent la Terre et plongèrent le monde dans les ténèbres. Les vents soufflaient tantôt glacials, tantôt brûlants et des milliers de gens moururent de ces écarts continuels de la température. Du ciel tomba la Nourriture des Dieux, appelée parfois la Manne. Sans elle, les peuples ainsi que les animaux seraient morts de faim car les récoltes avaient été détruites et ils n'avaient plus rien à manger.
"Hommes et femmes erraient en quête d'un abri qui leur permît de reposer leur corps exténué, meurtri par les tempêtes et les terribles cataclysmes. Ils imploraient le ciel de leur envoyer le calme, le suppliant de les sauver. Mais la Terre continuait à être agitée de secousses sismiques, les pluies à tomber à torrents et les déflagrations d'électricité à éclater dans l'espace sidéral. À mesure que le temps s'écoulait, et que les lourds nuages noirs s'éloignaient en grondant, le Soleil devenait de plus en plus petit, comme s'il allait disparaître au loin. Tous, pensant que le Dieu Soleil, le Dispensateur de la Vie, les abandonnait, se mirent à hurler de peur. Mais phénomène plus étrange encore, le Soleil se déplaçait dans le ciel de l'est à l'ouest, au lieu de suivre sa trajectoire habituelle d'ouest en est.
"L'homme n'avait plus aucune notion du temps dont le cours ne pouvait être mesuré par suite de l'obscurcissement du Soleil ; personne, même les plus sages, n'aurait pu situer l'époque où tous ces événements prirent place. Le ciel fut encore le siège d'un étrange phénomène : un monde y apparut, un monde énorme et gibbeux, de couleur jaunâtre, dont on put croire qu'il allait lui aussi s'écraser sur la Terre. Ce qui maintenant est connu de tous sous le nom de ‘Lune’ fit son apparition à cette époque, l'un des résultats de la collision entre les deux planètes. Plus tard, on devait découvrir en Sibérie un vaste cratère à l'endroit où vraisemblablement la surface du globe fut défoncée lors de la collision et d'où peut-être la Lune y fut arrachée.
"Avant celle-ci, il existait des villes où une grande partie du savoir de la Race Supérieure était conservée dans de grands bâtiments. Quand ils s'effondrèrent au cours du cataclysme, tous leurs secrets furent ensevelis sous des montagnes de décombres. Les sages des tribus savaient que sous ces amas étaient cachées des boîtes contenant des pièces uniques et des ouvrages gravés sur du métal. Ils savaient que tout le savoir du monde reposait sous ces ruines ; aussi entreprirent-ils des fouilles, de longues fouilles, pour tenter de sauver ce qu'ils pouvaient des anciens écrits, et, en utilisant les connaissances de la Race Supérieure, d'accroître ainsi leur puissance.
"Dans les années qui suivirent, les jours devinrent de plus en plus longs, jusqu'à atteindre une durée deux fois supérieure à celle d'avant le cataclysme. Puis la Terre, accompagnée de la Lune, la Lune que nous connaissons, cet astre né d'une collision, se plaça sur sa nouvelle orbite. Elle continua cependant à être secouée par des séismes, qu'accompagnaient de sourds grondements ; des montagnes s'élevèrent et vomirent des flammes et des rochers, semant ainsi la destruction. De grandes coulées de lave dévalèrent le flanc des montagnes, ravageant tout sur leur passage et se refermant souvent sur les sources du savoir ; or, le métal sur lequel était gravée la plus grande partie des documents était suffisamment dur pour résister à la chaleur de la lave de sorte que celle-ci les protégea en les entourant d'une gangue de pierre poreuse. Un jour, cette gangue devait s'effriter sous l'effet du temps et révéler les trésors qu'elle contenait pour le bénéfice de ceux entre les mains desquels ils tomberaient. Mais ce jour ne devait arriver que beaucoup plus tard. Lorsque la Terre s'affermit sur sa nouvelle orbite, le froid l'envahit graduellement et les animaux moururent ou émigrèrent vers des climats plus chauds. Le mammouth et le brontosaure, incapables de s'adapter à de nouvelles conditions d'existence, disparurent. De la glace tomba du ciel et les vents devinrent plus mordants. Le ciel, autrefois d'une pureté presque parfaite, se remplit de nuages. Le monde avait changé du tout au tout : la mer fut soumise à des marées alors qu'auparavant elle ressemblait à un immense lac tranquille, dont la surface n'était troublée que par le souffle du vent. Désormais, d'énormes vagues se lançaient à l'assaut du ciel et pendant des années de gigantesques marées menacèrent d'engloutir les terres et les hommes. La voûte céleste n'était plus la même non plus. La nuit, d'étranges constellations remplaçaient les étoiles familières et la Lune était très proche. De nouvelles religions prirent naissance et les prêtres de cette époque voulurent, pour imposer leur autorité, donner leur version des événements. Préoccupés seulement de leur importance et de leur influence, ils se soucièrent fort peu de la Race Supérieure. Faute de pouvoir expliquer la genèse du cataclysme, ils l'attribuèrent à la colère divine, en affirmant que tous les hommes étaient conçus dans le péché.
"Avec le temps, la Terre s'installa sur sa nouvelle orbite, les éléments se calmèrent et la stature des hommes diminua. Les siècles se succédèrent et les continents se stabilisèrent. De nombreuses races, surgies, pourrait-on dire, à titre expérimental, essayèrent de survivre sans y réussir et disparurent laissant la place à d'autres. Une souche humaine plus résistante finit par se développer et ce fut le début d'une nouvelle civilisation ; celle-ci devait toujours garder au fond d'elle-même dans une sorte de ‘mémoire raciale’, le souvenir d'une catastrophe épouvantable dont quelques cerveaux puissants essayèrent de retracer l'histoire. Pour lors, la pluie et le vent avaient accompli leur œuvre. Les vieux documents commencèrent à sortir des débris de lave solidifiée et, en les voyant, des habitants de la Terre décidèrent de les réunir et de les soumettre aux plus sages d'entre eux, lesquels, au prix de longs efforts, réussirent à en déchiffrer une partie. Dès qu'ils furent capables d'en lire et d'en comprendre quelques-uns, les savants de l'époque s'acharnèrent à en rechercher d'autres afin de combler leurs lacunes et d'arriver à une compréhension d'ensemble. De grandes fouilles donnèrent de nombreux résultats intéressants. Alors, la nouvelle civilisation connut un réel développement. Des villes et des cités s'élevèrent un peu partout et la science commença sa course au désastre. Elle se consacra à la destruction en se mettant au service de certaines factions. On oublia tout à fait que l'homme peut vivre en paix et que la guerre porte en elle les germes des catastrophes les plus terribles.
"Pendant de longs siècles, la science régna en maîtresse. Les prêtres se posèrent comme hommes de science et éliminèrent tous les savants qui n'étaient pas prêtres eux-mêmes. Leur pouvoir s'accrut ; ils adorèrent la science et ne reculèrent devant rien pour assurer leur domination, écraser l'homme moyen et l'empêcher de réfléchir. Bientôt, ils se firent passer pour des Dieux ; rien ne pouvait être fait sans leur autorisation. Ce qu'ils voulaient, ils s'en emparaient sans que personne pût s'y opposer. À force de s'exercer, leur pouvoir grandit jusqu'à devenir presque illimité, tant ils avaient oublié que le pouvoir absolu corrompt toujours ceux qui le détiennent.
"De grands aéronefs sans ailes glissaient dans les airs, sans le moindre bruit, ou planaient immobiles, comme n'auraient pu le faire des oiseaux. Les savants avaient découvert comment maîtriser la pesanteur, l'antipesanteur et utiliser ces forces à leur profit. Un seul homme, muni d'un minuscule appareil tenu dans le creux d'une main, pouvait déplacer à son gré d'énormes blocs de pierre. Nul travail n'était trop pénible puisque les machines de l'homme fonctionnaient sans qu'il lui en coutât le moindre effort. De gigantesques engins sillonnaient la surface de la Terre, mais rien ne bougeait sur la mer ; il n'y avait, en effet, pour naviguer que ceux qui aimaient voyager lentement, tant leur plaisait le jeu du vent et des vagues. Tous les déplacements se faisaient par les airs, ou, s'ils étaient courts, par la voie terrestre. Des peuples émigrèrent dans certains coins de la Terre et y établirent des colonies. Mais à cette époque, ils ne pouvaient plus communiquer par télépathie à la suite de la collision catastrophique. Ils ne parlaient plus un même langage ; les dialectes se multiplièrent, se différencièrent de plus en plus et finirent par donner naissance à des langues incompréhensibles à ceux qui ne les connaissaient pas.
"Par suite de leur incapacité à communiquer et à se comprendre mutuellement, les peuples se prirent de querelles et des guerres éclatèrent. Des armes effrayantes furent inventées et les batailles firent rage sur toute la surface du globe. Hommes et femmes furent blessés et les terribles radiations qui étaient utilisées provoquèrent force mutations dans la race. Des années passèrent et la lutte devint plus acharnée, le carnage plus effrayant. Partout des inventeurs, stimulés par leurs chefs, rivalisaient d'ardeur pour fabriquer des armes encore plus meurtrières. Les savants travaillaient avec acharnement pour mettre au point des engins d'une puissance offensive sans cesse plus redoutable. On cultiva des microbes infectieux que des avions volant à haute altitude lâchaient sur l'ennemi. Des bombes endommagèrent les canalisations d'égout, de sorte que la peste et des épidémies de toutes sortes ravagèrent la Terre, frappant gens, animaux et plantes. La Terre courait vers sa destruction.
"Dans une région lointaine, épargnée par la guerre, un groupe de prêtres clairvoyants, que la soif du pouvoir n'avait pas corrompus, gravèrent sur de minces plaques d'or l'histoire de leur époque, ainsi que la carte des cieux et de la Terre. Ils y consignèrent également les plus grands secrets de leur science et des avertissements solennels sur les dangers qu'encourraient ceux qui en feraient un mauvais usage. Il fallut de nombreuses années pour préparer ces plaques, après quoi elles furent, avec des spécimens des armes, des outils, des livres et de tous les objets utilisés à l'époque, cachées en certains endroits afin que l'humanité pût un jour connaître son passé et, espérait-on, en tirer profit. Car, bien évidemment, ces prêtres connaissaient le cours que suivrait l'histoire ; ils savaient ce qui se passerait et qui arriva, comme ils l'avaient prédit. Une arme nouvelle fut mise au point et expérimentée. Un nuage fantastique s'éleva de la Terre en tourbillonnant dans la stratosphère ; du coup, le globe fut brutalement secoué comme s'il allait basculer sur son axe. D'énormes murailles d'eau déferlèrent sur la terre, en balayant sur leur passage de nombreuses races humaines. Une fois de plus, des montagnes s'affaissèrent sous les eaux cependant que d'autres les remplaçaient. Un petit nombre d'hommes, de femmes et d'animaux, avertis à temps par les prêtres, eurent la vie sauve grâce à des bateaux construits à l'épreuve des gaz et des germes toxiques qui ravageaient la Terre. D'autres, soulevés avec les régions qu'ils habitaient, se retrouvèrent très haut dans les airs ; d'autres moins chanceux, entraînés dans les profondeurs, furent ensevelis sous les eaux, ou virent des montagnes se refermer sur leurs têtes.
"L'eau, le feu et les rayons de la mort firent des millions de victimes et il ne resta plus sur Terre qu'un petit nombre d'humains, isolés les uns des autres selon les hasards du désastre. Rendus à moitié fous par la peur, ébranlés dans tout leur être par la terrible force de l'explosion, ils se cachèrent longtemps dans des cavernes et au sein d'épaisses forêts. Toute trace de culture avait disparu et ils revinrent à un état sauvage, comme au temps de la préhistoire, se couvrant de peaux de bêtes, s'enduisant le corps du jus des baies et s'armant de massues à la pointe de silex.
"De nouvelles tribus se rassemblèrent et errèrent sur cette nouvelle face du globe. Certaines s'établirent dans ce qui est maintenant l'Égypte, d'autres en Chine ; quant aux hommes qui avaient habité les agréables abords du littoral, région où se plaisait fort la Race Supérieure, ils se retrouvèrent soudainement à des milliers de pieds (m) au-dessus du niveau de la mer, sur une terre entourée par des montagnes aux neiges éternelles et qui se refroidissait rapidement. Il en mourut des milliers, incapables de résister à cet air raréfié et au climat rigoureux. Ceux qui survécurent sont les ancêtres de la robuste race tibétaine moderne. C'est là que les prêtres clairvoyants avaient transporté leurs fines plaques d'or pour y graver tous leurs secrets. Ces plaques, ainsi que des modèles de leurs productions artistiques et artisanales avaient été enfouies dans de profondes cachettes creusées dans une caverne de montagne à l'intention des futures générations de prêtres. D'autres furent cachées dans une grande ville située sur les Hautes-Terres de Chang Tang.
"Bien que l'humanité fût revenue à un état sauvage, toute civilisation cependant ne disparut pas pendant ces Années Noires. Sur certains points isolés à la surface du globe, de petits groupes d'hommes et de femmes, plongés dans les ténèbres infernales de la sauvagerie, luttaient désespérément pour ne pas laisser mourir la connaissance, pour ne pas laisser s'éteindre la faible flamme de l'intelligence humaine. Au cours des siècles suivants, les religions évoluèrent beaucoup et de nombreuses recherches furent entreprises pour essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'était passé. Or pendant tout ce temps, dans les cavernes profondes du Tibet, était caché le Savoir suprême, gravé sur des plaques d'or incorruptibles, immortelles, attendant ceux qui les découvriraient et qui pourraient les déchiffrer.
"L'homme, une fois de plus, évolua peu à peu ; l'obscurantisme recula ; la sauvagerie fit place à une demi-civilisation. Des progrès furent accomplis. De nouveau, des cités s'élevèrent et des machines sillonnèrent le ciel. Les montagnes cessèrent une fois de plus d'être des obstacles et l'homme parcourut le monde sur terre et sur mer. Mais comme autrefois, les peuples, à mesure qu'augmentaient leur science et leur puissance, devinrent arrogants et se mirent à opprimer les plus faibles. Ce fut une époque de troubles, de haines, de persécutions et de recherches secrètes. Opprimés par les nations plus puissantes, les peuples faibles inventèrent des machines, et des guerres éclatèrent, des guerres qui devaient durer des années. De nouvelles armes encore plus terribles que les précédentes étaient sans cesse mises au point. Chaque camp s'efforçait de découvrir l'arme absolue et pendant ce temps, dans les cavernes du Tibet était enfoui le Savoir ! Et pendant tout ce temps, dans les Hautes-Terres de Chang Tang se dressait une grande cité déserte, sans défense, qui gardait en ses flancs le plus précieux savoir du monde, attendant la visite de ceux qui daigneraient y pénétrer pour découvrir, étalé sous leurs yeux..."
Étalé... C'était moi qui étais étalé sur le dos, dans mon cachot souterrain, le regard voilé d'une buée rouge. De mon nez, de ma bouche, de l'extrémité de mes doigts et de mes orteils s'écoulait un flot de sang. J'avais mal partout. Comme si j'avais été plongé dans un bain de feu. J'entendis vaguement la voix d'un Japonais.
— Vous y êtes allé trop fort cette fois... Il ne s'en tirera pas... Certainement pas...
Mais je m'en suis tiré. Je voulais survivre pour leur montrer de quoi était capable un homme du Tibet. Je voulais leur montrer que les tortures les plus diaboliques étaient impuissantes à faire parler un Tibétain.
Mon nez, cassé par un furieux coup de crosse, était aplati sur ma figure. J'avais la bouche pleine de sang, les mâchoires brisées et les dents arrachées. Mais toutes leurs tortures ne purent m'arracher une parole. Ils finirent par y renoncer car, même eux, ils comprenaient combien il était vain de vouloir forcer à parler quelqu'un résolu à se taire. Des semaines passèrent après lesquelles on me mit au travail : je devais m'occuper des cadavres de ceux qui n'avaient pas survécu. Sans doute pensaient-ils qu'une telle tâche briserait mes nerfs et qu'ainsi je finirais par parler. Empiler des cadavres sous un soleil de plomb, des cadavres verdâtres, dégageant une odeur infecte, n'a rien de plaisant. Les corps, démesurément enflés, éclataient comme des ballons crevés d'un coup d'épingle. Un jour, je vis un homme tomber raide mort. Je sais qu'il était mort pour l'avoir examiné moi-même, mais les gardes ne prirent même pas la peine de s'en assurer ; deux hommes saisirent son corps et le lancèrent sur une pile de cadavres, l'abandonnant au soleil brûlant et aux rats. Peu importait qu'un homme fût mort ou non, car s'il était trop malade pour travailler, il était tué sur place à coups de baïonnette et jeté sur le tas de cadavres, à moins qu'il n'y fût tout simplement jeté alors qu'il respirait encore.
Je résolus de ‘mourir’ moi aussi pour être jeté à mon tour sur les cadavres et m'évader à la faveur de la nuit. Ayant établi mon plan dans ses grandes lignes, j'observai attentivement pendant trois ou quatre jours la routine des Japonais pour mettre au point ma tactique. Cela fait, je pris l'habitude de marcher en titubant pour faire croire que j'étais plus faible que je ne l'étais en réalité. Le jour où j'avais résolu de ‘mourir’, je me rendis à l'appel, qui avait lieu dès les premières lueurs de l'aube, à pas chancelants. Au cours de la matinée, je donnai tous les signes de l'épuisement total, puis, peu après midi, je me laissai tomber sur le sol. En vérité, cela ne me fut pas difficile, car toute comédie mise à part, j'aurais pu m'écrouler à n'importe quel moment, tant ma fatigue était grande. Les tortures et le manque de nourriture m'avaient considérablement affaibli ; bref, j'étais mortellement épuisé. Aussi, je m'écroulai pour tout de bon sur le sol où je m'endormis aussitôt. Je sentis qu'on me soulevait brutalement et qu'on lançait mon corps en l'air à la volée. J'atterris sur le tas de cadavres qui fut secoué de craquements et le choc me réveilla. Après avoir bougé légèrement la masse macabre se stabilisa. La violence du choc m'avait fait ouvrir les yeux et j'aperçus une sentinelle qui jetait dans ma direction un regard distrait, sur quoi j'ouvris les yeux encore plus grands, pour leur donner la fixité de ceux d'un mort, et il détourna son regard. Après tout, il était trop habitué à voir des cadavres pour se soucier qu'il y en ait un de plus ou de moins. En dépit des corps qui s'abattaient autour de moi et sur moi, je réussis à observer une immobilité absolue, évoquant une fois de plus le passé et tirant des plans sur l'avenir.
Cette journée me parut durer une éternité. Ne ferait-il donc jamais sombre ? Enfin le jour commença à baisser et les signes avant-coureurs de la nuit firent leur apparition. Je respirais l'odeur presque insupportable de ces corps déjà depuis longtemps privés de vie. Sous moi, j'entendais les petits cris aigus des rats vaquant à leur macabre besogne et grignotant la chair humaine. De temps à autre, un des corps placés en bas du monticule s'affaissait sous le poids des autres et la pile se tassait en penchant sur le côté ; chaque fois, je priais pour qu'elle ne s'écroulât pas comme cela arrivait souvent. Car si les gardes étaient obligés d'entasser de nouveau les cadavres, ils s'apercevraient peut-être que je n'étais pas mort, à moins — ce qui serait pire encore — que je me retrouve complètement en dessous de la pile et incapable de m'en sortir.
Enfin les commandos de prisonnières qui travaillaient un peu partout dans le camp furent reconduits à leurs baraquements. Lentement, ô combien lentement, le soleil se coucha ; l'une après l'autre, de petites lumières jaunes s'allumèrent aux fenêtres des salles de garde. Enfin, lentement, de façon presque imperceptible, la nuit nous enveloppa.
Je restai longtemps, très longtemps, couché dans ce lit de cadavres puants, immobile et observant tout de mon mieux. Quand les sentinelles furent au bout de leur ronde, je poussai de côté, avec d'infinies précautions, le corps qui s'appuyait contre moi et celui qui était au-dessus de moi. Ce dernier bascula et dégringola le long de la pile jusqu'au sol où il fit grand bruit. Horrifié, je retins mon souffle ; j'étais sûr que les sentinelles allaient accourir et me découvriraient. Circuler dans le camp après le crépuscule équivalait à une mort certaine ; des projecteurs étaient allumés et les malheureux qui étaient surpris par les Japonais étaient lardés de coups de baïonnette et éventrés, ou bien pendus au-dessus d'un feu brûlant lentement, ou bien encore torturés de façon diabolique pour satisfaire le sadisme de nos gardes et pour que les prisonniers, obligés d'assister à ce spectacle, comprennent combien il était vain d'essayer d'échapper aux Fils du Ciel.
Rien ne bougea. Apparemment, les Japonais avaient trop l'habitude des bruits causés par la chute des cadavres. J'essayai de remuer : tout le monceau de cadavres se mit à craquer et à osciller. Remuant un pied à la fois, je finis par gagner le bord en rampant, puis je me laissai glisser sur dix ou douze pieds (3 ou 3,6 m) en m'agrippant aux cadavres ; j'étais en effet trop faible pour sauter et je ne voulais pas courir le risque de me fouler le pied ou de me rompre les os. Le bruit n'attira pas l'attention des Japonais qui étaient évidemment à cent lieues de penser que quelqu'un pût utiliser une cachette aussi macabre. Une fois sur le sol, je me dirigeai lentement et avec mille précautions vers l'ombre que projetaient les arbres près du mur du camp. J'attendis là de longs moments. Au-dessus de ma tête, des gardes se rencontrèrent sur le chemin de ronde. J'entendis une conversation à voix basse et je vis la lueur brève de l'allumette avec laquelle ils allumèrent leurs cigarettes. Ensuite les deux soldats se quittèrent et s'éloignèrent dans des directions opposées, l'un vers la droite du mur, l'autre vers la gauche, chacun dissimulant sa cigarette dans le creux de la main. Comme la flamme de cette allumette jaillissant dans la nuit les avait provisoirement à moitié aveuglés, j'en profitai pour grimper lentement par-dessus le mur que je franchis sans faire le moindre bruit. Le camp n'ayant été construit qu'à titre provisoire, les Japonais n'avaient pas eu le temps d'électrifier leurs barbelés. Après les avoir passés, je me perdis dans l'ombre. Je passai toute la nuit dans un arbre, presque en vue du camp. "S'ils s'aperçoivent de ma fuite, me dis-je, ou s'ils m'ont vu m'évader, ils se rueront à ma poursuite dans la campagne. L'idée qu'un prisonnier évadé puisse rester si près du camp ne leur viendra certainement pas à l'esprit."
Je restai tapi dans ma cachette toute la journée du lendemain ; j'étais trop faible et trop malade pour bouger. La nuit venue, je me laissai glisser à terre le long du tronc et me mis en route dans cette région que je connaissais bien.
Je savais que dans les parages vivait un vieux, très vieux Chinois. J'avais prodigué mes soins à sa femme moribonde et je choisis de me diriger vers sa maison. Arrivé devant sa porte, je frappai doucement. L'air semblait chargé d'angoisse. Enfin dans un souffle, je dis mon nom. De l'intérieur me parvint le bruit de pas étouffés, la porte s'entrouvrit de quelques pouces (cm) et le visage du vieillard apparut.
— Ah, me dit-il, c'est vous ! Entrez, faites vite !
Il ouvrit la porte et je me faufilai à l'intérieur en passant sous son bras tendu. Après avoir mis les volets et fait de la lumière, il me regarda... et un cri d'horreur s'étouffa dans sa gorge. J'avais l'œil gauche fortement abîmé, le nez écrasé, et ma bouche aux commissures affaissées n'était plus qu'une plaie. Il mit de l'eau à bouillir, lava mes plaies et me donna à manger. Je restai avec lui, dans sa hutte, toute la nuit et toute la journée du lendemain. Il me quitta ensuite pour aller prendre les dispositions nécessaires pour me faire conduire jusqu'aux lignes chinoises. Pendant plusieurs jours, je dus rester dans cette cabane située en plein territoire occupé, plusieurs jours pendant lesquels, grelottant de fièvre, je restai entre la vie et la mort.
Une dizaine de jours plus tard, ayant recouvré une partie de mes forces, je fus capable de me lever et de me mettre en route. Par un itinéraire soigneusement étudié, je pus rejoindre le quartier général chinois près de Shanghaï. Lorsque je m'y présentai, les gens regardèrent mon visage tuméfié avec horreur. Je restai plus d'un mois à l'hôpital où l'on préleva un morceau d'os sur ma jambe pour me refaire le nez. On décida de m'envoyer en convalescence à Chongqing, où je me reposerais avant de reprendre du service dans le corps médical de l'armée chinoise. Chongqing ! Je songeai au plaisir que j'aurais à revoir la ville après toutes mes aventures et tout ce que j'avais dû endurer. C'est dans ces dispositions d'esprit que je me mis en route en compagnie d'un ami qui devait s'y remettre de diverses maladies contractées pendant la guerre.
Chapitre Neuf
Prisonnier des japonais
Nous fûmes stupéfaits des changements qui avaient pris place à Chongqing. La ville n'était plus celle que nous avions connue ! Partout de nouveaux bâtiments — des façades remises à neuf — des boutiques de toutes espèces ! Chongqing fourmillait de gens, des réfugiés de Shanghaï et des villes du littoral. Parmi eux se trouvaient des hommes d'affaires qui, après avoir perdu leur gagne-pain sur la côte, avaient fui à l'intérieur des terres jusqu'à Chongqing pour recommencer leur vie, les plus heureux avec ce qu'ils avaient pu réussir à dérober à la rapacité des Japonais. Mais le plus souvent, ils devaient repartir de rien.
Les universités s'étaient installées dans des immeubles, ou avaient fait élever des constructions provisoires, pour la plupart de simples baraques. Et pourtant, le centre culturel de la Chine n'était pas ailleurs. Peu importait l'aspect des bâtiments puisqu'à l'intérieur se trouvaient les plus belles intelligences de la Chine et peut-être du monde.
Nous nous rendîmes aussitôt à la lamaserie où nous avions séjourné auparavant, avec le sentiment de rentrer ‘chez nous’. Dans le temple si calme, où les volutes de l'encens évoluaient au-dessus de nos têtes, nous eûmes le sentiment que nous touchions à un havre de paix et que les Images Sacrées, approuvant nos efforts, nous jetaient des regards bienveillants, peut-être même teintés de compassion pour les sévices que nous avions subis. Oui, en vérité, nous étions rentrés chez nous, où l'âme en paix nous allions nous remettre de nos blessures avant d'affronter de nouveau le monde sauvage et cruel où nous attendaient de nouveaux tourments encore plus terribles. Les cloches du temple carillonnèrent, les trompettes sonnèrent. L'heure était venue d'assister à l'office qui nous était si familier. Quand nous prîmes nos places dans le temple, notre cœur débordait de joie à l'idée d'être de retour !
Ce soir-là, nous nous couchâmes fort tard car les sujets de discussion ne manquaient pas. Nous avions beaucoup à raconter et aussi à apprendre, car Chongqing avait beaucoup souffert des bombardements. Mais nous arrivions du ‘grand monde extérieur’, comme on disait au temple ; aussi notre gorge était-elle bien desséchée quand on nous laissa, enroulés dans nos couvertures, nous coucher à notre place habituelle, sur le sol, près de l'enceinte du temple, où le sommeil finit par nous surprendre.
Le lendemain matin, je dus me rendre à la consultation de l'hôpital où j'avais été attaché comme étudiant, chirurgien, puis médecin en chef. D'y être admis en tant que patient fut vraiment une nouvelle expérience. Mon nez cependant me causait des ennuis ; comme il s'était infecté, il fallut le faire ouvrir et ruginer, opération d'autant plus douloureuse que nous manquions d'anesthésiques. La route de Burma étant coupée, rien ne parvenait plus à Chongqing. Il ne me restait plus qu'à supporter le mieux possible ce qui ne pouvait être évité. Dès la fin de l'opération, je rentrai au temple car l'hôpital de Chongqing manquait de lits. Les blessés affluaient, mais seuls ceux qui étaient gravement atteints ou incapables de marcher trouvaient une place à l'hôpital. Jour après jour, je me rendis à Chongqing en suivant le petit sentier qui menait à la grand-route. Enfin, deux ou trois semaines plus tard, le doyen de la Faculté de Chirurgie me fit appeler dans son bureau.
— Eh bien, Lobsang, mon ami, me dit-il, nous n'aurons pas besoin d'engager trente-deux coolies après tout ! Nous avons pourtant craint le pire, vous savez. Votre vie n'a tenu qu'à un fil !
En Chine, les funérailles sont prises très, très au sérieux, et on attache la plus grande importance à ce que le nombre des porteurs corresponde exactement à la position sociale du défunt. Pour moi, rien ne me semblait plus absurde, car je savais qu'une fois l'esprit libéré du corps, la façon dont celui-ci est traité importe peu. Au Tibet, nous ne faisions pas tant d'embarras, nous nous contentions de faire enlever les cadavres par les Briseurs de Corps qui les dépeçaient et les offraient en pâture aux oiseaux. Il n'en va pas de même en Chine, où une telle façon de faire reviendrait presque à condamner le défunt à l'enfer éternel ! En Chine, pour un enterrement de première classe, le cercueil doit être porté par trente-deux coolies ; pour un enterrement de deuxième classe, la moitié suffit, soit seize, comme si — par parenthèse — il fallait seize hommes pour porter un simple cercueil ! La troisième classe — la plus commune — comprenait huit coolies et un grand cercueil en bois laqué. Pour la quatrième, celle de la classe ouvrière, quatre coolies suffisaient. Le cercueil n'était qu'une simple boîte d'un prix minime. Au-dessous de cette classe, il n'y avait pas de coolies, le cercueil était trimbalé sur le premier véhicule venu. En plus des coolies, bien d'autres personnages entraient en scène : les membres du cortège officiel, ceux qui pleuraient et ceux qui se lamentaient, bref, tous ceux dont le métier consistait à accompagner les morts à leur dernière demeure.
Enterrement ?... La mort ? Certains incidents sont vraiment inoubliables. Il en est un en particulier dont j'ai toujours gardé le souvenir, et qui eut lieu près de Chongqing. Il me semble intéressant de le rapporter ici pour donner aux lecteurs une image en raccourci de la guerre... et de la mort.
C'était le jour de la fête du ‘Quinzième Jour du Huitième Mois’, qui a lieu à la mi-automne, à l'époque de la pleine lune et qui, en Chine, compte parmi les ‘occasions propices’. C'est le moment de l'année où les familles font tout leur possible pour se retrouver autour d'une table bien garnie quand le jour touche à sa fin. Des ‘gâteaux de lune’ sont alors mangés pour célébrer la lune des moissons ; ils servent d'offrandes propitiatoires pour que l'année suivante soit encore plus fortunée.
Mon ami Huang, le moine chinois qui lui aussi avait été blessé, séjournait au temple en même temps que moi. Ce jour-là, nous rentrions à pied à Chongqing, venant de Chiaoting, un village des faubourgs perché très haut sur les rives abruptes du Yangtsé, où habitaient de riches familles qui n'avaient rien à se refuser. Tout en marchant, nous apercevions au-dessous de nous, par des échappées de terrain, le fleuve avec ses flottilles de bateaux. Plus près, dans les jardins en terrasses, des hommes et des femmes vêtus de bleu, penchés sur leurs houes, arrachaient inlassablement les mauvaises herbes. La matinée était superbe ; c'était un de ces jours chauds et ensoleillés où l'on se sent heureux de vivre et où tout semble beau et joyeux. La guerre était bien loin de nos pensées pendant cette promenade au cours de laquelle nous nous arrêtions souvent pour admirer le paysage à travers les arbres. D'un bosquet tout proche s'élevait le chant d'un oiseau célébrant la beauté du jour. Poursuivant notre chemin, nous gravîmes la colline.
— Arrêtons-nous une minute, Lobsang, me dit Huang, tout essoufflé.
Nous nous assîmes donc sur un rocher à l'ombre des arbres. Qu'il était agréable de contempler le paysage magnifique qui s'étendait de l'autre côté de l'eau, le sentier moussu qui descendait le long de la colline tachetée des mille couleurs de petites fleurs d'automne. Les arbres aussi commençaient à prendre de nouvelles teintes ; au-dessus de nous, des petits flocons de nuages dérivaient paresseusement dans le ciel.
Un cortège marchant dans notre direction apparut à l'horizon et la brise légère nous apporta quelques bribes de musique.
— Cachons-nous, Lobsang, me dit Huang. C'est l'enterrement du vieux Shang, le marchand de soie. Un enterrement de première classe. J'aurais dû y assister, mais j'ai dit que j'étais trop faible ; s'ils me voient maintenant, je perdrai la face. Il se mit debout, j'en fis autant et, quittant notre rocher, nous fîmes quelques pas dans le bois jusqu'à un endroit d'où nous pouvions tout voir sans nous-mêmes être vus. Nous nous tapîmes derrière un petit mur de rochers, Huang un peu en retrait de moi pour demeurer complètement invisible au cas où on m'apercevrait. Nous nous installâmes confortablement, drapés dans nos robes dont la couleur était harmonieusement assortie aux teintes rousses de l'automne.
Le convoi funèbre approchait lentement. Les moines chinois, vêtus de robes de soie jaune, portaient sur leurs épaules des capes couleur de rouille. Le pâle soleil d'automne brillait sur leurs crânes rasés de frais, faisant ressortir les cicatrices des cérémonies initiatoires ; ses rayons faisaient resplendir les clochettes d'argent qu'ils tenaient à la main ; quand ils les agitaient, celles-ci étincelaient et jetaient de vifs éclats de lumière. Devançant l'énorme cercueil laqué traditionnel porté par trente-deux coolies, les moines marchaient en chantant les cantiques mineurs du service funèbre. Des acolytes frappaient sur des gongs et lançaient des pétards pour tenir à distance les démons rôdeurs qui, selon les croyances chinoises, sont prêts à ce moment à s'emparer de l'âme du défunt et qu'il faut par conséquent effrayer par des pétards et toutes sortes de bruits. Derrière eux venaient les membres de la famille éplorée, la tête entourée d'un drap blanc, symbole du chagrin. Une femme dont la grossesse était très avancée, très certainement une proche parente du défunt, marchait, soutenue par d'autres membres de la famille, en versant des larmes amères. Des pleureurs professionnels faisaient retentir l'air de leurs lamentations et chantaient à tue-tête les vertus du défunt à qui voulait les entendre. Derrière, venaient des domestiques portant de l'argent et des reproductions en papier de toutes les choses que le mort avait possédées en ce monde et dont il aurait besoin dans l'autre. De notre cachette, derrière le mur de rochers, tapis au milieu des buissons, nous pouvions respirer l'odeur de l'encens et le parfum des fleurs écrasées sous les pas du cortège. Il s'agissait vraiment d'un enterrement très important. Shang, le marchand de soieries, avait dû être un des plus importants notables de la ville pour que son enterrement fût aussi fastueux.
Le cortège se rapprocha lentement de nous dans un concert assourdissant de lamentations, de cymbales et autres instruments de musique auquel se mêlait le tintement des sonnettes. Tout à coup des ombres se profilèrent sur la face du soleil et, dominant le bruyant brouhaha de la foule, nous entendîmes le ronronnement de puissants moteurs d'avions qui devenait de plus en plus fort et de plus en plus menaçant. Trois appareils japonais à l'aspect sinistre surgirent au-dessus des arbres, entre le soleil et nous, et se mirent à décrire des cercles. L'un d'eux se sépara des autres, piqua vers le sol et vint passer juste au-dessus du convoi funèbre. Nous n'en fûmes pas inquiets, car nous pensions que même des Japonais sauraient respecter le caractère sacré de la mort. Nous respirâmes cependant un peu mieux quand, après nous avoir survolés de nouveau, il s'en alla rejoindre les deux autres pour disparaître au loin. Notre joie cependant fut de courte durée ; les avions décrivirent une grande courbe et revinrent vers nous ; de dessous leurs ailes, se détachèrent de petits points noirs qui grossirent à vue d'œil : c'étaient des bombes dont le souffle déchira l'air avant de tomber directement sur la procession.
Devant nous, les arbres tremblèrent, la Terre entière parut secouée par un cataclysme et des éclats de métal passèrent près de nous en sifflant. Les bombes tombèrent si près que nous ne les entendîmes même pas exploser. Au milieu de la fumée et de la poussière volèrent des morceaux de cyprès déchiquetés. De grosses masses rougeâtres traversèrent l'air en tourbillonnant avant de s'écraser un peu partout dans un bruit écœurant. Pendant quelques instants, tout fut recouvert par un épais manteau de fumée noire et jaune. Quand le vent l'eut dissipée, une épouvantable scène de carnage se présenta devant nos yeux.
Sur le sol, le cercueil était ouvert : il était vide. Près de lui, le corps du pauvre défunt gisait les bras en croix comme une misérable poupée brisée, déchirée et mise au rebut.
Quand nous nous relevâmes, nous tremblions de tout notre corps ; les ravages, la violence de l'explosion et aussi le fait d'avoir frisé la mort d'aussi près, nous avaient laissés à moitié assommés. Une fois debout, je retirai d'un arbre placé derrière moi un long éclat de métal qui s'y était fiché, en me manquant de peu puisqu'il était passé en sifflant à deux doigts au-dessus de ma tête. L'extrémité acérée de cet éclat était pleine de sang et elle était si chaude que je la lâchai aussitôt avec un cri de douleur en regardant lugubrement l'extrémité brûlée de mes doigts.
Sur les arbres mutilés, des morceaux d'étoffe auxquels adhéraient encore des lambeaux de chair s'agitaient doucement dans le vent. À moins de cinquante pieds (15 m) de nous, un bras encore attaché à son épaule se balançait à la fourche d'un arbre. Il se balança, glissa, fut rattrapé un instant par une branche plus basse, puis finalement tomba à terre, spectacle qui nous souleva le cœur. Des branches décharnées d'un arbre, une tête difforme et sanglante, figée sous l'effet d'une brusque épouvante dans un sourire grimaçant, tomba sur le sol où elle roula jusqu'à mes pieds ; ses yeux me regardaient pleins de peur et aussi d'étonnement devant tant de cruauté de la part des Japonais.
Un moment, je crus que le temps, frappé d'horreur lui-même, s'était arrêté. Une odeur d'explosifs, de sang et d'entrailles empestait l'atmosphère. Seuls rompaient le silence les bruits étouffés que faisaient des choses innommables en tombant du ciel ou des arbres. Nous courûmes vers la scène du désastre, espérant pouvoir sauver quelqu'un, convaincus qu'il devait y avoir au moins un survivant à cette tragédie. Nous trouvâmes d'abord un corps déchiqueté, perdant ses entrailles ; il était si mutilé, si écorché qu'il était impossible de savoir si c'était le corps d'un homme ou d'une femme, et qu'il avait même perdu toute forme humaine. Couché en travers de ce corps, un petit garçon dont les jambes avaient été sectionnées à la hauteur des cuisses, gémissait de terreur. Le temps que je m'agenouille près de lui et il vomissait un flot de sang vermeil et, dans une quinte de toux, rendait le dernier soupir. Le cœur plein de tristesse, nous poussâmes plus loin nos recherches. La femme enceinte gisait sous un arbre qui, soufflé par l'explosion, s'était renversé sur elle. De son ventre, qui avait éclaté sous le choc, sortait son enfant mort, mort avant d'avoir connu la vie. Un peu plus loin, une main coupée serrait encore la poignée d'une clochette d'argent. Nos recherches durèrent longtemps mais nous ne devions trouver aucune trace de vie.
Du ciel, nous parvint un bruit de moteurs d'avions : les assaillants revenaient contempler leur macabre travail. Allongés sur le dos, au milieu des flaques de sang, nous vîmes un avion japonais descendre vers nous, en décrivant des cercles, pour évaluer les dégâts et s'assurer qu'il n'avait laissé vivant aucun témoin susceptible de parler. Sans se presser, il vira de bord, puis, glissant sur son aile comme un épervier fondant sur sa proie, il revint sur nous en volant en ligne droite toujours plus près du sol. J'entendis le crépitement des mitrailleuses suivi du sifflement des balles fouettant les arbres. Il me sembla qu'on tirait sur le bas de ma robe et j'entendis un hurlement, cependant que je sentais comme une brûlure à ma jambe. "Pauvre Huang, pensai-je, il vient d'être touché et il a besoin de moi."
Au-dessus de nous, l'avion tournait dans les airs, décrivant paresseusement des cercles comme si le pilote se penchait le plus possible pour examiner le sol. Ensuite, amorçant un piqué léger, il tira quelques rafales décousues avant de décrire un nouveau cercle. Il dut être satisfait car il agita ses ailes avant de s'éloigner. Quand, après avoir laissé passer quelques moments, je me relevai pour soigner Huang, je le trouvai ‘planqué’ sur le sol, mais heureusement indemne. En relevant ma robe, je m'aperçus que ma jambe gauche portait la marque d'une brûlure là où une balle m'avait frôlé. Tout près de moi, la tête grimaçante portait les traces toutes fraîches d'une balle qui, entrant par une tempe, était ressortie par l'autre, y creusant un trou énorme par où la cervelle avait jailli.
Une fois de plus, nous fouillâmes les buissons et le bois sans trouver le moindre signe de vie. À peine quelques minutes auparavant, une cinquantaine ou une centaine de personnes, peut-être même davantage, se trouvaient en cet endroit pour rendre hommage à un mort. Et voilà qu'eux aussi étaient morts, et qu'il ne restait d'eux qu'une bouillie informe. Nous tournions sur place, frappés d'impuissance ; il n'y avait rien que nous puissions faire, personne que nous puissions sauver. Seul le temps effacerait ces sanglantes cicatrices.
Cela s'était passé le ‘Quinzième Jour du Huitième Mois’, ce jour où les familles se réunissent à la tombée du jour, et où chacun est tout à la joie de se trouver parmi les siens. Grâce aux Japonais, ces familles-là au moins avaient été réunies dans ce qui devait être leur dernier jour. Alors que nous quittions les lieux de la catastrophe pour poursuivre notre route, un oiseau reprit son chant interrompu comme si rien ne s'était passé.
À cette époque, la vie à Chongqing était vraiment très dure. Une foule d'aigrefins s'y étaient réfugiés, bien décidés à exploiter la misère du peuple et à tirer profit de la guerre. Les prix montaient en flèche et la situation était devenue si difficile que nous fûmes très heureux de recevoir l'ordre de reprendre notre service. Il y avait eu beaucoup de blessés sur la côte et on y avait un besoin urgent de médecins. Nous quittâmes donc Chongqing une fois de plus pour rejoindre le littoral où le Général Yo nous attendait pour nous donner ses instructions. Quelques jours plus tard, j'étais nommé à la direction d'un hôpital en tant que médecin-chef. Hôpital ! Il y avait de quoi rire ! L'hôpital en question n'était en fait qu'un certain nombre de champs de paddy où les malheureux blessés couchaient à même le sol détrempé puisqu'il n'y avait pas un seul lit et que nous étions démunis de tout. Notre matériel ? Des bandages en papier, des instruments chirurgicaux démodés et des appareils de fortune fabriqués de nos mains ! Il nous restait notre métier et la volonté de secourir ceux qui étaient gravement blessés, et de ceux-là nous ne manquions pas. Les Japonais étaient victorieux sur tous les fronts et nos pertes étaient effroyables.
Un jour, il y eut un bombardement qui me parut plus sévère que d'habitude. Les bombes pleuvaient partout. Nos champs étaient environnés de cratères. Les troupes chinoises battaient en retraite. Le soir même, un détachement de soldats japonais envahit notre ‘hôpital’. Après nous avoir menacés de leurs baïonnettes, ils blessèrent quelques-uns de nos camarades pour bien nous faire comprendre qu'ils étaient les maîtres. Sans armes, sans rien pour nous défendre, toute résistance était impossible. Après m'avoir interrogé sans douceur en tant que responsable de l'hôpital, ils se dispersèrent dans les champs pour inspecter les blessés. Tous reçurent l'ordre de se lever. Ceux qui ne pouvaient pas marcher ou porter un fardeau furent tués sur place à coups de baïonnette. Les autres, quel que soit leur état de santé, durent à marches forcées prendre la direction d'un camp de prisonniers situé très loin à l'intérieur du pays. Chaque jour, nous faisions des milles et des milles (km). Beaucoup de blessés s'écroulaient et mouraient sur le bord de la route ; à peine étaient-ils tombés que les soldats accouraient en toute hâte pour détrousser leurs cadavres. Leur cupidité ne reculait devant rien. À l'aide d'une baïonnette, ils desserraient les mâchoires crispées par la mort et faisaient sauter d'un coup violent toutes les dents aurifiées.
Un jour, je remarquai que les gardes qui marchaient au-devant de notre colonne portaient quelque chose d'étrange au bout de leurs baïonnettes. Ils les agitaient en tous sens comme pour célébrer un événement, me parut-il, d'autant que ces choses ressemblaient à des ballons. Tout à coup, ils se mirent à courir le long de la colonne en riant et en hurlant, et nous aperçûmes, le cœur plein de dégoût, que ces ballons étaient des têtes, des têtes aux yeux et à la bouche ouverts, la mâchoire pendante, des têtes de prisonniers, qu'ils portaient au bout de leurs armes pour bien montrer — une fois de plus — qu'ils étaient les maîtres.
À notre hôpital, nous avions soigné des malades de toutes les nationalités. Et c'étaient des cadavres de toutes les nationalités qui jonchaient les bords de la route où nous avancions, des cadavres qui, maintenant, ne formaient plus qu'un seul peuple, le peuple des morts. Les Japonais les avaient dépouillés de tout. Nous marchâmes des jours et des jours, chaque jour moins nombreux, chaque jour plus épuisés que la veille. Lorsque notre petit groupe de survivants arriva aux portes du camp, nous titubions de fatigue ; un brouillard violacé flottait devant nos yeux et nos pieds enveloppés dans de misérables chiffons laissaient derrière eux de longues traînées sanglantes. Nous entrâmes dans le camp, un camp vraiment très primitif et là, nous fûmes interrogés de nouveau.
Qui étais-je ? Que faisais-je ? Comment se faisait-il qu'un lama tibétain combatte du côté des Chinois ? Je répondis que je ne participais pas aux combats, m'efforçant seulement de soigner les blessés et de guérir les malades, réponse qui m'attira des coups et des injures.
— Oui, dirent-ils, bien sûr ! Vous soignez les blessés pour qu'ils puissent reprendre le combat contre nous !
Finalement, on me chargea de m'occuper des malades et de les soigner pour qu'ils puissent être enrôlés de force dans des commandos de travailleurs, d'esclaves, devrais-je dire. Quatre mois environ après notre entrée au camp, il y eut une grande inspection. On attendait de hauts fonctionnaires chargés de voir si parmi les prisonniers ne se trouvaient pas de personnages importants qui pourraient leur être utiles. Alignés dès avant l'aurore, on nous laissa debout en rang pendant des heures et des heures, de sorte qu'en fin d'après-midi nous ne formions plus qu'une masse pitoyable. Ceux qui étaient terrassés par la fatigue étaient achevés à coups de baïonnette et traînés sur le tas de cadavres. Nous réussîmes tant bien que mal à reformer nos rangs quand arrivèrent en rugissant de puissantes voitures d'où sautèrent des hommes à la poitrine constellée de décorations. D'un air désinvolte, un commandant japonais nous passa en revue, en dévisageant chaque prisonnier. Après m'avoir jeté un coup d'œil, il me regarda avec plus d'attention ; puis, fixant ses yeux dans les miens, il me dit quelque chose que je ne compris pas. Comme je ne répondais pas, il me frappa au visage du fourreau de son sabre, faisant jaillir le sang. Une ordonnance se précipita vers lui et l'officier se détourna de moi pour lui dire quelques mots. L'ordonnance courut au bureau et en revint, quelques secondes plus tard, avec mon dossier, que le commandant lui arracha des mains pour le parcourir avidement. Après quoi, il m'accabla d'injures et sur son ordre, les gardes qui l'entouraient m'assommèrent — une fois de plus — à coups de crosse. Une fois de plus, ils me cassèrent le nez — ce nez tout neuf qu'on venait de me refaire — et me traînèrent jusqu'au corps de garde. Là, on m'attacha les bras et les jambes derrière le dos en les relevant pour les lier à mon cou, de sorte que je manquais m'étrangler chaque fois que j'essayais de reposer les bras. Pendant un long moment, on fit pleuvoir sur moi une grêle de coups de poing et de coups de pied, on me brûla avec des bouts de cigarettes, tout en me pressant de questions. Ensuite, on me fit mettre à genoux et les gardes sautèrent sur mes talons, comptant sur la douleur pour m'obliger à parler. Sous leur poids, les os de la voûte plantaire cédèrent.
Que dire des questions qu'ils me posèrent ? Comment m'étais-je évadé ? À qui avais-je parlé pendant que j'étais libre ? Est-ce que je me rendais compte que s'évader, c'était insulter l'empereur ? Ils me questionnèrent également sur les mouvements des troupes chinoises, persuadés qu'en ma qualité de lama tibétain, je devais en savoir beaucoup sur le dispositif chinois. Naturellement, je ne répondis pas ; aussi continuèrent-ils à me brûler avec leurs cigarettes allumées et à m'appliquer leurs procédés de torture habituels. Enfin, ils m'attachèrent sur une espèce de chevalet grossier et serrèrent le tourniquet si fort que je crus que mes bras et mes jambes étaient désarticulés. Chaque fois que je m'évanouissais, ils me ranimaient en me lançant un seau d'eau froide à la figure et en me piquant de leurs baïonnettes. L'officier de santé en charge du camp finit par intervenir en déclarant qu'à coup sûr je mourrais si on n'arrêtait pas de me torturer ; et si je mourais, comment pourraient-ils tirer de moi les renseignements désirés ? Ils décidèrent donc de ne pas me tuer pour la simple raison que mort, j'échapperais à leurs questions. Aussi, on me jeta au fin fond d'un cachot souterrain, en ciment, qui avait la forme d'une bouteille, après m'y avoir traîné par le cou. J'y restai enfermé pendant des jours, des semaines peut-être ; j'avais perdu toute notion de temps et je ne savais plus où j'en étais. Le cachot était noir comme un four. Tous les deux jours, on me lançait quelque chose à manger. Quant à l'eau, on la faisait descendre dans une boîte de conserve qui se renversait souvent ; il me fallait alors ramper dans l'obscurité en tâtonnant pour essayer de la retrouver ou tout au moins de m'humecter les lèvres sur le sol. Soumis à un tel régime et dans des ténèbres si profondes, j'aurais dû perdre la raison, mais la formation que j'avais reçue me sauva. Une fois de plus, j'évoquai le passé.
Les ténèbres ? Je pensais aux ermites du Tibet et à leur tranquille retraite perchée sur des sommets de montagne inaccessibles, perdus dans les nuages. Ils y passaient des années entières, murés dans leurs cellules, s'efforçant de libérer l'esprit du corps et l'âme de l'esprit afin d'atteindre la suprême liberté spirituelle. Mes pensées ne s'attardaient pas au présent, elles remontaient dans mon passé et mes rêveries m'amenèrent inévitablement à évoquer ce merveilleux épisode de ma vie : ma visite aux Hautes-Terres de Chang Tang.
(Visite aux Hautes-Terres de Chang Tang)
En compagnie de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, et de quelques compagnons, j'avais quitté le Potala et ses toits dorés pour chercher des herbes rares. Pendant des semaines, nous étions remontés vers le Grand Nord glacé, jusqu'aux Hautes-Terres de Chang Tang, appelées parfois Shambhala. Ce jour-là, nous approchions du but de notre voyage. Il faisait un froid glacial, le froid le plus terrible que nous eussions connu dans ces régions déjà si froides. Une tempête de neige glacée nous cinglait le visage. Nos robes claquant au vent étaient criblées de glaçons qui écorchaient les endroits de la peau laissés sans protection. À près de vingt-cinq mille pieds (7 600 m) au-dessus du niveau de la mer, le ciel était d'un violet éclatant et, par comparaison, les quelques nuages qui couraient dans le ciel étaient d'une extraordinaire blancheur. On eût dit les chevaux blancs des dieux emportant leurs cavaliers à travers le Tibet.
Nous continuâmes notre ascension, rendue chaque jour plus difficile en raison de l'état du terrain, la gorge en feu comme si nous avions avalé des lames de rasoir. Maintenant à grand-peine notre équilibre, nous nous agrippions aux moindres aspérités en enfonçant nos doigts dans les plus petites fentes des glaciers. Enfin, nous arrivâmes à la mystérieuse ceinture de nuages (voir ‘Le Troisième Œil’). Au fur et à mesure que nous la traversions, le sol se réchauffait sous nos pieds et l'air ambiant devenait de plus en plus doux et de plus en plus reposant. Émergeant peu à peu du brouillard, nous arrivâmes dans un charmant sanctuaire, un paradis verdoyant. Devant nous s'étendait un pays d'un âge révolu.
Cette nuit-là, nous nous reposâmes bien au chaud, en savourant le bien-être du Pays Secret. C'était merveilleux de dormir sur un moelleux tapis de mousse et de respirer le doux parfum des fleurs. Il y avait dans ce pays des fruits que nous n'avions jamais goûtés et dont nous fîmes nos délices. Quelle volupté aussi de pouvoir se baigner dans une eau chaude et de se prélasser à son aise sur une rive dorée.
Le lendemain, nous repartions ; notre voyage nous amenait à des altitudes toujours plus hautes, mais la clémence du climat rendait notre avance facile. Sur notre passage, nous rencontrions des massifs de rhododendrons, des noyers et bien d'autres arbres dont le nom nous était inconnu. Ce jour-là, nous ne pressâmes pas l'allure. Une fois de plus la nuit tomba sur nous mais nous étions à l'abri du froid, détendus et confortables. Assis sous les arbres, nous eûmes vite fait d'allumer un feu et de préparer notre dîner, après quoi, enroulés dans nos robes, nous nous couchâmes sur le sol pour bavarder jusqu'à ce que, l'un après l'autre, le sommeil nous surprît.
Nous repartîmes de bon matin ; à peine avions-nous parcouru deux ou trois milles (3 ou 4,8 km) que tout à coup, à notre vive surprise, nous débouchions sur un paysage sans arbres et quel paysage ! Nous nous arrêtâmes net, paralysés pour ainsi dire par l'étonnement, tremblants à la pensée que nous nous trouvions devant quelque chose qui dépassait notre entendement. Devant nous s'étendait une plaine de plus de cinq milles de largeur (8 km). À l'autre bout se dressait un énorme mur de glace, telle une gigantesque fenêtre dressée vers le ciel, une fenêtre ouverte sur le ciel à moins que ce ne fût sur le passé. De l'autre côté, en effet, de ce mur de glace, apparaissait, comme au travers d'une eau très limpide, une étrange ville, absolument intacte, comme nous n'en avions jamais vu même dans les livres illustrés du Potala.
Sur le glacier se profilaient des édifices dont la plupart étaient dans un bon état de conservation ; la glace, en effet, avait fondu si doucement au contact de l'air chaud de la vallée secrète que pas une partie des bâtiments, pas une pierre, n'avaient subi de dégâts. Certains d'entre eux, en fait, étaient absolument intacts ; le merveilleux air du Tibet, sec et pur, les avait préservés depuis d'innombrables siècles. Certains même avaient l'air si neuf qu'ils auraient pu dater de la semaine précédente.
Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, rompit notre silence empreint d'une crainte respectueuse.
— Mes frères, dit-il, voici où vivaient les dieux il y a un demi-million d'années. Il y a cinq cent mille ans, cet endroit était une agréable station balnéaire habitée par des savants d'une race et d'un type différents. Je vous raconterai un jour leur histoire. Sachez cependant qu'ils étaient originaires d'un tout autre pays et qu'après que leurs expériences eurent provoqué une catastrophe sur la Terre, ils s'enfuirent, abandonnant derrière eux l'humanité ordinaire. Ils furent responsables du cataclysme ; c'est au cours de leurs expériences que la mer sortit de son lit pour être littéralement transformée en glace. Vous avez sous les yeux une ville que les glaces de ces temps immémoriaux ont protégée, une ville qui fut engloutie sous les flots lorsque la terre en se soulevant entraîna la mer avec elle et qui fut aussitôt recouverte de glace.
Fascinés, nous écoutions silencieusement mon Guide poursuivre son récit, nous parlant du passé et des vieux documents gravés sur des feuilles d'or et enfouis sous le Potala, comme aujourd'hui dans le monde Occidental les documents sont conservés pour la postérité dans ce qu'ils ont appelé des ‘capsules temporelles’.
D'un commun élan, nous nous levâmes pour explorer les bâtiments les plus proches de nous. Plus nous nous rapprochions et plus notre étonnement grandissait, tant le spectacle était étrange. Pendant quelques secondes, il nous fut impossible de comprendre ce qui nous arrivait. Nous avions le sentiment d'avoir été d'un seul coup transformés en nains. Puis la lumière se fit dans nos esprits. Ces bâtiments immenses avaient été construits pour des hommes deux fois plus grands que nous. Oui, c'était cela, l'explication. La taille de ces hommes, de ces surhommes, était le double de celle de la race humaine actuelle. Nous entrâmes dans quelques maisons pour y jeter un coup d'œil. L'une d'elles en particulier, une sorte de laboratoire, semblait-il, était remplie d'étranges appareils dont certains étaient encore en état de marche.
Un violent jet d'eau glacé me ramena brutalement à la réalité, à ma misérable vie de douleur dans mon oubliette de pierre. Les Japonais avaient décidé que mon séjour y avait été suffisamment long et qu'on ne m'avait pas assez ‘travaillé’. Pour me faire sortir, ils employèrent un moyen très simple : ils remplirent ma cellule d'eau et je flottai à la surface tel un bouchon dans une bouteille pleine. Au moment où j'arrivai à la surface, près de l'étroit goulot de la cellule, des mains rudes me hissèrent hors de l'eau. Après quoi, on me jeta dans une autre cellule, située cette fois au-dessus du sol.
Le lendemain, on m'en fit sortir pour me remettre au travail. Un peu plus tard dans la semaine, une nouvelle inspection de hauts fonctionnaires japonais provoqua un grand affolement. Tout à fait surpris, les gardes furent pris de panique. Je me trouvais alors tout près de la grande porte du camp. Comme personne ne semblait se soucier de moi, j'en profitai pour m'éloigner, pas trop vite certes, pour ne pas attirer l'attention, mais pas trop lentement non plus car il n'était guère sain de musarder dans les parages ! Je continuai à marcher comme si j'avais parfaitement le droit de me trouver hors du camp. Une sentinelle m'ayant hélé, je me tournai vers elle et la saluai de la main. Pour une raison ou pour une autre, elle en fit autant et reprit sa faction. Je poursuivis mon chemin et dès que des buissons me cachèrent du camp, je me mis à courir aussi vite que mes pauvres forces me le permettaient.
Il me revint à l'esprit qu'à quelques milles (km) de là, des Occidentaux de ma connaissance possédaient une maison. J'avais été en mesure autrefois de leur rendre quelques services. Aussi, dès la tombée de la nuit, je m'y rendis, à pas prudents. Ils m'accueillirent avec de nombreuses expressions de commisération, pansèrent mes blessures, me donnèrent à manger et me mirent au lit, en me promettant de tout mettre en œuvre pour me faire traverser les lignes japonaises. Je m'endormis, détendu et heureux de me retrouver entre des mains amies.
Des cris rauques accompagnés de coups me sortirent brutalement de mon sommeil et me ramenèrent à la réalité. Des gardes japonais penchés sur moi me tiraient hors du lit en me piquant les côtes de leurs baïonnettes. En dépit de leurs protestations d'amitié, mes hôtes avaient attendu que je fusse endormi pour prévenir les Japonais qu'un prisonnier s'était réfugié sous leur toit. Les gardes n'avaient pas perdu de temps pour venir me cueillir. Avant d'être emmené, je réussis à demander aux Occidentaux pourquoi ils s'étaient conduits avec tant de perfidie. Leur réponse fut parfaitement claire.
— Nous ne sommes pas de la même race, dirent-ils. Nous devons nous occuper d'abord de nos compatriotes. Vous garder eût été commettre un acte d'hostilité vis-à-vis des Japonais, qui eût pu compromettre notre action.
De retour au camp, je fus vraiment très, très maltraité. Hissé au haut d'une branche, j'y restai suspendu pendant des heures, suspendu par les deux pouces attachés l'un à l'autre. Ensuite le commandant du camp procéda à un simulacre de jugement.
— Cet individu, lui dit-on, est un récidiviste de l'évasion et nous cause trop d'ennuis.
La sentence prononcée, on me roua de coups, et je tombai à terre. Aussitôt, ils me forcèrent à m'étendre et ils placèrent sous mes jambes des billots de bois de façon à les caler sans qu'elles touchassent terre. Deux gardes japonais prirent place sur mes jambes et sautèrent dessus. D'un coup, les os se rompirent et la douleur fut si atroce que je m'évanouis. Quand je repris mes esprits, je me retrouvai dans un cachot froid et humide, infesté de rats.
Manquer à l'appel qui avait lieu avant l'aurore, c'était, je le savais, signer son arrêt de mort. À l'aide de bambous apportés par un de mes compagnons de captivité, je fabriquai des éclisses que je fixai à chacune de mes jambes pour maintenir les os en place. Deux autres bambous me servirent de béquilles et je m'appuyai sur un troisième pour garder mon équilibre. Ainsi, je réussis à être présent à l'appel et à éviter d'être pendu, ou criblé de coups de baïonnette, ou éventré, ou encore mis à mort selon une des techniques dans lesquelles les Japonais étaient passés maîtres.
Dès que mes jambes furent guéries et les os remis en place — tant bien que mal puisque je n'avais personne pour me soigner — le commandant me fit appeler. Il m'informa que j'allais être envoyé dans un camp de femmes, situé encore plus à l'intérieur des terres, à titre d'officier de santé. Comme un convoi de camions devait s'y rendre et que j'étais le seul prisonnier à être transféré, on me fit monter sur le marchepied d'une voiture où je fus enchaîné comme un chien. Après plusieurs jours de voyage, le convoi arriva à mon nouveau camp, on me libéra de mes liens et je fus conduit auprès du commandant.
Le matériel médical et les médicaments nous faisaient cruellement défaut. Il nous fallut utiliser au mieux de vieilles boîtes de fer-blanc que nous affûtions sur des pierres, des bambous durcis au feu, et fabriquer de la charpie avec des vêtements en loques. Certaines femmes n'avaient rien pour se couvrir ou portaient des guenilles. Les opérations se pratiquaient sans endormir les patientes et les plaies étaient cousues avec des fils de coton bouilli. Souvent, aux approches de la nuit, les Japonais faisaient sortir les femmes de leurs baraques pour les passer en revue. Celles qu'ils trouvaient à leur goût, ils les emmenaient dans les baraquements des officiers pour servir aux amusements de ces messieurs ou des visiteurs de marque. Le lendemain matin, les femmes étaient raccompagnées à leurs baraques, malades, la honte inscrite sur leur visage ; et il me fallait, en tant que médecin des internées, essayer de soigner leurs pauvres corps malmenés.
Chapitre Dix
Comment il faut respirer
Les gardes étaient de nouveau de fort méchante humeur. Officiers et soldats parcouraient le camp, le visage renfrogné, frappant tous ceux qui avaient le malheur de rencontrer leur regard. Nous envisagions sans joie une nouvelle journée de terreur, de corvées inutiles et de privations. Quelques heures auparavant, une grosse voiture américaine tombée aux mains des Japonais était arrivée dans un tourbillon de poussière et s'était arrêtée si brutalement que ceux qui l'avaient fabriquée en auraient eu le cœur brisé. Des commandements et des cris avaient retenti et les soldats s'étaient rassemblés en boutonnant précipitamment leurs uniformes minables. Les gardes se ruèrent sur n'importe quelle pièce d'équipement qui leur tombait sous la main pour sauver les apparences et montrer qu'ils étaient efficaces et faisaient leur travail.
Un des généraux commandant la région venait de nous faire la surprise de sa visite, et pour une surprise, c'en fut vraiment une ! Personne ne s'attendait à cette inspection puisque la dernière avait eu lieu à peine deux jours auparavant. Parfois les Japonais organisaient une inspection uniquement pour regarder les femmes et choisir celles qui assisteraient à leurs ‘réceptions’. Après les avoir fait mettre en rang, ils les examinaient et en choisissaient quelques-unes à leur goût qu'ils faisaient emmener sous escorte armée. Un peu plus tard, nous entendions des cris d'angoisse et des hurlements de terreur... ou de souffrance. Cette fois, pourtant, il s'agissait d'une véritable inspection, faite par un homme important, un général venu spécialement du Japon pour se rendre compte de ce qui se passait dans les camps de concentration. Nous devions apprendre plus tard qu'à la suite de quelques revers, on avait pensé en haut lieu qu'au cas où les atrocités seraient par trop nombreuses, certains personnages officiels seraient obligés de rendre des comptes !
Enfin les gardes, alignés tant bien que mal et non sans de multiples bousculades qui soulevaient des nuages de poussière devant leurs yeux effrayés, furent prêts pour l'inspection. De derrière les barbelés, nous regardions ce spectacle avec beaucoup d'intérêt puisque cette fois c'était leur tour d'être inspectés. Les soldats étaient déjà depuis longtemps sur les rangs, quand l'atmosphère devint brusquement tendue ; il allait sûrement se passer quelque chose. Une certaine agitation se manifesta devant la salle de garde et nous vîmes qu'on présentait les armes. Le général apparut et avec des effets de torse commença à passer les troupes en revue, son long sabre de samouraï traînant derrière lui. Il était furieux d'avoir dû attendre, la colère lui déformait le visage et ses aides de camp paraissaient nerveux et mal à leur aise. Passant à pas lents devant les hommes alignés, il s'arrêtait parfois devant l'un d'eux, cherchant quelque chose à lui reprocher. Vraiment ce jour-là, tout allait de travers et les choses se présentaient de plus en plus mal.
À vrai dire, les petits ‘Fils du Ciel’ faisaient piètre figure. Complètement affolés ils avaient, dans leur hâte, ramassé le matériel le plus hétéroclite, fût-il le moins approprié. Il leur fallait montrer que loin de perdre leur temps à flâner dans le camp, c'étaient tous des gens ayant fort à faire. Tout à coup, le général fit halte ; il haletait de rage. Un des soldats portait sur l'épaule, en guise de fusil, une perche munie d'une vieille boîte de conserve avec laquelle une des prisonnières, un peu auparavant, avait nettoyé les latrines. Le général posa son regard sur l'homme, puis sur la perche, et enfin leva la tête pour examiner la boîte. Sa colère atteignant au paroxysme, il se vit incapable de prononcer le moindre mot. Déjà, en se dressant sur la pointe des pieds, il avait violemment souffleté des soldats qui n'avaient pas eu l'honneur de lui plaire. Mais à la vue de cette perche, il devint fou furieux. Il se mit à trépigner de rage en cherchant du regard un objet quelconque pour frapper le soldat. Une idée lui traversa l'esprit. Il se baissa, décrocha le fourreau de son épée et se servit de cette arme de cérémonie pour assener un coup extrêmement violent sur la tête du malheureux garde. Les genoux du pauvre type se dérobèrent sous lui et il s'effondra sur le sol, perdant des flots de sang par les narines et par les oreilles. Le général lui décocha alors un coup de pied méprisant ; sur un signe de lui, des gardes prirent le malheureux par les pieds et le traînèrent sur le sol où sa tête rebondit plusieurs fois. Enfin, il disparut de notre vue. Nous ne devions jamais plus le revoir.
Tout alla de travers au cours de cette inspection. Le général et les officiers de sa suite trouvèrent partout des raisons d'être mécontents. Sous l'effet de la rage leur visage tourna à un curieux rouge violacé. La première inspection terminée, une autre eut lieu immédiatement après. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. Pour nous, l'affaire eut son bon côté, car le général fut si mécontent des gardes qu'il en oublia les prisonnières. Finalement, les officiers supérieurs disparurent dans la salle de garde d'où nous parvinrent des cris de colère et une ou deux détonations. Après quoi, ils remontèrent dans leurs voitures et s'en allèrent. Les soldats reçurent l'ordre de rompre les rangs ; quand ils se dispersèrent, ils tremblaient encore.
Donc, les gardes étaient de fort méchante humeur. Ils venaient juste de rosser une Hollandaise si grande qu'elle les dominait de la tête, ce qui leur donnait un complexe d'infériorité. Ils ne lui avaient pas caché qu'être plus grande qu'eux, c'était insulter l'empereur. Abattue d'un coup de crosse, elle avait été piétinée et tourmentée de toutes les façons, au point que des lésions internes avaient provoqué de fortes hémorragies. Pendant une heure ou deux encore, il lui fallut rester perdant son sang, agenouillée devant la salle de garde, à l'entrée principale du camp. Sans leur autorisation, il était impossible de transporter une prisonnière, quel que soit son état. Venait-il à mourir, cela ne faisait jamais qu'une bouche de moins à nourrir. Aussi, les Japonais se soucièrent peu de la pauvre malheureuse à qui il ne resta plus qu'à mourir. Elle devait s'écrouler peu avant le coucher du soleil, sans que personne pût aller à son secours. Enfin, un garde fit signe à deux prisonnières de l'enlever. Quand ils m'apportèrent son corps, il n'y avait plus rien à faire. La Hollandaise était morte, saignée à blanc.
Il était très difficile de soigner les malades du camp. Nous manquions de tout, à commencer par les bandages qui étaient usés à force d'avoir été lavés et relavés, et dont les fils nous restaient dans la main. Quant à en fabriquer d'autres avec nos vêtements, il n'en était pas question, nous n'en avions déjà pas assez et certaines prisonnières n'avaient même pas de quoi se vêtir. Le problème se posait de la façon la plus aiguë. Il y avait tant de plaies, tant de blessures à soigner, et nous étions si démunis. Mais au Tibet j'avais étudié les simples, ce qui me permit lors d'un commando hors des limites du camp de voir une plante qu'il me sembla reconnaître. C'était une plante de grande taille dont les feuilles épaisses possédaient d'éminentes propriétés astringentes, ce dont justement nous avions désespérément besoin. Il s'agissait donc pour nous d'en ramener de grandes quantités au camp, mais comment ? Nous en discutâmes, en petit comité, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Finalement, il fut décidé que des commandos de prisonnières devraient coûte que coûte cueillir ces feuilles et se débrouiller pour les ramener en les cachant sur elles d'une façon qui restait à mettre au point. Après un long échange de vues, une prisonnière fort astucieuse suggéra que la prochaine corvée dissimulât ces feuilles dans les larges tiges de bambou qu'elle était chargée de ramasser.
Les femmes, ou plutôt les ‘filles’ comme elles s'appelaient elles-mêmes quel que fût leur âge, ramenèrent de grandes quantités de ces feuilles charnues. Les voir me remplit de joie : j'avais l'impression de retrouver de vieux amis. Nous les étalâmes sur le sol derrière nos baraquements, sous l'œil indifférent des Japonais qui crurent sans doute que nous avions perdu la tête. Quoi qu'il en soit, il était nécessaire de les étendre pour pouvoir les trier ; les ‘filles’, peu habituées à ce genre de cueillette, nous en avaient en effet rapporté de toutes les sortes, alors qu'une seule variété pouvait nous être utile. Un tri nous permit de sélectionner celles que nous voulions. Quant au reste, dont il fallut bien se débarrasser, nous le jetâmes sur le tas de cadavres, qui s'élevait en bordure du camp.
Après avoir séparé les petites feuilles des grandes, nous les nettoyâmes soigneusement. Il ne nous était pas possible de les laver car l'eau, au camp, était une denrée très rare. Cela fait, nous partîmes à la recherche d'un récipient, dans lequel il serait possible de les broyer. Le bol à riz du camp étant le plus grand que nous pussions trouver, nous y plaçâmes nos feuilles triées avec tant de soin. Nous nous occupâmes ensuite de trouver une pierre qui nous permît de réduire les feuilles, après macération, en une fine pulpe. Finalement, nous réussîmes à en trouver une qui nous convenait ; il n'était pas possible de la tenir d'une main. Aussi les femmes, qui m'aidaient, se relayaient-elles pour malaxer et écraser les feuilles et nous obtînmes une pâte visqueuse de couleur verte.
Il nous fallut ensuite trouver quelque chose qui absorbât le sang et le pus pendant que l'astringent agissait et aussi un moyen de maintenir le tout en place. Le bambou est une plante aux multiples usages ; nous décidâmes de lui en trouver un autre. Ayant extrait la moelle de vieux rotins et de morceaux de bois, nous la fîmes sécher au-dessus d'un feu dans une boîte de fer. Bien séchée, elle était fine comme de la farine et possédait des pouvoirs absorbants supérieurs à ceux du coton hydrophile. Le mélange, moitié moelle de bambou et moitié feuilles écrasées donna des résultats très satisfaisants. Malheureusement, il était si friable qu'il s'émiettait dès qu'on y touchait.
Trouver une surface plane pour y étaler la pâte ne fut pas facile. Nous fûmes obligés de décortiquer de jeunes pousses de bambou et d'effilocher leurs fibres extérieures avec beaucoup de soin pour obtenir des fils suffisamment longs. Ces fils furent ensuite placés sur une plaque de métal soigneusement nettoyée, qui servait à isoler le plancher du feu. Nous disposâmes alors les fibres les unes sur les autres, comme si nous avions voulu tisser un tapis long et étroit. Finalement, après un dur labeur, nous réussîmes à obtenir une sorte de médiocre claie, mesurant huit pieds (2 m 44) de long sur deux pieds (61 cm) de large.
Un rouleau découpé dans une tige de bambou de gros diamètre nous permit de faire entrer le mélange de moelle et de feuilles entre les mailles, de façon que toutes les fibres fussent recouvertes d'une couche à peu près régulière. Après quoi, nous retournâmes la claie pour en recouvrir l'autre face. Ainsi, nous obtînmes une sorte d'apprêt vert pâle, qui étanchait le sang et facilitait la cicatrisation. Cette préparation ressemblait à la fabrication du papier : nous avions obtenu une sorte de carton vert très épais et souple, mais difficile à plier et à couper avec les outils grossiers dont nous disposions. Nous réussîmes néanmoins à le découper en languettes de quatre pouces (10 cm) environ de large et à les décoller de la plaque de métal à laquelle elles adhéraient. Telles qu'elles étaient, elles gardaient leur souplesse pendant des semaines, et nous étions bien heureux de les avoir.
Un jour, une femme employée à la cantine japonaise se fit porter malade et vint me trouver, passablement surexcitée. En nettoyant un réduit où était entreposé un important matériel pris aux Américains, elle avait par mégarde renversé une boîte dont l'étiquette avait disparu et d'où s'étaient répandus des cristaux d'un brun rougeâtre. Distraitement, elle y avait porté la main : à quoi pouvaient-ils donc servir ? Quand un peu plus tard elle avait voulu se laver les mains, elles étaient couvertes de taches légèrement brunâtres. Était-elle empoisonnée ? Les Japonais lui avaient-ils tendu un piège ? "Il valait mieux, pensa-t-elle, venir me trouver très vite." J'examinai ses mains et en reniflai l'odeur... Si j'avais été émotif, j'aurais pu sauter de joie. L'origine de ces taches était évidente : ces cristaux étaient du permanganate de potasse, exactement ce dont nous avions besoin pour soigner les ulcères tropicaux qui étaient si fréquents.
— Nina, lui dis-je, débrouille-toi pour m'apporter cette boîte. Remets le couvercle, camoufle-la dans un seau vide, fais ce que tu veux mais rapporte-la-moi en la gardant bien au sec.
Elle retourna à la cantine, débordante de joie à la pensée que grâce à elle les souffrances des autres seraient atténuées. Quelques heures après, elle était de retour avec une boîte de cristaux, qui fut suivie d'une autre quelques jours plus tard et enfin d'une troisième. Ce jour-là, nous bénîmes les Américains !... et même les Japonais qui avaient été assez intelligents pour leur voler ce permanganate !
L'ulcère tropical est une maladie affreuse, provoquée principalement par une alimentation et des soins insuffisants. L'impossibilité de se laver à fond peut contribuer à son développement. Le malade ressent d'abord une légère démangeaison et il se gratte machinalement. Puis, apparaît un petit bouton de la grosseur d'une tête d'épingle, si exaspérant qu'on finit par l'écorcher. La saleté des ongles a tôt fait d'infecter la plaie, et petit à petit toute cette partie du corps devient d'un rouge violent. Sous la peau se forment de petits nodules jaunes qui aggravent l'irritation et provoquent d'autres démangeaisons frénétiques. L'ulcère s'élargit et se creuse : un pus nauséabond apparaît. Au bout d'un certain temps le corps réagit de moins en moins bien et l'état général s'aggrave. L'ulcère ronge la chair, gagne de plus en plus en profondeur, atteint le cartilage, parfois l'os, détruisant moelle et tissus. Faute alors de soins énergiques, le malade est condamné à une mort certaine.
Il fallait donc faire quelque chose, reséquer d'une façon ou d'une autre, et le plus rapidement possible cet ulcère, source de l'infection. Manquant de tout matériel médical, force nous fut d'avoir recours à des mesures désespérées. Pour sauver la vie du patient, nous devions opérer l'ulcère, l'enlever radicalement. Eh bien, il n'y avait qu'une seule façon de faire : découper une curette dans une vieille boîte de conserve, en affûter le bord et le stériliser le mieux possible sur la flamme d'un feu. Pendant que des prisonnières maintenaient leur camarade, j'enlevais à l'aide de cette curette tranchante la chair morte et le pus, en respectant les tissus sains. Il fallait veiller à ne pas laisser le moindre foyer d'infection sans quoi l'ulcère aurait repoussé comme une mauvaise herbe. Une fois les tissus complètement nettoyés de leur pourriture, la grande cavité était comblée avec notre bouillie d'herbes et à force de soins infinis, la malade recouvrait la santé, tout au moins relativement, car ce qu'était la santé au camp eût été ailleurs presque synonyme de la mort. Ce permanganate de potasse allait faciliter la guérison de ces ulcères par son action sur le pus et autres sources d'infection. Aussi nous était-il plus précieux que des pépites d'or !
Notre thérapeutique vous semble brutale ? Elle l'était assurément ! Mais cette ‘brutalité’ permit de sauver de nombreuses vies et d'éviter de douloureuses amputations. Sans ce traitement, les ulcères devenaient de plus en plus gros, ils empoisonnaient le système, au point que pour sauver la vie de la malade, l'amputation du bras ou de la jambe — pratiquée sans anesthésiques — devenait inéluctable. Au camp, l'hygiène était un grave problème. Les Japonais nous refusaient tout secours ; aussi j'en vins à utiliser mes connaissances dans l'art de respirer et j'enseignai à bon nombre de mes malades de captivité des exercices respiratoires spéciaux. Une respiration correcte, c'est-à-dire bien rythmée, permet en effet d'améliorer grandement la santé morale et physique.
Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'avait enseigné l'art de respirer un jour où il m'avait surpris, à mi-hauteur d'une colline, soufflant comme un bœuf, au bord de la syncope.
— Lobsang, Lobsang, me dit-il, comment t'es-tu mis dans un état pareil ?
— Honorable Maître, répondis-je en haletant, j'ai voulu gravir cette colline, monté sur mes échasses.
Il me jeta un regard peiné en hochant la tête d'un air tristement résigné puis, avec un soupir, me fit signe de m'asseoir. Il s'ensuivit un long silence, silence que troublaient cependant, tant que je n'eus pas repris mon souffle, les bruits rauques sortant de ma poitrine.
J'étais allé sur mes échasses près de la route de Lingkhor ‘épater’ les pèlerins ; il s'agissait de leur prouver que personne à Lhassa n'était plus habile dans l'art de monter sur des échasses, qu'il s'agisse de vitesse ou d'endurance, que les moines du Chakpori ! Pour parachever ma démonstration, j'avais entrepris de gravir, toujours sur mes échasses, une colline située près de la route. Mais à peine avais-je atteint le premier tournant, disparaissant ainsi de la vue des pèlerins, que je m'étais écroulé, complètement épuisé. C'est dans cette posture ridicule que mon Guide m'avait surpris.
— Lobsang, dit-il, il est grand temps que tu développes tes connaissances. C'en est assez des jeux et des sports. Comme tu viens de le démontrer si éloquemment, tu as grand besoin d'apprendre à respirer. Suis-moi, nous allons voir comment remédier à cet état de choses. S'étant relevé, il se mit à monter la colline. Je lui emboîtai le pas, de mauvaise grâce, après avoir ramassé mes échasses qui gisaient sur le sol. Il avançait à grandes enjambées ; on eût dit qu'il glissait, sans effort apparent, tandis que moi, son cadet par bien des années, haletant comme un chien par une brûlante journée d'été, j'avais beaucoup de mal à le suivre.
Parvenus au sommet de la colline, nous pénétrâmes dans l'enceinte de la lamaserie, et je suivis mon Guide jusque dans sa chambre. Une fois assis à même le sol, comme à l'accoutumée, il sonna pour se faire apporter l'inévitable thé sans lequel aucun bon Tibétain ne peut soutenir une discussion sérieuse. Nous gardâmes le silence pendant que des moines nous servaient le thé et la tsampa ; après leur départ, le lama, tout en versant le thé, me donna ma première leçon sur l'art de respirer, leçon qui devait me rendre d'inestimables services au cours de mon séjour dans ce camp.
— Lobsang, me dit-il, tu souffles comme un vieillard. Je t'apprendrai vite à surmonter cela. Un acte si quotidien, si banal, si naturel que la respiration ne devrait pas demander tant d'efforts. Trop de gens négligent leur respiration. Ils se figurent qu'il suffit d'absorber une certaine quantité d'air puis de la rejeter et ainsi de suite.
— Mais, Honorable Maître, répondis-je, voilà neuf ans et plus que je ne respire pas trop mal ! Comment pourrais-je respirer autrement que je l'ai toujours fait ?
— Lobsang, rappelle-toi que le souffle est la source même de la vie. Tu peux marcher, tu peux courir, certes, mais uniquement parce que tu respires. Il te faut apprendre une nouvelle méthode et pour cela adopter d'abord un rythme respiratoire ; seul ce rythme en effet permet de mettre au point les divers temps de la respiration ; or, les temps varient avec le but cherché. (Se saisissant de mon poignet gauche, il me montra un endroit particulier.) Prends la pulsation de ton cœur. Il bat à la cadence de l, 2, 3, 4, 5, 6. Mets ton doigt ici et sens ton pouls toi-même... Tu comprendras ce que je veux dire. J'obéis et en posant le doigt sur mon poignet gauche, je sentis nettement mon pouls qui battait comme il me l'avait dit : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je levai ensuite les yeux sur mon Guide qui poursuivit :
— Si tu fais attention, tu constateras que tes respirations durent le temps qu'il faut à ton cœur pour battre six fois. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois à même de modifier considérablement ton rythme respiratoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. (Il se tut un moment, puis reprit, les yeux fixés sur moi :) Sais-tu, Lobsang, que vous autres garçons — je vous ai observés attentivement au cours de vos jeux — vous vous éreintez uniquement parce que vous ignorez le premier mot de l'art de respirer. À vos yeux, tout ce qui compte, c'est de faire entrer de l'air dans vos poumons puis de l'en faire sortir. Vous ne pourriez pas vous tromper plus lourdement. Pour respirer, il existe quatre grandes méthodes et nous allons les passer en revue pour en voir les avantages et en quoi elles consistent. La première ne vaut pas grand-chose. On la connaît sous le nom de ‘respiration par le haut’, car elle n'intéresse que la partie supérieure de la poitrine et des poumons, c'est-à-dire, comme tu dois le savoir, une partie infime de la capacité respiratoire. Dans cette méthode, par conséquent, la quantité d'air qui pénètre dans les poumons est très limitée, tandis qu'au contraire le creux des poumons reste plein d'air vicié. Vois-tu, seul le haut de la poitrine entre en action... le bas ainsi que l'abdomen restent immobiles, ce qui est très mauvais. Oublie donc cette ‘respiration par le haut’ Lobsang, elle est sans aucune utilité. C'est la plus mauvaise de toutes. Maintenant, passons aux autres.
Après une pause, il se tourna vers moi en disant :
— Tiens, je vais te montrer en quoi consiste la respiration par le haut. Regarde la position incommode à laquelle elle me condamne. Comme tu le constateras plus tard, cette méthode est celle de la plupart des Occidentaux, et en fait de la plupart des peuples, à l'exception de ceux du Tibet et de l'Inde. Cela explique la confusion de leurs pensées et leur paresse mentale.
Je le regardai bouche bée... Jamais je n'aurais cru que respirer pût poser tant de problèmes. J'avais toujours été persuadé que je ne me débrouillais pas trop mal et voilà que j'apprenais que j'étais dans l'erreur.
Lobsang, tu ne m'écoutes pas... Passons maintenant à la seconde méthode, la respiration dite ‘médiane’. Elle n'est pas très fameuse non plus. Il est inutile de nous y attarder puisque je ne veux pas que tu l'emploies, mais lorsque tu arriveras en Occident, tu en entendras parler sous le nom de ‘respiration costale’, une respiration qui suppose l'immobilité du diaphragme. La troisième méthode, ou ‘respiration par le bas’, n'est pas parfaite, si elle est légèrement supérieure aux précédentes. Certains la connaissent sous le nom de ‘respiration abdominale’. Les poumons ne sont toujours pas complètement remplis, l'air qui s'y trouve n'est donc pas entièrement renouvelé, il se vicie, d'où une mauvaise haleine et des maladies. Laisse donc de côté ces trois méthodes et pratique comme moi et tous les lamas d'ici, la ‘respiration totale’ dont je vais te faire une démonstration.
"Ah ! pensai-je, nous y voilà... Je vais enfin apprendre quelque chose... mais pourquoi m'avoir parlé de toutes les autres méthodes, puisque je ne dois pas les pratiquer ?"
— Parce que, Lobsang, me dit mon Guide qui avait manifestement lu mes pensées, il convient que tu connaisses le mal comme le bien. Au Chakpori, continua-t-il, tu as certainement remarqué que nous insistons toujours sur la nécessité de garder la bouche fermée. Ce n'est pas seulement pour éviter d'offenser la vérité, mais pour nous obliger à respirer exclusivement par le nez. Respirer par la bouche, c'est ne pas utiliser les filtres naturels que sont les narines et la faculté de s'adapter à la température que possède le corps. De plus, à force de ne respirer que par la bouche les narines finissent par se boucher, d'où des catarrhes, des migraines et toutes sortes d'autres malaises.
À ce moment-là, je me rendis compte à ma grande honte que je regardais mon Guide littéralement bouche bée, tant son discours m'étonnait. Aussitôt, je refermai mes mâchoires en les claquant si fort qu'une lueur amusée passa dans ses yeux. Il s'abstint cependant de tout commentaire.
— Le rôle des narines, reprit-il, est des plus importants ; aussi doit-on les garder propres. Si, par hasard, elles s'encrassent, aspire un peu d'eau par le nez, laisse-la couler à l'intérieur de ta bouche, de façon à pouvoir la recracher. Respire seulement par le nez, et jamais par la bouche. À propos, il n'est pas mauvais d'employer de l'eau tiède, car de l'eau froide pourrait te faire éternuer.
Se détournant, il agita la sonnette posée près de lui. Un serviteur apporta de la tsampa fraîche, renouvela le contenu de la théière, puis sortit après nous avoir salués. Quelques instants plus tard, le Lama Mingyar Dondup poursuivait son discours.
— Maintenant, Lobsang, nous allons passer à la vraie façon de respirer, la ‘Respiration Totale’ qui a permis à certains lamas tibétains de prolonger leur vie de façon vraiment extraordinaire. Voyons en quoi elle consiste. Comme son nom l'indique, elle réunit les trois autres méthodes, inférieure, médiane et supérieure, de sorte que les poumons étant complètement ventilés, le sang s'en trouve purifié et chargé de force vitale. Elle est très facile. Il faut d'abord, que l'on soit assis ou debout, adopter une position confortable et respirer par les narines. Je t'observais il y a quelques instants, Lobsang, tu étais complètement affalé, le corps affaissé. Il n'est pas possible de respirer correctement dans une telle position. Il faut se tenir très droit. C'est là tout le secret. Il me regarda en soupirant, mais l'expression ironique de son regard m'empêcha de prendre ce soupir au sérieux. Puis il se leva et, s'étant approché de moi il mit ses mains sous mes coudes et me souleva légèrement pour m'obliger à me tenir droit.
— Voilà, Lobsang, comment il faut t'asseoir, la colonne vertébrale droite, ton abdomen sous contrôle, les bras à tes côtés. Maintenant assis-toi ainsi. Gonfle la poitrine, projette ta cage thoracique en avant, et baisse le diaphragme de façon à gonfler aussi ton bas-ventre. Tu auras alors une respiration complète. Il n'y a rien de magique en tout cela, Lobsang, tu le vois bien, c'est une question de bon sens. Il s'agit seulement de faire entrer dans tes poumons le maximum d'air et de les vider complètement afin de le renouveler. Il se peut que pour le moment tu trouves la méthode compliquée, confuse, voire trop difficile, et sans aucune utilité. Or, elle VAUT la peine que tu fasses un effort. Si tu penses le contraire, c'est parce que tu es léthargique et que tu as contracté des habitudes stupides. Il te faut, par conséquent, commencer à respirer avec discipline.
J'appliquai donc sa méthode et à mon grand étonnement, je m'aperçus que je respirais plus facilement qu'avant. Pendant quelques secondes, j'éprouvai un léger étourdissement, mais par la suite tout se passa très bien. Je voyais les couleurs plus nettement, et au bout de quelques minutes à peine, je me sentais déjà mieux.
— Je vais t'indiquer des exercices respiratoires à faire chaque jour, me dit mon Guide, et je te demande de les pratiquer régulièrement. Grâce à eux, tu ne sauras plus jamais ce que c'est que d'être essoufflé. Cette malheureuse colline t'a épuisé alors que moi, ton aîné, et de combien d'années, je l'ai gravie sans difficultés.
Il se recula pour me regarder respirer selon sa méthode. Tout de suite, je me rendis compte combien il avait raison.
— Quelle que soit la méthode adoptée, reprit-il en s'installant confortablement, notre seul objectif est de faire entrer le maximum d'air dans nos poumons pour que toutes les parties du corps le reçoivent sous la forme de ce que nous appelons le prana, autrement dit : la force vitale. Le prana est la force qui anime les hommes et tout ce qui vit, plantes, animaux, jusqu'aux poissons qui doivent tirer leur oxygène de l'eau pour le transformer en prana. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, Lobsang, c'est ta façon de respirer. Aspire l'air lentement et retiens-le pendant quelques secondes. Puis expire-le très lentement. Tu apprendras que pour ces trois opérations — inspiration, rétention de l'air, expiration — il existe différents rythmes permettant d'obtenir la purification, la revitalisation, etc. La respiration la plus importante peut-être de toutes est celle que nous appelons le ‘souffle purificateur’. Nous allons l'examiner maintenant, car je veux que dorénavant tu le pratiques matin et soir ainsi qu'au début et à la fin de tous tes exercices.
J'avais suivi ses paroles avec la plus grande attention ; en effet, je connaissais fort bien les pouvoirs des grands lamas, je savais qu'ils pouvaient glisser sur le sol plus vite qu'un cavalier lancé au galop et arriver à leur destination reposés, sereins, maîtres d'eux-mêmes. Je résolus qu'avant de devenir lama — je n'étais alors qu'un acolyte — je posséderais à fond l'art de respirer.
— Voyons donc, Lobsang, reprit mon Guide, en quoi consiste ce souffle purificateur. Respire à fond, trois fois de suite. Non, rien de superficiel comme cela. Je veux des inspirations vraiment très profondes, les plus profondes possible ; remplis bien tes poumons, tiens-toi droit et laisse l'air envahir ton corps. C'est bien. Maintenant, à la troisième inspiration, retiens l'air pendant quatre secondes à peu près, arrondis les lèvres comme si tu allais siffler, mais sans gonfler les joues. Souffle un peu d'air entre tes lèvres de toutes tes forces. Souffle fort, pour qu'il s'en aille. Assez ! Garde l'air dans tes poumons pendant une seconde. Souffle encore un peu, encore de toutes tes forces. Arrête-toi une seconde, puis souffle tout l'air qu'il te reste en vidant complètement tes poumons. Souffle le plus vigoureusement possible. Souviens-toi que dans ce cas-ci tu DOIS chasser l'air par les lèvres avec le maximum d'énergie. Et maintenant dis-moi, n'éprouves-tu pas une merveilleuse impression de fraîcheur ?
Je dus en convenir, non sans surprise. Je m'étais d'abord senti un peu ridicule en gonflant mes joues et en soufflant l'air de mes poumons, mais après quelques essais, je me sentis plein d'énergie et dans une ‘forme’ que je n'avais peut-être jamais connue auparavant. Je me mis donc à dilater mes poumons, à aspirer et à souffler à m'en faire sauter les joues. Tout à coup, j'eus la tête qui tournait et je me sentis devenir de plus en plus léger. La voix de mon Guide me parvint à travers une sorte de léger brouillard.
— Arrête, Lobsang, arrête ! Ne respire pas comme cela. Respire comme je te le dis. Pas d'expériences surtout, elles sont dangereuses. Te voilà intoxiqué pour avoir respiré de façon incorrecte et trop vite. Borne-toi aux exercices que je t'indique, car j'ai l'expérience. Plus tard, tu pourras expérimenter par toi-même. N'oublie pas surtout de mettre en garde ceux que tu instruiras plus tard, contre toute expérience ; qu'ils se contentent des exercices. Dis-leur bien de ne pas modifier la durée des différents temps de la respiration sans être assistés d'un maître compétent, toute modification pouvant être extrêmement dangereuse. Les exercices que je t'enseigne, au contraire, sont excellents pour la santé et sans risques pour quiconque suit les instructions.
"Et maintenant, dit-il en se levant, ce ne serait pas une mauvaise idée d'augmenter ton potentiel nerveux. Lève-toi et tiens-toi aussi droit que moi. Respire autant d'air que possible, puis lorsque tu croiras que tes poumons sont pleins, force-toi à faire une petite inspiration supplémentaire. Expire cet air lentement. Lentement. Remplis tes poumons à nouveau et retiens ton souffle. Étends tes bras droit devant toi sans faire aucun effort ; regarde, juste ce qu'il faut pour maintenir tes bras à l'horizontale en faisant aussi peu d'effort que possible. Maintenant, regarde bien. Ramène tes mains vers les épaules en contractant peu à peu tes muscles et en les raidissant pour qu'au moment où tes mains touchent tes épaules, tes muscles soient très durs et tes poings bien serrés. Regarde comme mes poings sont serrés. Serre tes mains si fortement qu'elles tremblent sous l'effort. Toujours en gardant les muscles tendus, écarte lentement les poings, puis ramène-les rapidement à plusieurs reprises, peut-être une demi-douzaine de fois. Expire vigoureusement, très vigoureusement comme je te l'ai dit avant, par la bouche, les lèvres arrondies avec juste un trou par lequel tu souffles de toutes tes forces. Après avoir répété cet exercice plusieurs fois, termine la séance encore une fois par le souffle purificateur.
Je lui obéis. Cet exercice me fit beaucoup de bien. De plus, je m'amusais beaucoup et j'étais toujours prêt à m'amuser !
— Lobsang, me dit mon Guide, en interrompant mes pensées, je veux insister, et insister encore, sur le fait que la vitesse du mouvement en arrière des poings et la tension des muscles déterminent le profit que tu peux retirer de ceci. Bien entendu, avant de l'entreprendre, il est essentiel de remplir complètement ses poumons. Incidemment, je te signale qu'il est d'une utilité inestimable et qu'il te sera d'un très grand secours plus tard.
Il s'assit et me regarda m'entraîner, corrigeant mes fautes avec douceur, ou me félicitant de mes progrès. Quand il fut satisfait, il me fit reprendre dès le début, pour s'assurer que je n'avais plus besoin de ses conseils. Enfin, me faisant signe de prendre place à ses côtés, il me raconta comment la découverte des vieux documents cachés dans les cavernes souterraines du Potala avait permis de mettre au point les méthodes tibétaines de respiration.
Plus tard, au cours de mes études, je devais approfondir le sujet, car au Tibet nous soignons les malades non seulement par les simples mais aussi par des exercices respiratoires. La respiration est la source de la vie ; aussi ces quelques notes permettront peut-être à des gens qui, sait-on jamais, souffrent depuis longtemps, de faire disparaître ou au moins d'atténuer leurs souffrances. Ils y arriveront grâce à une bonne respiration, mais de grâce rappelez-vous de suivre strictement les instructions que je vous donne ici car, à moins d'avoir à ses côtés un maître compétent, il est très dangereux de se livrer à des expériences. Je le répète : expérimenter à tort et à travers est de la ‘folie furieuse’.
Ce que nous appelons la ‘respiration contrôlée’ permet de venir à bout des troubles stomacaux, hépatiques et sanguins. Rien de magique à cela, croyez-le bien, même si les résultats le paraissent, tant ils sont extraordinaires ! Avant tout, il convient de se tenir bien droit ou, si on est couché, d'être complètement allongé. Admettons que vous n'êtes pas alité et que vous pouvez vous tenir debout. Tenez-vous droit, les talons joints, les épaules effacées, la poitrine en avant, en contrôlant la position de votre diaphragme. Procédez à une inspiration profonde, la plus profonde possible et gardez l'air dans vos poumons jusqu'à ce que vous ressentiez une légère, très légère palpitation au niveau des deux tempes. À ce moment-là, expirez l'air par la bouche ouverte, en y mettant toute votre énergie, je dis bien TOUTE votre énergie. Ne vous contentez pas de laisser l'air s'échapper doucement, expulsez-le en soufflant de toutes vos forces. Il convient ensuite de pratiquer l'exercice du ‘souffle purificateur’, sur lequel il est inutile de revenir puisque vous savez déjà tout ce que mon Guide, le Lama Mingyar Dondup m'a enseigné sur ce point. Je me bornerai à vous redire ceci : cet exercice est d'une utilité inestimable, car il améliorera grandement votre état général.
Avant de corriger sa façon de respirer, il importe d'adopter un rythme, une unité de temps égale à la durée d'une inspiration normale. J'ai déjà mentionné ce principe, tel qu'il m'a été enseigné, mais il serait peut-être bon d'y revenir, pour qu'il soit gravé dans votre esprit de façon permanente. Le battement de cœur d'une personne est la norme rythmique appropriée pour la respiration de cet individu particulier. Pratiquement personne n'a la même norme bien sûr, mais c'est sans importance. Pour découvrir le rythme de votre respiration normale, il suffit de placer les doigts de votre main droite sur votre poignet gauche et de compter vos pulsations. Admettons que vous obteniez une moyenne de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fixez ce rythme fermement dans votre subconscient pour le connaître inconsciemment, sub-consciemment, de façon à ne pas avoir à y penser. Mais peu importe votre rythme — je le répète — du moment que vous le connaissez, que votre subconscient le connaît. Supposons donc que le vôtre soit moyen, et que par conséquent votre inspiration dure le temps que votre cœur batte six fois. Il s'agit là de votre rythme routinier ‘quotidien’. Nous serons amenés à en adopter de très différents en fonction des résultats cherchés, sans éprouver de grandes difficultés. En fait rien n'est plus facile et il en résultera une amélioration spectaculaire de la santé. Au Tibet, tous les acolytes d'un rang supérieur apprenaient l'art de respirer. Avant d'étudier quoi que ce fût, il nous fallait pratiquer certains exercices spéciaux et voici comment s'effectuait notre ‘mise en train’. Est-ce que cela VOUS plairait d'essayer ? Eh bien, d'abord tenez-vous droit, debout si vous le voulez, encore que cela ne soit pas nécessaire si vous pouvez être assis. Inspirez lentement selon le système de respiration complète. Ce qui veut dire, poitrine et abdomen tout en comptant six pulsations. Cela est très facile, vous savez. Il suffit de mettre votre doigt sur les veines de votre poignet et de laisser votre cœur battre une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Quand l'air est entré dans vos poumons, comptez trois pulsations avant de le souffler — par le nez — en comptant encore six pulsations ; il faut en d'autres termes que l'expiration ait une durée égale à celle de l'inspiration. Vos poumons une fois vidés, comptez trois pulsations avant d'inspirer à nouveau. Vous pouvez répéter cet exercice autant de fois qu'il vous plaira, à condition de ne pas vous fatiguer. Au moindre signe de lassitude, arrêtez-vous. Ces exercices ne doivent jamais vous fatiguer ; ils doivent au contraire vous stimuler, vous mettre en forme.
Nous commencions toujours nos exercices par le ‘souffle purificateur’, qui ne saurait être répété trop souvent. Il est extrêmement salutaire et ne présente aucun danger. Grâce à lui, l'air vicié et toutes les impuretés sont éliminés des poumons, de sorte qu'au Tibet la tuberculose est inconnue ! Pratiquez donc le ‘souffle purificateur’ chaque fois que vous en aurez envie, il vous fera le plus grand bien.
Une méthode de tout premier ordre pour arriver à contrôler son esprit consiste en se tenant bien droit à procéder à une respiration complète, suivie du ‘souffle purificateur’. Après quoi, respirez à la cadence de un, quatre, deux ; c'est-à-dire (comptons en secondes pour changer !) qu'il vous faut inspirer pendant cinq secondes, puis retenir votre souffle pendant quatre fois cinq secondes, soit vingt secondes. Cela fait, expulsez l'air pendant dix secondes. Cette excellente méthode permet également de soulager de nombreux malaises ; donc si vous ressentez une douleur quelconque, allongez-vous complètement ou asseyez-vous bien droit, comme vous voudrez. Respirez rythmiquement, gardant la pensée dans votre esprit qu'avec chaque inspiration la douleur disparaît, avec chaque exhalation la douleur est poussée dehors. Imaginez que chaque fois que vous aspirez vous aspirez la force de vie qui remplace la douleur. Imaginez que chaque fois que vous expirez vous faites sortir la douleur de votre corps. Mettez votre main sur la partie affectée et imaginez qu'avec votre main avec chaque souffle vous faites partir la cause de la douleur. Faites cela pour sept respirations complètes. Ensuite passez au ‘souffle purificateur’ avant de vous reposer pendant quelques secondes, en respirant lentement et normalement. Vous constaterez probablement que vous ne souffrez plus du tout, ou si peu que cela ne compte pas. Mais si pour une raison quelconque la douleur persistait, répétez la même chose, essayez la même chose une fois ou deux fois de plus jusqu'à ce que finalement vienne le soulagement. Vous comprendrez bien sûr que si c'est une douleur inattendue et si elle se reproduit, vous devrez consulter votre médecin à ce sujet parce que la douleur est un avertissement de la nature que quelque chose ne va pas, et bien qu'il soit parfaitement admissible de chercher à atténuer les souffrances quand elles se font sentir, il n'en reste pas moins essentiel d'en chercher les causes pour y remédier. Aucune douleur ne devrait jamais être négligée !
Si vous vous sentez fatigué, ou s'il vous a fallu donner un brusque ‘coup de collier’, voici une façon très rapide de récupérer vos forces. Encore une fois, il importe peu que vous soyez debout ou assis, du moment que vos pieds sont joints, orteils et talons se touchant. Joignez alors les mains et entrecroisez les doigts, afin que vos mains et vos pieds forment chacun une sorte de cercle fermé. Respirez rythmiquement à quelques reprises, en aspirant profondément et en expirant lentement. Arrêtez-vous le temps de trois pulsations et passez au ‘souffle purificateur’. Vous constaterez alors que votre fatigue a disparu.
Bon nombre de gens sont envahis par une très, très grande nervosité lorsqu'ils doivent rencontrer quelqu'un, au point qu'ils en ont les mains moites quand ce ne sont pas leurs genoux qui tremblent ! Il est vraiment inutile de se mettre dans un état pareil, alors qu'il est si facile de surmonter cette nervosité. Voici une méthode que vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser, qui sait, dans la salle d'attente d'un dentiste ! Inspirez très profondément, par le nez bien entendu, puis gardez l'air dans vos poumons pendant dix secondes. Expirez alors lentement, sans cesser de contrôler votre souffle. Permettez-vous ensuite deux ou trois respirations normales, et refaites une aspiration profonde pendant dix secondes. Retenez votre souffle une nouvelle fois et expirez lentement, toujours pendant dix secondes. Faites cela trois fois ; vous pouvez y arriver facilement sans vous faire remarquer et vous constaterez que vous êtes absolument rassuré. Votre cœur ne battra pas follement dans votre poitrine et vous aurez infiniment plus de confiance en vous-même. En sortant de la salle d'attente pour affronter la personne qui vous attend, vous serez maître de vous. Dans le cas d'un soudain accès de nervosité, faites une aspiration profonde et retenez votre souffle pendant une seconde ou deux, en profitant d'un moment où votre interlocuteur sera en train de parler. Votre assurance sur le point de faiblir s'en trouvera raffermie. Tous les Tibétains pratiquent des méthodes de ce genre. Nous avons aussi recours au contrôle respiratoire pour soulever les objets, qu'il s'agisse de meubles ou de gros ballots ; la meilleure façon de s'y prendre en effet est de prendre une très profonde inspiration et de retenir son souffle tant que dure l'effort. Une fois celui-ci terminé, laissez sortir lentement l'air de vos poumons, puis continuez à respirer normalement. Lever des objets avec les poumons pleins d'air est facile. Faites l'expérience, elle en vaut la peine. Soulevez un objet relativement lourd, d'abord les poumons vides et ensuite avec les poumons bien gonflés, et vous verrez la différence.
La respiration en profondeur permet aussi de maîtriser la colère. Il suffit de retenir son souffle et d'expirer lentement. Si pour une raison quelconque la colère vous gagne — même si elle est sainte ! — aspirez profondément, retenez l'air pendant quelques secondes et expirez très lentement. Vous constaterez que vous dominez vos émotions et que vous êtes le maître (ou la maîtresse) de la situation. Céder à la colère ou à l'irritation est très mauvais pour la santé, car on risque des ulcères à l'estomac. N'oubliez donc pas ces exercices respiratoires : inspiration profonde, temps d'arrêt et expiration lente.
Vous pouvez faire tous ces exercices avec une confiance absolue, sachant qu'ils ne peuvent tout simplement vous nuire d'aucune façon, mais un mot d'avertissement — tenez-vous-en à ces exercices et n'essayez rien de plus avancé sauf sous la direction d'un maître compétent, parce que des exercices de respiration malavisés peuvent faire beaucoup de mal. Au camp nous avions appris à nos camarades prisonnières à respirer correctement. Nous étions même allés plus loin en leur enseignant une technique de la respiration qui les libérait de la douleur ; c'est grâce à celle-ci et à l'hypnotisme que nous fûmes en mesure de mener à bien de graves opérations abdominales et d'amputer bras et jambes. Nous n'avions pas d'anesthésiques, aussi devions-nous recourir à cette méthode pour tuer la douleur — hypnose et contrôle de la respiration. C'est la méthode de la nature, le moyen naturel.
Chapitre Onze
La bombe
Les jours se traînaient avec une lenteur qui nous rongeait l'âme ; ils formèrent des semaines, puis des mois, puis des années. Enfin quelque chose vint rompre la routine des journées que nous passions à soigner les malades. Un matin, les gardes arrivèrent au pas de course, des liasses de papiers à la main, faisant signe à une prisonnière par-ci, une prisonnière par-là. J'étais sur cette liste-là. On nous rassembla sur le terre-plein situé devant nos baraquements. Nous y restâmes des heures à ne rien faire, condamnés à une attente interminable. Quand le commandant apparut, le jour touchait à sa fin.
— Votre abominable conduite, dit-il, est une insulte à notre Empereur. Aussi nous allons vous transférer dans un camp où on s'occupera de vous. Départ dans dix minutes.
Là-dessus, il fit brusquement demi-tour et s'éloigna à grands pas, nous laissant plus ou moins stupéfaits. Dix minutes pour nous préparer ? C'était bien assez pour des gens qui n'avaient rien à eux ! Après avoir fait quelques adieux rapides, nous étions de retour sur le terre-plein.
Nous allions donc changer de camp. Comment serait celui qui nous attendait ? Où serait-il situé ? Autant de questions qui nous venaient à l'esprit, mais comme il est inévitable en pareil cas, personne n'avait de réponses constructives à offrir. Au bout de dix minutes, des coups de sifflet retentirent, les gardes revinrent en courant et notre détachement, fort de quelque trois cents d'entre nous, se mit en marche. Nous aurions aimé savoir où l'on nous menait, mais n'était-il pas vain de s'interroger sur le camp qui allait nous accueillir ? Les Japonais nous considéraient comme des agitateurs ‘patentés’ qui n'avaient jamais cédé à leurs séductions. Et nous connaissions trop bien leurs sentiments pour ne pas être sûrs que notre prochain camp, où qu'il fût situé, n'aurait rien d'agréable !
En chemin, notre colonne croisa des soldats qui paraissaient d'excellente humeur. Nous n'en fûmes guère étonnés puisque d'après les nouvelles qui nous étaient parvenues, les Japonais étaient vainqueurs sur tous les fronts. D'après eux, ils allaient bientôt être les maîtres du monde. Ils se trompaient lourdement ! À l'époque cependant, faute d'autres sources d'information, nous devions nous contenter de ce qu'ils nous racontaient. En nous croisant, ces soldats se montraient fort agressifs, ne laissant échapper aucune occasion de nous donner des coups, de nous frapper sauvagement, sans raison, juste pour le plaisir d'entendre le bruit que fait une crosse quand elle s'écrase sur une chair déjà glacée par la terreur. Nous continuâmes à avancer, pressés par les jurons des gardes toujours prêts eux aussi à faire usage des crosses de leurs fusils. Trop souvent les malades s'écroulaient sur le bord de la route où elles étaient rouées de coups. Si elles ne parvenaient pas à se relever et tout hébétées de fatigue qu'elles fussent, à reprendre la route soutenues par leurs camarades, les gardes avaient vite fait de mettre un terme à leurs souffrances d'un coup de baïonnette. Parfois un garde coupait la tête d'une victime et la fixait au bout de sa baïonnette. Après quoi, il courait le long de notre colonne, et nos regards horrifiés le faisaient éclater d'un rire satanique.
Finalement, après de nombreux jours d'une marche rendue encore plus épuisante par les privations, nous arrivâmes à un petit port, où on nous interna dans un camp rudimentaire près de la mer. Une foule de prisonniers de toutes nationalités, des ‘agitateurs’ comme nous, s'y trouvaient déjà. C'est à peine s'ils levèrent la tête pour nous regarder tant l'épuisement et les mauvais traitements avaient eu raison de leur vitalité. Notre groupe avait tristement fondu : sur les trois cents qui avaient pris le départ, à peine soixante-quinze avaient survécu. Nous passâmes la nuit couchés à même le sol, derrière les barbelés, sans abris ni commodités d'aucune sorte. Il est vrai que nous en avions pris l'habitude. Hommes et femmes couchèrent donc sur le sol nu et firent ce qu'ils avaient à faire sous les yeux des Japonais qui, pendant toute cette longue nuit, gardèrent braqués sur nous les faisceaux de leurs projecteurs.
Le lendemain matin, après l'appel, notre pauvre troupe vacillante dut rester en rangs, pendant deux ou trois heures. Enfin les gardes daignèrent s'occuper de nous et on nous conduisit au port, sur un quai où était amarré un vieux rafiot tout rouillé, véritable épave des mers. J'étais loin d'être compétent en matière de bateaux. En fait, à peu près tous mes camarades en savaient plus long sur la question, mais même moi je me rendis compte que celui-là pouvait sombrer d'une minute à l'autre. Quant à la vieille passerelle pourrie, elle menaçait de s'écrouler à tout instant, et de nous laisser tomber dans une eau couverte d'une écume sale, où flottaient débris, caisses de bois, boîtes de conserve, bouteilles et cadavres humains.
Une fois à bord, on nous fit descendre dans une cale située à l'avant du navire. Nous étions environ trois cents, de sorte qu'il était impossible de s'asseoir et encore moins d'aller et venir. Les derniers arrivés furent littéralement enfoncés dans la cale par les gardes qui ne ménagèrent ni les imprécations, ni les coups de crosse. Tout à coup nous entendîmes un bruit terrible comme si les portes de l'enfer se refermaient sur nous : le panneau venait d'être rabattu avec violence, nous ensevelissant sous des nuages de poussière nauséabonde. Nous entendîmes des maillets s'abattre sur des coins de bois et la cale fut plongée dans l'obscurité. Après ce qui nous parut être un laps de temps terriblement long, le bateau se mit à vibrer ; le vieux moteur poussif laissa échapper des craquements rauques. Nous avions l'impression que la carcasse allait voler en éclats et que nous nous retrouverions bientôt au fond de la mer. Du pont nous parvenaient des cris étouffés et les hurlements des officiers commandant la manœuvre. Les machines continuèrent à faire entendre leur ‘teuf-teuf’ ; bientôt, un terrible mouvement de roulis et de tangage nous fit comprendre que le navire était sorti du port et avait atteint la haute mer. Le voyage n'avait rien d'agréable. La mer devait être démontée, car jetés sans cesse les uns contre les autres, nous nous écroulions sur le fond de la cale où nos camarades nous piétinaient. Une seule fois, pendant la nuit, nous eûmes la permission de monter sur le pont. Les deux premiers jours, on ne nous donna rien à manger. C'était pour briser notre résistance, nous le savions. Mais ils en furent pour leurs frais. Par la suite, nous eûmes droit à une ration quotidienne qui consistait en un bol de riz.
Bientôt de nombreux prisonniers déjà très affaiblis ne purent résister plus longtemps à l'odeur suffocante, à cette réclusion dans une cale nauséabonde où il n'y avait pas assez d'oxygène pour tous. Beaucoup moururent, s'écroulant comme de vieilles poupées désarticulées sur les plaques de fer vissées au fond de la cale. Quant à nous, les survivants, qui étions à peine plus favorisés par le sort, nous fûmes contraints de continuer à vivre avec leurs cadavres qui se décomposaient, puisque les gardes ne nous permettaient pas de les évacuer. Pour eux nous n'étions que des prisonniers, et peu leur importait que nous fussions vivants ou morts, du moment que personne ne manquait sur leurs listes. Aussi les corps putréfiés devaient-ils rester dans la cale en compagnie des malheureux survivants, jusqu'au moment où, arrivés à destination, les gardes pourraient faire l'appel des morts comme des vivants.
Nous avions perdu toute notion du temps quand, après un nombre de jours difficile à estimer, les machines changèrent de régime. Le roulis et le tangage diminuèrent et comme les vibrations se faisaient moins fortes nous supposâmes — à juste titre — que le bateau approchait d'un port. Hurlements... manœuvres... Enfin nous entendîmes qu'on déroulait les chaînes et le bruit des ancres jetées à l'eau. Après une interminable attente, les écoutilles s'ouvrirent et des gardes japonais accompagnés d'un médecin du port commencèrent à descendre dans la cale. À mi-chemin, ils s'arrêtèrent dégoûtés, et le médecin, incommodé par l'épouvantable puanteur, se mit à vomir sur nos têtes. Ensuite, faisant fi de toute dignité, ils battirent en retraite et remontèrent précipitamment sur le pont.
L'incident eut une suite : des tuyaux en effet furent braqués sur nous, et nous faillîmes périr, noyés sous leurs jets puissants. Peu à peu, l'eau s'éleva dans la cale ; nous en eûmes jusqu'à la taille, à hauteur de nos poitrines et enfin de nos mentons, de sorte que des lambeaux de chair putréfiée flottaient juste devant nos bouches. À ce moment-là nous entendîmes des cris et l'eau fut coupée. Un officier de pont se pencha sur nous et il s'ensuivit une vive discussion donnant lieu à force gesticulations. Le bateau allait couler, déclara-t-il, si l'on continuait à nous arroser. Aussi nous balancèrent-ils sur la tête un gros tuyau qui servit à pomper l'eau de la cale.
Toute la journée et toute la nuit on nous laissa au fond du bateau, claquant des dents dans nos guenilles détrempées et l'estomac retourné par l'odeur des cadavres. Le lendemain, on nous fit monter sur le pont par petits groupes de deux ou trois. Ce fut enfin mon tour ; en sortant de la cale, je fus soumis à un interrogatoire sans nuances. Qu'avais-je fait de ma plaque d'identité ? Mon nom fut pointé sur une liste et je fus conduit à grands coups dans les côtes jusqu'à un chaland chargé, ou plutôt surchargé d'une collection de véritables épouvantails vivants, grelottant sous leurs haillons. Certains étaient nus comme des vers. Bientôt l'eau atteignit les plats-bords ; quand il fut évident qu'un seul passager de plus ferait couler l'embarcation, les Japonais décidèrent d'arrêter l'opération. Un canot à moteur se plaça à l'avant et il prit la direction du rivage, tirant derrière lui le vieux chaland délabré au bout d'un câble solidement arrimé.
C'est ainsi que je vis le Japon pour la première fois. Après avoir débarqué, nous fûmes enfermés dans un camp de concentration à ciel ouvert, un terrain vague entouré de barbelés. Là, hommes et femmes furent soumis à un interrogatoire qui dura plusieurs jours. Enfin un petit groupe d'entre nous fut conduit à quelques milles (km) à l'intérieur des terres dans une prison qu'on avait évacuée à notre intention.
Un jour un des prisonniers, un homme de race blanche, déclara sous la torture que j'avais aidé des camarades de captivité à s'évader et que d'autres m'avaient confié des secrets militaires sur leur lit de mort. Ces ‘aveux’ me valurent d'être interrogé une fois de plus — et avec une ardeur... excessive — par des Japonais infiniment désireux de me faire parler. Comme ils avaient vu dans mon dossier que toutes les tentatives précédentes avaient échoué, cette fois ils se surpassèrent vraiment. Mes ongles, qui avaient repoussé, furent retournés et ils frottèrent les endroits à vif avec du sel. Cela ne suffisant pas à me faire mettre ‘à table’, je fus pendu par les deux pouces à une poutre pendant un jour entier, pendaison qui me rendit affreusement malade, sans qu'ils s'en déclarassent satisfaits. La corde fut coupée et je fis une chute sonore sur les dalles cimentées de la salle de torture où je crus me briser les os. On m'enfonça la crosse d'un fusil dans les côtes, puis à genoux sur mon ventre, des gardes m'écartèrent les bras qu'ils attachèrent à deux gros pitons — c'était à n'en pas douter des spécialistes qui n'en étaient pas à leur coup d'essai ! Un tuyau fut introduit de force dans ma gorge. Quand l'eau se mit à couler, je crus que, faute d'air, j'allais mourir asphyxié ou noyé, ou encore que mon corps allait éclater. J'avais l'impression que l'eau giclait par tous mes pores et qu'on me gonflait tel un ballon. La douleur était intolérable. Des points lumineux passaient devant mes yeux. Finalement mon cerveau fut pris comme dans un étau et je m'évanouis. Des stimulants eurent tôt fait de me ranimer, mais j'étais trop faible et trop malade pour me mettre debout. Aussi trois gardes japonais — j'étais de forte corpulence — me traînèrent jusqu'à la poutre où j'avais déjà été pendu.
— Tu as l'air trempé, me dit un officier survenu entre-temps. Il est temps, je pense, de te sécher. Ça te rendra peut-être plus bavard. Allons, qu'on le pende !
Deux gardes se baissèrent brusquement et me tirèrent si brutalement par les chevilles que ma tête heurta violemment le sol en ciment. Mes chevilles furent ligotées à l'aide d'une corde que l'on fit passer par-dessus la poutre ; après quoi, en ahanant comme des travailleurs de force, ils me hissèrent par les pieds jusqu'à une verge (m) environ du sol. Avec lenteur, comme des gens qui ne veulent pas perdre une seconde de leur plaisir, les gardes placèrent, juste en dessous de ma tête, des morceaux de papier et des petits bouts de bois. Un sourire sardonique aux lèvres, l'un d'eux frotta une allumette et y mit le feu. Peu à peu des ondes chaudes montèrent vers moi. Le bois s'enflamma et sous l'effet de la chaleur, je sentis mon cuir chevelu se plisser, se ratatiner.
— Il va mourir, fit une voix. Ne le laissez pas crever, sinon, gare à vous ! Il faut à tout prix qu'il parle.
De nouveau un choc lourd... la corde avait été coupée et j'étais tombé la tête la première au milieu des braises. Une nouvelle fois, je m'évanouis.
Lorsque je repris conscience, je me retrouvai étendu dans un cachot à demi souterrain, le dos baignant dans une flaque d'eau froide. La cellule grouillait de rats. Dès que je fis un geste, ils s'enfuirent effrayés en poussant de petits cris aigus. Plusieurs heures plus tard, des gardes firent leur entrée et me remirent debout. Sans ménager les jurons ni les coups, ils me portèrent à une fenêtre garnie de barreaux qui était juste au niveau du sol à l'extérieur. À l'aide de menottes, on m'attacha à ces barreaux de façon que mon visage fût pressé contre eux.
— Regarde bien ce qui va se passer, me dit un officier, après m'avoir allongé un coup de pied. Ne tourne pas la tête et ne ferme pas les yeux, si tu ne veux pas écoper d'un coup de baïonnette.
Je regardai, mais il n'y avait rien à voir, si ce n'est à peu près à la hauteur de mon nez, un bout de terrain plat. Bientôt cependant, j'entendis du bruit et j'aperçus des prisonniers que des gardes faisaient avancer, en les traitant avec une extrême brutalité. Leur groupe se rapprocha peu à peu de ma fenêtre devant laquelle ils furent obligés de s'agenouiller. Ils avaient déjà les bras liés derrière le dos, mais à ce moment-là, les gardes attachèrent leurs poignets à leurs chevilles de sorte que leur corps était courbé comme un arc. Involontairement, je fermai les yeux, mais je fus vite contraint de les rouvrir quand mon corps fut traversé par une douleur fulgurante. Un Japonais m'avait donné un coup de baïonnette et je sentais mon sang dégouliner le long de mes jambes.
Je regardai donc dehors : les Japonais procédaient à une exécution collective. Certains prisonniers furent tués à coups de baïonnette, d'autres décapités. L'un de ces pauvres malheureux avait dû se conduire particulièrement mal, tout au moins du point de vue des Japonais, car ils lui ouvrirent le ventre et le laissèrent perdre tout son sang. La même scène se répéta plusieurs jours de suite. On amenait des prisonniers devant ma fenêtre et on les mettait à mort en les fusillant, en les criblant de coups de baïonnette ou en les décapitant. Des flots de sang coulaient dans ma cellule où ils attiraient des masses grouillantes d'énormes rats.
Nuit après nuit, j'étais interrogé par les Japonais qui espéraient tirer de moi ce qu'ils voulaient savoir. Vivant jour et nuit dans une sorte de brouillard sanglant, souffrant horriblement, je n'aspirais plus qu'à être exécuté pour que tout soit fini. Au bout de dix jours, qui me parurent aussi longs qu'une centaine, on m'annonça que je serais fusillé si je ne consentais pas à leur donner les informations qu'ils désiraient. Les officiers me dirent qu'ils en avaient assez de moi et que mon attitude était une insulte à l'empereur. Mais je persistai dans mon mutisme. On me ramena alors dans mon cachot, où on me jeta avec une telle violence sur le sol en ciment qui me servait de lit, que j'en restai à moitié assommé.
— Plus de nourriture pour toi, me dit un garde, avant de me quitter. À partir de demain, tu n'en auras plus besoin.
Le lendemain matin, les faibles lueurs de l'aube commençaient à peine à traverser le ciel quand la porte de mon cachot s'ouvrit à grand fracas devant un officier accompagné d'un peloton de soldats. On me conduisit à l'endroit même où j'avais vu exécuter tant de prisonniers. L'officier me montra du doigt le sol tout détrempé de sang.
— Le tien aussi va y couler bientôt, dit-il. Mais tu auras ta tombe personnelle, car tu vas la creuser toi-même. On m'apporta une pelle et sous l'aiguillon des baïonnettes, je dus creuser le trou peu profond qui serait ma tombe. Après quoi je fus attaché à un poteau de telle sorte qu'une fois qu'ils auraient tiré, la corde pourrait juste être coupée et je tomberais la tête la première dans la tombe que j'avais moi-même creusée. L'officier prit une attitude théâtrale et lut la sentence aux termes de laquelle j'étais condamné à être fusillé pour avoir refusé de collaborer avec les Fils du Ciel.
— Voici ta dernière chance, dit-il. Donne-nous les informations que nous voulons, sinon nous allons t'envoyer rejoindre tes ancêtres sans honneur.
Je restai silencieux — faute d'une réponse qui me parût adéquate — et il répéta sa question. Comme je ne répondais pas, les soldats du peloton, à son commandement, mirent leur fusil en joue. L'officier s'approcha à nouveau de moi et me répéta que cette chance était vraiment ma dernière chance et il me gifla à toute volée, pour donner sans doute plus de poids à ses paroles. Pas un mot ne sortit de mes lèvres. Il montra alors aux soldats la place de mon cœur, puis pour ne pas être en reste, me frappa au visage du plat de son épée et cracha sur moi avant de me tourner le dos, complètement dégoûté.
Arrivé à mi-chemin entre le poteau et le peloton d'exécution, il s'arrêta — s'assura qu'il ne se trouvait pas dans la ligne de mire de ses hommes — et se tournant vers eux leur donna l'ordre de se préparer à tirer. Les soldats épaulèrent leurs fusils. Les canons se braquèrent sur moi. J'eus l'impression que le monde se remplissait de gros trous noirs, des trous noirs qui étaient des gueules de fusils. Ils me parurent grossir et grossir, devenir de plus en plus menaçants ; il était clair, hélas, que d'un instant à l'autre, ils allaient cracher la mort. L'officier leva son épée d'un geste lent, puis l'abaissa vivement en commandant : "FEU !"
Le monde sembla se dissoudre dans le feu et la douleur, sous des nuages d'une fumée suffocante. J'eus l'impression d'être piétiné par des chevaux géants dont les sabots auraient été portés au rouge. Tout se mit à tourner, comme si le monde était pris de folie. La dernière chose que j'eus devant les yeux fut un brouillard sanglant d'où coulait du sang. Ensuite, ce furent les ténèbres, des ténèbres traversées par un immense rugissement. Mes liens se défirent, je m'affaissai — et ce fut le néant.
Quand je repris conscience plus tard, je fus stupéfait de constater combien les Champs Célestes, ou l'Autre Monde, me semblaient familiers. Mais cette illusion fut de courte durée car je me retrouvai allongé dans ma tombe, face contre terre. Tout à coup, une baïonnette me piqua les reins. Du coin de l'œil, j'aperçus l'officier japonais qui me déclara que l'exécution avait eu lieu avec des balles ‘spéciales’.
— Nous avons pratiqué l'expérience sur plus de deux cents prisonniers, ajouta-t-il.
Ils avaient diminué la charge de poudre et remplacé le plomb de la balle par quelque chose d'autre, de façon à me blesser sans me tuer — car ils voulaient toujours obtenir ces fameuses informations.
— Et nous les obtiendrons, dit-il, car nous mettons au point d'autres méthodes. Quant à toi, plus tu attendras pour dire la vérité et plus tu souffriras.
Ma vie avait été vraiment très dure, entièrement consacrée à un entraînement rigoureux, fondé sur le contrôle de moi-même ; sans la formation spéciale qui m'avait été donnée à la lamaserie, je n'aurais certes pas pu survivre et garder ma raison. Quiconque n'ayant pas été entraîné comme moi n'aurait pas résisté, j'en suis certain.
Les sérieuses blessures dues à mon ‘exécution’ provoquèrent une double pneumonie. J'étais pour lors désespérément malade, aux portes de la mort, privé de tout soin médical et du moindre confort. Allongé sur le sol cimenté de ma cellule, sans rien pour me couvrir, agité et tremblant de fièvre, je ne souhaitais que mourir.
Quand, lentement, mon état se fut amélioré quelque peu, j'avais pris conscience depuis quelques jours de vrombissements de moteurs d'avion qui ne m'étaient pas familiers du tout. Ce n'étaient certes pas des avions japonais, car ceux-là je ne les connaissais que trop bien. Que pouvait-il donc se passer ? Le camp était situé dans un village proche d'Hiroshima et je pensai que les Japonais — qui étaient victorieux sur tous les fronts — ramenaient chez eux des appareils dont ils s'étaient emparés.
J'étais encore très malade quand un jour j'entendis de nouveau des moteurs d'avions. Tout à coup, le sol se mit à trembler et une énorme déflagration retentit dans les airs. Des nuages de poussière tombèrent du ciel et une odeur de moisi se répandit dans l'atmosphère qui paraissait électrique, tendue à l'extrême. Pendant un instant tout parut frappé d'immobilité, puis les gardes affolés se mirent à courir, hurlant de peur et suppliant l'empereur de les protéger de ce danger inconnu. Le bombardement atomique d'Hiroshima du 6 août 1945 venait d'avoir lieu. Un bon moment, je restai sur place, m'interrogeant sur la conduite à tenir. Comprenant enfin que les Japonais étaient trop occupés pour se soucier de moi, je me levai et gagnai la porte en chancelant. Elle n'était pas fermée, car j'étais trop affaibli pour qu'on me crût capable de m'évader. D'ailleurs en temps normal elle était gardée par des soldats, mais eux aussi avaient disparu. Partout régnait une panique extrême. Les Japonais, croyant avoir été abandonnés de leur Dieu Soleil, tournaient en rond dans le plus grand affolement, comme une colonie de fourmis qui vient d'être attaquée. Le sol était jonché de fusils, d'équipements et de vivres. Du côté des abris aériens où les soldats voulaient tous entrer en même temps, s'élevaient des cris et des exclamations.
J'étais très faible, presque trop faible pour tenir sur mes jambes. En me baissant pour ramasser une tunique et une casquette japonaises, je fus pris d'un étourdissement et je faillis tomber à la renverse. À quatre pattes sur le sol, je parvins à endosser la tunique et à me coiffer de la casquette. Je trouvai un peu plus loin une paire de sandales que je chaussai, car j'étais nu-pieds. Après avoir lentement rampé jusqu'à un buisson, je poursuivis péniblement mon avance. Des coups sourds ébranlaient l'air et toutes les batteries antiaériennes étaient entrées en action. Le ciel était rouge, avec çà et là de grandes bannières de fumée noire et jaune. Le monde entier paraissait être sur le point d'exploser et je me souviens de m'être alors étonné de faire tant d'efforts pour m'évader, puisque manifestement la fin du monde était arrivée.
Pendant toute la nuit, souffrant mille morts, je poursuivis ma lente avance en direction de la côte que je savais n'être distante que de quelques milles (km). J'étais vraiment dans un état affreux. Ma gorge était nouée et je tremblais de tous mes membres. Pour continuer à avancer, il me fallait faire appel à toute l'énergie qui me restait. Enfin, à l'aube, j'arrivai à une petite crique. Épuisé par la fatigue et la maladie, je jetai un coup d'œil prudent par-dessus les buissons et j'aperçus un petit bateau de pêche qui dansait au bout de ses amarres. Il paraissait abandonné. Son propriétaire pris de panique sans doute, s'était réfugié à terre. Je m'en approchai avec prudence et une fois près de lui, je parvins à me redresser et à regarder à l'intérieur. Le bateau était vide. Après avoir réussi à placer un pied sur l'amarre, je me hissai à bord dans un effort surhumain. Mais mes forces m'abandonnèrent et je basculai la tête la première au fond de la cale, pleine d'une eau sale où flottaient des bouts de poissons pourris manifestement destinés à servir d'appât. Il me fallut un temps infini pour retrouver assez de force pour couper l'amarre avec un couteau que j'avais trouvé. Puis, je me laissai tomber au fond du bateau que la marée descendante entraîna vers le large. Je me glissai vers l'avant où je m'accroupis, complètement épuisé. Quelques heures plus tard, le vent paraissant favorable, je parvins à hisser une voile en lambeaux. Mais l'effort fut trop violent et je m'effondrai au fond de la cale, terrassé par une syncope.
Derrière moi, sur la terre japonaise, venait de s'abattre la dernière carte. La bombe atomique était tombée, annihilant toute volonté de résistance. La guerre était finie et je n'en savais rien. Pour moi aussi, la guerre était finie, du moins je le pensais, puisque je dérivais sur la mer du Japon, sans eau ni vivres, à l'exception de quelques bouts de poissons pourris. Je me relevai et pris appui sur le mât ; je me cramponnai de toutes mes forces, y appuyant même mon menton, cherchant à tout prix à me tenir debout. Quand je tournai la tête vers l'arrière, la côte japonaise, recouverte d'un léger brouillard, disparaissait au loin. Mes yeux se portèrent ensuite vers l'avant, sans rien voir que la mer.
Je songeai à toutes les épreuves que j'avais endurées, je songeai à la Prophétie. Alors, il me sembla entendre, venant de très loin, la voix de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup.
— Tu t'es très bien conduit, mon Lobsang. Très, très bien. Ne te décourage pas, car rien n'est encore terminé.
Un rayon de soleil éclairant brièvement l'étrave m'apporta son réconfort. Le vent fraîchit et le léger clapotis de l'eau contre les flancs du bateau fut comme une douce musique. Et moi ? Vers quel port voguais-je ? Si je l'ignorais, je savais néanmoins qu'à cet instant j'étais à l'abri des tortures, délivré des prisons et de l'enfer des camps de concentration. Peut-être étais-je même libre de mourir ? Non, car j'avais beau aspirer à la paix et au soulagement que procure la mort, je savais que l'heure n'était pas encore venue, puisque mon destin est de terminer ma vie au pays de l'homme rouge, l'Amérique. Il me fallait donc dériver sur la mer du Japon, crevant de faim et de solitude à bord de ce bateau. Je sentis la douleur abattre sur moi ses lourdes vagues et immédiatement j'eus l'impression d'être une nouvelle fois soumis à la torture. Des râles s'étranglaient dans ma gorge et des ombres passèrent devant mes yeux. Et si les Japonais s'étaient aperçus de mon évasion et avaient lancé une vedette rapide à ma poursuite ? Je ne pus supporter cette pensée. Mon étreinte se relâcha et je glissai jusqu'en bas du mât, où je m'affalai. De nouveau, je fus plongé dans les ténèbres, les ténèbres de l'oubli, cependant que la barque continuait sa course vers l'inconnu.