T. LOBSANG RAMPA
L'HISTOIRE DE RAMPA
Titre original : The Rampa Story
(Édition : 22/04/2020)
L'Histoire de Rampa — (Initialement publié en 1960) Suite à sa fuite du camp de concentration japonais, le Dr. Rampa se retrouve tout d'abord en Corée, puis en Russie, traverse l'Europe, fait la traversée par bateau jusqu'aux États-Unis et finit par être renvoyé en Angleterre. Là, Lobsang doit endurer une nouvelle fois la captivité et encore d'autres tortures jusqu'à ce qu'il réussisse de nouveau à s'échapper. Dans ce livre Lobsang explique comment il a pris, au moyen de la transmigration, le corps d'un Anglais du nom de Cyril Henry Hoskins, ce dernier très impatient de quitter ce monde, ce qui donna la chance à Lobsang de poursuivre sa tâche spéciale.
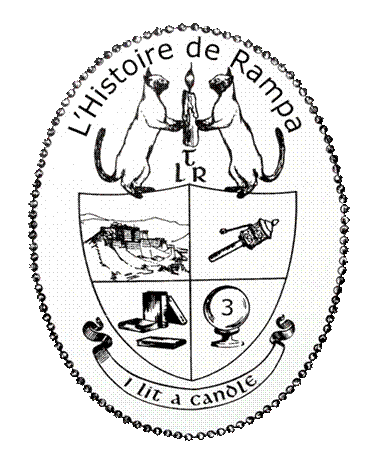
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
Table des matières
(Le voyage astral intersidéral)
(Adam et Ève dans le Jardin d'Éden)
(La parabole de la Graine de Moutarde)
Service d'entraide pour les éditeurs
L'incroyable vérité
Peu de livres ont suscité plus de controverses ces dernières années que LE TROISIÈME ŒIL de Lobsang Rampa et les autres ouvrages qui nous viennent de lui. La raison en est assez simple. Quand un Anglais soutient que son corps a été pris en charge par l'esprit d'un Lama Tibétain, il peut raisonnablement s'attendre à la moquerie. Quand, en outre, il raconte des expériences extraordinaires, extrêmement détaillées qui présupposent la possession de pouvoirs personnels tout à fait en dehors des lois de la nature telles que nous les comprenons, il n'est pas étonnant que la réaction devienne un tollé. Mais de tels tollés naissent parfois de l'ignorance. Jeter un coup d'œil sur ce qui était précédemment inconnu est toujours inquiétant. Le fait que le Dr Rampa ait maintenant des milliers de lecteurs à travers le monde est la preuve que tous les esprits ne sont pas fermés à l'inconnu. C'est pour cette grande masse de lecteurs — et non moins pour les sceptiques qui n'ont pu ni réfuter son histoire ni non plus expliquer comment il a pu acquérir toute la connaissance qu'il possède si son histoire est fausse — que le Dr Rampa a écrit ceci, son troisième livre. L'HISTOIRE DE RAMPA est la réponse de Lobsang Rampa à tous ses détracteurs et chaque page porte sa propre garantie inébranlable de la vérité.
*****************************************
Cet ouvrage a paru sous le titre original :
THE RAMPA STORY
CE LIVRE EST DÉDIÉ
À mes amis de Howth, Irlande
Ils furent mes amis quand ‘soufflait le bon vent’.
Ils furent loyaux, compréhensifs et de meilleurs amis encore quand souffla le mauvais vent, car les Irlandais ont l'habitude des persécutions : et ils savent discerner le vrai du faux. C'est pourquoi,
Mr et Mrs O'Grady,
La famille Loftus,
Dr W.I. Chapman
Et Brud Campbell
(pour n'en mentionner que quelques-uns)
MERCI !
(The Rampa Story – publié en 1960)
************************************
Avant-propos de l'auteur
— Pas d'amertume, dit M. l'Éditeur.
"Bien, me dis-je, mais pourquoi éprouverais-je l'amertume ? Je cherche simplement à accomplir ma tâche : écrire un livre ainsi qu'il m'a été ordonné."
— Rien contre la presse, ajouta M. l'Éditeur. Rien !
"Mon Dieu, songeai-je, pour qui me prend-il ?"
Donc, pas un mot contre la presse ! Après tout, les journalistes s'imaginent faire leur travail et si on leur fournit des informations erronées, on ne saurait, me semble-t-il, les tenir pour totalement responsables. Mais mon opinion sur la presse ? Chut, chut. Non. Pas un mot de plus sur ce sujet.
Ce livre fait suite au Troisième Œil et à Docteur de Lhassa (Lama Médecin). Et je vous dirai, dès l'abord, qu'il s'agit de la Vérité et non d'une fiction. Tout ce que j'ai écrit dans mes deux précédents ouvrages est vrai et constitue mes propres expériences personnelles. Ce que je vais écrire concerne les ramifications de la personnalité humaine et du moi, thème que nous connaissons à fond, nous autres gens d'Extrême-Orient.
Toutefois, cet avant-propos s'arrêtera là. Le livre parlera pour lui-même !
*************************************
Chapitre Un
Les pics déchiquetés des rudes monts Himalaya se découpaient brutalement sur le violet ardent du ciel vespéral tibétain. Le soleil couchant, caché derrière cette masse titanesque, jetait des lueurs scintillantes et irisées sur les longs tourbillons de neige qui soufflent perpétuellement des hautes cimes. L'air vivifiant était clair comme du cristal, et la visibilité presque infinie.
Au premier abord, la campagne, glacée et désolée, paraissait totalement dénuée de vie. Rien n'y bougeait, rien n'y remuait, sauf la longue bannière neigeuse soufflant au-dessus des pics. Il semblait que rien ne pût subsister dans la morne solitude de ces montagnes. Aucune vie n'y avait, apparemment, jamais été possible depuis le début des temps eux-mêmes. Seul celui qui savait, celui à qui on avait appris, maintes et maintes fois, à surprendre les faibles traces prouvant la présence d'êtres humains, parvenait à les discerner. Seule l'habitude pouvait guider les pas dans ces lieux âpres et sauvages. Alors, mais alors seulement, on pouvait apercevoir une entrée, nimbée d'ombre, menant à une grotte sombre et lugubre, qui n'était que le vestibule d'une myriade de tunnels et de chambres alvéolant cette austère chaîne de montagnes.
Depuis de longs mois, les lamas les plus éprouvés, faisant office d'humbles messagers, avaient quitté Lhassa et parcouraient péniblement des centaines de milles (km) afin de déposer les anciens Secrets là où ils seraient à tout jamais protégés des vandales chinois et des traîtres communistes tibétains. C'est là aussi qu'après des efforts et des souffrances infinis, avaient été portées les Formes Dorées des Incarnations précédentes, afin d'être dressées et vénérées au cœur de la montagne. Des Objets Sacrés, des écrits infiniment anciens, les prêtres les plus respectables et les mieux instruits se trouvaient ici en sécurité. Depuis plusieurs années, sachant bien que l'invasion chinoise était imminente, des Abbés loyaux s'étaient périodiquement assemblés en conclaves solennels pour choisir et désigner ceux qui se rendraient dans la Nouvelle Demeure lointaine. Prêtre après prêtre fut mis à l'épreuve à son insu, son passé fut examiné, de sorte que l'on pût choisir les hommes les plus dignes et les plus évolués sur le plan spirituel. Des hommes que leur formation et leur foi rendaient capables de résister, le cas échéant, sans trahir des renseignements vitaux, aux pires tortures que les Chinois puissent infliger.
De sorte que, quittant Lhassa occupé par les communistes, ils étaient arrivés dans leur nouvelle demeure. Aucun avion porteur de bombes ne serait capable de voler à cette altitude. Aucune armée ennemie ne pourrait subsister dans ces contrées arides, dépourvues de terre, rocheuses et traîtresses avec leurs blocs granitiques mouvants et leurs abîmes béants. Contrées si hautes, si pauvres en oxygène que seul un robuste peuple de montagnards peut y respirer. C'était là enfin dans le sanctuaire des cimes que régnait la Paix, la Paix pendant laquelle les prêtres travailleraient à sauvegarder l'avenir, à préserver la Science Ancienne et à préparer les temps où le Tibet pourrait se relever et se libérer de son agresseur.
Des millions d'années auparavant, ces lieux avaient été une chaîne de volcans vomissant des flammes, des rochers et de la lave à la surface changeante de la jeune Terre. Le monde était alors à demi plastique et subissait les douleurs de l'enfantement, prélude d'une ère nouvelle. Au bout d'innombrables années, les flammes s'apaisèrent et les rocs en fusion se refroidirent. La lave avait coulé pour la dernière fois et des jets gazeux, venus des profondeurs de la Terre, en avaient expulsé les résidus dans l'air, laissant nus et déserts les chenaux et les tunnels interminables. Certains, fort rares, furent bouchés par les chutes de pierres, mais d'autres demeurèrent intacts, durs comme du verre et marqués par les traces des métaux jadis en fusion. De certaines parois coulaient des sources de montagnes, pures et étincelant au moindre rai de lumière.
Siècle après siècle, tunnels et grottes étaient restés dépourvus de toute vie, désolés et solitaires, connus seulement de lamas capables de voyager astralement n'importe où et de tout voir. Les voyageurs de l'astral avaient parcouru le pays à la recherche d'un refuge de ce genre. À présent que la Terreur pesait sur le pays tibétain, les couloirs de jadis étaient peuplés par l'élite d'un peuple spirituellement évolué, d'un peuple destiné à se relever lorsque les temps seraient accomplis.
Alors que les premiers moines, choisis avec soin, prenaient le chemin du nord pour préparer une demeure dans la roche vivante, d'autres, restés à Lhassa, emballaient les objets les plus précieux et se préparaient à partir dans le plus grand secret. Tel un mince filet d'eau, les élus arrivaient des lamaseries et des couvents. Par groupes restreints, à la faveur des ténèbres, ils se dirigeaient vers un lac éloigné et campaient sur ses rives en attendant leurs compagnons.
Dans la ‘nouvelle demeure’, un Ordre Nouveau avait été établi, l'École de la Sauvegarde de la Connaissance, et le vieil Abbé qui la dirigeait, un moine très savant, plus que centenaire, avait, au prix de souffrances indescriptibles, atteint les grottes au cœur des montagnes. Il était accompagné par les hommes les plus évolués du pays, les Lamas Télépathes, les Clairvoyants et les Sages de Grande Mémoire. Lentement, pendant de longs mois, ils avaient grimpé de plus en plus haut dans les montagnes, où l'air se raréfiait toujours davantage au fur et à mesure qu'augmentait l'altitude. Parfois leurs organismes de vieillards ne pouvaient parcourir qu'un mille (1 600 m) par jour, un mille pendant lequel il leur fallait gravir d'énormes roches où le vent éternel des hauts défilés s'acharnait contre leurs robes et menaçait de les faire s'envoler. Parfois une profonde crevasse obligeait à un long et pénible détour. Pendant près d'une semaine, le vieil Abbé fut forcé de demeurer dans une tente en peau de yak, étroitement close, tandis que des herbes et des potions étranges lui fournissaient l'oxygène vital qui soulageait ses poumons et son cœur torturés. Puis, avec une force d'âme surhumaine, il continua le terrible voyage.
Enfin, ils atteignirent leur destination ; leur nombre avait beaucoup diminué, car quantité d'entre eux étaient tombés en chemin. Peu à peu, ils s'accoutumeraient à ce changement d'existence. Les Scribes rédigèrent un compte rendu méticuleux du voyage et les Sculpteurs fabriquèrent lentement les blocs destinés à imprimer les livres à la main. Les Clairvoyants étudièrent l'avenir et prédirent celui du Tibet et d'autres pays. Ces hommes, d'une pureté absolue, étaient en contact avec le Cosmos et les Archives Akashiques qui renseignent sur le passé, le présent immédiat du monde entier et toutes les probabilités du futur. Les Télépathes eux aussi avaient fort à faire : ils envoyaient des messages à d'autres, au Tibet, et gardaient le contact télépathique avec ceux de leur Ordre, dispersés aux quatre coins du globe : ils gardaient le contact avec Moi !
— Lobsang, Lobsang !
L'appel retentit à mes oreilles, me tirant de ma rêverie. Les messages télépathiques ne m'impressionnaient pas, ils m'étaient plus familiers que des coups de téléphone, mais celui-là était tenace ; différent, en un sens. Vivement, je me détendis et m'assis dans la position du lotus, mettant mon esprit en état de réceptivité et mon corps à l'aise. Puis, prêt à recevoir des messages télépathiques, j'attendis. Pendant un certain temps, rien ne se produisit qu'un léger ‘sondage’, comme si ‘Quelqu'un’ regardait au fond de mes yeux et apercevait... apercevait quoi ? Le fleuve boueux, nommé Détroit, et les hauts gratte-ciel de la ville du même nom. La date du calendrier, en face de moi, était celle du 9 avril 1960. De nouveau... rien. Soudain, comme si ‘Quelqu'un’ avait pris une décision, la voix se fit entendre de nouveau.
— Lobsang. Tu as beaucoup souffert. Tu as bien agi, mais le temps n'est pas au contentement de soi-même. Tu as encore une autre tâche à accomplir.
Il y eut une pause comme si l'Orateur avait été brusquement interrompu, et j'attendis, le cœur serré, empli d'appréhension. J'avais eu plus que mon lot d'épreuves et de souffrances au cours des années passées. J'en avais assez de changer perpétuellement d'existence, d'être pourchassé et persécuté. Pendant que j'attendais, je captais de furtives pensées télépathiques émises par ceux qui se trouvaient auprès de moi. La jeune fille qui tapait impatiemment du pied, à l'arrêt de l'autobus, sous ma fenêtre : "Oh ! ce service d'autobus est le pire du monde ! Est-ce qu'il n'arrivera jamais ?" Ou l'homme qui apportait un paquet à la maison voisine : "Est-ce que je vais oser demander une augmentation au patron ? Millie va être furibonde si je ne lui rapporte pas bientôt un peu d'argent !" Au moment où je me demandais vaguement qui était ‘Millie’ — de même qu'on attend au téléphone en laissant couler les pensées — l'insistante voix intérieure se fit de nouveau entendre :
— Lobsang ! Notre décision est prise. L'heure est venue pour toi de te remettre à écrire. Ton prochain livre sera une tâche essentielle. Tu devras insister sur ce point : le fait qu'un être humain peut s'intégrer dans le corps d'un autre, avec le consentement total de ce dernier.
Je tressaillis d'inquiétude et faillis rompre le contact télépathique. Moi, écrire de nouveau ? Sur ce sujet ? J'étais ‘matière à discussion’ et cela me navrait. Moi, je savais que tout ce que j'affirmais être, que tout ce que j'avais écrit auparavant était la vérité absolue, mais servirait-il à quelque chose d'alimenter la presse à scandales ? La tâche était au-dessus de mes forces. J'étais troublé, profondément désemparé, angoissé, comme un homme attendant son exécution.
— Lobsang !
La voix télépathique avait à présent une inflexion acerbe et ce ton tranchant agit comme un choc électrique sur mon cerveau engourdi.
— Lobsang, nous sommes plus aptes que toi à porter un jugement. Tu es pris dans l'engrenage des labeurs de l'Occident. Nous, qui n'y sommes en rien mêlés, nous jugeons la situation à sa juste valeur. Tu ne connais que les nouvelles locales, alors que nous, nous avons de l'univers une vision d'ensemble.
Humble et silencieux, j'attendis la suite du message, reconnaissant que ‘Eux’ savaient évidemment la voie à suivre. Au bout d'un moment, la voix s'éleva de nouveau : "Tu as beaucoup souffert injustement, mais c'était pour la bonne cause. Ton travail antérieur a été, pour beaucoup d'hommes, une source de bienfaits, mais tu es malade et incapable de porter un jugement lucide sur la question de ton prochain livre."
Tout en écoutant, je pris ma boule de cristal et la tins devant moi, sur son étoffe de couleur sombre. Rapidement, le verre se ternit et devint blanc comme du lait. Une déchirure apparut et les nuages blancs s'écartèrent comme des rideaux qui s'ouvrent pour laisser entrer la lumière de l'aube. Je voyais en même temps que j'entendais. Au loin, les pics enneigés de l'Himalaya se dressaient vers le ciel. J'éprouvai une sensation de chute si intense que je sentis mon estomac remonter dans ma poitrine. Le paysage s'agrandit : j'aperçus la Grotte, la Nouvelle Demeure de la Connaissance. Un Patriarche très, très âgé, était assis sur un tapis en laine de yak. Malgré son rang élevé — c'était un Père Abbé — il était simplement vêtu d'une robe fatiguée et rapiécée qui semblait presque aussi vieille que lui. Son front haut et bombé luisait comme un vieux parchemin et la peau de ses mains ridées recouvrait à peine les os qui la supportaient. C'était une vénérable figure, nimbée d'une forte Aura de puissance et respirant la sérénité ineffable que donne la véritable connaissance. Autour de lui, formant un cercle dont il était le centre, sept Lamas de haut degré étaient assis dans une attitude de méditation, les paumes levées et les doigts entrecroisés, selon le geste immémorial et symbolique. Leurs têtes, légèrement inclinées, étaient toutes tournées vers moi. Grâce à ma boule de cristal, j'avais la sensation d'être debout devant eux dans la même caverne volcanique. Nous conversions comme si un contact physique était établi entre nous.
— Tu as beaucoup vieilli, me dit l'un.
— Tes livres ont apporté la joie et la lumière à un grand nombre, ne te laisse pas décourager par la jalousie et la malveillance de certains, me dit un autre.
— Le minerai de fer peut croire qu'il est torturé sans raison dans la fournaise, dit un troisième, mais lorsque la lame de l'acier le plus fin réfléchit à cette torture, elle en comprend la raison.
— Nous perdons du temps et de l'énergie, dit l'Ancien Patriarche. Son cœur est malade en dedans de lui, et il est debout à l'ombre de l'Autre Monde. Nous ne devons pas trop exiger de ses forces et de sa santé, car il a devant lui une tâche toute tracée.
De nouveau, ce fut le silence. Cette fois, c'était un silence bienfaisant, car les Lamas Télépathes versaient en moi l'énergie vivifiante qui me faisait si souvent défaut depuis ma seconde attaque de thrombose coronaire. La vision que j'avais sous les yeux, vision dont je semblais faire partie, devint plus lumineuse encore, presque plus lumineuse que la réalité. Puis le Vieil Homme leva les yeux et parla.
— Mon Frère, dit-il — terme qui était un honneur, en vérité, bien que je fusse moi aussi un Abbé — Mon Frère, nous devons révéler à un grand nombre la vérité suivante : à savoir qu'un moi peut quitter volontairement son corps et permettre à un autre moi de s'y intégrer et de réanimer le corps déserté. Divulguer ce fait, telle est la tâche qui t'incombe.
Ce fut un choc, en vérité. Ma tâche ? Jamais je n'avais souhaité divulguer de pareils sujets, préférant garder le silence, même lorsque j'aurais pu retirer des avantages matériels de semblables révélations. J'estimais que dans l'Occident aveugle en matière d'ésotérisme, mieux valait que la plupart des gens ignorassent l'existence des mondes occultes. La majorité des ‘occultistes’ que j'avais rencontrés ne savait pas grand-chose dans ce domaine et une connaissance incomplète est chose dangereuse. Mon introspection fut interrompue par l'Abbé :
— Comme tu le sais, nous sommes à l'aube d'une Ère Nouvelle, d'une Ère où il est prévu que l'Homme sera purifié de ses impuretés et vivra en paix avec les autres et avec lui-même. Les populations se stabiliseront, elles n'augmenteront ni ne diminueront, il sera mis fin aux intentions belliqueuses, car un pays de plus en plus surpeuplé doit avoir recours aux armes pour obtenir un plus grand espace vital. Nous voudrions que les gens sachent comment un corps peut être rejeté ainsi qu'un vieux vêtement dont le possesseur n'a plus l'emploi et transmis à un autre qui a besoin de ce corps en vue d'un but particulier.
Je tressaillis involontairement. Oui, j'étais au courant de toutes ces choses, mais je ne m'étais pas attendu à devoir les exposer par écrit. Cette idée me faisait peur.
Le vieil Abbé eut un bref sourire et dit :
— Je crois que cette idée, cette mission, ne te plaît pas, mon Frère. Pourtant, même en Occident, dans ce qu'on appelle la foi chrétienne, on a constaté de très nombreux cas de ‘possession’. Que tant de ces cas soient considérés comme néfastes, ou comme des manifestations de la magie noire, est regrettable et ne fait que refléter l'attitude de ceux qui sont peu versés en la matière. Ta tâche sera d'écrire de sorte que ceux qui ont des yeux puissent lire et que ceux qui sont prêts puissent savoir.
"Le suicide, pensai-je. Les gens auront recours au suicide afin d'échapper à leurs dettes, à leurs soucis, ou afin de rendre service à d'autres en leur procurant un corps."
— Non, non, mon Frère, dit le vieil Abbé. Tu es dans l'erreur. Nul ne peut échapper à sa dette par le suicide et nul ne peut quitter son corps pour un autre, à moins que certaines circonstances spéciales ne le permettent. Nous devons attendre l'épanouissement de cette Ère Nouvelle et personne ne pourra légitimement abandonner son corps avant que le laps de temps qui lui est alloué n'ait pris fin. Jusqu'à présent, cela ne peut intervenir qu'avec la permission des Forces Supérieures.
Je regardai les hommes qui se trouvaient devant moi, j'observai le jeu de la lumière dorée autour de leurs têtes, le bleu électrique de la sagesse dans leurs Auras, et l'effet réciproque de la lueur émanant de leurs Cordes d'Argent. Une vision de couleurs vivantes d'hommes doués de sagesse et de pureté. Des hommes austères, ascétiques, vivant à l'écart du monde. Se sachant maîtres d'eux-mêmes, ne comptant que sur eux-mêmes. "Tout est très simple pour eux, murmurai-je. Ils ne sont pas forcés de vivre dans le tohu-bohu de la vie occidentale." Par-delà le boueux fleuve Détroit, le rugissement de la circulation m'arrivait par vagues successives. Un steamer qui se dirigeait vers les Grands Lacs, passa sous ma fenêtre, broyant la glace du fleuve qui craquait devant son étrave. La Vie Occidentale ? Du bruit. Du vacarme. Des postes de radio hurlant les mérites présumés de telle ou telle marque d'auto. Dans la Nouvelle Demeure régnait la paix, la paix qui permettait de travailler, de méditer sans avoir à se demander qui — comme ici — allait être le suivant à vous poignarder dans le dos pour quelques dollars.
— Mon Frère, dit le Vieil Homme, nous, nous vivons dans le tohu-bohu d'un pays envahi où résister à l'oppresseur équivaut à mourir après de lentes tortures. La nourriture doit nous être apportée à pied, sur une distance de plus de cent milles (160 km), par de périlleux sentiers de montagne sur lesquels un faux pas ou une pierre branlante peut envoyer un homme jusqu'au fond d'un précipice. Nous vivons d'un bol de tsampa qui nous suffit pour la journée. Comme boisson, nous avons l'eau des ruisseaux de la montagne. Le thé est un luxe superflu dont nous avons appris à nous passer, car il est mal de prendre un plaisir qui fait courir un risque à d'autres. Regarde avec plus d'attention dans ta boule de cristal, mon Frère, et nous nous efforcerons de te montrer le Lhassa d'aujourd'hui.
Je me levai de mon siège, près de la fenêtre, et m'assurai que les trois portes de ma chambre étaient bien fermées. Il n'y avait aucun moyen de réduire au silence le grondement incessant de la circulation sur la rive canadienne du fleuve et le bourdonnement plus sourd de Détroit, ville bruissante d'activité. Entre le fleuve et moi, s'étendaient la route nationale et les six voies de chemin de fer. Le bruit ? Il était perpétuel ! Jetant un dernier regard sur ce spectacle de la trépidante vie moderne, je fermai les stores et me rassis, tournant le dos à la fenêtre.
Devant moi, le cristal frémissait, émettant une lumière bleue qui changea et tournoya au moment où je m'approchai. Comme je prenais la boule et m'en touchais brièvement la tête pour établir de nouveau un ‘rapport’, je sentis qu'elle était tiède, signe certain qu'une source extérieure y insufflait un fort potentiel d'énergie.
Le vieil Abbé me considérait avec bienveillance et un fugitif sourire éclaira son visage, puis tout se passa comme si une explosion s'était produite. La vision devint floue, ne fut plus qu'un kaléidoscope de milliers de couleurs disparates et de bannières tournoyantes. Soudain, j'eus l'impression qu'on avait ouvert une porte, une porte dans le ciel, et que je me tenais sur le seuil. Je ne regardais plus dans une boule de cristal : J'étais là !
À mes pieds, brillant doucement dans la lumière du soir, s'étendait mon pays, ma ville de Lhassa, blottie à l'abri des puissantes montagnes, le Fleuve Heureux coulant rapidement à travers la verte Vallée. De nouveau, j'éprouvai une nostalgie amère. Toutes les haines, toutes les duretés de la Vie Occidentale bouillonnèrent en moi et je crus que mon cœur allait se briser. Le souvenir des joies et des peines, de l'entraînement rigoureux que j'avais subi là-bas, la vue de mon pays natal suscitèrent en moi un sentiment de révolte contre le féroce manque de compréhension des Occidentaux.
Mais ce n'était pas pour mon plaisir que j'étais là ! J'eus l'impression de descendre lentement du ciel, comme si j'avais été dans un ballon. À quelques milliers de pieds (m) de la surface terrestre, je poussai une exclamation de surprise horrifiée. Un aérodrome ? Il y avait des aérodromes autour de la Cité de Lhassa ! Le paysage avait perdu son aspect familier et en regardant autour de moi, je vis que deux nouvelles routes traversaient les montagnes et s'étrécissaient en direction de l'Inde. Des véhicules, des véhicules à roues, y passaient rapidement. Je descendis plus bas, sous la surveillance de ceux qui m'avaient amené jusque-là. Et je vis que des esclaves creusaient des fondations, sous la garde de Chinois en armes. Horreur des horreurs ! Au pied même du glorieux Potala s'étalait un affreux bidonville, desservi par un réseau de chemins de terre. Des fils de fer épars reliaient les bâtiments, donnant à l'endroit un aspect hétéroclite et mal tenu. Je levai les yeux vers le Potala et — par la Dent Sacrée du Bouddha ! — je vis que le Palais était souillé de slogans communistes chinois ! Avec un sanglot de dégoût, je détournai mes regards.
Un camion apparut sur la route, me traversa de part en part — car j'étais dans mon corps astral, fantomal et dénué de substance — et s'arrêta en trépidant quelques verges (m) plus loin. Des soldats chinois hurlants, débraillés, en descendirent, entraînant cinq moines avec eux. Des haut-parleurs se mirent à rugir au coin de toutes les rues et, aux ordres émis par cette voix d'airain, la place où je me trouvais fut rapidement envahie par la foule. Rapidement, car des gardes-chiourme chinois, armés de fouets et de baïonnettes, frappaient sur les traînards. La foule, des Tibétains et des colons chinois venus là de mauvais gré, semblait déprimée et émaciée. Elle s'agitait nerveusement, soulevant sous ses pieds de petits nuages de poussière qu'emportait la brise du soir.
Les cinq moines, maigres et ensanglantés, furent brutalement jetés à genoux. Je reconnus l'un d'eux, dont le globe oculaire, arraché de son orbite, pendait sur sa joue. Il avait été acolyte du temps que j'étais Lama. Un silence tomba sur la foule morne tandis qu'une jeep, de marque russe, quittait un bâtiment portant l'écriteau ‘Département de l'Administration Tibétaine’, et roulait à toute allure sur la route. Tout le monde parut se figer lorsque la voiture fit le tour de l'assistance et s'arrêta à vingt pieds (6 m) environ derrière le camion.
Les soldats se mirent au garde-à-vous et un Chinois à l'air arrogant descendit de la jeep. Un soldat se hâta vers lui ; il déroulait un fil de métal tout en marchant. Puis, arrivé face au puissant personnage, il salua et tendit un microphone. Le Gouverneur ou l'Administrateur, quel que fût son titre, jeta autour de lui un regard méprisant avant de prendre la parole en face de l'appareil.
— Vous avez été réunis ici, dit-il, pour être témoins de l'exécution de cinq moines réactionnaires aux idées subversives. Nul ne fera obstacle à la marche du glorieux peuple chinois, sous la présidence compétente du camarade Mao.
Il se détourna et les haut-parleurs placés au sommet du camion se turent. Le gouverneur fit signe à un soldat, porteur d'un long sabre à lame courbe. Ce dernier s'avança vers le premier captif, agenouillé et ligoté devant lui. Pendant un moment il demeura immobile, les jambes écartées, tâtant du pouce le fil de l'épée. Satisfait, il se mit en position et effleura le cou de l'homme. Puis il leva au-dessus de sa tête son arme dont la lame polie étincela au soleil, et l'abattit. Il y eut un bruit sourd, suivi aussitôt d'un ‘crac’ aigu et la tête de l'homme sauta du tronc, suivie d'un jet de sang vermeil qui tremblota par deux fois avant de se transformer en un maigre filet liquide. Lorsque le corps décapité, frémissant, fut étendu sur le sol poussiéreux, le Gouverneur cracha dessus et s'écria :
— Ainsi périssent tous les ennemis de la commune !
Le moine à l'œil arraché releva fièrement la tête et cria d'une voix forte :
— Vive le Tibet ! Par la Gloire du Bouddha, il se relèvera !
Un soldat allait le transpercer de sa baïonnette, mais un geste du Gouverneur l'arrêta. Le visage convulsé de rage, il hurla :
— Tu insultes le glorieux peuple chinois ? Puisqu'il en est ainsi, tu mourras lentement !
Et se tournant vers les soldats, il rugit des ordres. Les hommes se dispersèrent. Deux coururent vers un bâtiment voisin et en revinrent chargés de cordes. D'autres tranchèrent les liens du moine, lui infligeant des coupures aux bras et aux jambes. Le Gouverneur marchait de long en large, criant qu'on fît venir d'autres Tibétains pour assister à la scène. Les haut-parleurs se remirent à hurler et des camions militaires apparurent, amenant des hommes, des femmes et des enfants pour ‘voir la justice des camarades chinois’. Un soldat frappa le moine au visage avec la crosse de son fusil, lui faisant éclater l'œil arraché et lui brisant le nez. Le Gouverneur, immobile, jeta un coup d'œil aux trois autres moines, toujours agenouillés dans la poussière.
— Tuez-les, dit-il, tuez-les d'une balle dans la nuque et laissez leurs cadavres sur la route.
Un soldat s'avança et tira son revolver. Le posant juste derrière l'oreille d'un des moines, il appuya sur la détente. L'homme tomba en avant, sa cervelle se répandit sur le sol. Impassible, le soldat s'approcha du second moine et l'abattit de la même façon. Au moment où il allait tuer le troisième, un jeune soldat dit :
— Laisse-moi faire, Camarade, car je n'ai pas encore tué.
Inclinant la tête, le bourreau s'écarta et laissa le jeune soldat, tremblant d'impatience, prendre sa place. Tirant son revolver, ce dernier le braqua sur le troisième moine, ferma les yeux, et appuya sur la détente. La balle traversa la joue de la victime et blessa au pied un des spectateurs tibétains.
— Essaye de nouveau, dit l'autre soldat, et garde les yeux ouverts.
Mais la main de l'exécuteur tremblait tellement de peur et de honte en voyant le Gouverneur qui l'observait avec mépris, qu'il rata son coup.
— Mets-lui le canon du revolver dans l'oreille et tire, dit le Gouverneur.
Une fois encore, le jeune soldat s'approcha du condamné, lui enfonça brutalement le canon de l'arme dans l'oreille et appuya sur la détente. Le moine s'écroula en avant, mort, cette fois, à côté de ses compagnons.
La foule était devenue plus dense ; en jetant un regard autour de moi, je vis que le moine, mon ancien camarade, avait été attaché à la jeep par le bras et la jambe gauches. Son autre bras et son autre jambe étaient liés au camion. Un soldat chinois, souriant, monta dans la jeep et mit le moteur en marche. Lentement, aussi lentement que cela lui était possible, il embraya et la voiture démarra. Le bras du moine se tendit, rigide comme une barre de fer ; il y eut un craquement et le membre fut complètement arraché de l'épaule. La jeep continua à avancer. L'os de la hanche craqua à son tour, et la jambe droite de l'homme fut arrachée du tronc. La jeep s'arrêta, le Gouverneur y monta ; puis elle s'éloigna, tirant le corps ensanglanté du moribond qui rebondissait sur la route pierreuse. Les soldats grimpèrent dans le gros camion qui démarra, traînant derrière lui une jambe et un bras sanglants.
Comme je me détournais, bouleversé jusqu'à l'écœurement, j'entendis, derrière un des bâtiments, un cri de femme, suivi par un rire grossier. Puis un juron en chinois — la femme avait dû mordre son agresseur — et enfin une plainte gargouillée au moment où celui-ci la poignardait.
Au-dessus de moi, c'était la voûte bleu sombre du ciel nocturne, constellée de points lumineux qui constituaient d'autres mondes dont, je le savais, bon nombre étaient habités. Je me demandais combien d'entre eux étaient aussi sauvages que cette Terre ? Autour de moi gisaient des cadavres. Des cadavres sans sépulture. Des cadavres que l'air glacé du Tibet préserverait jusqu'à ce que les vautours et autres bêtes sauvages s'en repaissent ; aucun chien ne pourrait les aider dans cette besogne, car les Chinois les avaient tués pour les manger. Les chats ne gardaient plus les temples de Lhassa ; eux aussi avaient été mis à mort. La mort ? Aux yeux des envahisseurs communistes, la vie d'un Tibétain n'avait pas plus de valeur qu'un brin d'herbe.
Le Potala surgit devant moi. Dans la lumière pâlie du crépuscule, les slogans grossiers des Chinois se fondaient dans l'ombre et devenaient invisibles. Un projecteur, monté sur les Tombes Sacrées, répandait à travers la vallée de Lhassa une lumière crue comme un regard malveillant. Le Chakpori, mon École de Médecine, semblait morne et désolé. De son sommet venaient des bribes d'une chanson chinoise aux paroles obscènes. Je demeurai un moment en contemplation profonde. Et, tout à coup, une Voix dit : "Mon Frère, il faut t'éloigner à présent, car tu as été longtemps absent. Regarde bien autour de toi en remontant."
Lentement, je m'élevai dans les airs, comme un duvet de chardon emporté par une brise vagabonde. La lune était haute, à présent, et baignait d'une pure lumière argentée la vallée et les cimes des monts. Je regardai avec horreur les anciennes lamaseries, bombardées et désertes, jonchées de débris abandonnés qui avaient été des possessions terrestres de l'Homme. Les morts sans sépulture gisaient en tas grotesques, conservés par le froid éternel. Certains tenaient des moulins à prières, d'autres, dépouillés de tout vêtement, avaient été déchiquetés en lambeaux sanglants par l'explosion des bombes et des éclats de métal. J'aperçus une Statue Sacrée, intacte, contemplant avec compassion, semblait-il, la folie meurtrière des hommes.
Sur les pentes rocailleuses, où les ermitages s'accrochaient amoureusement à flanc de montagne, je vis que tous avaient été pillés par les envahisseurs. Les ermites, emmurés pendant des années dans une ténébreuse solitude, étaient devenus aveugles dès que la lumière du soleil avait pénétré dans leurs cellules. Chacun d'eux, ou presque, était étendu mort devant sa demeure en ruine, à côté du cadavre de l'homme qui avait été, toute sa vie, son ami et serviteur.
J'étais incapable d'en voir davantage. Un carnage ? L'assassinat insensé de moines innocents, sans défense ? Je me détournai et priai ceux qui me guidaient de m'éloigner de ce charnier.
Ma tâche dans la vie, je le savais depuis toujours, concernait l'Aura humaine, cette radiation qui entoure complètement le corps humain et qui, par ses couleurs changeantes, montre à l'Adepte si une personne est ou non digne de respect. On pourrait discerner, par les couleurs de son Aura, la maladie dont souffre un être humain. Tout le monde a dû remarquer le halo qui se forme autour d'un réverbère, par une nuit brumeuse. Certains ont dû même observer le ‘halo fluorescent’ qui entoure des câbles à haute tension, à un moment donné. L'Aura humaine est, en un sens, un phénomène analogue. Elle décèle la force vitale à l'intérieur de l'individu. Les artistes d'autrefois peignaient une auréole autour de la tête des saints. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient en voir l'Aura. Depuis la publication de mon premier livre, des gens m'ont écrit de tous les coins du monde ; certains d'entre eux peuvent également voir l'Aura.
Il y a des années, un docteur Kilner, qui effectuait des recherches dans un hôpital de Londres, découvrit qu'il pouvait discerner l'Aura, en certaines circonstances. Il écrivit un livre sur ce sujet. La science médicale n'était pas prête à admettre semblables révélations et tout ce que le docteur avait découvert fut tenu secret. Moi aussi, à ma façon, j'entreprends des recherches et j'imagine un instrument qui permettra à n'importe quel médecin ou savant de voir l'Aura d'une autre personne et de guérir les maladies ‘incurables’, grâce aux vibrations ultra-soniques. L'argent, l'argent, là est le problème. Les recherches coûtent toujours très cher.
"Et à présent, me disais-je, ils veulent que j'entreprenne une autre tâche ! Une tâche concernant l'échange des corps !"
Devant ma fenêtre éclata un fracas formidable qui fit littéralement trembler la maison. "Ah ! songeai-je, les cheminots font de nouveau des manœuvres de triage. Inutile d'espérer le silence d'ici un bon moment." Sur le fleuve, la sirène d'un steamer des Grands Lacs fit entendre un ululement mélancolique, comme une vache pleurant son veau, et au loin, un autre bateau lui répondit.
— Mon frère !
La voix retentit à nouveau et je me hâtai de reporter mon attention sur le cristal. Les vieillards étaient toujours assis en cercle, le Patriarche au milieu d'eux. Ils semblaient las, à présent, ‘épuisés’ serait peut-être le terme exact pour décrire leur état, car ils avaient émis une forte dose d'énergie afin de rendre possible ce voyage impromptu.
— Mon frère, tu as pu te rendre compte de l'état dans lequel se trouve notre pays. Tu as vu la main de fer de l'oppresseur. Ta tâche, tes deux tâches, sont nettement définies et tu peux les mener à bien toutes deux, pour la gloire de notre Ordre.
Le vieil homme semblait anxieux. Il savait, comme moi-même, que je pouvais, sans faillir à l'honneur, refuser cette mission. J'avais été victime d'incompréhension par suite des calomnies qu'avait répandues un groupe malveillant. Néanmoins je possédais, à un degré très élevé, les dons de clairvoyance et de télépathie. Un voyage dans l'astral était pour moi plus simple qu'une promenade. Écrire ? Eh bien oui, les gens pourraient lire ce que j'écrirais et même si tous ne pouvaient m'accorder foi, il y avait ceux qui étaient suffisamment évolués pour croire et reconnaître la vérité.
— Mon Frère, dit doucement le Vieil Homme, même si les non-évolués, les non-éclairés feignent de croire que tu écris des œuvres d'imagination, une partie de la Vérité pénétrera jusqu'à leur sub-conscient et — qui sait ? — la petite graine de vérité s'épanouira peut-être dans leur vie présente ou dans la suivante. Ainsi que le Seigneur Bouddha Lui-même l'a dit dans la parabole des Trois Chariots, la fin justifie les moyens.
La parabole des Trois Chariots ! Quels souvenirs poignants elle me rappelait ! Quelle image précise j'avais conservée de mon Guide et ami bien-aimé, le Lama Mingyar Dondup, qui m'instruisait au Chakpori.
Un vieux moine médecin avait calmé les craintes d'une femme très malade grâce à quelque pieux mensonge inoffensif. Moi, jeune et sans expérience, persuadé de ma supériorité, j'avais exprimé ma surprise indignée d'entendre un moine dire un mensonge, même en pareil cas. Alors mon Guide s'était approché de moi et m'avait dit :
— Allons dans ma chambre, Lobsang, nous aurons intérêt à consulter les Écritures.
Il me sourit, et son Aura rayonnait de bienveillance et de satisfaction tandis que nous nous dirigions vers sa chambre dominant le Potala.
— Du thé et des gâteaux indiens, oui, nous allons prendre quelques rafraîchissements, Lobsang, car, en même temps qu'eux, tu pourras digérer quelques principes. Le moine-servant, qui nous avait vus entrer, apporta de lui-même les friandises que j'aimais et que je ne pouvais obtenir que grâce aux bons offices de mon Guide.
Pendant un moment, nous demeurâmes assis, conversant à bâtons rompus ou plus exactement, je parlai tout en mangeant. Puis, lorsque j'eus terminé, l’illustre Lama me dit :
— Il y a des exceptions à chaque règle et chaque pièce de monnaie a deux faces. Le Bouddha s'est longuement entretenu avec Ses amis et disciples et une grande partie de Ses propos a été consignée par écrit. Il existe un récit qui pourrait fort bien s'appliquer au cas présent. Je vais te le raconter.
Il s'installa plus confortablement, s'éclaircit la voix et continua :
— Voici la parabole des Trois Chariots, ainsi nommée parce que les chariots étaient très en demande chez les garçons, à l'époque, de même que le sont aujourd'hui les échasses et les gâteaux indiens. Le Bouddha parlait à l'un de ses disciples nommé Sariputra. Ils étaient assis à l'ombre d'un de ces gros arbres indiens, discutant de la vérité et du mensonge, et disant que les mérites de la première étaient parfois inférieurs à la bienveillance du second. Le Bouddha dit : "À présent, Sariputra, parlons du cas d'un homme très riche, si riche qu'il peut satisfaire tous les caprices de sa famille. C'est un vieillard possesseur d'une vaste demeure et père de nombreux fils. Depuis la naissance de ces fils, il a tout fait pour les protéger du danger. Ils ignorent ce que c'est et n'ont point fait l'expérience de la souffrance. L'homme quitte son domaine afin de se rendre pour affaires au village voisin. En revenant chez lui, il voit une colonne de fumée monter vers le ciel. Il hâte le pas et au moment où il approche de sa maison, il s'aperçoit qu'elle est en feu. Les quatre murs sont en flammes et le toit brûle. À l'intérieur de la maison, ses fils continuent à jouer, car ils ignorent le danger. Ils auraient pu sortir mais ils ignorent le sens de la douleur puisqu'ils en ont toujours été préservés ; ils ne comprennent pas le danger du feu, car le seul qu'ils aient vu brûlait dans les cuisines.
"Le père est affolé, car comment peut-il, seul, entrer dans la maison et sauver tous ses fils ? S'il y entre, il pourra peut-être emporter l'un d'eux dans ses bras, mais les autres continueront à jouer, croyant à une plaisanterie. Certains sont très jeunes. Ils pourront errer à travers la maison et tomber dans les flammes qu'ils n'ont pas appris à redouter. Le père s'avance jusqu'à la porte et leur dit : “Mes enfants, mes enfants, sortez ! venez ici immédiatement !”
"Mais les garçons refusent d'obéir à leur père, ils veulent jouer, ils veulent se grouper au centre de la maison, loin de cette chaleur toujours accrue dont ils ignorent la cause. Le père songe : “Je connais bien mes fils, je les connais à fond, je connais chaque différence de leur tempérament, chaque nuance de leur caractère. Je sais qu'ils ne sortiront d'ici que s'ils en espèrent quelque avantage, quelque jouet nouveau.” Il revient donc vers la porte et crie d'une voix sonore : “Enfants, enfants, sortez, sortez d'ici immédiatement, j'ai des jouets pour vous, à côté de cette porte. Des chariots à bœufs, des chariots à chèvres, et un chariot aussi rapide que le vent, car il est tiré par un cerf. Venez vite ou je ne vous les donnerai pas.”
"Les garçons, ne craignant pas le feu, ne craignant pas les dangers des murs et du toit embrasés, mais redoutant seulement de ne pas avoir ces jouets, se précipitent hors de la maison. Ils arrivent en courant, se bousculant les uns les autres, chacun voulant être le premier à s'approcher des jouets et à choisir le plus beau. Et au moment où le dernier d'entre eux quitte la maison, le toit enflammé s'écroule au milieu d'une pluie d'étincelles et de débris.
Les garçons, sans prendre conscience du péril évité de justesse, poussent de grands cris : “Père, père, où sont les jouets que tu nous as promis ? Où sont les trois chariots ? Nous sommes venus en hâte et ils ne sont pas là. Tu as promis, père !”
"Le père, un homme riche pour lequel la destruction de sa maison n'était pas une grande perte, à présent que ses fils étaient hors de danger, se hâta d'aller leur acheter les jouets, les chariots, sachant que sa ruse avait sauvé la vie de ses fils.
"Le Bouddha se tourna vers Sariputra et lui dit : "Eh bien, Sariputra, cette ruse n'était-elle pas justifiée ? Cet homme ne justifiait-il pas la fin en ayant recours à des moyens innocents ? Sans lui, ses fils eussent été consumés par les flammes."
"Sariputra se tourna vers le Bouddha et dit : "Oui, Maître, la fin justifiait les moyens et elle a apporté des bienfaits."
Le Lama Mingyar Dondup me sourit :
— Tu es resté trois jours devant le Chakpori, me dit-il, tu as cru que l'entrée t'en était interdite et pourtant nous te soumettions à une épreuve, à un moyen qui a été justifié, en fin de compte, car tu fais des progrès satisfaisants.
Moi aussi, j'emploie ‘un moyen qui sera justifié en fin de compte’. J'écris ceci, mon histoire vraie — Le Troisième Œil et Docteur de Lhassa (Lama Médecin) sont absolument vrais aussi — afin de pouvoir continuer ultérieurement mon travail sur l'Aura. Tant de gens m'ont demandé dans leurs lettres pourquoi j'écris, que je veux leur en donner ici l'explication : j'écris la vérité, afin que les Occidentaux sachent que l'Âme de l'Homme est plus importante que les spoutniks ou que les fusées à réaction.
Un jour, l'Homme se rendra sur les autres planètes grâce aux voyages astraux, ainsi que je l'ai fait moi-même ! Mais l'Homme Occidental n'ira pas tant qu'il ne songera qu'à lui-même, qu'à son ambition personnelle et ne se souciera pas des droits de son prochain. J'écris la vérité afin d'être en mesure plus tard de faire progresser la cause de l'Aura humaine. Imaginez (cela viendra) un malade entrant dans le cabinet d'un médecin ; celui-ci n'aura pas besoin de poser de questions, il prendra simplement une caméra spéciale et photographiera l'Aura du patient. En une minute, ou à peu près, ce praticien non clairvoyant verra une photographie en couleurs de l'Aura de son malade. Il l'étudiera, en observera les stries et les nuances, exactement comme un psychiatre étudie les ondes cérébrales d'un malade mental.
Le médecin, après avoir comparé sa photographie en couleurs avec des graphiques standards, prescrira un traitement aux ultra-sons et aux couleurs du spectre, qui compensera les déficiences de l'Aura du malade. Le cancer ? Il sera guéri. La tuberculose ? Elle aussi sera guérie. C'est absurde ? Eh bien, il y a peu de temps, n'était-il pas ‘absurde’ de songer à envoyer des ondes radio à travers l'Atlantique ? ‘Absurde’ d'imaginer un avion volant à plus de cent milles (160 km) à l'heure ? Le corps humain ne supporterait pas l'épreuve, disait-on. Il était ‘absurde’ de songer à voyager dans les espaces intersidéraux. Les singes y sont déjà allés. Cette idée ‘absurde’ qui est la mienne, je l'ai vue à l'œuvre !
Les rumeurs du dehors pénétrèrent dans ma chambre, me ramenant au présent. Trains exécutant des manœuvres, sirène d'une voiture de pompiers, gens aux voix sonores, se hâtant vers les enseignes lumineuses d'un lieu de plaisir tout proche. "Plus tard, me dis-je, lorsque ce vacarme terrible se sera tu, j'utiliserai la boule de cristal et je Leur dirai que je suis prêt à leur obéir."
Une ‘sensation de chaleur’ m'envahit : Ils savent déjà et s'en réjouissent.
Voici donc, écrite selon les ordres reçus, la vérité, l'Histoire de Rampa.
Chapitre Deux
Le Tibet, au début du siècle, était en proie à de nombreux problèmes. La Grande-Bretagne menait grand bruit, accusant devant le monde entier le Tibet d'être trop bien avec la Russie, au détriment de l'Impérialisme britannique. Le Tsar de toutes les Russies vociférait dans les vastes salles de son palais moscovite, se plaignant que le Tibet se montrât trop amical à l'égard de la Grande-Bretagne. La Cour Royale de Chine éclatait en imprécations contre le Tibet qui, selon elle, était trop favorable à la Grande-Bretagne et à la Russie et ne l'était certainement pas assez à la Chine.
Lhassa grouillait d'espions de nationalités diverses, déguisés en moines mendiants, en pèlerins, en missionnaires, ou en tout ce qui pouvait offrir une excuse plausible pour se trouver au Tibet. Des messieurs de races variées se rencontraient furtivement à la faveur des ténèbres pour voir comment, eux, pourraient tirer profit d'une situation internationale aussi troublée. Le Grand Treizième, la Treizième Incarnation du Dalaï-Lama, grand homme d'État de son propre chef, préservait à la fois son sang-froid et la paix et dirigeait le Tibet de manière à sauvegarder son indépendance. Les chefs des principales nations du monde adressaient, à travers l'Himalaya Sacré, de courtois messages d'amitié inébranlable et des offres sournoises de ‘protection’.
C'est dans cette atmosphère de trouble et d'inquiétude que je vis le jour. Comme le disait si justement grand-mère Rampa, j'étais né pour les ennuis et j'en ai toujours eu depuis, quoique, dans la grande majorité des cas, je n'y aie été pour rien ! Les Prophètes et les Devins louaient hautement les dons innés ‘du garçon’ en matière de clairvoyance et de télépathie. ‘Un ego exalté’, déclara l'un. ‘Destiné à laisser son nom dans l'Histoire’, dit un autre. ‘Une Grande Lumière pour notre Cause’, affirma un troisième. Et moi, à cet âge tendre, j'élevai la voix pour protester avec véhémence contre la bêtise que j'avais commise en renaissant. Mes parents et amis, dès que je fus en mesure de comprendre leurs propos, ne manquèrent pas une seule occasion de me rappeler le bruit que j'avais fait en l'occurrence ; ils me disaient, d'un ton de jubilation, que ma voix avait été la plus rauque, la moins musicale qu'ils aient jamais eu le malheur d'entendre.
Père était l'un des hommes les plus éminents du Tibet. Gentilhomme de haut lignage, il exerçait une influence considérable sur les affaires de notre pays. Mère, elle aussi, par l'intermédiaire de sa famille, avait une autorité considérable en matière de politique. À présent, en jetant un regard sur le passé, j'ai tendance à penser que ces problèmes étaient presque aussi importants que Mère le croyait, ce qui n'est pas peu dire.
J'ai passé mon enfance dans notre demeure, près du Potala, de l'autre côté du Kaling Chu, le Fleuve Heureux. ‘Heureux’, car ses eaux chantantes qui serpentaient à travers Lhassa donnaient la vie à cette cité. Notre maison était protégée par des bois, la domesticité y était nombreuse et mes parents menaient une vie princière. Moi — eh bien moi, j'étais soumis à une discipline très dure. L'invasion chinoise, dans la première décennie du siècle, avait profondément aigri mon père et il semblait avoir conçu à mon égard une hostilité irrationnelle. Mère, comme la plupart des femmes du monde, n'avait guère le temps de s'occuper de ses enfants ; elle les considérait comme des objets dont il fallait se débarrasser le plus vite possible en les confiant aux soins de quelque subalterne payé pour cette besogne.
Frère Paljor ne demeura pas longtemps avec nous ; avant son septième anniversaire, il partit pour les ‘Champs Célestes’ et la Paix. J'avais quatre ans à l'époque et l'animosité de Père à mon égard parut s'accroître encore après ce deuil. Sœur Yasodhara avait six ans lorsque notre frère mourut, et nous déplorâmes tous deux non point la mort de Paljor, mais le fait qu'après sa disparition la discipline devint pour nous plus rude encore.
À présent, tous les membres de ma famille sont morts, assassinés par les Communistes chinois. Ma sœur fut tuée parce qu'elle résistait aux avances des envahisseurs ; mes parents, parce qu'ils étaient des propriétaires terriens. La demeure, d'où je regardais avec admiration le parc superbe, a été transformée en dortoirs pour les travailleurs esclaves. Dans une des ailes de la maison se trouvent les femmes, dans l'autre, les hommes. Tous sont mariés, et si mari et femme ont une conduite satisfaisante, s'ils accomplissent leur quote-part de travail, ils ont le droit de se voir une fois par semaine pendant une demi-heure, après quoi ils sont examinés par un médecin.
Toutefois à l'époque lointaine de mon enfance, ces événements appartenaient à l'avenir ; on savait qu'ils devaient se produire un jour, mais, de même que l'on songe rarement à sa propre mort, on ne s'inquiétait guère à ce sujet. Bien que les astrologues les eussent évidemment prédits, nous continuions à mener notre vie quotidienne, sans nous soucier de l'avenir.
Immédiatement avant mon septième anniversaire, à l'âge même auquel mon frère avait quitté cette vie, eut lieu une très importante cérémonie où les Astrologues d'État consultèrent leurs graphiques et dévoilèrent quel serait mon avenir. Tous les gens qui étaient ‘quelqu'un’ avaient été invités. Bon nombre vinrent sans en avoir été priés, après avoir graissé la patte aux domestiques. La foule était tellement dense que l'on avait peine à circuler malgré l'ampleur de notre domaine.
Les prêtres se trémoussèrent et marmottèrent, selon leur habitude, et jouèrent une comédie impressionnante avant d'énoncer les points essentiels de ma carrière. Je dois en toute bonne foi reconnaître qu'ils avaient parfaitement raison en ce qui concerne toutes les épreuves qui me sont arrivées. Puis ils déclarèrent à mes parents que je devais entrer dans la Lamaserie du Chakpori afin d'y devenir Moine-Médecin.
J'en fus profondément attristé car j'avais le pressentiment que cette décision serait la source de mes ennuis. Toutefois, personne ne s'inquiéta de mon opinion, et bientôt je subis l'épreuve qui consistait à me laisser trois jours et trois nuits devant la porte de la Lamaserie, simplement afin de voir si j'avais l'endurance nécessaire pour être moine-médecin. Le fait que j'aie passé l'épreuve avec succès est dû plus à la crainte que j'éprouvais de mon père, qu'à la vigueur de mon tempérament. Entrer au Chakpori fut l'étape la plus facile. Nos journées étaient longues et il était dur, certes, de se lever à minuit et d'assister à des services qui avaient lieu aussi bien la nuit que le jour, à intervalles réguliers. On nous enseigna le programme académique ordinaire, nos devoirs religieux, les secrets de l'univers métaphysique et la science médicale, car nous devions devenir moines-médecins. Les traitements médicaux étaient tels en Orient, que la pensée de l'Occident est encore incapable de les comprendre. Pourtant — des laboratoires pharmaceutiques Occidentaux s'efforcent de synthétiser les ingrédients puissants contenus dans les herbes que nous employons.
Le remède, que l'Orient a connu de tout temps, sera artificiellement produit dans une éprouvette, qualifié d'un nom pompeux et salué comme une réussite de la technique Occidentale. Tel est le progrès.
Lorsque j'eus huit ans, je subis une opération qui m'ouvrit le ‘Troisième Œil’, cet organe spécial de clairvoyance, moribond chez la plupart des gens parce qu'ils en nient l'existence. Grâce à cet ‘œil’, j'étais capable de discerner l'Aura humaine et de deviner ainsi les intentions de ceux qui m'entouraient. Il était — et est ! — très divertissant d'écouter les paroles creuses de ceux qui feignent l'amitié désintéressée et qui n'ont au cœur que des pensées meurtrières. L'Aura peut révéler toute l'histoire médicale d'un être humain. En déterminant ce qui manque à une Aura, et en remplaçant les déficiences par des radiations spéciales, on peut guérir les gens de leurs maladies.
Comme je possédais un pouvoir de clairvoyance particulièrement fort, j'étais fréquemment appelé par le Très Profond, la Treizième Grande Incarnation du Dalaï-Lama, afin d'observer l'Aura de ceux qui Lui rendaient visite ‘en amis’. Mon Guide bien-aimé, le Lama Mingyar Dondup, un clairvoyant très éminent, m'avait bien exercé en la matière. Il m'avait également appris les grands secrets du voyage astral, qui est devenu pour moi plus simple que la marche. Presque tous les hommes, quelle que soit leur religion, croient à l'existence d'une ‘âme’ ou d'un ‘autre corps’. En fait, il existe plusieurs ‘corps’ ou ‘enveloppes’, mais nous ne nous occuperons pas de leur nombre exact pour le moment. Nous croyons — ou plutôt, nous savons ! — qu'il est possible de se dépouiller du corps physique ordinaire (celui qui porte les vêtements !) et de se rendre n'importe où, même au-delà de la Terre, sous la forme astrale.
Chacun de nous voyage astralement, même ceux qui voient là une ‘absurdité’. Non, c'est aussi naturel que de respirer. La plupart des gens y parviennent pendant leur sommeil, de sorte qu'à moins d'être entraînés, ils n'en sont pas conscients. Que de gens s'exclament, le matin : "Oh ! j'ai fait un rêve merveilleux, cette nuit. J'avais l'impression d'être avec Une telle. Nous étions très heureux d'être ensemble et elle m'a dit qu'elle m'écrirait. Bien sûr, tout est très vague, à présent." Et, généralement, quelques jours plus tard, la lettre arrive. L'explication est la suivante : une des deux personnes en question s'est rendue astralement auprès de l'autre et comme elles ne possédaient pas l'entraînement approprié, le voyage est devenu un ‘rêve’. Presque tout le monde peut se déplacer astralement. N'existe-t-il pas de nombreux cas authentiques où un moribond a rendu visite en rêve à un être aimé, afin de lui dire adieu ? Il s'agit encore de voyage astral. Le mourant, dont les liens avec le monde se détachent, n'éprouve aucune difficulté à se rendre auprès d'un ami, au moment du grand passage.
La personne bien entraînée peut s'allonger et se détendre, puis relâcher les liens enchaînant l'ego, ou le corps-compagnon, ou l'âme, appelez cela comme il vous plaira, c'est la même chose. Puis lorsque le seul lien qui demeure est la ‘Corde d'Argent’, le second corps peut dériver comme un ballon captif au bout de ses amarres. Lorsque vous êtes bien exercé, vous pouvez vous rendre, totalement conscient, totalement éveillé, en n'importe quel lieu de votre choix. L'état de rêve est celui où un être se déplace astralement sans le savoir, et rapporte de ce voyage des impressions confuses, embrouillées. À moins que l'on ne soit entraîné, la ‘Corde d'Argent’ reçoit constamment une multitude d'impressions qui plongent le rêveur dans une confusion de plus en plus grande. Dans l'astral vous pouvez vous rendre n'importe où, même au-delà des confins de la Terre, car le corps astral ne respire ni ne se nourrit. Tous ses besoins sont satisfaits par la ‘Corde d'Argent’ qui, au cours de sa vie, le relie constamment au corps physique.
La Bible chrétienne fait allusion à la ‘Corde d'Argent’ : "De peur que la ‘Corde d'Argent’ ne soit tranchée et que le ‘Calice d'Or’ ne soit brisé" (cf. Livre de l'Ecclésiaste (12:8) : "[Mais souviens-toi de ton créateur…] avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne ;" — NdT). Le ‘Calice d'Or’ est l'auréole ou le nimbe qui entoure la tête d'un être spirituellement évolué. Ceux qui ne sont pas spirituellement évolués ont une auréole d'une couleur très différente ! Les artistes de jadis peignaient une auréole d'or autour de la tête des saints, parce qu'ils la voyaient réellement, sinon, ils ne l'auraient pas reproduite. Cette auréole n'est en réalité qu'une très petite partie de l'Aura humaine, mais elle se distingue plus aisément car elle est en général beaucoup plus brillante.
Si les savants voulaient étudier le voyage astral et les Auras, au lieu de jouer avec des fusées qui sont si souvent incapables de se placer sur leur orbite, ils auraient résolu le problème des voyages interspatiaux. Grâce à des projections astrales, ils seraient capables de visiter un autre monde et de déterminer ainsi quel type de navire pourrait faire le voyage, dans le domaine physique, car le déplacement astral a un grand désavantage : on ne peut y emporter ni en rapporter aucun objet matériel. On ne peut en rapporter que des connaissances nouvelles. Ainsi — les savants auront besoin d'un navire pour ramener des spécimens vivants et des photographies destinés à convaincre un monde incrédule, car les gens ne croient à l'existence d'une chose que lorsqu'ils peuvent la mettre en pièces, afin de prouver qu'après tout, elle existe peut-être.
(Le voyage astral intersidéral)
Je me rappelle en particulier un voyage que j'ai entrepris dans l'espace. Ceci est l'absolue vérité et les gens évolués le savent bien. Quant aux autres, peu importe qu'ils me croient ou non, ils apprendront lorsqu'ils auront atteint un stade plus élevé de maturité spirituelle.
Voici donc l'aventure qui m'est arrivée, il y a de nombreuses années, lorsque j'étudiais à la Lamaserie du Chakpori. Bien que les faits soient très anciens, le souvenir m'en est demeuré aussi frais que s'ils dataient d'hier.
Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, un autre lama nommé Jigme, qui était un de mes amis intimes, et moi-même, nous trouvions sur le toit du Chakpori, sur la Montagne de Fer, à Lhassa. C'était une nuit très froide, il faisait environ quarante degrés au-dessous de zéro. Tandis que nous étions debout sur ce toit exposé, le vent hurleur collait nos robes à nos corps frissonnants. À contrevent, nos robes battaient comme les Bannières de Prières, nous laissant glacés jusqu'aux os, et menaçant de nous projeter dans le précipice montagneux.
Tandis que nous regardions autour de nous, nous penchant à grand-peine contre le vent afin de garder notre équilibre, nous vîmes au loin les lumières de Lhassa, alors qu'à notre droite, celles du Potala ajoutaient encore à l'ambiance mystique de la scène. Toutes les fenêtres semblaient être ornées d'étincelantes lampes à beurre qui, bien que protégées par les murs puissants, oscillaient et dansaient au gré du vent. Sous la faible clarté des étoiles, les toits dorés du Potala luisaient comme si la lune elle-même était descendue jouer parmi les pinacles et les tombes, au sommet du majestueux bâtiment.
Mais nous frissonnions dans le froid âpre, nous frissonnions et nous souhaitions retrouver la chaleur, l'atmosphère chargée d'encens du temple, sous nos pieds. Nous étions montés sur le toit dans une intention précise, ainsi que nous l'avait déclaré le Lama Mingyar Dondup, d'un ton énigmatique. À présent, debout entre nous, aussi ferme, semblait-il, que la montagne elle-même, il désignait de son bras levé une étoile lointaine — un monde rougeâtre — et nous dit :
— Mes frères, voici l'étoile Zhoro, une vieille, vieille planète, l'une des plus anciennes de ce système solaire. Elle approche à présent du terme de sa longue existence.
Il se détourna vers nous, le dos au vent glacial, et reprit :
— Vous avez beaucoup étudié le thème du voyage astral. Maintenant, ensemble, nous allons nous rendre sur cette planète par projection astrale. Nous abandonnerons nos corps ici, sur ce toit battu des vents et nous nous élèverons au-delà de l'atmosphère, au-delà même du Temps.
Tout en parlant, il nous fit traverser le toit afin de gagner le maigre refuge offert par une coupole en saillie du toit. Puis il s'allongea et nous pria d'en faire autant. Nous serrâmes étroitement nos robes sur nous et chacun prit dans la sienne la main de l'autre. Au-dessus de nous s'étendait la voûte du Ciel, d'un violet sombre, cloutée de faibles lueurs multicolores, car toutes les planètes répandent des lumières différentes lorsqu'elles sont vues dans l'air transparent de la nuit tibétaine. Le vent hurlait autour de nous, mais, soumis dès l'enfance à une discipline sévère, nous ne songions pas à nous plaindre. Nous savions qu'il ne s'agirait pas d'un voyage ordinaire dans l'astral, car nous ne laissions pas souvent nos corps ainsi exposés aux intempéries. Lorsque le corps est mal à l'aise, l'ego peut se déplacer plus vite et plus loin et se rappeler les détails du voyage avec plus de précision. Ce n'est que pour de petits voyages interspatiaux que l'on installe confortablement le corps.
Mon Guide dit :
— À présent, joignons les mains et projetons-nous ensemble au-delà de cette Terre. Demeurez avec moi, nous irons très loin et il nous arrivera, cette nuit, d'étranges aventures.
Nous nous étendîmes sur le dos et respirâmes selon la méthode appropriée pour nous libérer de nos liens en vue du voyage astral. J'avais conscience des hurlements du vent entre les cordes des Bannières de Prières, qui s'agitaient frénétiquement au-dessus de nos têtes. Puis, soudain, une secousse se produisit et je ne sentis plus les doigts aigus du vent glacé. Je me sentis flotter, hors du temps terrestre, au-dessus de mon corps et tout n'était que paix. Le Lama Mingyar Dondup était déjà debout, ayant pris sa forme astrale, et en baissant les yeux, je vis que mon ami Jigme quittait son corps, lui aussi. Lui et moi nous redressâmes et créâmes un lien pour nous joindre à notre guide, le Lama Mingyar Dondup. Ce lien, appelé ectoplasme, est fabriqué à partir du corps astral par la pensée. C'est la substance grâce à laquelle les médiums suscitent des manifestations spirites.
Le lien parfait, nous nous élevâmes d'un bond dans le ciel nocturne. Toujours curieux, je jetai un regard vers le bas. Au-dessous de nous flottaient nos Cordes d'Argent, ces cordes infinies qui relient pendant la vie le corps physique au corps astral. L'ascension continuait. La Terre s'amenuisait. Nous pouvions voir la couronne du Soleil apparaître lentement à l'autre extrémité du globe, dans ce qui devait être le Monde Occidental, le Monde Occidental où nous avions tant voyagé astralement. Nous montions toujours, nous distinguions les contours des océans et des continents dans la partie éclairée de la planète. Vue de cette altitude, elle ressemblait à un croissant de lune, où l'Aurore Boréale, la Lumière du Nord, aurait étincelé au-dessus des pôles.
Nous nous élevions toujours, de plus en plus vite, et dépassâmes la vitesse de la lumière, car nous étions des esprits désincarnés, qui montaient sans cesse, à une rapidité se rapprochant de celle de la pensée. En regardant devant moi, j'aperçus une planète énorme, rouge, menaçante. Nous descendîmes vers elle à une allure incalculable. Quoique je fusse rompu aux voyages astraux, je sentis la peur m'envahir. La forme astrale du Lama Mingyar Dondup se mit à rire, télépathiquement, et me dit :
— Oh Lobsang ! si nous devions heurter cette planète, ni eux ni nous n'aurions le moindre mal. Nous la traverserions de part en part ; rien ne nous arrêterait.
Nous nous retrouvâmes enfin flottant au-dessous d'un monde rouge et désolé ; des roches rouges, du sable rouge dans une mer rouge, sans flux ni reflux. Au moment où nous nous rapprochions de la surface de ce monde, nous aperçûmes d'étranges créatures, semblables à d'énormes crabes, qui se déplaçaient d'une allure léthargique, le long de la mer. Debout, sur ce rivage rocheux, nous regardâmes l'eau morte et mortellement dangereuse, avec son écume rouge et nauséabonde. Tandis que nous la contemplions, la surface bourbeuse fut, à plusieurs reprises, agitée de frissons et une étrange créature en émergea, une créature de couleur rouge, elle aussi, lourdement cuirassée, avec des articulations extraordinaires. Elle poussait des grognements de lassitude et d'ennui, semblait-il, et une fois sur le sable, elle s'écroula le long de la mer sans marée. Au-dessus de nos têtes luisait un soleil rouge à la lumière morne qui projetait des ombres couleur de sang, dures, effrayantes. Autour de nous, rien ne bougeait, rien ne donnait signe de vie, sauf les bizarres créatures à carapace, étendues, à moitié mortes, sur le sol. Quoique j'eusse pris mon corps astral, j'éprouvai, en regardant autour de moi, un frisson d'appréhension. Une mer rouge sur laquelle flottait une écume rouge, des roches rouges, un sable rouge, des créatures à carapace rouge, et au-dessus de tout cela, un soleil rouge semblable aux braises mourantes d'un feu qui va bientôt s'éteindre à tout jamais.
Le Lama Mingyar Dondup dit :
— Ce monde est moribond. Il n'est plus soumis à la rotation. Il flotte à la dérive dans l'océan de l'Espace, satellite d'un soleil mourant, qui bientôt éclatera et deviendra une étoile naine dépourvue de vie et de lumière, une étoile naine qui à la longue entrera en collision avec une autre étoile, ce qui donnera naissance à un nouveau monde. Je vous ai amenés jusqu'ici car il existe néanmoins sur cette planète une vie très évoluée, une vie ayant pour but la recherche et l'étude des phénomènes de cette sorte. Regardez autour de vous.
Il se détourna et désigna de sa main droite l'horizon lointain ; alors nous aperçûmes trois immenses tours qui se dressaient dans le ciel tout rouge et au sommet de ces tours, trois boules de cristal qui brillaient et palpitaient d'une lumière jaune, comme si elles avaient été vivantes.
Pendant que, stupéfaits, nous contemplions ce spectacle, une des sphères devint d'un bleu électrique intense. Le Lama Mingyar Dondup reprit :
— Venez, ils nous souhaitent la bienvenue. Descendons dans le sol, où ils occupent une chambre souterraine.
Ensemble, nous nous approchâmes de la base de cette tour, et lorsque nous fûmes debout sous la charpente, nous aperçûmes une entrée fortement défendue par un curieux métal brillant, qui ressortait comme une cicatrice sur cette terre rouge et désolée. Nous traversâmes cette porte car, qu'il s'agisse de métal, de roche, ou de quoi que ce soit d'autre, il n'existe pas de barrière pour ceux de l'astral. Nous suivîmes de longs couloirs rouges de roche morte, et aboutîmes à un hall très vaste, orné de graphiques et de cartes, d'instruments et de machines étranges. Au centre se trouvait une longue table à laquelle étaient assis neuf hommes très âgés, tous dissemblables. L'un était grand et mince, avec une tête pointue, conique. Un autre était petit et d'aspect très robuste. Aucun de ces hommes ne ressemblait à un autre. Tous venaient évidemment de planètes différentes et appartenaient à des races différentes. Des humains ? Peut-être le terme d'humanoïde les décrirait-il avec plus de précision. Ils étaient tous humains, mais certains l'étaient plus que d'autres.
Nous nous rendîmes compte que tous les neuf regardaient fixement dans notre direction.
— Ah, dit l'un, télépathiquement, nous avons des visiteurs venus de loin. Nous vous avons vus atterrir ici, à notre station de recherches, et nous vous souhaitons la bienvenue.
— Pères respectés, répondit le Lama Mingyar Dondup, je vous ai amené ces deux compagnons qui viennent d'acquérir l'état de Lama et qui se consacrent assidûment à la recherche de la connaissance.
— Ils sont les très bienvenus, dit l'homme de haute taille, qui était apparemment le chef du groupe. Nous ferons tout notre possible pour vous être utiles, ainsi que nous avons aidé précédemment vos autres compagnons.
Cette réponse me surprit, car j'ignorais absolument que mon Guide accomplît de tels voyages astraux à travers l'espace céleste.
L'homme de petite taille qui me regardait, sourit. Il dit, dans le langage universel de la télépathie :
— Je crois, jeune homme, que la différence de nos apparences vous intrigue profondément.
— Père Respecté, dis-je, assez décontenancé par l'aisance avec laquelle il avait deviné mes pensées, que je m'étais efforcé de dissimuler, il est exact que je m'étonne de la diversité des tailles et des formes qui sont les vôtres, et j'ai songé que vous ne pouviez être tous des habitants de la Terre.
— Vous avez vu juste, me fut-il répondu. Nous sommes tous des humains, mais le milieu a quelque peu modifié notre aspect et notre stature. D'ailleurs ne constatez-vous pas la même chose sur votre propre planète, où au Tibet, par exemple, certains moines qui vous servent de gardiens ont sept pieds (2,13 m) de haut. Pourtant, en une autre contrée de la Terre, se trouvent des gens qui n'atteignent que la moitié de cette taille et que vous appelez Pygmées. Tous sont des humains ; ils sont capables de procréer les uns avec les autres, malgré la différence de stature, car nous autres humains sommes tous faits de molécules de carbone. Ici, dans cet univers particulier, tout dépend des molécules fondamentales de carbone et d'hydrogène, car toutes deux sont les briques qui composent la structure de votre Univers. Nous qui avons visité d'autres mondes, bien au-delà de ce secteur particulier de notre nébuleuse, nous savons que d'autres systèmes utilisent des briques différentes. Certains emploient le silicium, certains le gypse, ou d'autres éléments encore, mais leurs habitants diffèrent de ceux de cet Univers et nous constatons avec tristesse que nos pensées ne sont pas toujours en affinité avec les leurs.
Le Lama Mingyar Dondup prit la parole :
— J'ai conduit ici ces deux jeunes lamas, dit-il, afin qu'ils puissent voir les étapes de la mort et de la décrépitude sur une planète qui a épuisé son atmosphère et où l'oxygène de cette atmosphère s'est combiné avec des métaux pour les brûler et pour tout réduire à l'état de poussière impalpable.
— Cela est vrai, dit l'homme de haute taille. Nous voudrions faire comprendre à ces jeunes gens que tout ce qui naît est voué à la mort. Chaque chose vit pendant le laps de temps qui lui est alloué et ce laps de temps représente un nombre d'unités de vie. L'unité de vie pour chaque créature vivante correspond à un battement du cœur de cette créature. Une planète vit pendant 2 700 000 000 de battements de cœur, après quoi elle meurt, mais en donnant naissance à d'autres planètes. Un humain vit également le temps de 2 700 000 000 de battements et il en est de même pour le plus infime des insectes. Le cœur d'un insecte dont l'existence ne dépasse pas vingt-quatre heures, bat 2 700 000 000 de fois. Une planète — cela varie bien sûr — peut n'avoir qu'une seule pulsation cardiaque en 27 000 ans, après quoi elle sera agitée d'une convulsion, car elle se préparera pour le prochain battement de cœur. Donc, toute vie a la même durée, mais les créatures ne vivent pas toutes au même rythme. Les créatures sur Terre, l'éléphant, la tortue, la fourmi et le chien, vivent toutes un nombre égal de battements cardiaques, mais toutes ont des cœurs battant à des vitesses diverses, de sorte que leur existence semble plus ou moins longue.
Jigme et moi jugeâmes que ces paroles avaient un intérêt passionnant et elles nous expliquèrent bien des choses que nous avions pressenties dans notre Tibet natal. Nous avions, au Potala, entendu parler de la tortue qui vivait un très grand nombre d'années et d'insectes dont l'existence ne durait qu'un soir d'été. Nous comprenions à présent que leurs perceptions avaient dû être accélérées, afin de s'harmoniser avec les pulsations rapides de leur cœur.
L'homme de petite taille, qui paraissait nous considérer d'un air approbateur, déclara :
— En outre, de nombreux animaux représentent différentes fonctions du corps. La vache, par exemple, n'est comme chacun peut s'en rendre compte, qu'une glande mammaire ambulante, la girafe est un cou, un chien — eh bien, tout le monde sait à quoi un chien pense constamment — humant le vent pour savoir ce qui se passe, car il a une très faible vue — et ainsi un chien peut être considéré comme un nez. D'autres animaux ont des affinités similaires avec les diverses parties de l'anatomie humaine. Le fourmilier d'Amérique du Sud pourrait être considéré comme une langue.
Nous conversâmes ainsi télépathiquement pendant un certain temps et apprîmes bien des choses étranges. Et nous les apprîmes à la vitesse de la pensée, ainsi qu'il est de règle dans l'astral. Enfin, le Lama Mingyar Dondup se leva et déclara que le moment était venu de partir.
Au-dessous de nous, pendant notre retour, les toits dorés du Potala étincelaient sous la lumière du soleil hivernal. Nos corps étaient engourdis, alourdis, et il fut difficile de faire travailler nos articulations à demi gelées. "Eh bien, songions-nous, tout en nous remettant péniblement sur pied, voici une autre aventure, un autre voyage terminé. Quels seront les prochains ?"
Une science dans laquelle nous autres Tibétains excellions était celle de la guérison par les simples. Jusqu'à maintenant, le Tibet avait toujours été virtuellement interdit aux étrangers qui n'étudièrent jamais notre faune et notre flore. Sur les hauts plateaux croissent d'étranges plantes. Le curare, par exemple, ainsi que la mescaline ‘récemment découverte’, sont connus des Tibétains depuis des siècles. Nous pourrions guérir quantité de maux qui affligent le monde Occidental, mais encore faudrait-il que ce dernier eût un peu plus de foi. De toute façon, la plupart des Occidentaux sont fous, alors pourquoi se soucier d'eux ?
Chaque année certains d'entre nous, ceux qui avaient le mieux travaillé, partaient à la cueillette des simples. Plantes, pollens, racines et graines étaient soigneusement rassemblés et placés dans des sacs en peau de yak. J'aimais cette tâche et m'y consacrais avec zèle. Je m'aperçois aujourd'hui que ces plantes qui m'étaient si familières sont introuvables ici.
Finalement, on m'estima digne de subir la Cérémonie de la Petite Mort, dont j'ai parlé dans Le Troisième Œil. Grâce à des rites particuliers, je fus mis en état de mort cataleptique, loin au-dessous du Potala, et je voyageai dans le passé, le long des Archives Akashiques. Je parcourus aussi les divers pays de la Terre. Mais laissez-moi vous décrire ce que je ressentis alors :
Le couloir creusé dans le roc vif à des centaines de pieds (m) sous la terre gelée était humide, humide et sombre comme la tombe elle-même. Léger comme la fumée, j'avançais dans ces ténèbres et au fur et à mesure que mes yeux s'y habituaient, je vis, d'abord indistinctement, la phosphorescence verdâtre de la végétation moisie accrochée aux murs rocheux. Là où cette végétation proliférait et où la lueur était la plus brillante, je pouvais apercevoir l'éclat jaune de la veine aurifère courant le long de ce tunnel rocheux.
Je me déplaçais silencieusement, sans avoir conscience du temps, sans songer à rien si ce n'est que je devais m'enfoncer de plus en plus à l'intérieur de la terre ; c'était pour moi une date mémorable, puisque je revenais d'un voyage de trois jours dans l'état astral. Le temps s'écoulait et j'avançais toujours plus profondément dans les ténèbres de la chambre souterraine, des ténèbres qui semblaient sonores et vibrantes.
Je voyais, en pensée, le monde au-dessus de moi, le monde auquel je revenais à présent. J'apercevais mentalement la scène familière, à présent cachée par l'obscurité totale. J'attendis, suspendu dans l'atmosphère comme un nuage d'encens dans un temple.
Graduellement, si graduellement, si lentement qu'un certain temps s'écoula avant que je ne puisse le percevoir, un son s'éleva au fond du couloir, un son extrêmement vague mais qui s'enfla, s'intensifia peu à peu : des psalmodies, des clochettes d'argent, et le "shush-shush" étouffé de pieds gainés de cuir. Enfin, une lumière oscillante et spectrale brilla au long des murs du tunnel. Le son prenait plus d'ampleur, à présent. J'attendis, me tenant sur une arête rocheuse, dans l'obscurité. J'attendis.
Peu à peu, avec une pénible lenteur, des silhouettes avancèrent vers moi précautionneusement. Lorsqu'elles s'approchèrent, je vis que c'étaient celles de moines à robes jaunes, portant des torches fulgurantes, des torches précieuses, prises au temple, faites de bois résineux, d'espèces rares, et de bâtonnets d'encens liés ensemble ; elles répandaient un parfum qui éloignaient les odeurs de mort et de décrépitude et ces lumières brillantes rendaient invisible la lueur malsaine de la végétation fétide.
À pas lents, les prêtres entrèrent dans la chambre souterraine. Deux d'entre eux s'approchèrent de chacun des murs, près de l'entrée, et tâtèrent les saillies rocheuses. Alors, l'une après l'autre, les lampes à beurre s'illuminèrent. À présent, la chambre était mieux éclairée et je pus regarder autour de moi de nouveau et voir, car je n'avais pas vu pendant trois jours.
Les prêtres étaient debout autour de moi et ne me voyaient pas ; ils encerclaient une pierre tombale qui occupait le centre de la chambre. Les psalmodies et le tintement des clochettes d'argent s'amplifièrent. Enfin, à un signal donné par un vieillard, six moines s'immobilisèrent, puis, haletant et gémissant, soulevèrent la pierre qui recouvrait le cercueil. En y jetant un regard, j'aperçus mon propre corps, revêtu de la robe d'un prêtre lama. Les moines psalmodiaient maintenant d'une voix plus forte, et chantaient :
— Ô Esprit du Lama Visiteur, qui a erré à la surface du monde, reviens, car aujourd'hui, le troisième jour est arrivé et va se terminer. Un premier bâtonnet d'encens est allumé afin de rappeler l'Esprit du Lama Visiteur.
Un moine s'avança et alluma un bâtonnet d'encens odoriférant, de couleur rouge, puis il en sortit un autre d'une boîte, tandis que les prêtres psalmodiaient :
— Ô Esprit du Lama Visiteur, qui nous reviens ici, fais vite, car l'heure de ton réveil s'approche. Un second bâtonnet d'encens est allumé afin de hâter ton retour.
Tandis que le moine tirait solennellement de la boite un bâtonnet d'encens, le prêtre récita :
— Ô Esprit du Lama Visiteur, nous attendons pour réanimer et nourrir ton corps terrestre. Hâte-toi, car l'heure va sonner et en revenant ici, tu auras franchi une autre étape de ton éducation. Un troisième bâtonnet d'encens est allumé à l'appel du retour.
Tandis que la fumée montait en spirales nonchalantes, engouffrant ma forme astrale, je frissonnai de crainte. J'avais l'impression que des mains invisibles me tiraient, tiraient sur ma Corde d'Argent, me tiraient vers le sol, me forçaient à pénétrer dans ce corps glacé et inerte. Je sentis le froid de la mort, je sentis mes membres trembler, je sentis ma vision astrale diminuer et de grandes convulsions secouèrent mon corps qui fut agité de mouvements incoercibles. Les grands Prêtres se penchèrent sur la tombe de pierre, me soulevèrent la tête et les épaules et firent couler un liquide amer entre mes mâchoires serrées.
"Ah, me dis-je, de retour dans les limites du corps, de retour dans les limites du corps."
Il me semblait qu'un feu courait dans mes veines, des veines qui avaient dormi pendant trois jours. Peu à peu, les prêtres me sortirent de la tombe, ils me soulevèrent et m'aidèrent à demeurer debout ; ils me firent faire le tour de la chambre de pierre, s'agenouillèrent devant moi, se prosternèrent à mes pieds, récitèrent leurs mantras, dirent leurs prières et allumèrent les bâtonnets d'encens. Ils me forcèrent à prendre un peu de nourriture, me lavèrent, me séchèrent et remplacèrent ma robe par une autre.
Au fur et à mesure que je reprenais conscience, mes pensées revenaient pour quelque raison étrange au moment où, trois jours auparavant, s'était déroulée une cérémonie analogue. On m'avait alors étendu dans ce même cercueil de pierre. L'un après l'autre, les Lamas m'avaient regardé. Puis ils avaient remis le couvercle sur le cercueil et éteint les bâtonnets d'encens. Solennellement, ils s'étaient éloignés le long du corridor de pierre, emportant les lumières avec eux, pendant que moi je gisais, en proie à la peur, dans cette tombe de pierre, angoissé malgré l'entraînement que j'avais reçu, angoissé bien que sachant ce qui devait arriver. J'étais seul dans les ténèbres, dans le silence de la mort. Le silence ? Non, car mes perceptions avaient atteint un degré d'acuité tel que je pouvais entendre la respiration des moines s'atténuer tandis qu'ils s'éloignaient ; le bruit de leurs pas s'assourdit de plus en plus et ce furent l'obscurité, le silence, l'immobilité, et le néant.
"La mort elle-même ne pourrait être pire que cela", me dis-je. Le temps s'écoulait, interminablement, et moi, je me refroidissais de plus en plus. Soudain le monde explosa, comme dans une flamme dorée, et j'abandonnai ma prison corporelle, je quittai les ténèbres de la tombe de pierre et la chambre souterraine. Je me frayai un passage à travers la terre, la terre glacée, m'élevai à la vitesse de la pensée, dans l'air froid et pur, au-dessus du puissant Himalaya, au-dessus des terres et des océans, au-delà des confins de la Terre. J'errai seul dans l'astral éthéré, tel un spectre, cherchant les lieux et les palais de la Terre, m'instruisant en observant les autres. Les voûtes les plus secrètes elles-mêmes n'étaient point scellées pour moi, car je pouvais vagabonder aussi librement que la pensée et entrer dans toutes les Salles du Conseil du monde. Les chefs de tous les pays défilèrent devant moi et mon œil exercé lisait leurs pensées secrètes.
"Et à présent, me dis-je, tandis qu'en proie au vertige, je me remettais sur pied aidé par des lamas, à présent, il va falloir que je relate tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai éprouvé. Et puis ? Peut-être devrai-je bientôt subir une autre épreuve analogue ? Après quoi, il faudra que je parte pour le monde Occidental, afin d'y endurer les souffrances prévues."
Avec beaucoup d'entraînement derrière moi, et beaucoup d'épreuves aussi, je quittai le Tibet pour plus d'entraînement et beaucoup plus d'épreuves encore. Au moment où je jetai un regard en arrière, avant de franchir l'Himalaya, je vis les premiers rayons du soleil apparaître derrière les cimes, effleurer les toits dorés des Bâtiments Sacrés et les transformer en une vision d'une splendeur à vous couper le souffle. La Vallée de Lhassa semblait encore endormie et les Bannières de Prières pendaient mollement du haut de leurs mâts. Près du Pargo Kaling, je pus discerner une caravane de yaks ; les marchands, aussi matinaux que moi, se dirigeaient vers les Indes alors que je prenais le chemin de Chongqing en compagnie de ma suite.
Nous passâmes au-dessus des chaînes, suivant les sentiers familiers aux marchands qui apportaient du thé au Tibet, des briquettes de thé venues de Chine, breuvage qui, avec la tsampa, est l'un des aliments essentiels des Tibétains. Ce fut en 1927 que nous quittâmes Lhassa, en direction de Chotang, une petite ville sur le fleuve Brahmapoutre. De là, nous partîmes pour Kanting, dans les basses-terres, traversant des vallées luxuriantes, des vallées à la végétation humide. Et nous avions du mal à respirer, car nous étions tous habitués à une altitude de 15 000 pieds (4 500 m) ou plus. Les basses-terres, dont la lourde atmosphère nous oppressait, nous déprimaient moralement ; nos poumons comprimés, nous avions l'impression de nous noyer dans l'air. Mais nous continuâmes notre route, jour après jour, jusqu'à ce que, après avoir parcouru mille milles (1 600 km) ou plus, nous atteignîmes les limites de la Cité chinoise de Chongqing.
Nous campâmes pour la nuit, notre dernière nuit ensemble, car le lendemain matin mes compagnons s'en retourneraient vers notre Lhassa bien-aimé, et nous bavardâmes mélancoliquement. J'étais fort attristé de constater que mes camarades, mes serviteurs, me considéraient déjà comme mort au monde, et condamné à vivre dans les cités des basses-terres. Le lendemain, je me rendis à l'Université de Chongqing, où tous les professeurs et tout le personnel s'efforçaient par tous les moyens d'aider les étudiants et d'assurer leur succès. Seule une infime minorité se montrait hostile ou égoïste ou souffrait de xénophobie.
À Chongqing, j'étudiai la médecine et la chirurgie. Je passai également des examens de pilote d'avion, car mon existence était toute tracée, définie à l'avance dans les moindres détails et je savais, comme ce fut le cas, que j'accomplirais de grandes choses en tant que pilote et en tant que médecin. Mais à Chongqing, on n'entendait encore que le murmure lointain de la guerre et la plupart des habitants de cette ville, à la fois ancienne et moderne, vivaient au jour le jour, jouissant de leur bonheur quotidien, accomplissant leurs tâches quotidiennes.
Tel fut le premier séjour que je fis, revêtu de mon corps terrestre, dans une grande ville, telle fut, en fait, ma première visite à une cité autre que Lhassa, bien que sous la forme astrale, j'eusse visité la plupart des grandes villes du globe. N'importe qui peut faire de même avec un peu d'entraînement, car il n'y a rien d'ardu, rien de magique dans l'astral, c'est aussi facile que de marcher, plus facile que de monter à bicyclette, car sur une bicyclette, il faut garder son équilibre ; dans l'astral, il faut simplement utiliser les capacités et les facultés qui nous ont été conférées à notre naissance.
Pendant que j'étudiais encore à l'Université de Chongqing, je fus rappelé à Lhassa, car le Treizième Dalaï-Lama allait mourir. J'y allai et pris part aux cérémonies qui suivirent Sa mort, puis, après avoir réglé diverses affaires à Lhassa, je retournai de nouveau à Chongqing. Après un dernier entretien avec l'Abbé Suprême T'ai Shu, on me convainquit d'accepter une mission dans l'armée de l'Air chinoise et d'aller à Shanghaï, une ville où, je le savais, il me fallait résider, mais qui n'offrait aucun attrait pour moi. Une fois de plus, par conséquent, je fus déraciné et partis pour une autre demeure. Là, le 7 juillet 1937, les Japonais suscitèrent un incident au Pont Marco-Polo. C'est ainsi que commença réellement la guerre sino-japonaise et elle nous plaça dans une situation très difficile. Je dus quitter mon cabinet fort lucratif de Shanghaï et me mettre pendant un certain temps à la disposition du Conseil Municipal de Shanghaï, après quoi je me consacrai entièrement à des œuvres de miséricorde et devins pilote dans l'armée chinoise. D'autres et moi nous rendions par avion sur les lieux où la présence de chirurgiens était indispensable. Nous volions dans de vieux appareils hors d'usage, jugés assez bons, toutefois, pour ceux qui ne combattaient pas et qui se contentaient de rafistoler les corps blessés.
Les Japonais abattirent mon avion, me firent prisonnier et me traitèrent sans ménagement. Je n'avais pas l'air d'un Chinois, ils ne savaient pas très bien de quoi j'avais l'air, et ils se montrèrent extrêmement pénibles à mon égard, à cause de mon uniforme et de mon grade.
Je parvins à m'évader et à regagner les lignes chinoises, où j'espérais continuer ma tâche. Je fus d'abord envoyé à Chongqing, pour changer d'atmosphère avant de reprendre du service actif. La ville ne ressemblait plus à celle que j'avais connue. Les bâtiments y étaient neufs ou, plutôt, certains des vieux bâtiments avaient de nouvelles façades, car la ville avait été bombardée. Elle était surpeuplée : toutes sortes de commerçants, venus des principales cités chinoises, s'y étaient rassemblés dans l'espoir d'échapper aux ravages de la guerre qui se déchaînait un peu plus loin.
Une fois guéri, ou à peu près, je fus envoyé sur la côte et placé sous les ordres du Général Yo. Je fus nommé médecin-chef de l'hôpital, mais ‘l'hôpital’ n'était guère qu'une rizière complètement saturée d'eau. Les Japonais ne tardèrent pas à arriver et à nous faire prisonniers. Ils tuèrent tous les malades incapables de marcher. De nouveau je fus entre leurs mains et fort mal traité, car ils me reconnurent et ils n'aimaient guère les gens qui cherchaient à leur échapper.
Après un certain temps, je fus expédié comme Officier Médical de Prison en charge d'un camp d'internement pour femmes de toutes nationalités. Grâce à mes connaissances des vertus curatives des simples, je pus tirer le meilleur parti des ressources naturelles du camp, et je traitai ainsi des malades à qui tout médicament était refusé. Les Japonais estimèrent que j'en faisais trop pour les internées et que je n'en laissais pas mourir suffisamment, aussi m'envoyèrent-ils au Japon, en compagnie d'un troupeau humain, dans un camp réservé aux terroristes, me dirent-ils. Je traversai la Mer du Japon dans un bateau qui prenait l'eau et où nous fûmes fort malmenés. Les Japonais me torturèrent cruellement et j'attrapai une pneumonie à la suite de supplices continuels. Mais mes geôliers ne tenaient pas à ce que je meure et ils me soignèrent à leur manière. Pendant ma convalescence — je ne laissai pas voir aux Japonais à quel point j'avais repris des forces — le sol se mit à frémir. Je crus à un véritable tremblement de terre, puis, en regardant par la fenêtre, je m'aperçus que les Japonais couraient çà et là, épouvantés, que le ciel s'était embrasé, que le soleil semblait s'être obscurci. Bien que je l'ignorasse à l'époque, il s'agissait du bombardement atomique de Hiroshima, de la chute de la première bombe, le 6 août 1945.
Les Japonais ne s'occupaient plus de moi, ils avaient fort à faire pour eux-mêmes, et je réussis à mettre la main sur un uniforme, une casquette et une paire de lourdes sandales. Puis je franchis le seuil étroit de la porte que personne ne gardait plus, me retrouvai à l'air libre, et parvins à gagner la côte où je découvris un bateau de pêche. Sans doute son propriétaire avait-il pris la fuite au moment où la bombe était tombée, car je ne le vis nulle part. Le bateau se balançait nonchalamment au bout de ses amarres. Dans le fond gisaient quelques morceaux de poisson qui répandaient déjà une odeur de pourriture. Un bidon, dans un coin, contenait de l'eau croupie, tout juste buvable. Je parvins à couper la mauvaise corde qui retenait le bateau au rivage et pris la mer. Le vent gonfla la voile en lambeaux, et lorsque je parvins à la hisser quelques heures plus tard, je partis vers l'inconnu. Mais l'effort avait été trop dur pour moi. Je m'écroulai, évanoui, au fond de l'embarcation.
Longtemps après, j'ignore combien de temps, je ne peux en juger que par l'état de décomposition du poisson, je m'éveillai aux pâles lueurs de l'aube. Le bateau continuait sa course, les vaguelettes se brisaient sur l'étrave. Ma pneumonie me rendait trop malade pour manier l'écope. Je demeurai donc prostré, les épaules et le bas du corps dans l'eau salée où tournoyaient les débris de poissons pourris. Plus tard, un soleil éblouissant apparut. J'eus l'impression que mon cerveau rissolait dans ma tête, que mes yeux étaient en feu et que ma langue sèche, douloureuse, était devenue de la grosseur de mon bras. Mes lèvres et mes joues se craquelaient. La douleur était intolérable. Je sentis que mes poumons éclataient de nouveau et compris qu'une fois encore, la pneumonie les avaient attaqués tous les deux. Tout s'assombrit et je retombai, inconscient, dans l'eau croupissante.
Le temps n'avait plus de sens, il n'était qu'une suite de brouillards rougeâtres, ponctués par les ténèbres. La douleur faisait rage en moi, j'étais aux frontières de la vie et de la mort. Brusquement, il y eut une secousse violente, des graviers crissèrent sous la coque. Le mât s'agita comme s'il allait se briser et le chiffon en lambeaux qui servait de voile claqua frénétiquement sous la forte bise. Je glissai en avant au fond du bateau, inconscient au milieu de l'eau nauséabonde.
— Eh, Hank, y a un soldat coréen au fond du bateau, y m'paraît clamsé !
La voix nasillarde me sortit vaguement de ma léthargie. Je gisais là, incapable de bouger, incapable de prouver que j'étais encore vivant.
— Qu'est-ce que t'as ? T'as peur d'un macchabée ? On a besoin du bateau, pas vrai ? Donne-moi un coup de main, on va le sortir de là.
Des pas lourds agitèrent le bateau, menaçant de m'écraser la tête.
— Oh ! bon sang, dit la première voix, le pauvre type en a pris un sacré coup. Peut-être qu'il respire encore, Hank, qu'est-ce que t'en penses ?
— Ah ! cesse de pleurnicher ! L'est pour ainsi dire mort. Flanque-le dehors. On n'a pas de temps à perdre.
Des mains robustes et rugueuses me saisirent par les pieds et par la tête. Elles me balancèrent une fois, deux fois, puis me lâchèrent et j'allai atterrir, avec une violence qui me secoua jusqu'aux os, sur la plage de sable et de graviers. Sans un regard en arrière, les deux hommes s'escrimèrent sur le bateau échoué. Avec force grognements et jurons, ils écartèrent de la coque de petits blocs rocheux et des pierres. Finalement le bateau fut dégagé, et en grinçant, il glissa lentement sur l'eau. Pris de panique, pour une raison que j'ignorais, les deux hommes montèrent précipitamment à bord et l'embarcation s'éloigna, en louvoyant gauchement.
Le soleil tapait toujours. De petites créatures grouillant dans le sable me mordirent, j'endurai les tortures des damnés. Peu à peu, la journée s'écoula, le soleil, rouge et menaçant, se coucha. L'eau me lécha les pieds, monta jusqu'à mes genoux. Plus haut encore. Faisant un effort surhumain, je rampai quelques pieds, enfonçant mes coudes dans le sable, me tortillant, m'échignant. Puis ce fut l'oubli.
Des heures plus tard, des jours peut-être, je me réveillai : le soleil ruisselait sur mon visage. Péniblement, je tournai la tête et regardai autour de moi. L'endroit où je me trouvais m'était totalement inconnu. J'étais dans l'unique pièce d'une petite chaumière ; au loin, la mer étincelait, et j'aperçus un vieux prêtre bouddhiste, qui m'observait en souriant. Il s'avança vers moi et s'assit sur le sol, à côté de moi. Nous conversâmes, non sans mal. Nos langues étaient similaires, mais non identiques ; péniblement, remplaçant ou répétant les mots, nous discutâmes la situation.
— Il y a un certain temps, dit le prêtre, j'ai su que j'allais recevoir un visiteur éminent, un homme auquel une grande tâche est dévolue. Quoique âgé, j'ai survécu jusqu'à ce que ma propre tâche soit complétée.
La chambre était très pauvre, très propre et le vieux prêtre était visiblement au bord de la famine. Il était émacié, ses mains tremblaient de faiblesse et de vieillesse. Sa robe usée était soigneusement raccommodée aux endroits où il avait réparé les ravages du temps et des accidents.
— Nous avons vu ces hommes vous jeter hors du bateau, dit-il. Pendant un long moment, nous vous avons cru mort et n'osions pas aller jusqu'à la plage, car des bandits errent dans la contrée. À la tombée de la nuit, deux hommes du village sont allés vous chercher et vous ont ramené ici, il y a cinq jours de cela. Vous avez été très malade, en vérité. Nous savons que vous devez vivre pour voyager très loin et que votre existence sera dure.
Dure ! Pourquoi chacun me répétait-il si souvent que ma vie serait dure ? Croyait-on que cela me faisait plaisir ? Oui, elle était dure, elle l'avait toujours été, et je détestais la souffrance autant que n'importe qui.
— Nous sommes ici aux abords de Najin, continua le prêtre. Dès que vous en serez capable, il vous faudra partir d'ici, car ma fin est proche.
Pendant deux jours, je me déplaçai avec précautions, essayant de reprendre des forces, de renouer les fils de ma vie. J'étais affaibli, affamé, il ne m'importait guère de vivre ou de mourir. Quelques vieux amis du prêtre vinrent me voir et me donnèrent des conseils sur la conduite à tenir et la manière de voyager. Le troisième jour, à mon réveil, je vis que le vieux prêtre était étendu, rigide et froid, à mes côtés. Pendant la nuit, il avait relâché son emprise sur la vie et il était parti. Avec l'aide d'un vieillard de ses amis, nous creusâmes une tombe et l'enterrâmes. J'enveloppai dans un morceau d'étoffe le peu de nourriture qui restait et, prenant un gros bâton pour m'aider à marcher, je m'en fus.
Après avoir parcouru à peu près un mille (1,6 km), je me sentis exténué. Mes jambes tremblaient, la tête me tournait, j'y voyais mal. Pendant un certain temps, je restai étendu sur le bord de la route côtière, hors de vue des passants, car l'on m'avait prévenu que la région était dangereuse pour un étranger. Un homme pouvait, m'avait-on dit, perdre la vie si son aspect déplaisait aux bandes armées qui erraient dans le pays et y faisaient régner la terreur.
Je repris ma route, en direction d'Unggi. Mes informateurs m'avaient clairement expliqué comment traverser la frontière pour pénétrer en territoire russe. J'étais en mauvais état, forcé de me reposer fréquemment. Pendant une de mes haltes, assis au bord de la route, j'observai avec indifférence la circulation intense. Mes regards, qui allaient de groupe en groupe, furent finalement attirés par cinq soldats russes, armés jusqu'aux dents et accompagnés de trois énormes dogues. Pour une raison quelconque, au même moment, l'un des soldats m'aperçut. Il dit quelques mots à ses compagnons et détacha les trois chiens qui se précipitèrent vers moi, découvrant leurs crocs menaçants, et grondant avec férocité. Les soldats s'avancèrent, la mitraillette à la main. J'envoyai des pensées amicales aux chiens ; aucun animal n'a jamais éprouvé d'hostilité ou de crainte à mon égard. Brusquement, ils furent sur moi, battant de la queue, me léchant, me tuant presque à force de démonstrations affectueuses, car j'étais très faible. Un ordre bref et les dogues se couchèrent aux pieds des soldats, qui se penchaient sur moi.
— Ah, dit le caporal qui était le chef du trio, vous devez être un bon Russe et natif de la région, sinon les chiens vous auraient mis en pièces. Ils sont dressés à cela, attendez un peu, vous allez voir.
Ils s'éloignèrent, entraînant les chiens qui leur résistaient, car ils auraient voulu rester avec moi. Quelques minutes plus tard, les chiens bondirent sur leurs pattes et se ruèrent vers les broussailles bordant la route. Des cris épouvantables retentirent qui s'achevèrent par une espèce de gargouillis. J'entendis frémir les feuilles derrière moi et comme je me retournais, une main sanglante, sectionnée au poignet, tomba à mes pieds ! Le chien avait réapparu, remuant la queue !
— Camarade, dit le caporal en s'approchant de moi, vous devez être loyal à notre cause pour que Serge ait fait ça. Nous retournons à notre base, à Kraskino. Puisque vous êtes en voyage, voulez-vous qu'on vous emmène jusque-là, en compagnie de cinq cadavres ?
— Oui, Camarade caporal, je vous en serais très reconnaissant, répondis-je.
Me montrant le chemin, avec les chiens qui trottaient à côté de moi, en agitant la queue, il m'emmena jusqu'à un half-track auquel une remorque était accrochée. De l'un des coins de cette remorque, un filet de sang dégoulinait jusqu'au sol où il s'étalait en une petite mare écœurante. Jetant un regard indifférent aux cadavres empilés là, le caporal remarqua les derniers et faibles soubresauts d'un moribond. Sortant son revolver, il lui tira une balle dans la tête, puis remit l'arme dans son étui et il se dirigea vers le half-track sans même jeter un coup d'œil en arrière.
Il me dit de m'asseoir à l'arrière du véhicule. Les soldats étaient de bonne humeur, ils me déclarèrent avec fierté qu'aucun étranger n'avait jamais traversé la frontière quand eux étaient de garde, et que leur section avait reçu la décoration de l'Etoile Rouge pour ses bons services. Je leur dis que je voulais me rendre à Vladivostok afin de voir cette grande ville pour la première fois et que j'espérais ne pas avoir de difficultés avec la langue.
— Bah ! répondit le caporal avec un gros rire, un de nos camions de ravitaillement va là-bas demain, pour emmener les chiens au chenil, car avec tout le sang humain qu'ils boivent, ils deviennent tellement sauvages que nous-mêmes nous avons du mal à les faire obéir. Vous savez vous y prendre avec eux. Prenez soin d'eux à notre place et nous vous emmènerons demain à Vladi. Vous nous comprenez, on vous comprendra partout dans ce district. Nous ne sommes pas à Moscou, ici !
C'est ainsi que moi, ennemi farouche du Communisme, je passai la nuit comme invité des soldats de la Patrouille Frontalière Russe. Ils m'offrirent du vin et des femmes, mais je refusai, alléguant mon âge et ma mauvaise santé. Après un bon repas, le meilleur que j'eusse pris depuis fort longtemps, je m'étendis sur le sol et dormis du sommeil du juste.
Le lendemain matin, nous partîmes pour Vladivostok, le caporal, un soldat, les trois chiens et moi. C'est ainsi que, grâce à l'amitié d'animaux sauvages, j'arrivai sans ennui à Vladivostok, en voiture et bien rassasié.
Chapitre Trois
La route était poussiéreuse et creusée d'ornières. Tandis que nous y roulions, nous croisâmes des groupes de femmes qui, sous la garde d'un surveillant armé, comblaient les trous les plus profonds à l'aide de pierres ou de tout ce qu'elles pouvaient trouver. En passant, les soldats hurlèrent des remarques obscènes et firent des gestes suggestifs.
Nous traversâmes une région populeuse et finîmes par arriver devant des bâtiments d'aspect sinistre qui devaient être une prison. La voiture entra dans une cour pavée. Il n'y avait personne en vue. Les hommes jetèrent autour d'eux un regard consterné. Puis, au moment où le chauffeur arrêta le moteur, nous entendîmes une clameur formidable, des cris d'hommes mêlés à de furieux aboiements. Nous nous précipitâmes vers l'endroit d'où venait ce vacarme. En franchissant une porte ouverte, encastrée dans un haut mur de pierre, nous aperçûmes un enclos entouré d'un grillage épais, derrière lequel se trouvaient une cinquantaine de dogues énormes.
Une foule de soldats se trouvaient devant cet enclos et l'un d'eux nous raconta l'histoire d'une voix mal assurée. Les chiens, qui avaient pris le goût du sang humain, avaient tué et dévoré deux de leurs gardiens. Il y eut une brusque commotion, un mouvement dans la foule et je vis un troisième homme, accroché au grillage, perdre l'équilibre et tomber parmi les chiens. Un cri effroyable retentit, un son à vous glacer l'âme, puis il n'y eut plus qu'une meute hurlante de chiens.
Le caporal se tourna vers moi :
— Hé, vous ! Vous savez mater les chiens. (Puis, s'adressant à un soldat :) Demande au Camarade Capitaine de venir, dis-lui que nous avons ici un homme capable de mater les chiens.
Le soldat s'éloigna et je faillis me trouver mal. Moi ! Pourquoi fallait-il toujours que les difficultés et les ennuis pleuvent sur moi ? Puis, jetant un coup d'œil sur les chiens, je me dis : "Pourquoi pas ? Ces bêtes ne sont pas plus féroces que les dogues tibétains, mais elles sentent la peur que les soldats ont d'elles et c'est pourquoi elles attaquent."
Un capitaine à l'air arrogant traversa la foule qui s'écartait respectueusement devant lui. S'arrêtant à quelques pas de moi, il me toisa et eut un sourire dédaigneux.
— Pouah, Caporal, dit-il d'un ton railleur, qu'avons-nous là ? Un abruti de prêtre indigène !
— Camarade Capitaine, répondit le caporal, les chiens n'ont pas attaqué cet homme. Serge a tranché la main d'un type qui traversait la frontière en fraude et la lui a apportée. Envoyez-le dans le chenil, Camarade Capitaine.
Le capitaine fronça les sourcils, frotta ses semelles dans la poussière et se mordit les ongles avec alacrité. Enfin, il releva la tête.
— Oui, c'est ce que je vais faire, dit-il. Moscou m'a défendu d'abattre d'autres chiens, mais on ne m'a pas dit quelles mesures il fallait prendre si le goût du sang les rendait fous furieux. Si cet homme est tué, eh bien tant pis, ce sera un accident. S'il devait s'en sortir vivant, ce qui est bien improbable, nous le récompenserons. (Il se détourna, fit quelques pas, et regarda les chiens qui rongeaient les os des trois gardiens qu'ils avaient tués et dévorés. Puis, s'adressant au caporal, il reprit :) Occupez-vous de ça, caporal ! S'il réussit, vous serez nommé sergent.
Sur ces paroles, il s'en fut. Pendant un moment, le caporal demeura bouche bée :
— Moi, un sergent ? Sacré nom de nom ! s'exclama-t-il, en se tournant vers moi. Si vous matez les chiens, tous les hommes de la Patrouille Frontalière seront vos amis. Allez-y.
— Camarade caporal, répondis-je, j'aimerais que les trois autres bêtes entrent avec moi, car ils me connaissent et ils connaissent ces chiens.
— D'accord, dit-il, allons les chercher.
Nous regagnâmes la remorque du half-track. Je caressai les trois chiens, les laissant me lécher et m'imprégner de leur odeur. Puis, les bêtes bondissant autour de moi, je m'approchai de la porte de l'enclos. Elle était barricadée et des gardes armés se tenaient devant, pour le cas où un chien se serait échappé. On l'entrouvrit rapidement et on me poussa sans douceur à l'intérieur de l'enclos.
Des chiens se précipitèrent sur moi de tous côtés. Les crocs menaçants de ‘mes’ bêtes tinrent la plupart de leurs congénères à distance respectueuse, mais un animal gigantesque, à l'aspect féroce, apparemment le chef de la bande, me sauta à la gorge. J'étais prêt à parer l'attaque. Faisant un pas de côté, je lui portai un coup rapide à la gorge, une passe de judo (ou karaté, ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui) qui le tua avant même qu'il ne retouchât terre. J'eus à peine le temps de faire un bond en arrière, déjà le corps de la bête était recouvert par la masse grouillante de ses congénères. Leurs grognements, les claquements de leurs mâchoires faisaient un bruit abominable.
Pendant quelques instants, j'attendis, désarmé, sans défense, n'émettant que des pensées bienveillantes et amicales envers les chiens, leur affirmant mentalement que je n'avais pas peur d'eux, que j'étais leur maître. Enfin ils abandonnèrent leur proie et j'eus un sursaut de dégoût en voyant le squelette décharné de l'animal qui, quelques moments plus tôt, avait été leur chef. Les chiens se tournèrent vers moi. Je m'assis sur le sol et leur ordonnai mentalement de faire la même chose. Alors, ils s'allongèrent devant moi, en demi-cercle, les pattes écartées, la gueule ouverte, la langue pendante, la queue battant de droite et de gauche.
Je me levai et appelai Serge. Lui posant la main sur la tête, je dis à voix haute :
— À partir de maintenant, c'est toi, Serge, qui seras le chef de ces chiens. Tu m'obéiras et tu veilleras à ce qu'ils m'obéissent.
De la cour monta une ovation spontanée. J'avais complètement oublié les soldats ! Me retournant, je vis qu'ils agitaient amicalement les mains. Le capitaine, empourpré par l'émotion, s'approcha du grillage et hurla :
— Sortez de là les cadavres des gardiens ou leurs squelettes.
Je m'approchai, non sans répugnance, du premier corps, masse déchiquetée, sanglante, dont la cage thoracique était à nu. Je le saisis par un bras, mais le bras se détacha de l'épaule. Alors, je le tirai par la tête : ses entrailles traînaient dans la poussière. Il y eut un murmure horrifié et je vis que Serge marchait à côté de moi, tenant le bras entre ses crocs. Péniblement, j'enlevai les trois cadavres, du moins ce qu'il en restait. Puis, épuisé par cette épreuve, je me dirigeai vers la porte que l'on m'ouvrit.
Le capitaine était devant moi.
— Tu pues, me dit-il, va te nettoyer de cette pourriture. Tu resteras ici un mois à t'occuper des chiens. Après quoi ils retourneront à leurs patrouilles et tu seras libre. Tu toucheras la solde de caporal. (Il se tourna vers le caporal et lui dit :) Comme promis, tu es nommé sergent à partir de maintenant.
Il fit demi-tour et s'éloigna, visiblement enchanté du dénouement de l'affaire.
Le sergent m'adressa un large sourire.
— Vous êtes un magicien ! Jamais je n'oublierai la façon dont vous avez tué cette bête, ni la vision du capitaine sautant d'un pied sur l'autre, en filmant toute la scène. Vous vous êtes distingué. La dernière fois que les chiens se sont rebellés, nous avons perdu six hommes et quarante bêtes. Le capitaine s'est fait durement taper sur les doigts par Moscou. On lui a dit qu'il le paierait cher s'il perdait d'autres chiens. Il vous traitera bien. Vous allez manger à notre mess. On ne vous posera pas de questions. Mais, venez, le capitaine a raison, vous puez, allez laver cette cochonnerie. J'avais toujours dit à Andréï qu'il mangeait trop et qu'il sentait mauvais ; maintenant que je l'ai vu en pièces détachées, je sais que j'avais raison.
J'étais si las, si exténué, que cet humour macabre ne réussit même pas à me choquer.
Un groupe d'hommes, des caporaux qui se trouvaient dans la salle du mess, éclatèrent de rire et dirent quelque chose au sergent. Celui-ci s'esclaffa et s'approcha de moi.
— Ha Ha ! Camarade prêtre, rugit-il, en riant aux larmes, ils disent que vous avez une telle quantité de boyaux d'Andréï sur votre robe que vous devriez hériter de toutes ses affaires maintenant qu'il est mort. Il n'a pas de famille. Nous allons vous appeler Camarade Caporal Andréï pendant votre séjour ici. Tout ce qu'il possédait vous appartient à présent. Et vous m'avez fait gagner un joli paquet de roubles quand j'ai parié sur vous, au moment où vous étiez dans le chenil. Vous êtes mon ami.
Le sergent Boris était un brave homme, au fond. Rustre, grossier, sans aucune prétention intellectuelle, il m'était très reconnaissant de lui avoir fait gagner un grade et une quantité considérable de roubles.
— Sans vous, je serais resté caporal toute ma vie, me dit-il.
Bon nombre de ses camarades avaient déclaré que je n'avais pas une chance de sortir vivant de l'enclos aux chiens. À quoi Boris avait répondu :
— Ce type est à la hauteur, vous auriez dû le voir quand nous avons lâché les chiens sur lui. Il n'a pas bronché. Il était assis comme une statue. Les chiens l'ont pris pour l'un des leurs. Il va mater cette bande, vous allez voir !
— Tu veux parier, Boris ? cria l'un des hommes.
— Il vous faudra trois mois pour me payer, dit Boris.
En fin de compte, il avait gagné une somme correspondant à trois ans et demi de sa solde et il m'en était reconnaissant.
Cette nuit-là, après un très copieux diner, car les hommes de la Patrouille Frontalière menaient une existence confortable, je dormis dans une cabane bien chauffée, près du chenil. Le matelas était rembourré d'alfa, et les hommes avaient obtenu des couvertures neuves pour moi. Je me félicitai d'avoir subi un entraînement qui m'avait permis de si bien comprendre la mentalité animale.
Dès l'aube, je m'habillai et allai voir les chiens. On m'avait montré l'endroit où l'on gardait la nourriture qui leur était destinée et je pus constater qu'elle était excellente. Ils m'entourèrent, battant de la queue et parfois l'un d'eux me mettait les pattes sur les épaules. À un moment donné, je jetai par hasard un regard autour de moi, et j'aperçus le capitaine, qui, de l'autre côté du grillage, bien entendu, observait la scène.
— Ah ! Prêtre, me dit-il, je suis simplement venu voir pourquoi les chiens étaient si tranquilles. L'heure de la pâtée ne se passait jamais sans furieuses batailles ; le gardien restait devant la porte, jetait la nourriture dans l'enclos et les bêtes se bagarraient pour obtenir leur part. Je ne te poserai pas de questions. Donne-moi ta parole que tu resteras ici quatre ou cinq semaines, jusqu'à ce que tous les chiens soient partis. Alors, tu pourras aller à la ville, si tu le désires.
— Camarade Capitaine, répondis-je, je vous promets volontiers de rester ici jusqu'au départ de tous ces chiens. Puis, je repartirai.
— Autre chose, Prêtre, reprit le capitaine. La prochaine fois qu'on nourrira les chiens, j'apporterai ma caméra et je filmerai la scène, afin que mes Supérieurs puissent se convaincre que nous avons les chiens bien en main. Va voir l'Intendant, demande un uniforme de caporal et si tu peux trouver quelqu'un pour t'aider, fais-lui nettoyer le chenil à fond. Si tout le monde a peur, charge-t'en toi-même.
— Je le ferai moi-même, Camarade Capitaine, répondis-je, ainsi les chiens resteront tranquilles.
Le capitaine eut un bref signe de tête et s'éloigna, visiblement fort satisfait de pouvoir montrer que lui savait s'y prendre avec ces bêtes assoiffées de sang !
Pendant trois jours, je ne m'éloignai pas de plus d'une centaine de verges (91 m) du chenil. Les soldats avaient le revolver facile, et ils n'hésitaient pas à tirer dans les fourrés "au cas où il s'y trouverait des espions", selon leurs propres termes.
Pendant trois jours, je me reposai, reprenant des forces, me mêlant aux soldats. Je commençais à les connaître, eux et leurs habitudes. Andréï avait eu approximativement la même stature que moi et ses vêtements m'allaient à peu près. Toutefois, il me fallut laver et relaver toutes ses affaires, car la propreté n'était pas son fort. Le capitaine m'abordait souvent, cherchant à lier conversation, mais bien qu'il se montrât amical à mon égard, et très intéressé par ma personne, je ne devais pas oublier que mon rôle était celui d'un simple prêtre, ne connaissant que les Écritures Bouddhiques — et les chiens ! Le capitaine se moquait de la religion, déclarait que la vie future n'existait pas et qu'il n'y avait d'autre Dieu que le Père Staline. Moi, je citais les Textes Sacrés, mais je n'affichais jamais de connaissances supérieures à celles qu'aurait pu avoir un pauvre prêtre de village.
Boris assista un jour à l'une de ces discussions. Il était nonchalamment appuyé contre le grillage du chenil et mâchonnait un brin d'herbe.
— Sergent s'exclama le capitaine, exaspéré, le Prêtre n'est jamais sorti de son petit village. Emmène-le faire une virée en ville. Emmène-le en patrouille à Artem et à Razdol'noye. Montre-lui ce qu'est la vie. Il ne sait parler que de la mort, croyant que la vraie vie, c'est elle. Il cracha au sol, alluma une cigarette de contrebande et s'éloigna.
— Oui, venez donc, Prêtre, il y a si longtemps que vous restez avec les chiens que vous commencez à leur ressembler. J'admets que vous les avez bien matés. Et vous m'avez fait gagner pas mal de roubles. Je roule sur l'or, Prêtre, et il faut que je le dépense avant ma mort.
Il se dirigea vers une voiture, y entra et me fit signe de l'imiter. Il mit le moteur en marche et la voiture démarra. Elle nous emmena en cahotant le long des routes sillonnées d'ornières, et pétaradant dans les rues étroites de Vladivostok. Dans le port se trouvaient un grand nombre de navires ; je n'aurais jamais pensé qu'il en existât autant dans le monde !
— Écoutez, Prêtre, me déclara Boris, ces navires ont intercepté des produits que les Américains envoyaient à un pays quelconque, aux termes de l'accord ‘prêt-bail’. Ils s'imaginent que les Japonais ont mis la main dessus, mais nous envoyons les cargaisons par le Chemin de Fer (le Transsibérien) jusqu'à Moscou où les chefs du Parti se servent en premier. Du moins ils le croient. Les premiers servis, c'est nous, parce que nous avons un accord avec les dockers. Nous fermons les yeux sur leurs agissements, ils ferment les yeux sur les nôtres. Avez-vous jamais possédé une montre, Prêtre ?
— Non, répondis-je, je n'ai pas possédé grand-chose dans ma vie. Je connais l'heure par la position du soleil et des ombres.
— Il faut que vous ayez une montre, Prêtre !
Boris appuya sur l'accélérateur et bientôt la voiture s'arrêta près d'un cargo amarré dans les docks. Le navire était strié de rouille et sa coque étincelait sous une couche de sel laissé par les embruns. Le voyage autour de la Corne d'Or avait dû être rude. Des grues balançaient leurs longues potences et déchargeaient des produits venus de toutes les contrées du globe. Les hommes hurlaient et gesticulaient, manipulant des filets, tirant sur des haussières. Boris bondit de la voiture, m'entraîna par le bras et franchit précipitamment la passerelle, moi toujours à sa remorque.
— Nous voulons des montres, Cap'taine, cria-t-il au premier homme en uniforme que nous aperçûmes. Des montres-bracelets.
Un homme, vêtu d'un uniforme plus orné que ceux des autres, apparut et nous fit signe d'entrer dans sa cabine.
— Des montres, Cap'taine ! rugit Boris. Une pour lui, et deux pour moi. Vous voulez descendre à terre, Cap'taine ? Tirer une bordée ? Faire ce que bon vous semble ? Les filles, vous soûler ? Ça nous est égal. Nous voulons des montres !
Le capitaine sourit et nous versa à boire. Boris avala bruyamment le contenu de son verre et je lui passai le mien.
— Il boit pas, Cap'taine, c'est un prêtre qui est devenu dompteur de chiens, un bon dompteur ; c'est un brave type aussi.
Le capitaine alla tirer une boîte de dessous sa couchette. Il l'ouvrit : elle contenait une douzaine de montres-bracelets. D'un geste si rapide que je le vis à peine, Boris en prit deux, à boîtier d'or, et sans se donner la peine de les remonter, en glissa une à chaque poignet.
— Servez-vous, Prêtre, ordonna-t-il.
Je pris une montre chromée.
— Celle-là est meilleure, Prêtre, dit le capitaine, c'est une Oméga en acier chromé, imperméable, de qualité bien supérieure.
— Merci, Capitaine, répondis-je. Si vous n'y voyez pas d'objection, je prendrai donc celle que vous me conseillez.
— À présent, je suis sûr que vous êtes cinglé, Prêtre, dit Boris. Vous préférez une montre d'acier à une montre d'or ?
Je répondis en riant :
— L'acier est assez bon pour moi. Vous êtes sergent, moi je ne suis qu'un caporal à titre très provisoire.
En quittant le navire, nous allâmes visiter les voies de chargements du Transsibérien. Des équipes de travail étaient occupées à charger dans les wagons les marchandises de choix extraites des navires. D'ici, les wagons seraient dirigés sur Moscou, à six mille milles (9 600 km) environ. Un train partit sous nos yeux. Deux locomotives tirant toute une longue file de wagons, chaque locomotive dotée de cinq roues de chaque côté. C'étaient de gigantesques machines, bien entretenues, et que les employés du service considéraient presque comme des créatures vivantes.
La voiture de Boris longea les rails. Il y avait des gardes partout et, installés dans les fossés, des hommes armés scrutaient le dessous des trains qui passaient, afin de repérer les voyageurs clandestins.
— Vous semblez avoir bien peur que l'on ne voyage illégalement, dis-je, mais pourquoi donc ? Quel mal y aurait-il à laisser les gens se déplacer à travers le pays ?
— Prêtre, répondit Boris d'un ton attristé, comme l'a dit le capitaine, vous ne connaissez pas la Vie. Des ennemis du Parti, des saboteurs et des espions capitalistes essaieraient de s'infiltrer dans nos villes. Aucun Russe honnête ne voyagerait sans en avoir reçu l'ordre de son Commissaire.
— Mais ces voyageurs clandestins sont-ils nombreux ? Qu'en faites-vous, quand vous en découvrez un ?
— Ce que nous faisons ? Nous les abattons, évidemment ! Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais demain je vais à Artem et je vous y emmènerai. Vous verrez comment nous traitons les éléments subversifs. Quand le personnel du train en trouve un, on lui lie les mains, on lui passe la corde au cou et on le jette par la portière. Ça salit les voies, par exemple, et ça attire les loups.
Boris se tassa sur son siège, scrutant du regard le défilé des wagons de marchandises. Soudain, il se redressa comme électrisé et appuya brutalement sur l'accélérateur. La voiture bondit en avant et dépassa la tête du train. Freinant avec la même vigueur, Boris sauta à terre, saisit sa mitraillette et se cacha derrière la voiture. Lentement le train passa. J'aperçus une silhouette agrippée aux tampons, entre deux wagons, puis j'entendis le crépitement de la mitraillette. Le corps s'écroula entre les rails.
— Je l'ai eu ! s'écria Boris d'un ton triomphal, et il fit une encoche à la crosse de son arme. Ça en fait cinquante-trois, Prêtre, cinquante-trois ennemis de l'État en moins !
Je tournai la tête, le cœur serré, mais cachant mon écœurement, car Boris m'aurait tué aussi calmement qu'il avait tué cet homme, s'il avait su que je n'étais pas un prêtre de village.
Le train s'éloigna et Boris s'approcha du cadavre sanglant, criblé de balles. Le retournant avec son pied, il regarda le visage du mort et dit :
— Je le reconnais, c'est un cheminot. Il n'aurait pas dû se balader ainsi. Je ferais peut-être mieux de lui faire sauter la figure, comme ça, personne ne me posera de questions.
Ce disant, il braqua le canon de l'arme sur le visage du mort et appuya sur la détente. Abandonnant le cadavre décapité, il retourna à la voiture et nous repartîmes.
— Je n'ai encore jamais pris le train, Boris, dis-je.
— Eh bien, répondit-il, demain nous irons à Artem par un train de marchandises et vous pourrez visiter la ville. J'y ai de bons amis que je tiens à revoir, à présent que je suis sergent.
Depuis longtemps, je nourrissais l'espoir d'embarquer clandestinement sur un navire en partance pour l'Amérique. Je dis à mon compagnon :
— Boris, vous passez votre temps à arrêter les gens à la frontière et à vous assurer que personne ne voyage clandestinement par le train. Mais tous ces navires... n'importe qui pourrait monter à bord et y rester.
Boris rejeta la tête en arrière et éclata de rire.
— Prêtre ! dit-il, vous êtes vraiment naïf ! Les Gardes Maritimes montent à bord du navire alors que celui-ci est à un mille des côtes et ils vérifient l'identité de tous les membres de l'équipage. Puis ils scellent tous les hublots et tous les ventilateurs et ils versent de l'acide cyanhydrique dans les cales et dans tous les espaces creux, sans oublier les canots de sauvetage. Et ils font une bonne récolte de macchabées parce qu'il y a des réactionnaires qui ne sont pas au courant du procédé.
Le cynisme dont ces hommes faisaient preuve, en considérant ces exécutions comme un sport, m'écœurait profondément, et je renonçai aussitôt à mon projet de traversée clandestine.
Je me trouvais donc à Vladivostok, mais j'avais une tâche à accomplir et, aux termes de la Prophétie, je devais d'abord aller en Amérique, puis en Angleterre et revenir ensuite sur le continent Nord-Américain. Le problème, c'était de quitter la Russie. Je décidai de récolter le plus de renseignements possibles sur le Trans-sibérien, sur l'endroit où se terminaient les recherches et les vérifications et de savoir ce qui se passait au terminus de Moscou.
Le lendemain, j'exerçai et donnai de bonne heure leur pâtée aux chiens et lorsqu'ils furent repus et satisfaits, je partis avec Boris et trois autres gardes. Nous allions à un avant-poste, distant d'environ cinquante milles (80 km), et où les gardes devaient en remplacer trois autres. Pendant tout le trajet, les hommes discutèrent de tous les ‘évadés’ qu'ils avaient tués et je glanai un certain nombre d'informations utiles. J'appris en quel endroit cessaient les vérifications, j'appris aussi qu'avec certaines précautions, il était possible de parvenir aux faubourgs de Moscou sans se faire prendre.
Le gros problème, ce serait l'argent, je m'en rendais bien compte. J'en gagnais en exécutant des corvées à la place de certains soldats, en les soignant, et, grâce aux bons offices de quelques-uns, en soignant même de riches membres du Parti, qui habitaient la ville. Comme les autres, je m'arrangeai pour monter à bord des navires et pour opérer des prélèvements sur les nouvelles cargaisons. Tout mon "butin" fut transformé en roubles. Je me préparais à traverser la Russie.
Cinq semaines plus tard environ, le capitaine m'annonça que les chiens allaient retourner à leurs stations de patrouille. On attendait un nouveau Commissaire, il fallait que je parte avant son arrivée. Où avais-je l'intention d'aller ? Ayant appris à le connaître, je répondis :
— Je vais rester à Vladivostok, Camarade Capitaine, je me plais ici.
Son visage prit une expression inquiète :
— Tu dois partir, tu dois quitter le district, dès demain.
— Mais, Camarade Capitaine, je ne sais pas où aller, je n'ai pas d'argent.
— On te donnera des roubles, des vivres, des vêtements et tu quitteras le district en voiture.
J'insistai :
— Camarade Capitaine, je ne sais pas où aller. J'ai travaillé dur ici et je veux rester à Vladivostok.
Le capitaine fut inflexible :
— Demain, nous envoyons des hommes à l'extrême frontière de notre zone, aux confins de Vorochilov. On t'emmènera jusque-là. Je te donnerai une lettre attestant que tu nous as rendu des services et que tu es parti à Vorochilov avec notre permission. Ainsi, tu ne risques pas de te faire arrêter.
Cette promesse dépassait mes espérances. Je voulais me rendre à Vorochilov, car c'était là que j'avais l'intention de prendre le train. Je savais que si je pouvais arriver sans encombre à l'autre extrémité de cette ville, je serais probablement tiré d'affaire.
Le lendemain, avec un certain nombre d'hommes, je montai dans un camion pour transport de troupes qui prit à toute allure le chemin de Vorochilov. Cette fois, je portais un complet de bonne qualité et un vaste sac à dos qui contenait mes possessions. J'avais également une musette emplie de vivres. Je n'éprouvais pas le moindre malaise à la pensée que les vêtements que je portais avaient été pris à un voyageur clandestin assassiné.
— Je ne sais pas où vous allez, Prêtre, dit Boris, mais le capitaine a déclaré que c'était lui qui avait maté les chiens et que vous deviez partir. Ce soir vous pourrez dormir dans l'avant-poste et demain vous vous mettrez en route.
Je passai une mauvaise nuit. J'étais extrêmement las d'errer d'un endroit à l'autre. Extrêmement las de vivre avec la Mort à mes côtés. J'éprouvais une profonde impression de solitude en compagnie de ces hommes qui m'étaient tellement étrangers et dont la façon de vivre était si totalement opposée à la mienne.
Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux, je dis au revoir à Boris et aux autres, mis sac et musette sur mon dos et partis. Je marchai pendant un bon nombre de milles (km), évitant la grand-route et m'efforçant de contourner Vorochilov. Soudain, j'entendis derrière moi le grondement d'un moteur, le grincement de freins que l'on serre brusquement et je me retrouvai face à la gueule noire d'une mitraillette.
— Qui es-tu ? Où vas-tu ? me cria un caporal, les sourcils froncés.
— Je vais à Vorochilov, répondis-je, j'ai une lettre du Camarade Capitaine Vassily.
M'arrachant la lettre des mains, il en déchira l'enveloppe, le visage crispé par l'effort qu'exigeait cette lecture. Puis, un large sourire éclaira ses traits.
— Nous venons de quitter le sergent Boris, dit-il. Monte, nous allons te conduire à Vorochilov et te déposer où tu voudras.
Cette proposition ne me fit aucun plaisir, car je m'efforçais de contourner la ville ! Néanmoins, je montai dans la voiture qui prit rapidement le chemin de Vorochilov. Je fus déposé près du Commissariat Central, et, tandis que la voiture entrait au garage, je continuai ma route, marchant d'un bon pas, car je voulais faire avant la nuit le plus grand nombre de milles (km) possible. J'avais l'intention de camper près du Chemin de Fer et d'observer, pendant un jour et une nuit, avant de monter dans un train, comment les choses se passaient.
À Vorochilov même, on arrêtait et on examinait les trains de voyageurs, mais ceux de marchandises s'arrêtaient juste à l'extérieur de la ville, peut-être afin que les habitants ne sachent pas combien de passagers clandestins étaient abattus. Je ne cessai d'observer les lieux et je conclus que mon seul espoir était de monter dans un wagon au moment où le train s'ébranlerait.
Le soir du second jour, un train s'arrêta. Il me parut être exactement conforme à mes besoins. Grâce à l'expérience que j'avais acquise, je savais qu'il devait contenir quantité de marchandises provenant du ‘prêt-bail’. "Il ne faut pas que je le manque", me dis-je, et je me glissai le long des voies, regardant sous les wagons, essayant les portes, ouvrant celles qui n'étaient pas fermées à clef. De temps à autre éclatait une détonation, suivie par le choc d'un corps tombant au sol. On n'employait pas les chiens, de crainte qu'ils ne se fassent écraser par les roues. Je me roulai dans la poussière, me salissant le plus possible.
Les gardes arrivèrent et examinèrent le train à l'aide de puissantes lampes électriques, tout en s'interpellant les uns les autres. Aucun d'eux ne songea à regarder derrière lui, seul le train les intéressait. Moi, allongé sur le sol, derrière eux, je me disais : "Mes chiens auraient été bien plus malins qu'eux. Ils n'auraient pas tardé à me repérer !"
Leurs recherches achevées, les hommes s'éloignèrent. Je me laissai rouler jusqu'à la voie et me précipitai entre les roues d'un wagon. Vivement, je grimpai sur un essieu et fixai à un tenon en saillie la corde que j'avais eu soin de prendre. L'accrochant à l'autre côté, je me hissai et m'attachai sous le plancher du wagon — dans la seule position pouvant échapper aux regards scrutateurs. Depuis un mois, j'avais préparé mon coup. Le train démarra avec une secousse qui faillit me jeter au sol, et, comme je l'avais prévu, une jeep dotée d'un projecteur ne tarda pas à arriver avec ses occupants, en armes, examinant les essieux. Je me collai encore plus étroitement au plancher ; je ressentais ce que pourrait éprouver un homme tout nu au milieu d'une assemblée de nonnes ! La jeep s'éloigna, tourna, revint et sortit à la fois de ma vue et de ma vie. Le train partit en grondant. Pendant cinq ou six milles (8 ou 9 km), je demeurai dans cette position inconfortable, puis, convaincu que tout danger était écarté, je me dégageai lentement de la corde et parvins à demeurer en équilibre sur l'une des boîtes d'essieu.
Pendant un moment, je me reposai aussi bien que je le pus, sentant que mes muscles engourdis retrouvaient un peu de souplesse. Puis lentement, précautionneusement, je m'avançai jusqu'à l'extrémité du wagon et parvins à saisir une barre de fer. Pendant une demi-heure environ, je demeurai assis sur les attelages, puis me hissant jusqu'à la plate-forme qui oscillait, je rampai à l'aveuglette pour contourner l'arrière des wagons et grimpai sur le toit. La nuit n'était éclairée que par la sombre clarté des étoiles. La lune n'était pas encore levée et je savais que je devais me hâter d'entrer dans un wagon, avant que quelque cheminot aux aguets ne m'aperçût à la lumière du clair de lune sibérien. Une fois sur le toit, j'accrochai une des extrémités de la corde autour de ma taille et l'autre autour de la barre du toit et glissai avec précaution le long des flancs du wagon, laissant filer la corde entre mes doigts. M'écorchant et rebondissant contre les aspérités du wagon, je parvins bientôt à ouvrir la porte avec une clef que j'étais arrivé à me procurer à Vladivostok. La même clef s'adaptait à toutes les serrures du train. Ce fut extraordinairement difficile que d'ouvrir la porte, car j'oscillais comme un pendule, mais la vision des premiers rayons d'une lune très claire me stimula, la porte glissa et, à bout de forces, je me laissai tomber à l'intérieur du wagon. Défaisant l'extrémité libre de la corde, je tirai sur l'autre, tant et si bien que toute la corde me resta dans les mains. Tremblant d'épuisement, je fermai la porte et m'écroulai sur le plancher.
Deux ou trois jours plus tard — en pareil cas, on perd toute notion du temps — je sentis que le train ralentissait. Courant à la porte, je l'entrebâillai et jetai un regard au-dehors. Je n'aperçus qu'une étendue neigeuse et me précipitai de l'autre côté. Des gardes couraient après un groupe de réfugiés. De toute évidence, une opération de recherches à grande échelle était en cours. Prenant mes affaires, je me laissai tomber dans la neige. Je marchai en zigzag entre les roues des wagons et parvins à ne laisser sur la neige que des empreintes confuses. Tandis que j'en étais encore à cela, le train se remit en marche et je m'accrochai désespérément à l'attelage le plus proche, dont le métal était glacé. Par chance, je réussis à l'entourer de mes bras et j'y restai suspendu, les jambes ballantes, jusqu'à ce qu'une brusque secousse me permît d'y prendre pied.
Je me redressai et vis que j'étais à l'arrière d'un wagon recouvert d'une bâche rigide et gelée. Les nœuds n'étaient que glace, la lourde toile avait l'apparence d'une tôle. Debout sur l'attelage mobile, je m'escrimai sur les nœuds, soufflant dessus dans l'espoir de les dégeler, mais mon souffle gelait, lui aussi, et ne faisait qu'épaissir la couche de glace. Je frottai alors la corde d'avant en arrière contre la paroi métallique du wagon. La nuit tombait lorsque la corde s'effilocha enfin complètement et je réussis, au prix d'un immense effort, à m'agripper à la bâche et à me glisser dessous. Mais au moment où je tombai sur le plancher, un homme me sauta dessus, brandissant une lame d'acier. L'instinct et l'habitude vinrent à ma rescousse et bientôt l'homme recula avec un gémissement, soutenant son bras fracturé. Deux autres hommes s'avancèrent, l'un armé d'une barre de fer, l'autre d'un tesson de bouteille. Mais pour quelqu'un aussi rompu que moi à l'art de se défendre, ils n'étaient pas dangereux et je les désarmai sans peine. Ici, c'était la loi de la jungle, l'homme le plus fort était roi ! Je les avais battus, ils étaient mes serviteurs.
Le wagon était bourré de céréales que nous mangions telles quelles. En guise de boisson, nous sucions la neige ou la glace que nous arrachions de la bâche. Nous n'avions aucun moyen de nous réchauffer car il n'y avait rien à brûler, et d'ailleurs le personnel du train aurait aperçu la fumée. J'arrivai à supporter le froid intense, mais l'homme au bras cassé gela à mort, une nuit, et nous dûmes le jeter hors du wagon.
La Sibérie n'est pas qu'une étendue neigeuse, elle comprend des régions montagneuses, comme les Rocheuses Canadiennes, et d'autres aussi verdoyantes que l'Irlande. Toutefois à cette époque, il neigeait, malheureusement pour nous, car c'était la plus mauvaise saison pour voyager.
Nous découvrîmes que les céréales provoquaient des troubles sérieux : gonflements, dysenterie. Nous étions si affaiblis que peu nous souciait de vivre ou de mourir. Notre dysenterie finit par se calmer, mais nous souffrîmes cruellement de la faim. Je me laissai glisser, à l'aide de la corde, et grattai la graisse entourant les boîtes de l'essieu. Nous la mangeâmes, non sans d'horribles nausées.
Le train roulait toujours. Il longea l'extrémité du lac Baïkal et prit la direction d'Omsk. Là je savais qu'il s'arrêterait, que les wagons seraient triés et rassemblés. Il me fallait descendre avant d'arriver en ville et sauter dans un autre. Je ne décrirai pas ici toutes les tribulations par lesquelles je passai avant de réussir cet exploit. Toujours est-il qu'en compagnie d'un Russe et d'un Chinois, je parvins à monter dans un train de marchandises à marche rapide qui se dirigeait vers Moscou. Le train était en bon état. Ma clef, sur laquelle je veillais précieusement, ouvrit un wagon où nous grimpâmes à la faveur de la nuit sans lune. Le wagon était bourré de caisses, nous eûmes du mal à nous y installer. Il y régnait la plus complète obscurité et nous ne savions pas ce que contenaient toutes ces caisses. Une agréable surprise nous attendait le lendemain matin. Nous étions affamés et je vis que dans l'un des coins du wagon étaient stockés des colis de la Croix-Rouge qui, de toute évidence, n'avaient pas atteint leur destination, mais avaient été ‘libérés’ par les Russes. Nous vivions bien à présent : chocolat, boîtes de conserves, lait condensé, rien ne manquait. Nous découvrîmes même un petit fourneau avec une réserve de carburant solide, qui ne dégageait pas de fumée.
En fouillant les ballots, nous vîmes qu'ils étaient pleins de vêtements et d'objets, peut-être pillés dans des magasins de Shanghaï : des appareils photo, des jumelles, des montres. Nous nous octroyâmes des vêtements neufs, car les nôtres étaient en triste état. Mais l'eau nous faisait cruellement défaut. Nous étions obligés de gratter la neige sur les parois du wagon.
Quatre semaines et six mille milles (9 600 km) après mon départ de Vladivostok, le train approcha de Noginsk, à trente ou quarante milles (48 ou 64 km) de Moscou. Notre trio tint conseil et décida que le personnel du train manifestant un peu trop souvent sa présence — nous entendions marcher sur le toit — il serait plus prudent de déguerpir. Nous nous examinâmes l'un l'autre avec le plus grand soin, afin de nous assurer que nous ne présentions rien de suspect, puis nous primes une bonne provision de vivres et de ‘trésors’ qui serviraient, le cas échéant, de monnaie d'échange. Le Chinois partit le premier et, au moment où nous refermions la porte derrière lui, j'entendis plusieurs coups de feu. Trois ou quatre heures plus tard, le Russe sauta à son tour ; une demi-heure après, je faisais de même.
J'avançais péniblement dans l'obscurité, mais j'étais sûr de mon chemin, car le Russe, originaire de Moscou et qui avait été exilé en Sibérie, m'avait donné toutes les indications nécessaires. Au matin, j'avais parcouru plus de vingt milles (32 km) et mes jambes, qui avaient été si malmenées dans les camps de prisonniers, me faisaient beaucoup souffrir.
Dans un endroit pour manger, je montrai mes papiers de caporal des Gardes-Frontières. C'étaient ceux d'Andréï. On m'avait dit que je pouvais hériter de tous ses biens et personne n'avait songé à ajouter "sauf de ses papiers officiels et de sa Carte d'Identité". La serveuse prit un air dubitatif et appela un agent de police, debout à l'extérieur. Il entra et une discussion s'éleva. Non, je n'avais pas de carte d'alimentation, je l'avais oubliée à Vladivostok, où les règlements sur le ravitaillement ne s'appliquaient pas aux Gardes. Le policier examina mes papiers, puis il me dit :
— Il faudra que vous vous nourrissiez au Marché Noir jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une nouvelle Carte d'alimentation à l'Office du Ravitaillement. Mais il faudra d'abord que celui-ci se mette en rapport avec Vladivostok.
Sur ce, il tourna les talons.
La serveuse eut un haussement d'épaules.
— Commandez ce que vous voulez, Camarade, ça vous coûtera cinq fois le prix officiel.
Elle m'apporta du pain noir et amer, et une espèce de pâté à l'aspect effroyable et au goût plus effroyable encore. Elle se méprit sur le geste que je fis pour lui demander à boire et me servit un breuvage qui faillit me faire tomber en pâmoison. J'en pris une gorgée et me crus empoisonné. Une seule gorgée m'avait suffi, mais la serveuse me compta même l'eau, tandis qu'elle avalait bruyamment l'immonde breuvage qui me coûtait si cher.
L'agent de police m'attendait en sortant. Il m'emboîta le pas au moment où je m'éloignais.
— Il est contraire au règlement, Camarade, me dit-il, de vous promener avec un ballot sur le dos. Je me demande si je ne devrais pas vous emmener au Commissariat. Avez-vous une montre à me donner, Camarade, pour me faire oublier mes devoirs ?
Silencieusement, j'explorai ma poche et en sortis une des montres que j'avais prises dans le train. Le policier la prit, y jeta un coup d'œil et dit :
— Moscou, tout droit. Évitez l'artère principale et il ne vous arrivera rien. Puis il tourna les talons et s'éloigna.
Je suivis donc les routes latérales, évitant avec soin les policiers, de crainte qu'ils ne me réclament une montre. D'après ma propre expérience, il me semblait que les Russes ne désiraient rien tant que des montres. La plupart d'entre eux ne savaient pas lire l'heure, mais le simple fait de posséder une montre semblait leur causer un plaisir étrange. Un homme émacié qui marchait péniblement devant moi chancela tout à coup et tomba, la tête la première, dans le caniveau bordant la route. J'allais m'approcher de lui, lorsqu'un vieillard murmura derrière moi :
— Attention, Camarade étranger, si tu t'approches de lui, la police croira que c'est pour le voler. De toute façon, il est mort. De faim. Ça arrive ici tous les jours à des centaines de gens.
Je le remerciai d'un signe de tête et continuai mon chemin. "Quel terrible pays, me disais-je, où chaque homme se dresse contre son prochain. Sans doute est-ce parce qu'ils n'ont pas de religion pour les guider."
Cette nuit-là, je dormis derrière le mur croulant d'une Église abandonnée. Trois cents personnes environ me tinrent compagnie. Mon sac à dos me servit d'oreiller et pendant la nuit je sentis que des mains furtives essayaient d'en défaire les courroies. Un coup rapide sur la gorge de l'apprenti voleur l'envoya chanceler en arrière, le souffle coupé, et je ne fus plus dérangé.
Le lendemain matin, j'achetai de la nourriture au Marché Noir du Gouvernement, car en Russie c'est le Gouvernement qui dirige le Marché Noir. Et je repris ma route. Le Russe, mon compagnon de voyage, m'avait conseillé de me faire passer pour un touriste et de pendre mon appareil photographique (pris dans le train) autour de mon cou. Je n'avais pas de pellicule et à l'époque, j'étais incapable de distinguer l'avant de l'arrière d'un appareil photo.
Je me retrouvai bientôt dans le quartier le plus élégant de Moscou, celui que visite le touriste ordinaire, car le touriste ordinaire ne voit pas, ‘derrière la façade’, la misère, la pauvreté, la mort qui sévissent dans les taudis des rues latérales. La Rivière Moskova coulait sous mes yeux et j'en suivis un moment les rives avant de tourner sur la Place Rouge. Le Kremlin et la Tombe de Lénine ne m'impressionnèrent pas le moins du monde. J'étais habitué à la grandeur et à l'étincelante beauté du Potala. Près d'une des entrées du Kremlin, un petit groupe de gens attendaient, apathiques, mal habillés, ayant l'air d'avoir été conduits là comme du bétail.
Avec un ‘swoosh’ trois énormes voitures noires sortirent à toute allure, traversèrent la Place et disparurent dans l'obscurité des rues. Au moment où les gens lançaient un morne regard dans ma direction, je levai légèrement mon appareil. Soudain, je ressentis une terrible douleur dans la tête et crus un instant qu'un immeuble m'était tombé dessus. Je m'écroulai sur le sol et l'appareil me fut arraché des mains.
Des gardes soviétiques d'une taille gigantesque se penchaient sur moi. L'un d'eux m'envoyait, méthodiquement et froidement, des coups de pied dans les côtes pour me forcer à me relever. Mais j'étais trop assommé pour y parvenir, aussi deux policiers me mirent-ils brutalement sur pied. Ils me bombardaient de questions, mais ils parlaient si vite et avec un tel "accent moscovite" que je ne compris pas un mot. Finalement, las de m'interroger sans obtenir de réponses, ils me firent traverser la Place Rouge ; deux d'entre eux m'encadrèrent, à droite et à gauche et un troisième, derrière moi, m'enfonça le canon de son énorme revolver dans l'épine dorsale.
Nous nous arrêtâmes devant un bâtiment d'aspect sinistre et entrâmes par une porte du sous-sol. On me poussa brusquement — brutalement serait un meilleur mot — pour me faire descendre quelques marches de pierre et pénétrer dans une petite pièce. Un officier était assis à une table, deux gardes armés étaient debout contre un mur. Le gradé qui m'avait arrêté donna à l'officier un flot d'explications et posa mon sac à dos par terre, près de lui. L'officier rédigea ce qui devait être un reçu pour moi et mes possessions, et les policiers repartirent.
On me fit entrer, toujours avec la même brutalité, dans une autre pièce, très vaste celle-là, et on me laissa debout devant un immense bureau ; deux gardes armés m'encadrèrent de nouveau. Quelques instants plus tard, trois hommes entrèrent, s'assirent au bureau et commencèrent à examiner le contenu de mon sac à dos. L'un d'eux sonna un subalterne, lui confia mon appareil photographique et lui donna de brusques instructions. L'homme s'éloigna, portant l'inoffensif appareil comme s'il s'était agi d'une bombe près d'exploser.
Ils ne cessaient de me harceler de questions que j'étais incapable de comprendre. Finalement, ils appelèrent un interprète, puis un autre encore jusqu'à ce qu'ils en aient trouvé un capable de converser avec moi. On me fit déshabiller et un médecin m'examina. On palpa tous les ourlets de mes vêtements, et certains furent même ouverts d'un coup de ciseau. Puis on me les rendit, moins les boutons, la ceinture et les lacets de souliers. Sur un ordre, les gardiens m'emmenèrent, portant mes vêtements, et me firent suivre d'interminables couloirs. Chaussés de pantoufles en feutre, ils marchaient silencieusement et n'échangèrent pas un mot. Pendant le parcours, un cri s'éleva dans le silence, un cri à vous glacer le sang, qui s'acheva par un gémissement. Involontairement, je ralentis le pas, mais le garde, derrière moi, me bondit aux épaules avec une telle vigueur que je crus avoir la nuque brisée.
Enfin, nous nous arrêtâmes devant une porte rouge. Un garde l'ouvrit à l'aide d'une clé et me donna une bourrade qui m'envoya dégringoler, la tête la première, trois marches de pierre. La cellule était sombre et très humide. Elle avait environ six pieds sur douze (1,83 m x 3,6 m) avec un matelas immonde et nauséabond posé à même le sol. Pendant un temps indéfini, je demeurai là, dans l'obscurité ; j'étais de plus en plus affamé et je me demandais pourquoi la nature humaine était cruelle à ce point.
De longues heures plus tard, on m'apporta une miche de pain noir et moisi et une petite cruche d'eau fétide. Le garde, sans un mot, me fit signe de boire. J'avalai une gorgée : alors il m'arracha la cruche, en renversa l'eau sur le sol, et repartit. La porte se referma silencieusement. Je n'entendais aucun son, si ce n'est, de temps à autre, des cris affreux qui étaient vivement et brutalement étouffés. Le temps s'écoulait lentement. Je grignotais la miche de pain. J'avais tellement faim que je me croyais capable d'avaler n'importe quoi, mais ce pain était effroyable. Il puait comme si on l'avait sorti d'une fosse d'aisance.
Longtemps après, si longtemps que je me crus oublié à jamais, des gardes armés apparurent, toujours silencieux. Pas un mot ne fut échangé. Ils me firent signe de les suivre. N'ayant pas le choix, j'obéis, et nous enfilâmes d'interminables couloirs ; j'eus l'impression que l'on devait faire faire aux prisonniers le même chemin, maintes et maintes fois, afin de créer une atmosphère d'angoisse. Enfin, on me fit entrer dans une grande salle, dont l'un des murs était peint en blanc cru. Les gardes m'attachèrent les bras derrière le dos avec des menottes et me tournèrent face au mur blanc. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Puis des lampes extrêmement puissantes furent allumées de manière que leur éclat vraiment insoutenable se reflétât sur le mur. Même en fermant les paupières, j'eus l'impression que mes yeux étaient en train de brûler. Les gardes portaient des lunettes noires. La lumière m'arrivait par ondes, me donnant la sensation qu'on m'enfonçait des aiguilles dans les globes oculaires.
Une porte s'ouvrit et se referma doucement. J'entendis des chaises gratter le plancher, puis un froissement de papier. Enfin une conversation à voix basse, que je ne compris pas. Alors une crosse de fusil me frappa durement entre les omoplates et l'interrogatoire commença. Pourquoi étais-je en possession d'un appareil photographique démuni de film ? Pourquoi étais-je en possession des papiers d'un Garde-Frontière, stationné à Vladivostok ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? Heure après heure, toujours les mêmes questions stupides. La lumière brûlait toujours, j'avais une migraine terrible. Quand je refusais de répondre, je recevais un coup de crosse. Je ne connaissais de répit que pendant les brefs moments où, toutes les deux heures, les gardes et les inquisiteurs cédaient la place à d'autres. Car les lumières éblouissantes les épuisaient, eux aussi.
Après ce qui me parut être une éternité, mais qui, en réalité, dut être un laps de temps de six heures au plus, je m'écroulai sur le sol. Les gardes, sans la moindre émotion, me lardèrent de coups de baïonnette. Me remettre debout avec les bras liés derrière le dos ne fut pas chose aisée, mais j'y parvins, maintes et maintes fois. Quand je m'évanouissais, on me lançait des baquets d'eau de puisard. L'interrogatoire se poursuivit, heure après heure. Mes jambes se mirent à enfler. Mes chevilles devinrent plus grosses que mes cuisses, car les liquides de l'organisme descendaient vers le bas du corps et les chairs étaient saturées.
Toujours les mêmes questions, toujours la même brutalité. Soixante heures debout. Soixante-dix heures. Le monde n'était plus qu'un brouillard rougeâtre, j'étais à demi mort. Pas de nourriture, pas de repos, pas de répit. On me forçait à boire une drogue pour empêcher que je ne m'endorme. Des questions. Des questions. Des questions. Soixante-douze heures passèrent. Je ne voyais ni n'entendais plus rien. Tortionnaires, lumières, douleur, tout disparut et ce furent les ténèbres.
Après un laps de temps indéfini, je repris une conscience remplie de douleur, étendu sur le dos sur le plancher froid et humide d'une cellule puante. Le moindre mouvement était un supplice, j'étais gonflé comme une outre, j'avais l'impression que mon épine dorsale était en verre brisé. Aucun son ne décelait la présence d'autres êtres humains, aucune lumière ne différenciait le jour de la nuit. Rien qu'une éternité de souffrances, la faim, la soif. Enfin, j'entrevis une faible lueur : un garde posait brusquement une assiette de nourriture sur le sol. Une canette d'eau glissa à côté. La porte se referma et je demeurai de nouveau seul avec mes pensées, dans les ténèbres.
Les gardes revinrent, bien plus tard, et je fus traîné, car je ne pouvais plus marcher, jusqu'à la salle des interrogatoires. Là, je dus m'asseoir et écrire l'histoire de ma vie. Le processus se renouvela pendant cinq jours consécutifs. On m'emmenait dans une pièce, on me donnait un crayon et du papier et on me disait d'écrire tout ce qui me concernait. Pendant trois semaines, je restai dans ma cellule où je repris lentement des forces.
Une fois de plus, je fus emmené dans une salle et traduit devant trois hauts fonctionnaires. L'un d'eux jeta un coup d'œil aux autres, regarda un papier qu'il tenait à la main et me déclara que certains personnages influents avaient témoigné en ma faveur : j'avais rendu service à Vladivostok et j'avais aidé la fille de l'un d'eux à s'évader d'un camp de Prisonniers de Guerre Japonais.
— Vous allez être relâché, me dit le haut fonctionnaire, et emmené à Stryj, en Pologne. Un détachement de nos hommes va s'y rendre ; vous les accompagnerez.
Je fus de nouveau incarcéré, mais dans une cellule un peu plus confortable, jusqu'à ce que j'eusse repris assez de forces pour être en état de voyager. Enfin, je franchis le seuil de la Lubianka, Moscou, et pris le chemin de l'Occident.
Chapitre Quatre
Trois soldats attendaient devant la prison. Le gardien qui m'avait poussé dehors tendit un papier au caporal :
— Signe ici, Camarade, c'est simplement pour certifier que tu as pris un déporté en charge.
Le caporal se gratta la tête d'un air dubitatif, lécha le crayon et se frotta les paumes contre son pantalon avant de griffonner laborieusement son nom. Le gardien se détourna sans ajouter un mot et la porte de la Lubianka se referma bruyamment — cette fois, heureusement, j'étais dehors.
Le caporal me considéra en fronçant les sourcils :
— À cause de toi, il a fallu que je signe un papier. Lénine seul sait ce qui va arriver. Je pourrais bien échouer moi-même à la Lubianka. Allez viens, avance !
Le caporal ouvrit la marche et, un soldat de chaque côté, je fus emmené par les rues de Moscou jusqu'à une gare. Je ne portais rien ; tout ce que je possédais, un complet, je l'avais sur le dos. Les Russes avaient gardé mon sac à dos, ma montre, tout sauf les vêtements que je portais, c'est-à-dire, en gros et en détail, de lourdes chaussures à semelles de bois, un pantalon, un veston. Rien d'autre. Ni linge de corps, ni argent, ni provisions de bouche. Rien ! Si, je possédais néanmoins quelque chose : un papier disant que j'étais expulsé de Russie et que j'étais libre de me rendre en Allemagne de l'Est, où je devais me présenter au Commissariat le plus proche.
À la gare de Moscou, nous attendîmes dans le froid glacial. Les soldats allaient se réchauffer à tour de rôle. Moi, assis sur le quai de pierre, je tremblais de tous mes membres. J'avais faim, je me sentais malade et faible. Enfin un sergent arriva, suivi d'une centaine d'hommes. Il traversa le quai et me jeta un coup d'œil.
— Tu veux donc qu'il meure ? demanda-t-il au caporal d'une voix de stentor. Il faut que nous l'amenions vivant à Lwow (prononcez ‘Lvouv’, en Ukraine — NdT). Fais-le manger, le train ne partira que dans six heures.
Le caporal et un soldat me prirent chacun par un bras et me mirent debout. Le sergent me dévisagea et murmura :
— Hum. T'as pas l'air d'un mauvais type. Si tu nous causes pas d'ennuis, on t'en causera pas. (Il examina mes papiers que le caporal tenait en main.) Mon frère a été prisonnier à la Lubianka, me dit-il, après s'être assuré que personne ne pouvait l'entendre. Lui non plus n'avait rien fait. Ils l'ont expédié en Sibérie. À présent, tu vas aller te restaurer. Mange bien car, une fois à Lwow, tu te débrouilleras tout seul. (Il se détourna et appela deux caporaux :) Occupez-vous de lui, veillez à ce qu'il mange et boive à sa suffisance ; il doit nous quitter en bon état, sinon le Commissaire dira que nous tuons nos prisonniers.
Je m'éloignai, péniblement, entre les deux caporaux. Dans un petit restaurant près de la gare, le caporal-chef commanda de grands bols de soupe aux choux et des miches de pain noir. Le tout avait un goût de moisi, mais je parvins à l'avaler, tant j'avais faim. Je me rappelai la ‘soupe’ qu'on nous donnait dans les camps d'internement nippons : elle était composée de morceaux de tendons recrachés par les Japonais et de tout ce qu'ils avaient dédaigné.
Une fois restaurés, nous fûmes prêts à partir. Un caporal acheta d'autres miches de pain et trois numéros de la Pravda. Nous enveloppâmes le pain dans les journaux, en ayant bien soin de ne pas abîmer des photographies de Staline, puis nous retournâmes à la gare.
L'attente fut atroce. Six heures assis sur un quai, par un froid intense ! Enfin on fit monter notre troupeau dans un vieux train poussif, et en route pour Kiev. Cette nuit-là, je dormis serré entre deux soldats russes qui ronflaient bruyamment. Aucun de nous ne put s'étendre, nous étions terriblement à l'étroit. Les durs sièges de bois étaient inconfortables et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir sur le plancher. Le train roulait toujours, cahin-caha, s'arrêtant avec des grincements plaintifs chaque fois, semblait-il, que j'étais arrivé à m'assoupir. Très tard, la nuit suivante, après un pénible voyage d'environ quatre cent quatre-vingts milles (772 km), nous nous arrêtâmes dans une gare secondaire de Kiev. Au milieu des cris et de l'agitation, nous nous dirigeâmes vers la caserne voisine pour y passer la nuit. On me flanqua dans une cellule et, beaucoup plus tard, je fus tiré de mon sommeil par l'entrée d'un Commissaire et de son adjoint. Ils m'interrogèrent interminablement, et deux heures ou deux heures et demie après, ils repartirent enfin.
Pendant longtemps, je me tournai et me retournai, essayant de trouver le sommeil. Des mains brutales me giflèrent, aux cris de :
— Réveille-toi, réveille-toi, es-tu mort ? Voilà de quoi manger. Dépêche-toi... tu pars dans quelques minutes.
De quoi manger ? Encore de la soupe aux choux ! Encore du pain noir et moisi et de l'eau à boire ! J'avalai à la hâte, craignant d'être obligé de partir avant d'avoir terminé mon misérable repas. J'avalai et j'attendis. J'attendis des heures. Tard dans l'après-midi, deux policiers de l'armée entrèrent, me questionnèrent derechef, reprirent mes empreintes digitales, puis me déclarèrent :
— Nous sommes en retard. Tu n'as pas le temps de te restaurer à présent. Tu pourras peut-être manger quelque chose à la gare.
Devant la caserne trois camions militaires attendaient. Quarante soldats et moi-même parvînmes non sans mal à nous installer dans l'un d'eux, le reste grimpa dans les deux véhicules supplémentaires et nous partîmes, cahotés dangereusement tout le long de la route menant à la gare. Nous étions serrés les uns contre les autres, à tel point que j'avais du mal à respirer. Le chauffeur de notre camion, pris de folie, semblait-il, avait laissé les deux autres loin derrière lui. Il conduisait comme s'il avait été poursuivi par tous les diables du Communisme. Nous, à l'arrière, étions violemment secoués et ballottés et nous étions debout car il n'y avait pas la place de s'asseoir. La voiture carambolait à une allure effrénée le long de la route, il y eut un grincement aigu de freins trop rapidement bloqués et le camion dérapa. La paroi qui me faisait face se brisa en une pluie d'étincelles au moment où nous entrâmes en collision avec un gros mur de pierre. Il y eut des cris, des jurons, des hurlements, une véritable mer de sang, et je fus projeté en l'air. Je vis au-dessous de moi le camion démoli, en proie aux flammes. Une sensation de chute, un fracas terrible puis l'obscurité totale. Je perdis connaissance.
— Lobsang, dit une voix bien-aimée, la voix de mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, tu es très malade, ton corps est toujours sur la Terre, mais nous t'avons amené jusqu'ici, dans un monde au-delà de l'Astral. Nous nous efforçons de t'aider, car ta tâche en ce monde n'est pas encore terminée.
Mingyar Dondup ? C'était absurde. Il avait été tué par les traîtres Communistes alors qu'il tentait de parvenir à un accord pacifique au Tibet. J'avais vu les horribles blessures qu'il avait reçues quand on l'avait poignardé dans le dos. Mais naturellement je l'avais vu plusieurs fois depuis qu'il était parti pour les Champs Célestes.
La lumière blessait mes yeux aux paupières closes. Je me crus revenu devant ce mur de la Lubianka ; je m'attendais à ce que les soldats m'assènent de nouveau des coups de crosse entre les épaules. Toutefois, cette lumière était différente. En réalité, elle ne me faisait pas mal. "Ce doit être l'association d'idées", songeai-je vaguement.
— Lobsang, ouvre les yeux et regarde-moi !
La voix bienveillante de mon Guide me réconforta et un frisson de joie me parcourut. J'ouvris les yeux et regardai. Le Lama se penchait sur moi. Il paraissait en meilleure santé que je ne l'avais jamais vu sur Terre. Son visage semblait sans âge, son Aura rayonnait des couleurs les plus pures, sans aucune trace de passions terrestres. Sa robe safran était faite d'une étoffe immatérielle, elle resplendissait comme si elle avait été douée d'une vie propre. Il me sourit et me dit :
— Mon pauvre Lobsang, tu es un exemple particulièrement frappant de l'inhumanité de l'Homme envers l'Homme, parce que tu as survécu à maintes épreuves qui en auraient tué d'autres depuis bien longtemps. Tu es ici pour te reposer, Lobsang, un repos dans ce que nous appelons le ‘Pays de la Lumière Dorée’. Ici, nous avons dépassé le stade de la réincarnation. Ici, nous travaillons pour aider des peuples de bien des univers différents et non pas seulement de la Terre. Ton âme est meurtrie, ton corps est malade. Il faut que nous te remettions sur pied, Lobsang, car la tâche doit s'accomplir et tu n'as point de remplaçant.
Je jetai un regard autour de moi et je vis que je me trouvais dans une sorte d'hôpital. D'où j'étais étendu, j'apercevais un parc splendide ; des animaux y broutaient ou jouaient entre eux. Il me sembla qu'il y avait là des cerfs, des lions, et toutes ces bêtes qui, sur Terre, ne peuvent vivre paisiblement ensemble, étaient ici des amis qui s'amusaient comme les membres d'une même famille.
Une langue râpeuse me lécha la main droite, qui pendait en dehors du lit. Et j'aperçus Sha-lu, l'immense chat-gardien du Chakpori, l'un de mes premiers amis là-bas. Il me fit un clin d'œil et j'eus la chair de poule en l'entendant dire :
— Ah ! Ami, Lobsang, je suis heureux de te revoir, même pour un si court moment. Tu vas retourner sur Terre pendant un certain temps, en partant d'ici, mais dans quelques années, tu nous reviendras pour toujours.
Un chat doué de la parole ? Je connaissais bien le langage télépathique des chats et je le comprenais parfaitement, mais Sha-lu parlait, il n'émettait pas simplement des messages télépathiques. Un rire sonore me fit lever la tête : mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, était là et il semblait s'amuser beaucoup à mes dépens. De nouveau, mes cheveux se hérissèrent : Sha-lu était assis sur ses pattes de derrière, les coudes sur le lit. Lui et le Lama me regardèrent, puis se regardèrent. Et tous deux se mirent rire. Tous deux se mirent à rire, je le jure !
— Lobsang, poursuivit mon Guide, tu sais que la mort n'existe pas, tu sais qu'en quittant la Terre au moment de cette prétendue ‘mort’, l'ego se rend sur le plan où il se repose un certain temps avant de se réincarner dans un corps qui lui donnera l'occasion d'apprendre d'autres leçons et de progresser toujours davantage. Ici, nous sommes sur un plan d'où on ne se réincarne plus. Ici, nous vivons en harmonie, en paix, comme tu le vois, capables de nous rendre n'importe où, n'importe quand, grâce à ce que tu appellerais ‘une projection superastrale’. Ici, les humains, les animaux, et d'autres espèces aussi, conversent grâce la parole aussi bien que par télépathie ; nous employons le langage quand nous sommes près les uns des autres, la télépathie quand nous sommes éloignés.
Dans le lointain, j'entendis une musique suave, une musique que moi-même pouvais comprendre. Mes précepteurs, au Chakpori, avaient souvent déploré mon absence de dons musicaux. Leurs cœurs se seraient réjouis, me dis-je, s'ils avaient pu voir à quel point cette musique-là me réjouissait. À travers le ciel lumineux, des couleurs passaient et s'estompaient, comme pour accompagner la mélodie. Dans ce paysage merveilleux, les verts étaient plus verts, l'eau plus bleue. Aucun arbre n'était rabougri, aucune feuille n'était flétrie. Tout n'était que perfection. La perfection ? Alors que faisais-je là ? J'étais, hélas, loin d'être parfait, je ne l'ignorais pas.
— Tu as mené le bon combat, Lobsang, tu es ici pour te reposer, pour faire provision de courage ; tu l'as bien mérité.
Mon Guide me souriait avec bienveillance.
Je m'étendis de nouveau sur ma couche, puis me redressai, brusquement inquiet.
— Mon corps, où est mon corps terrestre ?
— Repose-toi, Lobsang, repose-toi, répondit le Lama. Quand tu auras repris des forces, nous te montrerons bien des choses.
Lentement, la lumière dorée de la chambre se transforma en une brume rougeâtre, très apaisante. Je sentis une main forte et fraîche se poser sur mon front, une patte douce et fourrée au creux de ma main droite et je perdis conscience.
Je rêvai que je me trouvais de nouveau sur Terre. Je regardais, sans émotion, les soldats russes fouiller les débris du camion et en retirer des cadavres calcinés ou en lambeaux. Je vis un homme lever la tête et désigner quelque chose du doigt. Les autres regardèrent à leur tour et je fis de même : mon corps brisé était accroché au sommet d'un mur. Du sang coulait de ma bouche et de mes narines. J'observai la scène tandis que l'on me descendait du mur et qu'on me transportait dans une ambulance. La voiture prit la direction de l'hôpital, et moi, qui d'en haut voyais tout, je remarquai que ma Corde d'Argent était intacte : elle brillait, bleue comme la brume matinale sur les vallées.
Des ambulanciers russes sortirent la civière, sans grandes précautions ; ils la portèrent dans une salle d'opérations et firent rouler mon corps sur une table. Des infirmières coupèrent mes vêtements ensanglantés et les jetèrent dans une poubelle. Une équipe de radiologues prit des photos : je vis que j'avais trois côtes cassées, dont l'une avait perforé mon poumon gauche. Mon bras gauche était fracturé en deux endroits, ma jambe gauche était de nouveau brisée au genou et à la cheville. L'extrémité d'une baïonnette brisée avait pénétré dans mon épaule gauche, manquant de peu une artère vitale. Les chirurgiennes poussèrent de bruyants soupirs, ne sachant par où commencer. J'avais l'impression de flotter au-dessus de la table d'opération, et me demandais si ces femmes possédaient une habileté suffisante pour me remettre en état. Une légère traction s'exerça sur ma Corde d'Argent et je traversai le plafond, apercevant sur mon passage les malades dans leurs lits, à l'étage supérieur. Puis, je m'élevai toujours plus haut dans l'espace, parmi les étoiles infinies, au-delà de l'astral, traversant les plans éthériques les uns après les autres, jusqu'à ce que j'eusse atteint de nouveau le ‘Pays de la Lumière Dorée’.
Je sursautai, essayant de distinguer à travers la brume pourpre.
— Il est revenu, dit une voix douce.
La brume se dissipa, pour faire place à la merveilleuse Lumière. Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, se tenait près de moi et me regardait. Sha-lu était étendu sur le lit, à mes côtés, et ronronnait paisiblement. Deux autres hauts personnages se trouvaient dans la pièce. Ils regardaient par la fenêtre, observant les gens qui flânaient, beaucoup plus bas.
En entendant mon exclamation stupéfaite, ils se retournèrent et me sourirent.
— Tu as été si malade, dit l'un, que nous avons craint que ton corps ne puisse en supporter davantage.
L'autre, que je connaissais bien, malgré la très haute position qu'il avait occupée sur Terre, me prit les mains entre les siennes.
— Tu as trop souffert, Lobsang. Le monde s'est montré trop cruel envers toi. Nous en avons discuté et pensons que tu désires peut-être abandonner la lutte. Si tu la continues, de nombreuses épreuves t'attendent encore. Tu peux quitter ton corps dès à présent et rester ici, pour l'éternité. Préfères-tu qu'il en soit ainsi ?
Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. La Paix après toutes mes souffrances. Des souffrances qui, sans l'entraînement spécial que j'avais subi, auraient depuis longtemps mis fin à mes jours. Un entraînement spécial. Oui, et pourquoi ? Pour que je puisse discerner l'Aura des êtres, pour que je puisse influencer la pensée et la diriger vers la recherche aurique. Et si j'abandonnais — qui continuerait cette tâche ?
— Le monde s'est montré trop cruel envers toi : personne ne te fera de reproche si tu abandonnes.
Il me fallait réfléchir profondément. Les autres ne me reprocheraient rien, soit, mais pendant toute l'éternité je serais obligé de vivre avec ma conscience. Qu'est-ce que la vie ? Quelques brèves années de misère. Encore quelques années d'épreuves, de souffrances, d'humiliations, et puis, si j'avais fait tout ce dont j'étais capable, ma conscience serait en paix. Pour l'éternité.
— Respectable Seigneur, répondis-je, vous m'avez donné le choix. Je servirai tant que mon corps le permettra. Pour le moment il est en piteux état, ajoutai-je.
Les hommes qui m'entouraient approuvèrent d'un sourire. Sha-lu ronronna plus fort et me gratifia d'une petite morsure amicale.
— Ton corps terrestre est, comme tu le dis, dans un état déplorable, à cause de tout ce que tu as enduré, dit l'Homme Éminent. Avant que tu ne prennes une décision finale, laisse-nous te dire ceci : Nous avons trouvé, dans le pays d'Angleterre, un corps que son possesseur a hâte de quitter. Son Aura possède un harmonique fondamental semblable au tien. Plus tard, si les conditions l'exigent, tu pourras prendre ce corps.
Ma surprise horrifiée fut telle que je faillis tomber du lit. Moi, prendre un autre corps ? Mon Guide se mit à rire :
— Eh bien, Lobsang, à quoi te sert ton entraînement ? Il ne s'agit que de prendre la robe d'un autre. Et au bout de sept années, le corps serait le tien, molécule pour molécule le tien, avec les mêmes cicatrices auxquelles tu tiens tant. Au début, cela te paraîtra un peu étrange, comme lorsque tu as mis pour la première fois des vêtements occidentaux. Je m'en souviens fort bien, Lobsang.
L'Homme Éminent reprit la parole :
— Tu as le choix, mon cher Lobsang. Tu peux, la conscience en repos, abandonner ton corps dès à présent et rester ici. Mais si tu retournes sur Terre, l'échange des corps ne se fera pas tout de suite. Avant que tu ne prennes une décision, je dois te dire qu'en revenant sur Terre, tu retrouveras la peine, l'incompréhension, l'incrédulité et même la haine, car il existe une force du mal qui tente d'empêcher tout ce qui est favorable à l'évolution humaine. Tu devras lutter contre ces forces mauvaises.
— Mon choix est fait, répondis-je. Vous m'avez montré la voie. Je continuerai jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie, et si je dois prendre un autre corps, eh bien, je le prendrai.
Une torpeur m'envahit. Mes yeux se fermèrent malgré moi. La pièce s'estompa et je perdis conscience.
Le monde semblait tournoyer sur lui-même. J'entendais à mes oreilles une sorte de rugissement et un murmure de voix. Et, sans pouvoir m'expliquer pourquoi, j'avais l'impression d'être attaché. Étais-je de nouveau en prison ? Les Japonais m'avaient-ils capturé ? Mon voyage à travers la Russie était-il un rêve ? Étais-je vraiment allé au ‘Pays de la Lumière Dorée’ ?
— Il reprend conscience, dit une voix rude. Hé, RÉVEILLEZ-VOUS, cria quelqu'un à mon oreille.
J'ouvris péniblement mes yeux douloureux. Une femme russe me regardait, les sourcils froncés. Près d'elle une grosse doctoresse jetait autour de la salle un regard glacial. Car j'étais dans une salle d'hôpital en compagnie d'une cinquantaine d'autres hommes. Alors la douleur m'envahit, se répandit dans tous mes membres, pareille à une onde de feu. Respirer était difficile. Je ne pouvais pas bouger.
— Bah, il s'en tirera, dit la doctoresse au visage impassible et elle s'éloigna, suivie par l'infirmière.
Je demeurai étendu, le souffle coupé par la douleur que je ressentais au côté gauche. Ici, on ne donnait pas de drogues pour calmer la douleur. Ici, on vivait et on mourait de soi-même, sans espérer ni obtenir de pitié ou de soulagement.
De robustes infirmières passaient, dont le pas lourd faisait trembler le lit. Chaque matin des doigts arrachaient sans précaution les pansements et les remplaçaient par d'autres. Pour le reste, on dépendait du bon vouloir des malades capables de se déplacer.
Je restai là pendant deux semaines, à peu près abandonné par les infirmières et le personnel médical, m'en remettant à la complaisance des autres malades et souffrant le martyre quand ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas me venir en aide. Au bout de deux semaines, la doctoresse au visage impassible apparut, accompagnée par l'infirmière poids lourd. Elles enlevèrent sans ménagement les plâtres entourant mon bras et ma jambe gauche. Je n'avais jamais vu traiter un blessé de la sorte et quand je faillis tomber, l'infirmière me retint par mon bras malade.
Pendant la semaine qui suivit, je claudiquai dans la salle, rendant de mon mieux service à mes compagnons. J'avais une couverture pour tout vêtement et je me demandais comment j'en trouverais d'autres. Le vingt-deuxième jour après mon hospitalisation, deux policiers apparurent dans la salle. M'arrachant ma couverture, ils me jetèrent un complet en criant :
— Dépêche-toi, tu vas être déporté. Il y a trois semaines que tu aurais dû partir.
— Comment aurais-je pu partir puisque j'étais sans connaissance ? Est-ce ma faute ? objectai-je.
Un coup en pleine figure fut la seule réponse et le second policier mit éloquemment la main sur l'étui de son revolver. Ils me firent descendre l'escalier et entrer dans le bureau du Commissaire Politique.
— Tu ne nous as pas dit, quand tu as été hospitalisé, que tu allais être déporté, me dit-il d'un ton courroucé. Tu as été soigné sous un faux prétexte, à présent tu dois payer les frais de traitement.
— Camarade Commissaire, répondis-je. On m'a amené ici sans connaissance, et si j'ai été blessé, c'est par la faute d'un soldat russe. Son imprudence m'a valu les pires souffrances et de graves dommages matériels.
Le Commissaire se frotta le menton d'un air songeur : — Comment sais-tu tout cela puisque tu avais perdu connaissance ? Il faut que j'étudie cette affaire. (Il se tourna vers le policier et lui dit :) Emmenez-le à votre Commissariat et mettez-le en cellule jusqu'à nouvel ordre.
De nouveau, ce fut en tant que prisonnier que je longeai les rues animées de la ville. Au poste de police, on prit, une fois de plus, mes empreintes digitales et on me conduisit dans un cachot souterrain. Pendant un long moment, je m'y crus oublié, puis un gardien m'apporta de la soupe aux choux, du pain noir et un ersatz de café à base de glands. La lumière était sans cesse allumée dans le couloir, rien ne permettait de distinguer la nuit du jour, ni de marquer le passage des heures. Finalement, on me conduisit dans une pièce où un homme d'aspect sévère consultait des papiers. Il m'examina par-dessus ses lunettes et me dit :
— Tu as été reconnu coupable d'être demeuré en Russie alors que tu avais été condamné à la déportation. Il est exact que tu as été victime d'un accident dont tu n'étais pas responsable, mais dès que tu as repris connaissance, tu aurais dû attirer sur ton cas l'attention du Commissaire de l'Hôpital. Ton traitement a coûté cher à la Russie, poursuivit-il, mais la Russie est miséricordieuse. Tu travailleras douze mois sur les routes de Pologne pour payer tes frais d'hospitalisation.
— C'est vous qui devriez me payer, rétorquai-je, puisque j'ai été grièvement blessé par la faute d'un soldat russe.
— Le soldat n'est pas ici pour se défendre. Il était indemne, alors nous l'avons fusillé. Je maintiens la sentence. Demain, tu seras emmené en Pologne où tu travailleras sur les routes.
Un gardien me saisit brutalement par le bras et me reconduisit à ma cellule.
Le lendemain, deux autres hommes et moi fûmes tirés du cachot et emmenés à la gare. Nous y restâmes un certain temps, avec la police pour compagnie. Puis un détachement de soldats fit son apparition et le chef des policiers qui nous gardaient s'approcha du Sergent et lui présenta un formulaire à signer. Une fois de plus, j'étais entre les mains de l'armée russe !
Une autre longue attente ; puis on nous fit monter dans le train qui allait nous emmener à Lwow, en Pologne.
Lwow était un endroit lugubre. La campagne était criblée de puits de pétrole et les routes étaient effroyables en raison de l'intense circulation du temps de guerre. Des hommes et des femmes travaillaient sur les routes, cassant les pierres, bouchant les fissures. Leurs rations alimentaires leur permettaient tout juste de ne pas mourir de faim. Les deux hommes partis de Kiev avec moi ne se ressemblaient guère. Jacob était un individu peu sympathique qui allait tout le temps se plaindre aux gardiens. Jozef, lui, au contraire, faisait consciencieusement sa besogne. L'état de mes jambes ne me permettant pas de rester longtemps debout, on me fit casser des pierres, assis sur le bord de la route. Apparemment, le fait que j'eusse un bras encore abîmé, et des poumons et des côtes à peine guéris, n'était pas considéré comme un handicap. Pendant un mois je tins le coup, m'exténuant sans recevoir d'autre salaire que ma nourriture. Même les femmes recevaient deux zlotys pour chaque verge cube (m) de pierre concassée. Au bout du mois, je m'écroulai, crachant le sang, sur le bord de la route. Sans tenir compte de l'ordre des gardes, Jozef courut vers moi. L'un des soldats leva son fusil et lui tira dans le cou une balle qui, heureusement, n'atteignit aucun organe vital. Nous restâmes ainsi, gisant côte à côte sur le sol, jusqu'à ce qu'un fermier passât dans sa charrette à cheval. Un garde l'arrêta et on nous jeta sur la cargaison de lin. Le garde s'installa près du fermier et la charrette prit, en cahotant, le chemin de l'hôpital de la prison. Pendant plusieurs semaines, je demeurai étendu sur les planches de bois qui me servaient de lit ; puis le médecin de la prison déclara que je devais être transporté ailleurs. D'après lui, j'étais mourant, et il aurait des ennuis si un autre de ses prisonniers mourait ce mois-ci, le quota étant déjà dépassé !
Il y eut une consultation d'un genre particulier dans ma cellule d'hôpital avec le Gouverneur de la prison, le médecin et un gardien-chef.
— Il faut que tu ailles à Stryj, dit le Gouverneur. Le régime n'y est pas aussi sévère et le pays y est plus sain.
— Mais, Gouverneur, répondis-je, pourquoi partirais-je d'ici ? Je ne suis pas en prison pour avoir commis un délit. Pourquoi partirais-je sans protester ? Je raconterai à tout venant comment on m'a traité.
Il y eut des cris et des grincements de dents. Finalement ce fut moi, le prisonnier, qui proposai une solution :
— Gouverneur, vous voulez, vous, que je parte dans votre propre intérêt. Eh bien, je ne me laisserai pas, sans mot dire, transférer dans une autre prison. Si vous voulez que je me taise, laissez-nous partir pour Stryj, Jozef Kochino et moi, comme des hommes libres. Donnez-nous des vêtements convenables. Donnez-moi un peu d'argent pour acheter quelques provisions. Nous serons discrets et nous filerons sur-le-champ, par les Carpates.
Le Gouverneur poussa force jurons et les trois hommes quittèrent ma cellule. Le lendemain, le Gouverneur revint, me dit qu'il avait examiné mes papiers et qu'il s'était rendu compte que j'étais un ‘homme d'honneur’, injustement incarcéré. Il allait accéder à ma requête.
Pendant une semaine, je n'eus aucune nouvelle de lui. Puis, à trois heures du matin, le huitième jour, un garde entra dans ma cellule, me secoua pour me réveiller et me dit que l'on me demandait au ‘bureau’. Je m'habillai vivement et le suivis. Il ouvrit la porte du bureau et me poussa à l'intérieur. Un garde y était assis ; il y avait à côté de lui deux piles de vêtements et deux sacs de l'Armée Russe. Des vivres étaient posés sur la table. Il me fit signe d'approcher en silence.
— On va t'emmener à Stryj, murmura-t-il, quand tu seras là, demande au garde — il sera seul — de te conduire un peu plus loin. Si tu peux, fais-lui prendre une route tranquille, désarme-le, ligote-le et laisse-le sur le bord du chemin. Tu m'as secouru quand j'étais malade, c'est pourquoi je t'avertis qu'ils ont l'intention de t'abattre pendant le trajet. Ils diront que tu tentais de t'évader. La porte s'ouvrit et Jozef entra :
— À présent, mangez votre déjeuner et dépêchez-vous, reprit le garde. Voilà de l'argent pour le voyage.
C'était une somme assez considérable et je devinai le complot. Le Gouverneur de la Prison dirait que nous l'avions volé et que nous avions pris la fuite.
Après avoir déjeuné, nous fûmes conduits jusqu'à une voiture, une sorte de jeep. Un policier à l'air morose était assis au volant, un revolver à côté de lui. Il nous fit signe de monter ; la voiture démarra et franchit le portail de la prison. Après avoir parcouru environ trente-cinq milles (56 km), nous n'étions plus qu'à cinq milles (8 km) de Stryj, et je me dis qu'il était temps d'agir. Me penchant vivement en avant, j'assenai une manchette de judo sous le nez du garde, tout en saisissant le volant de l'autre main. Le garde s'écroula, le pied sur l'accélérateur. Je coupai le contact et arrêtai la voiture sur le bord de la route. Jozef était resté bouche bée ; je le mis brièvement au courant du complot.
— Vite, Jozef, lui dis-je, enlève tes vêtements et mets les siens. Il va falloir que tu joues son rôle.
— Mais Lobsang, gémit-il, je ne sais pas conduire et tu n'as pas l'air d'un Russe.
Nous installâmes le garde au fond du véhicule et je me mis au volant. J'atteignis bientôt un sentier sillonné d'ornières que je suivis un certain temps. Puis je stoppai. Le garde avait repris connaissance. Nous le relevâmes et je braquai le revolver sur lui.
— Si tu tiens à la vie, lui dis-je de ma voix la plus menaçante, tu feras ce que je t'ordonne : tu nous conduiras en contournant les faubourgs de Stryj jusqu'à Skol'ye. Là, nous te relâcherons.
— Je ferai tout ce que vous voudrez, balbutia le garde, mais si vous devez traverser la frontière, laissez-moi passer avec vous car sinon on me fusillera.
Jozef s'assit au fond de la jeep, tenant le revolver avec précaution et considérant avec regret la nuque du gardien. J'étais assis à côté de ce dernier, pour éviter qu'il ne nous joue le tour de quitter la route ou de jeter la clef de contact. Nous continuâmes à rouler en évitant les chemins fréquentés. Au fur et à mesure que nous traversions les Carpates, le pays devenait plus montagneux, les bois plus touffus, offrant des refuges sûrs. À un endroit bien abrité, nous fîmes halte pour nous détendre les jambes et nous restaurer, partageant les provisions avec le garde. À Vel'ki-Berezni, n'ayant plus d'essence, nous arrêtâmes la voiture et la cachâmes. Nous avancions avec précaution, le garde entre nous deux. Nous étions en ‘pays frontalier’ et il nous fallait être prudent. Tout homme doué de bon sens peut traverser une frontière, il suffit pour cela d'un peu d'ingéniosité et de courage. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté à passer illégalement d'un pays dans un autre. Les seules fois où j'en ai eu, c'est lorsque j'étais muni de papiers parfaitement en règle. Les passeports ne font que causer des ennuis au voyageur innocent qui est soumis à toutes sortes de formalités ridicules. Jamais un homme obligé de traverser une frontière n'a échoué dans son entreprise, faute de passeport. Toutefois, les passeports doivent exister afin, je suppose, d'exaspérer les voyageurs inoffensifs et de donner du travail à une horde de fonctionnaires, souvent fort déplaisants.
Ceci n'est pas un traité sur la manière de franchir illégalement une frontière ; je me bornerai donc à dire que nous entrâmes tous trois sans encombre en Tchécoslovaquie. Le garde alla son chemin, nous le nôtre.
— J'habite Levice, me dit Jozef, c'est là que je veux aller. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu le désires.
Nous traversâmes Kosice et Zvolen, et continuâmes notre route vers Levice, parfois à pied, parfois en auto-stop, parfois en train. Jozef connaissait bien la région, il savait où se procurer des pommes de terre ou des betteraves, ou n'importe quoi de comestible.
Finalement nous atteignîmes Levice ; nous prîmes une rue misérable et nous arrêtâmes devant une petite maison. Jozef frappa à la porte. N'obtenant pas de réponse, il frappa de nouveau. Un rideau s'écarta précautionneusement d'un pouce ou deux (2,5 ou 5 cm) et la personne qui se trouvait derrière ce rideau reconnut Jozef. La porte s'ouvrit, il fut tiré à l'intérieur. La porte me claqua au nez. Je fis les cent pas dehors. Finalement, elle se rouvrit et Jozef apparut, l'air penaud.
— Ma mère ne veut pas que tu entres, me déclara-t-il. Elle dit qu'il y a trop d'espions dans les parages et que nous risquons d'être arrêtés si nous recevons un étranger. Je suis navré.
Sur ces mots, il tourna les talons, l'oreille basse, et rentra dans la maison.
Je demeurai un long moment cloué sur place. C'était grâce à moi que Jozef était sorti de prison, grâce à moi qu'il avait évité d'être abattu, qu'il était arrivé chez lui. À présent, il me laissait me débrouiller tout seul ! Tristement, je revins sur mes pas et repris la direction de la grand-route. Je n'avais ni argent ni provisions, je ne comprenais pas la langue. Je marchais aveuglément, attristé par la trahison de celui que j'avais appelé ‘mon ami’.
Pendant des heures, j'avançai le long de la grand-route. Les rares conducteurs de voitures qui passaient ne m'accordèrent pas un regard. Il y avait trop de vagabonds pour que j'attire l'attention. À quelques milles (km) de là, j'assouvis un peu ma faim en ramassant des pommes de terre à demi pourries qu'un fermier avait jetées à ses cochons. Boire ne posa pas de problème, grâce aux ruisseaux. Depuis longtemps je savais que l'eau des ruisseaux et des cours d'eau était pure, mais que celle des rivières était polluée.
À bonne distance de moi, sur la route toute droite, j'aperçus un volumineux objet. De loin on eût dit un camion de police ou un barrage. Pendant un moment j'observai, assis sur le bord de la route. N'apercevant ni policiers ni soldats, je repris prudemment mon chemin. En m'approchant, je vis qu'un homme s'escrimait sur le moteur de son véhicule. Il leva les yeux à mon approche et dit quelque chose que je ne compris pas. Il le répéta dans une autre langue, puis dans une autre encore. Enfin, je saisis à peu près le sens de ses paroles. Son moteur s'était arrêté, il ne pouvait pas le remettre en marche, est-ce que je m'y connaissais en moteurs ? Je regardai, tâtai, examinai les contacts et essayai le starter. Le réservoir était plein d'essence. Regardant sous le tablier, je vis que les fils étaient mal isolés, ce qui avait eu pour résultat de couper l'allumage lorsqu'un cahot de la route avait mis en contact deux fils dénudés. Je n'avais pas de chatterton, mais il ne me fallut pas longtemps pour envelopper les fils dans un morceau d'étoffe et pour les attacher solidement. Le moteur s'alluma et se mit à ronronner doucement.
"Il y a quelque chose de louche là-dessous, me dis-je. Ce moteur est trop bon pour appartenir à une vieille voiture de fermier."
L'homme sautait de joie.
— Bravo, bravo, s'exclamait-il, vous m'avez sauvé !
Je le regardai, perplexe. Comment avais-je pu le ‘sauver’ rien qu'en remettant son moteur en marche ?
Il m'examina avec attention.
— Je vous ai déjà vu, me dit-il, vous étiez accompagné d'un autre homme et vous traversiez le Pont de la Rivière Hron, à Levice.
— Oui, dis-je, et à présent je continue mon chemin tout seul.
Il me fit signe d'entrer dans la voiture. Tandis que nous roulions, je lui racontai tout ce qui s'était passé. Je voyais par son Aura que c'était un homme digne de confiance et bien intentionné.
— La guerre a mis fin à mon métier, me dit-il, et j'ai une famille à nourrir. Vous vous y connaissez en voitures et j'aurais besoin d'un chauffeur qui ne tombe pas en panne sur les routes. Nous faisons passer des produits alimentaires et quelques articles de luxe d'un pays dans un autre. Tout votre travail consisterait à conduire et à entretenir une voiture.
J'étais très hésitant. De la contrebande ? Je n'en avais jamais fait. L'homme me regarda et reprit :
— Il ne s'agit pas de drogues, ni d'armes, ni d'aucun produit nocif. Simplement d'aliments qui permettent aux gens de subsister et d'articles de luxe qui donnent un peu de joie aux femmes.
Je trouvai la chose bizarre, car la Tchécoslovaquie ne me semblait pas un pays qui pût se permettre d'exporter des aliments et des articles de luxe. Je le dis à mon compagnon qui me répondit :
— Vous avez raison, tout cela vient d'un autre pays, nous nous contentons de le faire passer. Les Russes mettent au pillage les pays occupés par eux. Ils emmènent par train les articles de valeur et les expédient aux leaders du Parti. Nous interceptons simplement les trains chargés des meilleurs vivres et nous les envoyons aux pays qui en ont le plus besoin. Tous les Gardes-Frontières sont dans la combine. Vous n'auriez qu'à conduire la voiture, avec moi dedans.
— Eh bien, dis-je, laissez-moi voir ce camion. S'il ne contient ni drogues ni produits nocifs, je vous conduirai où vous voulez.
Il se mit à rire et me dit :
— Montez à l'arrière. Regardez où vous voudrez. Mon chauffeur habituel est malade et je me suis cru capable de conduire ce véhicule tout seul, mais je ne connais rien à la mécanique. J'étais un avocat connu, à Vienne, avant la guerre.
Je fouillai l'arrière de fond en comble et n'y trouvai effectivement que des vivres et du linge de soie pour femmes.
— C'est bon dis-je, je vous conduirai.
Et nous partîmes pour un voyage qui me mena, via Bratislava, en Autriche, où nous traversâmes Vienne et Klagenfurt, puis en Italie où Vérone était la dernière étape. Des Gardes-Frontières nous arrêtèrent, feignirent d'inspecter notre cargaison, puis nous firent signe de poursuivre notre chemin dès qu'un petit paquet leur eut été remis. Un jour, une voiture de police nous dépassa, s'arrêta brusquement, me forçant littéralement à me mettre debout sur mes freins. Deux policiers se précipitèrent vers nous, le revolver menaçant. Puis, comme nous leur présentions certains papiers, ils battirent en retraite, l'air gêné, en balbutiant des excuses. Mon nouveau patron semblait fort satisfait de moi.
— Je pourrai vous mettre en rapport avec un homme qui conduit des camions à Lausanne, en Suisse, dit-il, et s'il est aussi content que moi de vos services, il vous fera connaître quelqu'un qui vous emmènera à Ludwigshafen en Allemagne.
Nous nous reposâmes une semaine à Venise, pendant qu'on déchargeait et rechargeait le camion. Après une randonnée aussi épuisante, nous avions besoin de nous délasser. Venise fut pour moi un endroit épouvantable car j'avais du mal à respirer sur ces terres basses. À mes yeux, la ville n'était qu'un égout à ciel ouvert.
De Venise, nous partîmes dans un autre camion pour Padoue, Vicence et Vérone. Toutes les personnalités officielles nous traitaient comme des bienfaiteurs publics et je me demandais qui était en réalité mon patron. D'après son Aura, et une Aura ne peut mentir, c'était certainement un homme bien. Mais la chose ne m'intéressait pas vraiment et je ne cherchai pas à me renseigner. Tout ce que je voulais, c'était reprendre ma route, continuer ma propre tâche. Et je savais qu'elle ne pourrait être accomplie tant que je serais ballotté d'un pays à l'autre, sans pouvoir me fixer définitivement.
Mon patron entra dans ma chambre de l'hôtel véronais.
— Il y a un homme dont je voudrais que vous fassiez connaissance. Il viendra ici cet après-midi. Ah, Lobsang, vous feriez mieux de raser votre barbe. Les Américains n'aiment pas les barbes et cet homme est un Américain qui répare les camions et les voitures et les fait passer d'un pays à l'autre. Qu'en dites-vous ?
— Monsieur, répondis-je, si ma barbe déplaît aux Américains ou à qui que ce soit, tant pis. Les Japonais m'ont brisé la mâchoire à coups de botte et je porte la barbe pour dissimuler mes cicatrices.
Mon patron s'entretint avec moi pendant un long moment et avant de nous séparer, il me donna une très belle somme d'argent, disant que puisque j'avais tenu ma promesse, il tiendrait la sienne.
L'Américain était un individu d'une élégance de mauvais aloi, qui roulait un énorme cigare entre ses lèvres épaisses. Il avait de nombreuses dents en or et ses vêtements de couleurs criardes tapaient littéralement dans l'œil. Une femme aux cheveux d'un blond platiné se trémoussait à ses côtés ; sa robe dissimulait à peine les parties de son anatomie qui, d'après les canons de la pudeur occidentale, auraient dû être invisibles.
— Dis donc, glapit-elle en m'examinant, est-ce qu'il est pas chou, est-ce qu'il est pas croquignolet ?
— Ah, ferme-la, Poupée, ordonna l'homme qui devait l'entretenir. File, va te balader, faut qu'on parle affaires. Avec une moue et une ondulation des hanches qui fit trembler dangereusement le tout et mit à l'épreuve le tissu léger de la robe, ‘Poupée’ quitta la pièce pour regagner le bar sans doute.
— On a une chouette Mercedes à faire sortir, dit l'Américain. Elle se vendra pas ici, mais dans un autre pays, elle rapportera gros. Elle appartenait à l'un des Gros Bonnets de Musso. On l'a libérée et repeinte. J'ai un contact au poil à Karlsruhe, en Allemagne. Si je peux l'amener jusque-là, je toucherai pas mal de grisbi.
— Pourquoi ne pas l'y conduire vous-même ? demandai-je. Je ne connais ni la Suisse ni l'Allemagne.
— Moi, la conduire ? J'ai fait ça trop souvent, tous les Gardes-Frontières me connaissent.
— Alors, vous voulez que ce soit moi, qui me fasse prendre ? rétorquai-je. Je suis venu de trop loin, j'ai vécu trop dangereusement pour courir un nouveau risque. Non, je refuse.
— Mais, mon vieux, pour vous ce sera du tout cuit. Vous avez l'air honnête et je peux vous fournir des papiers prouvant que la voiture vous appartient et que vous êtes un touriste. Oui, je peux vous donner tous les papiers nécessaires.
Il fouilla dans la grande serviette qu'il portait et en tira une liasse de documents divers. Je jetai sur eux un regard indifférent. Mécanicien de marine ! Je vis qu'ils étaient ceux d'un homme, d'un mécanicien de marine. Si j'arrivais à me les procurer, je pourrais monter à bord d'un bateau. Or, j'avais étudié la construction mécanique aussi bien que la médecine et la chirurgie à Chongqing ; j'avais passé un diplôme d'ingénieur, j'étais un pilote breveté, quantité de possibilités s'ouvraient devant moi.
— Eh bien, ça ne m'emballe pas, dis-je, trop risqué. Ces papiers n'ont pas ma photographie. Comment puis-je être certain que leur véritable possesseur ne va pas surgir au mauvais moment ?
— Le type est mort, mort et enterré. Il était soûl et il conduisait une Fiat à toute allure. Il s'est endormi au volant, je suppose ; en tout cas, il s'est écrasé sur l'arche d'un pont de pierre. On a appris l'histoire et on a ramassé ses papiers.
— Et si j'accepte, que me paierez-vous ? Et pourrai-je garder les papiers ? Ils m'aideront à traverser l'Atlantique.
— Bien sûr, mon vieux, bien sûr. Je vais vous donner deux cent cinquante dollars et vous payer tous vos frais et vous garderez les papiers. On y fera mettre votre photo à la place de la sienne. J'ai des copains. Ils arrangeront ça au mieux !
— Très bien, répondis-je, je conduirai la voiture jusqu'à Karlsruhe.
— Emmenez la fille avec vous, elle vous tiendra compagnie et ça me débarrassera d'elle. J'en ai une autre en vue.
Pendant un moment, je le considérai avec stupéfaction. Il se méprit sur mes sentiments :
— Mais oui, elle ne refusera pas. Vous vous amuserez bien.
— Non ! m'exclamai-je, je n'emmènerai pas cette femme avec moi, je ne veux pas voyager dans la même voiture qu'elle. Si vous n'avez pas confiance en moi, laissons tomber, ou faites-moi accompagner par un homme, deux si vous voulez, mais pas par une femme.
Il rejeta la tête en arrière et éclata de rire, en montrant toutes ses dents. Cette exhibition d'or me rappela les objets exposés dans les Temples du Tibet. Son cigare tomba au sol et s'éteignit au milieu d'une pluie d'étincelles.
— Cette bonne femme, dit-il quand il eut retrouvé la parole, me coûte cinq cents dollars par semaine. Je vous offre de vous la donner pour le voyage et vous refusez ! Ça, c'est quelque chose !
Deux jours plus tard, les papiers étaient prêts. Ma photographie y était collée et des fonctionnaires complaisants, après avoir soigneusement examiné les documents, y avaient apposé tous les cachets officiels nécessaires. La grosse Mercedes étincelait sous le soleil italien. Je vérifiai, comme toujours, la réserve d'essence, d'huile et d'eau, montai et mis le moteur en marche. Au moment où je m'éloignais, l'Américain m'adressa un grand geste d'adieu.
À la frontière suisse, les Douaniers examinèrent attentivement les papiers que je leur présentais. Puis ils s'occupèrent de la voiture. Ils soulevèrent le réservoir à essence pour voir s'il ne contenait pas de double fond, ils tapèrent la carrosserie pour s'assurer que rien n'était caché derrière les parois de métal. Deux d'entre eux regardèrent sous la voiture, sous le tablier et ils examinèrent même le moteur. Au moment où ils me rendaient ma liberté, j'entendis crier derrière moi et freinai vivement. Un garde s'approcha, hors d'haleine :
— Voulez-vous emmener quelqu'un jusqu'à Martigny ? Il est pressé et il doit aller là-bas pour une affaire urgente.
— Oui, répondis-je, s'il est prêt à partir, je l'emmène. Le garde fit un signe et un homme sortit rapidement du poste-frontière. Il me salua et monta près de moi dans la voiture. Je vis à son Aura que c'était un haut fonctionnaire et qu'il avait des soupçons. Il se demandait sans doute pourquoi je voyageais seul, sans femme.
Il était très bavard, mais il prit le temps de me bombarder de questions. Des questions auxquelles je pouvais répondre.
— Pas de femme, monsieur ? dit-il, c'est curieux. Vous avez peut-être d'autres préoccupations ?
Je me mis à rire.
— Vous autres, vous ne pensez qu'au sexe, un homme qui voyage seul vous paraît suspect. Je suis un touriste, je veux voir du pays. Je peux voir des femmes n'importe où.
Il me regarda d'un œil moins méfiant.
(Adam et Ève dans le Jardin d'Éden)
— Je vais, lui dis-je, vous raconter une histoire que je sais être vraie. C'est une autre version du Jardin d'Éden.
"Dans toute l'histoire des grandes religions, il existe des récits auxquels certains ont ajouté foi, mais que d'autres, plus clairvoyants peut-être, considèrent comme des légendes destinées à cacher des vérités qui ne doivent pas être connues d'hommes non évolués, car elles pourraient, en ce cas, devenir dangereuses.
"Telle est l'histoire ou la légende d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden où Ève, tentée par un serpent, a mangé du fruit de l'Arbre de la Connaissance. Adam en mangea aussi et tous deux s'aperçurent alors qu'ils étaient nus. Ayant ainsi acquis ce savoir interdit, ils furent chassés du Jardin d'Éden.
"Le Jardin d'Éden n'est évidemment que ce pays bienheureux de l'ignorance où l'on ne craint rien parce qu'on ne comprend rien, où l'on n'est, en fait, qu'un légume. Mais il existe une version plus ésotérique de cette histoire.
"L'homme et la femme ne sont pas qu'une simple masse de protoplasme, de chair collée à une charpente osseuse. L'homme est, ou peut être, beaucoup plus que cela. Ici, sur cette Terre, nous ne sommes que les pantins de notre Moi supérieur, ce Moi supérieur qui réside provisoirement dans l'astral et qui acquiert de l'expérience grâce au corps de chair, lequel est le pantin, l'instrument de l'astral.
"Les physiologistes, et d'autres, ont disséqué le corps humain et l'ont réduit à une masse de chair et d'os. Ils peuvent parler de tel ou tel organe, mais ce n'est là que matière. Ils n'ont pas découvert et ils n'ont pas cherché à découvrir les choses secrètes, les choses intangibles que les Indiens, les Chinois et les Tibétains ont sues des siècles avant la Chrétienté.
"L'épine dorsale est une structure extrêmement importante. Elle abrite le cordon médullaire sans lequel on est paralysé, sans lequel l'être humain ne sert à rien. Mais l'épine dorsale joue un rôle encore plus important. Au centre même du nerf spinal, le cordon médullaire est un tube qui s'étend à une autre dimension. C'est un tube sur lequel la force appelée Kundalini peut se déplacer lorsqu'elle est éveillée. À la base de l'épine, se trouve ce que les Orientaux appellent le Feu-Serpent. C'est le siège même de la Vie.
"Chez la plupart des Occidentaux, cette grande force est dormante, assoupie, presque paralysée à force de demeurer inemployée. Elle ressemble en fait à un serpent enroulé à la base de l'épine dorsale, un serpent doué d'un pouvoir immense, mais qui, pour diverses raisons, ne peut échapper provisoirement à sa prison. Cette image mystique du serpent est connue sous le nom de Kundalini, et chez les Orientaux évolués, cette force peut s'élever par le canal du nerf spinal ; elle peut s'élever jusqu'au cerveau et au-delà, jusqu'à l'astral. En s'élevant, elle active chacun des ‘chakras’, ou centres de pouvoir, tels que l'ombilic, la gorge et autres parties vitales. Quand ces centres sont éveillés, l'être humain se charge de vitalité, de puissance, il peut dominer les autres.
"Si l'on est parfaitement maître de la force-serpent, on peut réussir à peu près n'importe quoi. On peut déplacer des montagnes ou marcher sur les eaux, on peut léviter ou se laisser enfermer dans une chambre scellée d'où l'on ressortira vivant après n'importe quel laps de temps.
"La légende nous dit qu'Ève a été tentée par un serpent. En d'autres termes, d'une façon ou d'une autre, Ève a entendu parler de la Kundalini. Elle a pu libérer la force-serpent enroulée à la base de son épine dorsale ; la force s'est propagée le long de la colonne médullaire, a réveillé le cerveau d'Ève, lui a ouvert les portes de la connaissance. C'est pourquoi il peut être dit dans l'histoire qu'elle a mangé de l'Arbre de la Science, ou du fruit de cet arbre. Possédant cette science, elle pouvait voir l'Aura d'Adam, deviner ses pensées et ses intentions, et Adam venant d'être tenté par Ève, sa Kundalini s'éveilla à son tour et il put la voir telle qu'elle était.
"La vérité est que chacun contempla l'Aura de l'autre. Chacun vit, nue, la forme astrale de l'autre, la forme non revêtue du corps humain ; chacun vit toutes les pensées, les désirs, les connaissances de l'autre, chose qui n'aurait pas dû se produire au stade d'évolution d'Adam et d'Ève.
"Les prêtres de l'Antiquité savaient que dans certaines conditions l'Aura devenait visible et que la Kundalini pouvait être éveillée par l'expérience sexuelle. Donc, dans l'ancien temps, les prêtres enseignèrent que la sexualité était un péché, et la racine de tout mal, et que, parce qu'Ève avait tenté Adam, la sexualité avait causé la chute de l'humanité. S'ils enseignèrent cela, c'est parce que, ainsi que je l'ai dit, l'expérience sexuelle peut quelquefois éveiller la Kundalini qui demeure assoupie à la base de l'épine dorsale chez la plupart des gens.
"La force Kundalini est enroulée très bas sur elle-même, comme un ressort d'horloge ; c'est une force fantastique. Et, comme un ressort, elle peut être dangereuse quand elle se détend brusquement. Cette force particulière est située à la base de l'épine dorsale, en fait, elle se trouve partiellement à l'intérieur des organes génitaux. Les peuples de l'Orient le savent : certains Hindous font appel au sexe dans leurs cérémonies religieuses. Ils ont recours à une forme différente de manifestation sexuelle, et à une position sexuelle différente afin d'obtenir des résultats précis, et ils les obtiennent effectivement. Il y a des siècles et des siècles, les anciens adoraient le sexe. Ils pratiquaient le culte phallique. Certaines cérémonies dans les temples éveillaient la Kundalini qui donnait la clairvoyance, la télépathie et bien d'autres pouvoirs ésotériques.
"Le sexe, employé de façon appropriée et d'une certaine manière dans l'acte d'amour, peut augmenter les vibrations d'un individu. Il peut faire ouvrir ce que les Orientaux appellent la Fleur de Lotus. Il peut permettre d'embrasser le monde de l'esprit. Il peut faire jaillir la Kundalini et éveiller certains centres. Mais il ne faut jamais abuser du sexe et de la Kundalini. L'un devrait être le complément et le supplément de l'autre. Les religions qui s'opposent aux rapports sexuels entre mari et femme commettent une erreur funeste. Cette attitude est souvent préconisée par les sectes les plus discutables du Christianisme. Les Catholiques Romains sont plus près de la vérité puisqu'ils conseillent au couple d'avoir des rapports sexuels, mais ils le conseillent sans savoir pourquoi, estimant que le but en est simplement la procréation des enfants, ce qui n'est pas la raison d'être essentielle du sexe, contrairement à ce que croient la plupart des gens.
"Les religions qui condamnent les rapports sexuels cherchent à freiner l'évolution individuelle et l'évolution de la race. Voici comment opère le phénomène : dans le magnétisme, on obtient un aimant puissant en plaçant les molécules de la substance dans une certaine direction. Normalement, dans un morceau de fer, par exemple, toutes les molécules prennent n'importe quelle direction, comme une foule indisciplinée. Elles sont disposées au hasard, mais lorsqu'on leur applique une certaine force (force magnétisante, dans le cas du fer) toutes les molécules prennent une seule direction, et l'on obtient le grand pouvoir magnétique sans lequel il n'y aurait ni radio, ni électricité, ni transports par routes ou par voies ferrées, ni voyages aériens.
"Dans l'être humain, lorsque la Kundalini est éveillée, lorsque le Feu-Serpent s'anime, les molécules du corps se disposent toutes dans une même direction, car la force Kundalini, en s'éveillant, a attiré les molécules dans ce sens. Alors, le corps humain rayonne de vitalité et de santé, il accroît puissamment son savoir, il peut tout voir.
"Diverses méthodes permettent d'éveiller complètement la Kundalini, mais elles ne doivent être appliquées que chez les êtres suffisamment évolués parce que cet éveil complet donne un immense pouvoir sur les autres et que l'on pourrait abuser de ce pouvoir, l'utiliser à des fins néfastes. Mais la Kundalini peut être partiellement stimulée et peut vivifier certains centres, grâce à l'acte d'amour unissant le mari et la femme. Dans la véritable extase de l'étreinte, les molécules du corps sont disposées de telle sorte qu'un grand nombre sont tournées vers une seule direction et que les êtres acquièrent un grand pouvoir magnétique.
"Lorsque l'on aura supprimé toutes les fausses pudeurs et tous les enseignements erronés concernant la sexualité, l'Homme redeviendra un être supérieur, il sera de nouveau capable de voyager jusqu'aux étoiles."
Chapitre Cinq
La voiture continuait à rouler ; aucune route de montagne n'était capable d'arrêter ou de ralentir son élan. Mon passager était assis à côté de moi, silencieux, ne parlant que pour désigner, de temps à autre, un paysage d'une beauté particulièrement remarquable. Au moment où nous approchions de Martigny, il me dit :
— Un homme aussi perspicace que vous a dû deviner la vérité. Je suis un représentant du Gouvernement. Voulez-vous me faire le plaisir de dîner avec moi ?
— J'en serais ravi, monsieur, répondis-je. Je me proposais d'aller jusqu'à Aigle, mais au lieu de cela, je m'arrêterai dans cette ville.
Nous continuâmes notre route et grâce à ses indications, je stoppai devant un hôtel d'excellente apparence. On me prit ma valise, je conduisis la Mercedes au garage où je donnai mes instructions.
Le dîner fut un repas des plus agréables. Mon ex-passager, devenu mon hôte, ayant perdu toute sa méfiance à mon égard, se montra un brillant causeur et suivant le vieux précepte tibétain ‘Celui qui écoute en apprend davantage’, je le laissai parler. Il me raconta des histoires de douane et me parla d'une affaire récente, où l'on avait trouvé une quantité de narcotiques derrière les fausses parois d'une voiture luxueuse.
— Je suis un touriste ordinaire, dis-je, et s'il est une chose dont j'ai horreur, ce sont les drogues. Voulez-vous faire examiner ma voiture pour voir si elle ne dissimule rien ? Vous m'avez parlé d'un cas où la drogue avait été cachée dans la voiture à l'insu de son propriétaire.
J'insistai tant et si bien que la Mercedes fut amenée au commissariat local et laissée là jusqu'au matin pour qu'on pût l'examiner à loisir. Le lendemain, je fus accueilli à bras ouverts. Une fouille complète de la voiture n'y avait rien décelé de suspect. Je constatai que les policiers suisses étaient courtois et affables et tout prêts à rendre service aux touristes.
Je continuai mon chemin, seul avec mes pensées, me demandant ce que l'avenir me réservait. De nouvelles épreuves et de nouveaux ennuis, je le savais, car les Prophètes me les avaient prédits avec insistance. Derrière moi, dans le coffre à bagages, se trouvaient les valises d'un homme dont j'avais pris les papiers. Il n'avait plus de famille ; comme moi, il semblait avoir été seul au monde. Il avait possédé plusieurs ouvrages sur le génie maritime ; désormais ces ouvrages m'appartenaient. J'arrêtai la voiture et cherchai un des manuels. Tout en conduisant, je me récitai divers règlements qu'en tant que mécanicien de navire, j'aurais dû savoir. J'avais l'intention de me faire embaucher sur un navire d'une compagnie différente. Le Livret des Débarquements me montrerait quelles compagnies je devrais éviter pour ne pas être repéré.
Les milles (km) défilaient. Aigle, Lausanne, la frontière allemande. Les Douaniers allemands, très méthodiques, vérifièrent jusqu'au moteur et aux numéros des pneus. Ils étaient totalement dénués d'humour et d'affabilité.
Je continuai ma route. À Karlsruhe, je me rendis à l'adresse qu'on m'avait indiquée. On me dit que l'homme que je devais voir était à Ludwigshafen. Je partis donc pour Ludwigshafen, où, dans le meilleur hôtel de la ville, je retrouvai l'Américain.
— Ah ! mon vieux, me dit-il, je n'aurais pas pu conduire cette voiture sur des routes de montagne, mes nerfs sont en mauvais état. Je bois trop, je suppose. Je le ‘supposais’ aussi. Sa chambre d'hôtel ressemblait à un bar remarquablement bien équipé. Il n'y manquait même pas la barmaid. Celle-ci avait encore plus d'appas, et elle ne se privait pas plus de les exhiber, que la fille laissée en Italie. Elle n'avait que trois idées en tête : l'argent, la boisson et la bagatelle, dans cet ordre. L'Américain se montra très satisfait de l'état où je lui ramenais la voiture qui n'avait pas une égratignure et qui était parfaitement propre. Il me prouva sa satisfaction par le don d'un nombre appréciable de dollars.
Je travaillai trois mois pour lui, conduisant d'immenses camions jusqu'à diverses villes, et ramenant des voitures qui devaient être réparées ou reconstruites. J'ignorais au juste en quoi consistait ce trafic. Je l'ignore encore aujourd'hui, mais j'étais bien payé et j'avais le temps d'étudier mes livres sur le génie maritime. Dans les villes où je passais, j'allais voir les musées de la Marine et j'étudiais soigneusement tous les modèles de navires et de moteurs de navires.
Trois mois plus tard, l'Américain vint me trouver dans la petite chambre minable que j'avais louée et il se laissa tomber sur mon lit, empestant la pièce de son cigare.
— Bon sang, mon vieux, me dit-il, vous n'avez pas des goûts de luxe ! Une cellule de prison, aux États-Unis, est plus confortable que votre piaule. J'ai un boulot pour vous, un boulot sérieux. Vous le prenez ?
— Oui, s'il me rapproche de la mer, s'il me conduit au Havre ou à Cherbourg.
— Eh bien, il vous emmènera jusqu'à Verdun et il est tout à fait régulier. J'ai là une machine qui a plus de roues qu'une chenille n'a de pattes. Un truc invraisemblable à conduire, mais qui peut rapporter gros.
— Donnez-moi des détails, répondis-je. Je vous ai dit que je pouvais conduire n'importe quoi. Avez-vous les papiers nécessaires pour faire entrer ça en France ?
— Ouais. Je les ai attendus trois mois. Nous vous avons fait travailler dur, et vous avez gagné de l'argent de poche. Tout de même, je n'aurais jamais cru que vous habitiez un taudis pareil.
Il se leva et me fit signe de le suivre. Devant la maison se trouvait sa voiture, avec la petite amie dedans.
— Conduisez, me dit-il en montant s'asseoir près de la fille. Je vais vous indiquer le chemin.
Arrivés devant ce qui me parut être un aérodrome désaffecté, aux environs de Ludwigshafen, il me dit d'arrêter. Là, dans un immense hangar, j'aperçus la machine la plus étrange que j'eusse jamais vue. Elle semblait être surtout composée de poutrelles jaunes, prenant appui sur toute une série de roues de huit pieds (2,4 m) de diamètre. Ridiculement haut perchée, il y avait une petite cage vitrée. Au dos de l'engin étaient fixés des croisillons et une énorme pelle d'acier. Je grimpai précautionneusement jusqu'au siège.
— Hé, hurla l'Américain, vous ne voulez pas le manuel ? Il me tendit une brochure explicative. J'avais un type, me dit-il, qui allait livrer une balayeuse des rues, une machine toute neuve. Il n'a pas voulu lire le bouquin et quand il est arrivé à destination, il s'est aperçu que les brosses avaient fonctionné tout le temps et qu'elles étaient déjà usées. Je ne veux pas que vous esquintiez la route d'ici à Verdun !
Je feuilletai un moment la brochure et bientôt, je mis le moteur en marche. Il rugissait comme un avion au moment du décollage. J'embrayai avec précaution et la gigantesque machine sortit du hangar et gagna ce qui avait été jadis une piste d'atterrissage. Je fis plusieurs fois l'aller et retour, afin de me familiariser avec le fonctionnement de l'engin et au moment où je tournai pour revenir au hangar, une voiture de la police allemande surgit. Un policier en sortit, une espèce de brute qui venait sans doute de rendre son insigne de la Gestapo.
— Vous conduisez ça sans être accompagné par un aide ? aboya-t-il. "Un aide ? songeai-je, croit-il que j'aie besoin d'un Gardien ?" Je conduisis l'appareil jusqu'à sa voiture.
— Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ? criai-je. Ici c'est une propriété privée. Allez-vous-en !
À ma grande surprise, c'est ce qu'il fit ! Il monta dans sa voiture et s'arrêta juste à la sortie du terrain.
L'Américain se dirigea vers lui.
— Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ? demanda-t-il.
— Je suis venu vous dire que cette machine ne peut circuler sur la route que s'il y a à l'arrière un homme pour surveiller les voitures qui veulent doubler. Elle ne peut rouler que la nuit, à moins que vous n'ayez une voiture de police devant et une derrière.
Je crus un moment qu'il allait conclure par "Heil Hitler !", mais il tourna les talons, remonta en voiture et s'éloigna.
— Bon sang, dit l'Américain, c'est encore plus fort qu'un combat de coqs. Ça c'est sûr ! Je connais un Allemand nommé Ludwig qui...
— Non, non, m'exclamai-je. Je ne veux pas d'un Allemand ! Ils sont trop guindés pour moi.
— O.K., O.K., vieux, pas de Fritz. Vous énervez pas. Je connais un Français qui vous plaira : Marcel. Venez, on va aller le chercher.
Je rangeai la machine au hangar, m'assurai que tout y était bien fermé, puis je sautai à terre et refermai la porte.
— Vous vous épatez donc jamais de rien ? dit l'Américain. Vaudrait mieux que vous preniez le volant.
Il nous fallut happer Marcel dans un bar. À première vue, je crus qu'un cheval lui avait piétiné la figure. Puis, je me dis qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il ait été piétiné par un cheval. Marcel était laid. Effroyablement laid, mais il y avait quelque chose en lui qui me le rendit sympathique. Assis dans la voiture nous débattîmes des conditions pendant un certain temps, puis je retournai conduire la machine afin de me familiariser avec son fonctionnement. Comme je faisais le tour de la piste, je vis arriver une vieille guimbarde. Marcel en sortit, agitant frénétiquement la main. Je fis halte près de lui.
— Je l'ai, je l'ai, s'écria-t-il, tout excité. Sans cesser de gesticuler, il se tourna vers sa voiture, et faillit se fracturer le crâne sur la portière basse. Tout en se frottant la tête et en murmurant de terribles imprécations contre les fabricants de petites voitures, il tira un gros paquet de la banquette arrière.
— Un intercom, hurla-t-il. (Il hurlait toujours, même quand il se trouvait à deux pas de vous.) L'intercom, on peut parler, hein ? Vous là, moi ici, un fil entre nous deux, on se parle tout le temps ? D'accord ? (Sans cesser de crier à tue-tête, il bondit jusqu'à l'excavatrice, traînant du fil de cuivre tout autour de lui.) Vous voulez l'écouteur, non ? rugit-il. Vous m'entendriez mieux. Moi, j'ai le micro.
Étant donné le vacarme qu'il faisait, j'étais persuadé qu'aucun intercom n'était nécessaire. Sa voix couvrait largement le vrombissement du moteur, si puissant fût-il.
Je continuai à conduire l'engin, m'exerçant à prendre des tournants afin de m'y habituer. Marcel caracolait et bavardait de l'avant à l'arrière de la machine, enroulant les fils autour des poutrelles. En arrivant à mon ‘poste de commandement’, il passa un bras par la fenêtre ouverte, me frappa sur l'épaule et beugla :
— L'écouteur, vous l'avez mis, oui ? Vous entendez bien mieux. Attendez, je reviens ! (Il longea de nouveau les poutrelles, s'affala sur son siège à l'autre extrémité de la machine et cria dans le micro :) Vous entendez bien ? Oui ? je viens ! (Dans son enthousiasme, il avait oublié que moi aussi j'avais un micro. Avant même que je n'eusse le temps de reprendre mes esprits, il était de retour et tambourinait à ma vitre :) Ça va ? Vous entendez bien ?
— Écoutez, dit l'Américain, vous partirez ce soir tous les deux. Tous les papiers sont là. Marcel saura comment vous emmener jusqu'à Paris, et vous faire gagner quelques francs en route. J'ai été très heureux de faire votre connaissance.
Sur ce, il s'éloigna et je ne le revis plus. Peut-être lira-t-il ces lignes et se mettra-t-il en rapport avec moi par l'intermédiaire de mes éditeurs. Je revins à ma chambre solitaire, Marcel disparut dans un bar. Je dormis pendant le reste de la journée.
À la tombée de la nuit, je dînai et pris un taxi jusqu'au hangar. J'installai mes bagages, réduits maintenant au strict minimum, derrière mon siège. Le moteur tournait, les pressions étaient satisfaisantes. Le réservoir d'essence était plein, les feux fonctionnaient normalement. Je sortis la machine du hangar et lui fis faire le tour de la piste pour la réchauffer. La lune montait toujours plus haut dans le ciel. Marcel n'apparaissait pas. J'arrêtai le moteur, descendis de mon perchoir et marchai de long en large. Enfin une voiture traversa le champ et Marcel en sortit.
— Une petite réunion, rugit-il, une réunion d'adieu. On y va ?
Dégoûté, je remis le moteur en marche, allumai les phares puissants et engageai la voiture sur la route. Marcel criait tellement que je laissai pendre les écouteurs autour de mon cou et cessai de m'occuper de lui. À quelques milles (km) de là, une voiture de police allemande fit halte devant moi.
— Votre surveillant est endormi. Vous enfreignez le règlement en conduisant sans qu'un homme fasse le guet à l'arrière.
Marcel bondit :
— Moi, je dors ? Vous y voyez mal, monsieur l'Agent. Sous prétexte que je suis confortablement installé, vous faites du zèle !
Le policier s'approcha de moi et renifla soigneusement mon haleine.
— Non, c'est un saint, dit Marcel. Il ne touche pas à la dive bouteille, pas plus qu'aux femmes, ajouta-t-il après réflexion.
— Vos papiers ! dit le policier. (Il les examina avec attention, cherchant un prétexte pour nous causer des ennuis. Puis il vit mon livret de mécanicien.) Ainsi, vous êtes américain ? Eh bien, nous ne voulons pas avoir d'histoires avec votre consul. Partez !
Repoussant les papiers comme s'ils eussent été contaminés, il remonta dans sa voiture qui s'éloigna. Je dis à Marcel ma façon de penser, le renvoyai à son poste et nous continuâmes notre voyage dans la nuit. Nous ne devions pas dépasser vingt milles (32 km) à l'heure et les soixante-dix milles (112 km) qui nous séparaient de la frontière française me parurent interminables. Peu avant Sarrebruck, j'arrêtai le véhicule, le rangeai sur le bas-côté de la route pour ne pas gêner la circulation, et me préparai à passer la journée en ville. Après avoir déjeuné, je me rendis au Commissariat local pour obtenir l'autorisation de passer la frontière. Encadrés, à l'avant et à l'arrière, par des motards, nous suivîmes des routes latérales jusqu'au poste de douane.
Marcel était dans son élément quand il avait affaire à des compatriotes. Je crus comprendre que lui et l'un des Douaniers qu'il avait rencontré dans ‘la Résistance’ avaient à eux deux, ou presque, gagné la guerre. Une fois mes papiers en règle, nous fûmes autorisés à entrer en territoire français. Le Douanier que connaissait Marcel l'emmena pour la journée ; moi, je m'étendis près des poutrelles de la machine et m'endormis.
Tard, très tard, Marcel revint entre deux policiers français. Ils m'adressèrent un clin d'œil et l'attachèrent à son siège — il dormait comme un bienheureux — puis me firent gaiement signe de continuer mon chemin. J'avançais dans les ténèbres, une puissante machine sous les pieds, un ‘guetteur’ soûl derrière moi. Je craignais sans arrêt de voir surgir une voiture de police. L'une d'elles s'approcha effectivement, un agent se pencha à la portière, eut un geste de dérision à l'égard de Marcel, m'adressa un adieu amical... et poursuivit son chemin à toute allure.
Ayant laissé Metz loin derrière moi et n'entendant rien de Marcel, j'arrêtai la voiture sur le bord de la route, en descendis et allai voir en quel état se trouvait mon compagnon. Il dormait profondément. Rien ne l'aurait réveillé, aussi remontai-je au volant. L'aube pointait lorsque je traversai les rues de Verdun pour gagner le parking qui était ma destination.
— Lobsang, cria au fond du véhicule, une voix ensommeillée, si tu ne te décides pas à partir, nous serons en retard.
— En retard, dis-je, nous sommes à Verdun !
Il y eut un silence de mort. Puis Marcel s'exclama :
— À Verdun ?
— Écoute, Marcel, lui dis-je, on t'a ramené complètement soûl, on t'a attaché à ton siège, j'ai dû faire tout le travail et trouver le chemin seul. Maintenant, secoue-toi et va me chercher à déjeuner. Trotte !
Marcel, l'oreille basse, s'éloigna d'un pas mal assuré et me rapporta bientôt de quoi manger.
Cinq heures plus tard, un homme robuste et basané arriva dans une vieille Renault. Sans nous adresser la parole, il fit le tour de l'excavatrice, l'examinant soigneusement dans l'espoir d'y trouver une égratignure, ou n'importe quoi qui lui eût fourni prétexte à se plaindre. Ses sourcils épais se rejoignaient au-dessus de son nez, un nez qui avait été plusieurs fois brisé et à un moment donné mal opéré. Enfin, il s'approcha de nous.
— Lequel de vous deux est le chauffeur ? demanda-t-il.
— Moi, dis-je.
— Vous allez ramener ça à Metz.
— Non, répondis-je, on m'a payé pour l'amener ici. Tous les papiers sont faits pour Verdun. Je ne m'occupe plus de cette machine.
Son visage s'empourpra de rage et, à ma consternation, je le vis tirer de sa poche un couteau à cran d'arrêt. Je le désarmai aisément, le couteau vola par-dessus mon épaule et l'homme s'étala sur le dos. À ma surprise, je vis, en jetant un regard autour de moi, que tout un groupe d'ouvriers avait observé la scène.
— Il a flanqué le Patron à terre, dit l'un.
— Il a dû l'attaquer par surprise, dit l'autre.
L'homme basané se releva vivement, souple comme une balle de caoutchouc, et se précipitant dans l'atelier, il en revint avec une barre de fer munie d'un crochet au bout, le genre de barre qui sert à ouvrir des caisses d'emballage. Hurlant des insultes, il se rua sur moi et s'efforça de m'ouvrir la gorge. Je tombai à genoux, lui agrippai les genoux et poussai. Il tomba avec un cri horrible, la jambe gauche brisée. La barre de fer roula de sa main inerte et alla heurter, quelque part, un objet métallique.
— Eh bien, Patron, dis-je en me redressant, vous n'êtes pas mon Patron à moi, hein ? Maintenant faites-moi des excuses, sinon je vais vous esquinter encore davantage ; vous avez cherché à me tuer.
— Allez me chercher un docteur, allez me chercher un docteur, gémit-il. Je vais mourir !
— Faites-moi d'abord vos excuses, dis-je d'un ton rogue, sinon c'est un fossoyeur qu'il vous faudra.
— Qu'est-ce qui se passe ici ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ?
Deux agents de police français se frayèrent un passage à travers l'assistance, regardèrent ‘le Patron’ étalé sur le sol, et s'esclaffèrent bruyamment.
— Ah ! ah ! s'écria l'un d'eux, enfin il a trouvé plus fort que lui ! Voilà qui nous console de tous les embêtements qu'il nous a causés.
Les policiers me considérèrent avec respect, puis demandèrent à voir mes papiers. Satisfaits sur ce point et ayant entendu les rapports des témoins, ils tournèrent les talons et s'éloignèrent. L'ex-Patron me fit des excuses, avec des larmes de honte dans les yeux : je m'agenouillai près de lui, remis l'os en place et fixai deux planches en guise d'éclisses. Marcel avait disparu, ayant craint sans doute de s'attirer des ennuis. Je ne le revis jamais.
Mes deux valises étaient lourdes. Les enlevant de l'excavatrice, je me mis à marcher le long des rues. Une nouvelle étape de mon voyage venait de se terminer. Je n'avais pas de situation et je ne connaissais personne. Marcel s'était révélé un incapable, au cerveau saturé d'alcool. Verdun ne m'attirait nullement. J'arrêtai plusieurs passants pour leur demander le chemin de la gare, où je voulais laisser mes valises. Tout le monde semblait penser que j'aurais dû aller voir les champs de bataille plutôt que la gare, mais je finis tout de même par en connaître la direction. Je pris la rue Poincaré, me reposant de temps à autre et me demandant ce que je pourrais bien jeter pour alléger mes bagages. Des livres ? Non, il fallait les garder soigneusement. Les uniformes de la marine marchande ? Certainement pas ! Je finis par conclure à regret que je ne transportais que l'indispensable. Arrivé, non sans efforts, jusqu'à la Place Chevert, je tournai à droite et atteignis le Quai de la République. Je contemplai le mouvement des bateaux sur la Meuse et décidai de m'asseoir un moment. Une grosse Citroën glissa silencieusement le long du trottoir, ralentit et s'arrêta près de moi. Un homme de haute taille, aux cheveux bruns, me regarda un instant et sortit de la voiture.
— Êtes-vous l'homme que nous devons remercier pour avoir infligé une correction au ‘Patron’ ? questionna-t-il.
— Oui, répondis-je. Est-ce que ça ne lui a pas suffi ? L'inconnu se mit à rire et reprit :
— Pendant des années, il a terrorisé le district, la police elle-même avait peur de lui. Il affirme s'être conduit en héros pendant la guerre. À présent, voulez-vous un emploi ?
Je considérai attentivement mon interlocuteur avant de répondre.
— Oui, s'il s'agit d'un travail honnête.
— Le travail que je vous offre est tout ce qu'il y a de plus honnête.
Il se tut un moment et me sourit :
— Vous comprenez, je sais beaucoup de choses sur votre compte. Marcel devait vous conduire jusqu'à moi, mais il a pris la fuite. Je sais que vous avez traversé la Russie, que vous avez fait de nombreux autres voyages. Marcel m'a donné une lettre de ‘l'Américain’ à votre sujet, mais il m'a laissé en plan, moi aussi !
"Quel curieux réseau", me dis-je. Toutefois, les Européens ne faisaient rien comme nous autres, Orientaux.
L'homme me dit :
— Mettez vos valises dans la voiture ; je vais vous emmener déjeuner, comme ça nous pourrons bavarder un peu.
Cette proposition me plut. Enfin, je pourrais me débarrasser un moment de ces horribles valises. Je les plaçai dans le coffre à bagages et m'assis près de l'inconnu. Il nous conduisit au meilleur hôtel, le Coq Hardi, dont il était apparemment un familier. Après s'être exclamé plusieurs fois devant la modestie de mes exigences en matière de rafraîchissements, il en arriva au fait.
— Je connais deux vieilles dames, l'une de quatre-vingt-quatre ans, l'autre de soixante-dix-neuf, me dit-il, après avoir jeté un regard autour de lui. Elles voudraient se rendre auprès du fils de l'une d'elles, qui habite Paris. Elles ont peur des bandits — les vieilles gens ont parfois de ces craintes et elles ont subi deux guerres — et elles voudraient un chauffeur capable de les protéger. Elles paieraient bien.
Des femmes ? De vieilles femmes ? "Cela valait mieux que des jeunes", me dis-je. Toutefois, la proposition ne m'enchantait pas. Puis je songeai à mes deux lourdes valises. Et comment irais-je jusqu'à Paris ?
— Elles sont très généreuses, reprit mon compagnon. Il n'y aurait qu'un seul inconvénient, il ne faudrait pas dépasser trente-cinq milles à l'heure (56 km).
Je jetai prudemment à mon tour un regard sur la salle. Deux vieilles dames ! Assises, trois tables plus loin.
"Par la Dent Sacrée du Bouddha, me dis-je, à quoi en suis-je réduit ?" La vision de mes valises passa devant mes yeux, deux lourdes valises que je ne pouvais pas alléger. Et l'argent ! Plus j'en aurais, mieux je vivrais aux États-Unis, tout en me cherchant du travail. Je poussai un soupir :
— Elles sont généreuses, m'avez-vous dit ? Mais la voiture ? Je ne veux pas revenir ici.
— Oui, mon ami, elles vous paieraient fort bien. La Comtesse est riche. Quant à la voiture, c'est une Fiat neuve dont elle veut faire cadeau à son fils. Venez, je vais vous présenter.
Il se leva et se dirigea vers les deux vieilles dames. S'inclinant si bas que j'évoquai irrésistiblement les pèlerins sur la Voie Sacrée de Lhassa, il fit les présentations. La Comtesse me regarda d'un œil hautain, à travers son face-à-main.
— Ainsi vous vous croyez capable de nous conduire sans encombre à destination, mon brave ?
Je la toisai à mon tour et répondis :
— Madame, je ne suis pas votre ‘brave’. Quant à vous conduire sans encombre, ma vie m'est aussi précieuse que la vôtre. On m'a demandé de discuter cette affaire avec vous, mais j'avoue qu'à présent, j'ai des doutes.
Pendant un long moment, elle me fixa d'un regard glacé, puis ses mâchoires rigides se détendirent et elle éclata d'un rire de petite fille.
— Ah, s'exclama-t-elle, j'aime les gens qui ne se laissent pas faire. C'est si rare en cette époque difficile. Quand partons-nous ?
— Nous n'avons pas encore discuté les conditions de notre accord, et je n'ai pas encore vu la voiture. Quand voulez-vous partir, au cas où j'accepterais votre proposition ? Et pourquoi voulez-vous de moi comme chauffeur ? Il y a certainement bon nombre de Français qui accepteraient de vous conduire ?
Le prix qu'elle offrait était généreux, et les raisons qu'elle donnait étaient valables.
— Je préfère un homme hardi, un homme qui n'a peur de rien, qui a voyagé et qui connaît la vie. Nous partirons dès que vous serez prêt.
Deux jours plus tard, nous quittions la ville dans une Fiat de luxe. Nous prîmes la direction de Reims, à quatre-vingts milles (128 km) de là, et y passâmes la nuit. Conduire à trente-cinq milles (56 km) à l'heure me donna le temps de voir le paysage et de réfléchir un peu, ce dont les événements ne m'avaient guère laissé le temps. Le lendemain, nous partîmes à midi et arrivâmes à Paris à l'heure du thé. Je laissai la voiture dans le garage du fils de la Comtesse, qui habitait la banlieue parisienne, puis je repartis, mes valises à la main. Cette nuit-là, je dormis dans une médiocre pension de famille et, le lendemain, je cherchai le moyen de gagner Cherbourg ou Le Havre.
Je commençai par rendre visite aux marchands d'automobiles. Quelqu'un voulait-il faire conduire une voiture à Cherbourg ou au Havre ? Je parcourus ainsi des milles (km), mais personne n'avait besoin de mes services. À la fin de la journée, je retournai à ma pension de famille ; là, je fus témoin d'un accident. Un homme était transporté dans la maison par un agent de police et un autre pensionnaire. Une bicyclette, dont la roue avant était complètement esquintée, gisait sur le bord de la route. L'homme, qui revenait de son travail, avait jeté un coup d'œil derrière lui, sa roue avant s'était prise dans un caniveau et lui avait été projeté par-dessus le guidon. Il s'était foulé la cheville droite.
— Je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi, gémissait-il. Il fallait que j'aille livrer des meubles à Caen demain.
— Caen ?
Le nom m'était vaguement familier. Caen ? Je le cherchai sur la carte. Une ville à environ cent vingt-cinq milles (201 km) de Paris, sur la route de Cherbourg et à environ soixante-quinze milles (120 km) de cette dernière. Je réfléchis à la question et allai trouver le blessé.
— Je voudrais aller à Cherbourg ou au Havre, lui dis-je. Je prendrai votre camion et je livrerai les meubles si quelqu'un peut ramener la voiture. Je vous laisserai l'argent. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller là-bas en voiture.
Il me regarda avec gratitude :
— Oui, c'est possible, mon copain conduit ; nous devons emporter le mobilier d'une grande maison d'ici, le transporter à Caen et le décharger.
Tout fut promptement arrangé. Le lendemain, j'allais être promu aide-déménageur, à titre gracieux.
Henri, le chauffeur, aurait eu droit à un certificat pour ‘incapacité notoire’. Il n'excellait qu'en une chose : l'art de se défiler quand il s'agissait de travailler. Dès que la maison fut hors de vue, il arrêta le camion et me dit :
— Prends le volant, je suis fatigué.
Et descendant de son siège, il alla se percher sur le meuble le plus confortable qu'il put trouver et s'endormit. Je pris donc le volant.
À Caen, il me déclara :
— Commence à décharger, il faut que j'aille faire signer des papiers.
Quand il revint, tout se trouvait déjà à l'intérieur de la maison, sauf les meubles trop lourds pour un seul homme. Disparaissant de nouveau, il revint en compagnie du jardinier qui m'aida à les porter dans la maison. Il nous ‘dirigea’, afin que nous n'abîmions pas les murs. Une fois le travail terminé, je remontai au volant. Henri, sans réfléchir, s'assit à côté de moi. Alors je pris la direction de la gare que j'avais remarquée en chemin. Là, je m'arrêtai, attrapai mes deux valises et déclarai à Henri :
— Maintenant, c'est toi qui vas conduire.
Sur ce, je descendis du camion et entrai dans la gare.
Un train partait pour Cherbourg, vingt minutes plus tard. J'achetai un billet ainsi que quelques vivres, et montai dans le wagon juste avant le départ. Arrivé en gare de Cherbourg, je laissai mes valises à la consigne et errai sur le Quai de l'Entrepôt, à la recherche d'un gîte. Je le trouvai enfin dans une pension pour marins. J'y louai une chambre très modeste que je payai d'avance et allai rechercher mes bagages. Puis, étant fatigué, je me couchai et m'endormis.
Le lendemain matin, je me mêlai aux autres marins qui attendaient un embarquement. Par chance, je pus, au cours des jours suivants, visiter les salles des machines de navires amarrés dans le Port. Pendant la semaine, je hantai les Agences Maritimes dans l'espoir d'y trouver un travail qui me conduirait outre-Atlantique. Les Agents regardaient mes papiers, examinaient mon Livret de Débarquement et demandaient :
— Alors, vous avez dépensé tout votre argent en vacances ? Et vous voulez faire l'aller simple ? Bien, nous prenons note et nous vous préviendrons, le cas échéant.
Je me mêlai de plus en plus aux marins, apprenant leur vocabulaire, étudiant leurs personnalités. Et je me rendis surtout compte que moins on en disait, plus on écoutait, et plus on passait pour un homme intelligent.
Enfin, dix jours plus tard, je fus convoqué à une Agence Maritime. Un petit homme trapu était assis près de l'Agent.
— Seriez-vous disposé à partir ce soir, si besoin était ? me demanda-t-il.
— Je peux partir tout de suite, monsieur, répondis-je.
Le petit homme me considérait avec attention. Puis il lança un flot de questions que j'eus du mal à comprendre, à cause de son accent. L'Agent traduisit :
— Le Chef ici présent est Écossais, son Troisième Mécanicien est tombé malade, il a dû être transporté à l'hôpital. Il veut que vous montiez immédiatement à bord avec lui.
Non sans peine, je parvins à comprendre le reste du discours de l'Écossais et je pus répondre à ses questions de façon satisfaisante.
— Prenez vos valises et embarquez, me dit-il enfin.
De retour à la pension, je payai rapidement ma note, empoignai mes valises et pris un taxi jusqu'au navire. C'était un vieux rafiot, délabré, couvert de rouille, qui aurait eu grand besoin d'une couche de peinture et qui me parut bien petit pour traverser l'Atlantique.
— Ouais, me dit un homme qui se trouvait sur le quai, il est plus tout jeune à ce que vous pouvez voir et quand la mer est grosse, y vous secoue à vous faire cracher les boyaux !
Je grimpai vivement la passerelle, laissai mes valises près de la cuisine et descendis l'échelle de fer menant à la salle des machines où le Chef Mac attendait. Il me posa des questions sur les machines et parut satisfait de mes réponses.
— O.K., mon gars, conclut-il, on va signer l'engagement. Le Steward va vous montrer votre cabine.
Nous revînmes à l'Agence Maritime pour ‘signer l'Engagement’, et remontâmes à bord.
— Vous commencez tout de suite, mon gars, dit Mac. Et c'est ainsi que pour la première fois de l'Histoire, sans doute, un Lama tibétain, qui se faisait passer pour Américain, s'embarqua comme mécanicien. Les premières huit heures de travail, pendant lesquelles le navire resta à l'amarre, furent pour moi une bénédiction. Mes nombreuses lectures se complétaient à présent d'une expérience pratique et je me sentais capable de mener ma tâche à bien.
Au milieu du tintement des cloches et du sifflement bruyant de la vapeur, les pistons d'acier brillant s'élevaient et s'abaissaient. Les roues se mirent à tourner de plus en plus vite, le navire s'éveilla. Il y flottait une odeur d'huile chaude et de vapeur. C'était pour moi une atmosphère étrange, aussi étrange qu'aurait paru la vie d'un Lama au Chef Mac, qui se tenait maintenant debout, impassible, la pipe entre les dents, une main légèrement posée sur un volant d'acier étincelant.
La cloche sonna de nouveau et le cadran du télégraphe indiqua ‘demi-arrière’ ; Mac lui jeta un regard rapide, tourna la roue et donna une chiquenaude à un levier. Le grondement de la machine s'accentua et toute la coque se mit à trembler. ‘Stop !’ dit l'aiguille du cadran, ordre bientôt suivi par : ‘demi-avant !’ Mac avait eu à peine le temps de tourner sa roue, que la cloche retentissait de nouveau pour ‘en avant toute !’ Le navire s'ébranla doucement, Mac s'approcha de moi.
— Ah, mon gars, me dit-il, vous avez fait vos huit heures. Filez à présent, et réclamez en passant mon cacao au Steward.
Du cacao ! Cela me rappela que je n'avais pas mangé depuis plus de douze heures. Je grimpai vivement les échelles de fer et atteignis le pont, à l'air libre. L'écume se brisait sur la proue et le navire se mit à tanguer quelque peu en gagnant la haute mer. Derrière moi, les lumières de la côte française s'estompaient dans la nuit. Une voix coupante me rappela à la réalité.
— Qui êtes-vous, mon ami ?
Je me retournai : le Second se trouvait à mes côtés.
— Troisième Mécanicien, monsieur, répondis-je.
— Alors pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme ?
— Je suis mécanicien à titre temporaire, monsieur, j'ai embarqué à Cherbourg et pris mes fonctions immédiatement.
— Hum ! fit le Second. Mettez-vous tout de suite en uniforme, je veux qu'il y ait de la discipline à bord.
Ce disant, il s'éloigna comme s'il eût été Second sur un des vaisseaux de la Reine d'Angleterre et non sur un vieux rafiot crasseux et rouillé.
Arrivé à la porte de la cuisine, je transmis l'ordre du Chef Mac.
— C'est vous le nouveau Troisième ? demanda une voix derrière moi.
Je me retournai et aperçus le Mécanicien en Second.
— Oui, monsieur, répondis-je. Je vais aller me mettre en uniforme et puis je voudrais manger quelque chose.
Il inclina la tête :
— Je vais vous accompagner. Le Second vient de se plaindre que vous n'étiez pas en uniforme. Il vous prenait pour un passager clandestin. Je lui ai dit que vous veniez d'embarquer et que vous aviez pris votre service immédiatement.
Il fit quelques pas avec moi, et désigna ma cabine qui faisait face à la sienne :
— Appelez-moi quand vous serez prêt, me dit-il, nous dînerons ensemble.
Il fallut retoucher les uniformes pour les mettre à ma taille. Et vêtu à présent en Officier de la Marine Marchande, je me demandais ce que mon Guide le Lama Mingyar Dondup dirait s'il pouvait me voir. Je me mis à rire en pensant à la sensation que je ferais à Lhassa si j'apparaissais dans cette tenue. J'appelai le Mécanicien en Second et nous allâmes ensemble au Mess des Officiers pour dîner. Le Capitaine, déjà à table, nous jeta un regard réprobateur de dessous ses sourcils broussailleux.
— Pouah ! s'exclama le Mécanicien en Second, lorsqu'on lui apporta le premier plat, encore cette pâtée à cochons ! ne change-t-on jamais le menu ici ?
— Monsieur ! (La voix du Capitaine nous fit sursauter.) Monsieur, vous vous plaignez tout le temps. Changez donc de bateau quand nous arriverons à New York.
Quelqu'un gloussa, mais ce gloussement se transforma en une toux embarrassée, lorsque le Capitaine jeta un regard courroucé dans sa direction. Le repas se termina en silence jusqu'à la sortie du Capitaine, qui avait achevé avant nous.
— Foutu bateau ! dit l'un des officiers. Le vieux était Jimmy-The-One (Second) dans la Marine Britannique pendant la guerre. Il naviguait sur un cargo et il n'arrive pas à l'oublier.
— Ah, v's'êtes tous cinglés, toujours à rouspéter, dit une autre voix, dans le plus pur argot américain.
— Non, me murmura le Second, ce n'est pas un Américain, c'est un Porto-Ricain qui va trop souvent au cinéma.
J'étais las et je sortis sur le pont avant d'aller me coucher. Sous le vent, les hommes jetaient les cendres brûlantes à la mer et se débarrassaient de tous les détritus qu'accumule un navire pendant son séjour dans un port. Le navire ballottait un peu et je regagnai ma cabine. Les murs y étaient tapissés de photographies de pin up, que j'arrachai et jetai dans la corbeille à papiers. Tandis que je me déshabillais et me laissais tomber sur ma couchette, je songeai que je serais capable d'accomplir ma tâche de façon satisfaisante.
— Debout ! hurla une voix et une main ouvrit la porte et tourna le commutateur.
"Déjà ?" me dis-je. Il me semblait que je venais tout juste de m'endormir. Je jetai un coup d'œil à ma montre et me levai. Après m'être lavé et habillé, j'allai déjeuner. Le Mess était désert, je mangeai seul et rapidement. Jetant un coup d'œil aux premières lueurs de l'aube, je me hâtai de descendre l'échelle d'acier menant à la salle des machines.
— Vous êtes ponctuel, me dit le Second, ça me plaît. Rien à signaler sauf qu'il y a deux graisseurs dans le tunnel. Eh bien, je m'en vais, ajouta-t-il en bâillant copieusement.
Les machines continuaient à tourner à un rythme régulier et monotone et chaque révolution nous rapprochait de New York. Dans la chaufferie, les ‘gueules noires’ veillaient sur le feu en l'attisant à coups de ringard et gardant le volant de vapeur juste à la limite de la ligne rouge. Du tunnel abritant l'arbre de l'hélice émergèrent deux hommes couverts de sueur et de suie. Le sort m'était favorable, car les températures des coussinets étaient normales, il n'y avait rien à signaler. On me passa des papiers crasseux : consommation de charbon, pourcentage de CO2, et autres renseignements. Je les signai, m'assis et consignai dans le journal de bord les détails de ma veille.
— Comment ça marche, Mister ? me demanda Mac, qui venait de descendre l'escalier des cabines.
— Ça va, répondis-je, tout est normal.
— Bien, dit Mac. C'est ce... de Capitaine que je voudrais pouvoir rendre normal. Il dit que nous avons brûlé trop de charbon pendant le dernier voyage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Lui dire de prendre les rames ?
Il soupira, mit ses verres à monture d'acier, lut le journal et le signa.
Le navire continuait sa route à travers l'Atlantique rebelle. Les jours se suivaient, mornes et toujours semblables. Ce n'était pas un navire de plaisance. Les Officiers de Pont méprisaient les Officiers Mécaniciens. Le Capitaine était un homme morose qui s'imaginait commander un transatlantique au lieu d'un cargo délabré et poussif. Le temps lui-même était mauvais. Une nuit où je ne pouvais dormir tant le bâtiment tanguait et roulait, je montai sur le pont. Le vent hurlait à travers le gréement, lugubre comme un chant funèbre, et j'évoquai le soir où, sur le toit du Chakpori en compagnie du Lama Mingyar Dondup et de Jigme, j'avais entrepris ce grand voyage dans l'astral. A l'abri du vent, au milieu du navire, une silhouette solitaire s'agrippait désespérément au parapet, en proie à de terribles nausées qui lui ‘arrachaient le cœur’, comme plus tard il le dit lui-même. J'étais cuirassé contre le mal de mer ; cela m'amusait de voir des marins chevronnés en être victimes. La lumière de l'habitacle du pont jetait une très faible lueur. La cabine du Capitaine était plongée dans l'obscurité. L'écume se ruait à l'assaut de la proue et balayait le pont jusqu'où je me trouvais, à l'arrière du navire, qui roulait et ballottait, comme une bête folle ; ses mâts dessinaient dans le ciel des arcs de cercle démentiels. Au loin, un paquebot, étincelant de lumière, s'avançait dans notre direction, vrillant d'un mouvement qui devait être fort désagréable pour ses passagers. Avec le vent arrière, il filait bien et son énorme superstructure faisait office de voile. "Il sera bientôt arrivé à Southampton", songeai-je en tournant les talons pour redescendre.
Au plus fort de la tempête, l'une des prises des pompes de cale fut bloquée par un objet que le violent roulis du navire avait délogé. Je dus descendre dans la cale et surveiller les hommes qui s'efforçaient de rétablir la circulation de l'eau. Le bruit était effroyable. L'arbre de l'hélice vibrait parce que celle-ci tournoyait follement lorsque la poupe s'élevait dans l'air, ou trépidait lorsque la poupe plongeait dans l'eau, avant de rebondir sur la crête de la vague suivante.
Dans la cale, les hommes de pont s'escrimaient fébrilement à immobiliser une lourde caisse d'outils qui s'était désarrimée. Il me parut étrange qu'une atmosphère d'hostilité régnât sur ce navire ; nous accomplissions tous notre tâche de notre mieux. Quelle importance cela avait-il qu'un homme travaillât au milieu des mécaniques dans les entrailles du navire, pendant qu'un autre se promenait sur le pont ou se postait sur la Passerelle pour regarder l'eau glisser le long de la coque ?
Le travail ? Il n'en manquait pas ici. Il fallait réparer les pompes, recharger les boîtes à étoupe, inspecter et vérifier les bagues de presse-étoupe ainsi que les cordages des treuils, en prévision de l'arrivée à New York.
Le Chef, Mac, était un bon travailleur et un homme juste. Il aimait ses machines comme une mère aime son premier-né. Un après-midi, j'étais assis sur un caillebotis en attendant de prendre le quart. De légers nuages, annonciateurs de tempête, traversaient le ciel et il y avait de la pluie dans l'air. Je lisais, assis à l'abri d'un ventilateur. Soudain, une lourde main s'abattit sur mon épaule et une voix sonore, à l'accent écossais, s'exclama :
— Ah mon gars, je me demandais ce que vous faisiez pendant vos heures de loisir. Qu'est-ce que vous lisez ? Des histoires de cow-boys ? Des gaudrioles ?
En souriant, je lui passai le livre.
— Les moteurs de navire, lui dis-je. Ça m'intéresse davantage que les histoires de cow-boys... ou les gaudrioles !
Il poussa un grognement approbateur et après avoir jeté un coup d'œil sur le manuel, il me le rendit :
— C'est bien, mon garçon. On fera un mécanicien de vous et vous finirez par être Chef, si vous continuez comme ça. (Enfonçant sa vieille pipe dans sa bouche, il m'adressa un signe de tête amical et ajouta :) Vous pouvez prendre le quart, à présent, mon garçon.
C'était le branle-bas.
— Le Capitaine passe l'inspection, me murmura le Mécanicien en Second. Il est fou, il se croit sur un paquebot, il inspecte le bâtiment de fond en comble, cabines et tout le reste, à chaque traversée.
J'étais debout près de ma couchette lorsque le Capitaine entra, suivi par le Second et par le Commissaire.
— Hum, murmura le Grand Homme en jetant autour de lui un regard dédaigneux. Pas de pin up aux murs ? Je croyais que tous les Américains s'intéressaient aux jambes des femmes ! (Ses yeux se posèrent sur mes livres.) Est-ce qu'il y a un roman sous cette couverture austère ? demanda-t-il.
Silencieusement, j'ouvris tous les manuels au hasard. Le Capitaine passa un doigt çà et là, sur une barre, sous la couchette, sur le haut de la porte. Il considéra un instant son index demeuré propre et, visiblement déçu, hocha la tête et sortit. Le Second eut un sourire entendu :
— Vous l'avez eu, cette fois, ce fouineur de... !
Une atmosphère d'attente régnait à bord. Les hommes se mettaient sur leur trente et un et discutaient de la meilleure manière d'éviter les frais de douane. Ils parlaient de leur famille, de leurs petites amies. Les langues se déliaient, les conversations prenaient un ton plus libre. Bientôt tous ces hommes retrouveraient des parents, des êtres chers. Moi seul, je ne savais où aller, personne ne m'attendait. Moi seul, je débarquais à New York comme un étranger, que nul ne connaît, que nul n'apprécie.
Dressées contre le ciel, les hautes tours de Manhattan que la pluie avait lavées, étincelaient sous le soleil. Çà et là, une fenêtre en reflétait les rayons auxquels elle donnait une teinte vieil or. La statue de la Liberté, qui, je le remarquai, tournait le dos à l'Amérique, avait surgi devant nous. ‘Demi-vitesse avant !’ dit la sonnerie du télégraphe. Le navire ralentit et la petite vague, à l'étrave, s'effaça tandis que notre vitesse tombait. ‘Stop !’ dit le télégraphe au moment où nous accostions. Les cordes furent lancées et attrapées et, de nouveau, le bâtiment fut amarré à un quai. ‘Arrêtez les machines’, ordonna le télégraphe. Avec des sifflements plaintifs, la vapeur mourut dans les conduits. Les gigantesques tiges de piston s'immobilisèrent et le navire se balança doucement au bout de ses amarres, à peine secoué par le sillage des autres bateaux. Nous étions occupés à tourner des valves, à mettre en marche la machinerie auxiliaire, les treuils et les palans.
Sur le pont, les hommes s'affairaient, ils faisaient sauter les coins des panneaux de descente, ils ôtaient les bâches, ils ouvraient les cales. Les Agents de Bord embarquèrent, suivis par les déchargeurs. Bientôt le navire ressembla à une maison de fous, où partout des voix rauques hurlaient des ordres. On entendait le tuf-tuf et le grincement des grues. Un piétinement ininterrompu résonnait lourdement. Le Représentant du Service de Santé examina les papiers de l'équipage. Des policiers arrivèrent à leur tour et emmenèrent un passager clandestin dont nous autres, Mécaniciens, ignorions l'existence. Le malheureux partit, menottes aux mains, escorté par deux agents robustes, à l'air peu commode, qui l'entraînèrent jusqu'à une voiture de Police où ils le poussèrent sans douceur.
Nous fîmes la queue pour toucher notre argent, signâmes un reçu et on nous remit nos Livrets de Débarquement. Le Chef Mac avait écrit sur le mien : "Très consciencieux dans son travail et compétent dans tous les domaines. Serai toujours heureux de le reprendre comme compagnon de bord." "Quel dommage, me dis-je, que je doive faire une croix sur tout cela !"
Je retournai à ma cabine, la mis en ordre, pliai les couvertures et les rangeai. Puis, j'emballai mes livres et mes affaires personnelles dans mes deux valises et m'habillai en civil. Jetant un dernier regard en arrière, je sortis, fermant la porte derrière moi.
— Vous êtes bien décidé à partir ? me demanda le Chef Mac. Vous êtes un bon compagnon de bord et je serais heureux de vous donner le poste de Second Mécanicien au prochain voyage.
— Non, Chef, lui répondis-je. Je veux voir du pays et acquérir un peu plus d'expérience.
— L'expérience est une chose magnifique. Bonne chance, mon gars !
Je descendis la passerelle, mes valises à la main. Et je m'éloignai des navires à l'amarre. Une autre vie s'offrait à moi. Mais comme je haïssais ces pérégrinations incessantes, cette existence incertaine où je n'avais pas un ami !
— Où êtes-vous né ? interrogea le Douanier.
— À Pasadena, répondis-je, me rappelant les papiers que je tenais à la main.
— Qu'avez-vous à déclarer ?
— Rien, dis-je.
Il me jeta un regard perçant.
— O.K., ouvrez ça, aboya-t-il.
Je mis mes valises devant lui et les ouvris. Il les fouilla avec zèle, en sortit tous les objets, examina les doublures.
— Remballez, ordonna-t-il et il me planta là.
Je repris mes valises et sortis du bureau. Dehors, au milieu des frénétiques rugissements de la circulation, je m'arrêtai un instant pour recouvrer à la fois mes esprits et mon souffle.
— Qu'est-ce qu'y vous prend, mon vieux ? On est à New York ici ! dit derrière moi une voix vulgaire.
Je me retournai et vis qu'un policier me regardait d'un air furieux.
— Est-il interdit de s'arrêter ? demandai-je.
— Circulez, circulez ! rugit-il.
Lentement, je repris mes valises et continuai mon chemin, admirant les gratte-ciel de Manhattan, ces montagnes de métal, qui sont l'œuvre de l'homme. Jamais je ne m'étais senti plus isolé ; je me sentais complètement étranger à cette partie du monde. Derrière moi, le flic criait à quelque autre malheureux : "On fait pas ça à New York. Circulez !" Les gens semblaient harassés, énervés. Des véhicules motorisés passaient à folle allure. J'entendais sans cesse le grincement des pneus, je sentais l'odeur du caoutchouc brûlé.
J'avançais toujours. Enfin, j'aperçus devant moi une enseigne : ‘Hôtel des Marins’, et j'entrai en éprouvant un sentiment de soulagement. ‘Signez’, me dit une voix froide et impersonnelle. Je remplis soigneusement le formulaire qu'on m'avait jeté sur le comptoir et le rendis avec un remerciement. "Ne me remerciez pas, dit la voix. Je ne vous ai pas rendu un service, je fais mon travail." Je restai là à attendre. "Eh bien quoi ? dit la voix. Chambre 303, c'est écrit sur le formulaire et sur le disque attaché à la clef."
Je tournai les talons. À quoi bon discuter avec un robot ? Je m'approchai d'un homme, un marin de toute évidence qui, assis sur une chaise, feuilletait un magazine.
— Jenny ne nous a pas à la bonne, nous autres, dit-il avant que je n'aie pu ouvrir la bouche. Quel est le numéro de votre chambre ?
— Le 303, répondis-je d'un ton penaud. C'est la première fois que je viens ici.
— Au troisième étage, dit-il. Ça doit être la troisième chambre à tribord.
Je le remerciai et me dirigeai vers une porte marquée ‘Ascenseur’.
— Appuyez sur le bouton, me dit le marin.
J'obéis. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un liftier noir me fit signe d'entrer.
— Quel numéro ?
— 303, répondis-je.
Il appuya sur un bouton, la petite cabine s'éleva rapidement et s'arrêta bientôt. ‘Troisième’, dit le jeune Noir en ouvrant la porte. Celle-ci se referma derrière moi. J'étais seul de nouveau.
Je regardai le disque attaché à la clef pour vérifier encore une fois le numéro, puis je cherchai la porte de ma chambre. Oui, c'était bien ça : la troisième porte à droite de l'ascenseur avait le numéro 303. J'insérai la clef dans la serrure. La porte s'ouvrit et j'entrai dans la chambre qui n'était guère plus spacieuse qu'une cabine de bateau. Dès que j'en eus refermé la porte, j'aperçus un exemplaire du Règlement. Je le lus attentivement et vis que je ne pouvais pas rester plus de vingt-quatre heures, à moins que je ne doive rembarquer, auquel cas le séjour autorisé était de quarante-huit heures au maximum. Vingt-quatre heures ! Ainsi, là non plus, je ne pourrais pas trouver la paix. Je posai mes valises, me brossai, et descendis chercher des vivres et un journal afin de voir si une annonce offrirait un travail qui fût de ma compétence.
Chapitre Six
New York me parut une ville hostile. Les gens que je tentais d'arrêter au passage pour leur demander mon chemin m'adressaient un regard affolé et s'éloignaient rapidement. Après une nuit de sommeil, je déjeunai et pris un autobus pour le Bronx. D'après les journaux, j'avais eu l'impression que je trouverais là un logement meilleur marché. Près de Bronx Park, je descendis et suivis la rue dans l'espoir d'y découvrir une pancarte ‘chambre à louer’. Une voiture surgit entre deux camions de livraison, obliqua du mauvais côté de la rue, monta sur le trottoir et me heurta au côté gauche. Une fois de plus, j'entendis craquer mes os. Au moment où je glissais sur le trottoir et avant que l'oubli miséricordieux ne m'engloutit, je vis un homme saisir mes deux valises et s'enfuir.
L'air s'emplit de sons mélodieux. Après des années d'épreuves, je me sentais heureux, à l'aise.
— Ah, s'exclama la voix du Lama Mingyar Dondup, ainsi, te revoilà ?
J'ouvris les yeux et je le vis qui, debout, me souriait ; mais ses yeux rayonnaient de compassion.
— La vie sur Terre est dure et amère et tu as connu des épreuves qui sont heureusement épargnées à la plupart des gens. Ce n'est qu'un interlude, Lobsang, un interlude désagréable. Après la longue nuit viendra le réveil, le jour parfait où tu n'auras plus besoin de retourner sur Terre ni sur aucun des mondes inférieurs.
Je poussai un soupir. Je me sentais bien dans cet endroit dont le charme ne faisait que mettre en relief la dureté et l'injustice de la vie terrestre.
— Toi, Lobsang, reprit mon Guide, tu vis ta dernière existence sur la Terre. Tu paies tout ton Karma et tu accomplis aussi une tâche capitale, une tâche à laquelle les puissances mauvaises s'efforcent de faire obstacle.
Le Karma ! Ce mot me rappela la leçon que j'avais apprise dans mon bien-aimé Lhassa, si loin désormais.
Le tintement des petites clochettes d'argent s'était tu, les trompettes ne résonnaient plus, claires et fortes, dans l'air frais et raréfié de la vallée de Lhassa. Autour de moi régnait un silence insolite, un silence qui n'aurait pas dû être. Je sortis de ma rêverie au moment où les moines, dans le temple, entonnaient d'une voix profonde la Litanie des Morts. Des Morts ? Oui ! Bien sûr, la Litanie pour le vieux moine qui venait de trépasser après une vie de souffrances, de services rendus aux autres sans que personne parût lui en savoir gré.
"Quel Karma terrible il devait avoir, me dis-je. Quel être méchant il avait dû être dans sa vie précédente pour mériter pareil châtiment."
— Lobsang !
La voix résonna derrière moi comme un roulement de tonnerre dans le lointain. Mais les coups qui pleuvaient sur moi n'étaient pas si lointains, malheureusement.
— Lobsang ! Tu rêvasses, tu manques de respect à l'égard de notre Frère disparu, tiens, prends ça et ça !
Soudain, coups et insultes cessèrent comme par enchantement. Tournant mon visage angoissé, je levai les yeux vers la silhouette gigantesque qui me dominait de toute sa hauteur, tenant encore une trique à la main.
— Maître de Discipline, dit une voix bien-aimée, voilà un châtiment bien brutal pour un si petit garçon. Qu'a-t-il donc fait pour le mériter ? A-t-il souillé le Temple ? A-t-il manqué de respect envers les Formes Dorées ? Parle, explique ta cruauté.
— Seigneur Mingyar Dondup, geignit le Maître de Discipline, ce garçon rêvait tout éveillé alors qu'il aurait dû écouter la Litanie avec ses camarades.
Le Lama Mingyar Dondup, qui était lui aussi un homme de haute taille, leva sur l'homme de Kham, un géant de sept pieds (2,13 m), un regard attristé. Il dit d'un ton ferme :
— Tu peux disposer, Maître de Discipline, je vais m'occuper de lui moi-même.
Le Maître de Discipline s'inclina respectueusement et s'éloigna ; mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, se tourna vers moi :
— Maintenant, Lobsang, allons dans ma chambre où tu pourras m'énoncer la liste de tes nombreux péchés si sévèrement punis.
Ce disant, il se pencha doucement et me releva. Au cours de ma brève existence, personne d'autre que mon Guide ne m'avait témoigné de la bienveillance et j'eus du mal à retenir des larmes de gratitude et de tendresse.
Le Lama se détourna et prit d'un pas lent le long couloir désert. Je le suivis humblement, mais joyeusement, sachant que ce grand personnage ne se montrerait jamais injuste envers moi.
À l'entrée de sa chambre, il s'arrêta, se tourna vers moi et me posa une main sur l'épaule :
— Viens, Lobsang, tu n'as commis aucun crime, viens, et raconte-moi tes ennuis. (Ce disant, il me poussa devant lui et me fit signe de m'asseoir :) La nourriture, Lobsang, la nourriture, voilà à quoi tu songes aussi. Nous allons nous restaurer et boire du thé tout en parlant.
Il agita une sonnette d'argent et un domestique entra. Nous gardâmes le silence jusqu'à ce que la collation fût servie. Je pensais à la promptitude avec laquelle mes peccadilles étaient décelées et punies presque avant d'avoir été commises. De nouveau, une voix me rappela à la réalité.
— Lobsang, tu rêves tout éveillé ! Il y a des friandises, Lobsang, des friandises devant toi, et tu ne les vois pas ! Cela m'étonne grandement de toi.
La voix bienveillante et narquoise me tira de ma songerie et, presque machinalement, j'étendis la main vers l'un de ces gâteaux sucrés dont je faisais mes délices. Des gâteaux apportés des Indes lointaines pour le Dalaï-Lama, mais auxquels, grâce à sa bonté, j'avais le droit de goûter.
Pendant quelques moments encore, nous mangeâmes en silence, ou plutôt, moi, je mangeai, tandis que le Lama me considérait en souriant.
— Eh bien, Lobsang, dit-il lorsque je lui parus enfin rassasié, de quoi s'agit-il ?
— Maître, répondis-je, je réfléchissais au terrible Karma du moine qui vient de mourir. Il a dû être un très mauvais homme au cours de ses précédentes existences. Pendant que je songeais à cela, j'ai oublié les cérémonies du temple et le Maître de Discipline m'a puni avant que je n'aie pu lui échapper.
Il éclata de rire.
— Ainsi, Lobsang, tu essaierais d'échapper à ton Karma, si tu le pouvais !
Je le regardai mélancoliquement, sachant que rares étaient ceux qui pouvaient dépasser à la course les Maîtres de Discipline athlétiques, aux pieds rapides.
— Lobsang, cette question de Karma. Oh à quel point elle est mal comprise par certains même ici dans le Temple. Installe-toi confortablement, car je vais te parler longuement sur ce sujet.
Je m'agitai un peu et feignis de ‘m'installer confortablement’. Mais j'aurais voulu être dehors, avec les autres, au lieu d'écouter une conférence, car même venant d'un homme tel que le Lama Mingyar Dondup, un discours est un discours, et un médicament, même s'il a bon goût, n'en est pas moins un médicament.
— Tu sais tout cela, Lobsang, ou tu devrais le savoir si tu as prêté attention aux paroles de tes professeurs (ce dont je doute !), mais je vais te rafraîchir la mémoire, car je crains que ton attention ne soit quelque peu défaillante. (Ce disant, il me décocha un regard perçant et reprit :) Nous venons sur cette Terre comme à une école. Nous venons y apprendre une leçon. Au début, nous sommes dans la classe la plus basse, car nous ne savons rien et n'avons encore rien appris. À la fin de l'année, nous réussissons à nos examens ou nous échouons. Si nous avons réussi, alors en revenant de vacances, nous passons dans une classe supérieure. Dans le cas contraire, nous ‘redoublons’. Si nous avons échoué sur un seul sujet, nous pouvons être admis à passer dans la classe supérieure où nous étudierons également le sujet qui nous a valu cet échec.
C'était là un langage que j'étais à même de comprendre. Je savais ce que signifiait un examen, un échec, un passage dans une classe supérieure, où il fallait rivaliser avec des garçons plus âgés et en même temps étudier pendant des heures — qui auraient dû être consacrées aux loisirs — sous l'œil de quelque lama fossilisé, si vieux qu'il avait oublié sa propre enfance.
Il y eut soudain un bruit formidable, et j'eus si peur que je faillis sauter en l'air.
— Ah ! Lobsang, nous avons obtenu une réaction, après tout, dit mon Guide et, tout en riant, il remit à sa place la cloche d'argent qu'il avait laissée tomber derrière moi. Je t'ai adressé plusieurs fois la parole, mais ton esprit vagabondait...
— Pardonnez-moi, Vénérable Lama, répondis-je, je songeais à quel point vos explications étaient claires.
Le Lama dissimula un sourire et poursuivit :
— Nous venons donc sur cette Terre comme des enfants vont à l'école. Si, au cours de notre vie, nous nous conduisons bien et apprenons la raison de notre venue, alors nous progressons et passons au stade supérieur. Si nous n'apprenons pas nos leçons, nous renaissons dans un corps et dans des conditions à peu près semblables. Admettons qu'un homme, dans une vie antérieure, se soit montré cruel à l'égard de son prochain ; il lui faudra revenir sur Terre et s'efforcer de racheter ses fautes, il lui faudra renaître et faire le bien. Parmi les grands philanthropes actuels, beaucoup furent jadis de grands criminels. Ainsi tourne la Roue de la Vie, apportant d'abord des richesses à l'un, puis la pauvreté à l'autre ; le mendiant d'aujourd'hui peut être le prince de demain et cela se continue d'existence en existence.
— Mais, Honorable Lama, fis-je remarquer, cela signifie-t-il que si un homme est aujourd'hui un mendiant unijambiste, il ait coupé la jambe d'une autre personne dans une existence antérieure ?
— Non, Lobsang, cela signifie que cet homme doit connaître la pauvreté et subir la perte d'une jambe afin d'apprendre sa leçon. Lorsqu'il te faut étudier l'arithmétique, tu prends ton ardoise et ton boulier. Si tu veux apprendre à sculpter, tu te munis d'un couteau et d'un morceau de bois. Tu t'armes des outils appropriés à la tâche. Il en est de même en ce qui concerne le type de corps que nous possédons ; le corps et les circonstances de notre vie sont appropriés à la tâche que nous devons accomplir.
Je pensais au vieux moine qui était mort ; il s'était toujours plaint de son ‘mauvais Karma’ et se demandait ce qu'il avait fait pour mériter une vie aussi dure.
— Ah ! oui, Lobsang, me dit mon Guide, qui avait lu mes pensées, les non-initiés se plaignent toujours de leur Karma. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont parfois les victimes des mauvaises actions des autres, et que, s'ils souffrent injustement dans cette vie, dans une autre, ils seront pleinement récompensés. Je te le répète, Lobsang, tu ne peux pas juger l'évolution d'un homme par sa situation sur la Terre, et tu ne peux pas le condamner parce qu'il semble en proie à des difficultés. D'ailleurs, il ne faut jamais porter condamnation car, à moins de connaître tous les faits, ce qui est impossible dans cette vie, ton jugement sera erroné.
La voix des trompettes du Temple, résonnant à travers les halls et les corridors, nous interrompit pour nous appeler au service du soir. La voix des trompettes du Temple ? Ou était-ce un gong ? J'avais l'impression que le gong frappait dans ma tête et me secouait, me ramenait à l'existence terrestre. Péniblement, j'ouvris les yeux. Mon lit était entouré d'un paravent ; il y avait, à proximité, un cylindre à oxygène.
— Il est réveillé, Docteur, dit une voix.
Un piétinement, un frou-frou d'étoffe bien amidonnée. Un visage rougeaud m'apparut.
— Ah ! dit le médecin Américain, ainsi vous voilà ranimé. Vous en avez sûrement pris un coup !
Je le regardai avec des yeux vides d'expression.
— Mes valises ? demandai-je. Il ne leur est rien arrivé ?
— Si, un type a filé avec et la police ne peut pas le retrouver.
Plus tard dans la journée, un policier vint à mon chevet pour me demander des renseignements. Mes valises avaient été volées. L'homme dont la voiture m'avait renversé et sérieusement blessé n'était pas assuré. C'était un Noir en chômage. J'avais de nouveau le bras gauche cassé, quatre côtes enfoncées et les deux pieds écrasés.
— Vous serez remis dans un mois, me dit le médecin d'un ton allègre.
Mais j'attrapai une pneumonie double et restai neuf semaines à l'hôpital. Dès que je fus capable de me lever, on me présenta la note.
— Nous avons trouvé deux cent soixante dollars dans votre portefeuille, nous serons forcés d'en prélever deux cent cinquante pour votre séjour ici.
Je posai sur l'homme un regard effaré.
— Mais je n'ai pas de travail ! je n'ai rien, dis-je. Comment pourrais-je vivre avec dix dollars ?
Il haussa les épaules.
— Oh ! vous pouvez intenter un procès au Noir. Nous vous avons soigné, il faut nous payer. Votre histoire ne nous regarde en rien. Prenez-vous-en à l'homme qui en est responsable.
D'un pas chancelant, je descendis l'escalier et sortis dans la rue. Je n'avais que dix dollars en poche. Pas un sou de plus. Pas de situation, pas de toit. Comment allais-je vivre, là était la question. Le portier fit un signe du pouce. "En haut de la rue, il y a un Bureau de Placement, allez les voir." Inclinant la tête en silence, je m'éloignai à la recherche de mon unique espoir. Dans une minable rue latérale, j'aperçus une pancarte sale : ‘Emplois’. Monter jusqu'au troisième étage exigea un effort presque au-dessus de mes forces. À bout de souffle, je m'agrippai à la rampe jusqu'à ce que je me sentisse un peu mieux. "Peux-tu frotter les parquets, Gaillard ?" me demanda l'homme aux dents jaunâtres qui roulait un cigare déchiré entre ses lèvres épaisses et me regardait de haut en bas. "Je parie que tu sors tout juste du pénitencier ou de l'hôpital ?" Je lui racontai ce qui m'était arrivé, comment j'avais perdu à la fois mes valises et mon argent. "Alors tu veux gagner des dollars en vitesse", conclut-il, en prenant une fiche qu'il remplit. Il me la tendit et me dit de me rendre à un hôtel au nom très connu, l'un des plus sélects ! Je partis, dépensant quelques précieux cents pour le trajet en autobus.
— Vingt dollars par semaine et un repas par jour, m'annonça le Chef du Personnel.
Et pour ‘vingt dollars et un repas quotidien’, je lavai des montagnes de vaisselle sale et nettoyai d'interminables escaliers pendant dix heures par jour.
Vingt dollars par semaine, et un repas. La nourriture que l'on servait au personnel ne valait pas celle des clients. Elle était sévèrement contrôlée et réglementée. Mon salaire était si bas que je ne pouvais m'offrir le luxe d'une chambre. Je dormais dans les parcs et sous les portes et j'appris à fuir la nuit, avant que l'Agent-Faisant-Sa-Ronde ne surgît, armé de son bâton et grommelant : ‘Circulez, circulez !’ J'appris à rembourrer mes vêtements avec des journaux afin de me préserver des vents aigres qui, la nuit, balayaient les rues désertes de New York. Mon unique complet était usagé et taché et je n'avais qu'un seul jeu de sous-vêtements. Pour les nettoyer, je m'enfermais dans les toilettes des hommes, me déshabillais, remettais mon pantalon et je lavais le linge dans une cuvette ; puis je le faisais sécher sur les tuyaux de chauffage, car il m'était impossible de ressortir avant de les avoir récupérés. Les semelles de mes chaussures étaient trouées, je les bourrais de carton et cherchais dans les boîtes à ordures si un des clients de l'hôtel n'y avait pas jeté une paire en meilleur état. Mais bien des yeux aigus et des mains avides examinaient les ‘détritus de la clientèle’ avant qu'ils ne m'arrivent. Je vivais et travaillais en ne faisant chaque jour qu'un seul repas, arrosé de beaucoup d'eau. Peu à peu, je parvins à m'acheter des sous-vêtements, un costume et des chaussures d'occasion. Et je mis cent dollars de côté.
Un jour, j'entendis deux clients discuter près de l'office où je me tenais. Ils parIaient d'une annonce qui n'avait pas réussi à leur procurer le type d'homme qu'ils cherchaient. Je ralentis le rythme de mon travail. "Bien connaître l'Europe... Une bonne voix... des notions de radio." Quelque chose se déclencha en moi, je me précipitai vers la porte en m'exclamant :
— Moi, je remplis ces conditions-là !
Les hommes me regardèrent stupéfaits et éclatèrent de rire. Le Chef des Garçons et un aide-cuisinier se ruèrent sur moi, le visage crispé de fureur.
— Fiche le camp ! dit le Chef en me saisissant si violemment au collet que mon pauvre vieux veston se déchira du haut en bas.
Je me retournai et lui jetai à la figure les deux morceaux de vêtements.
— Vingt dollars par semaine ne vous donnent pas le droit de parler sur ce ton à un homme ! dis-je d'une voix farouche.
L'un des deux hommes me regarda avec des yeux horrifiés.
— Vingt dollars par semaine, avez-vous dit ?
— Oui, monsieur, voilà ce qu'on me donne, plus un repas par jour. Je couche dans les jardins publics, la police me pourchasse. Je suis venu dans ce ‘Pays de l'Avenir’ et le lendemain de mon arrivée, un homme m'a renversé avec sa voiture ; tandis que je gisais sans connaissance, un Américain m'a volé toutes mes affaires. La preuve, monsieur ? Je vous en donnerai la preuve, vous pourrez vérifier mon histoire !
Le Chef d'Étage surgit, se tordant les mains, prêt à pleurer. Il nous fit entrer dans son bureau. Les autres s'assirent ; moi, je restai debout. Le plus âgé des deux hommes téléphona à l'hôpital, où après un certain temps, on confirma mon histoire dans tous ses détails. Le Chef d'Étage me mit un billet de vingt dollars dans la main.
— Achetez un nouveau veston ‘et filez !’ me dit-il.
Je repoussai le billet dans sa main flasque.
— Prenez-le, dis-je, vous en aurez plus besoin que moi.
Je me détournai pour partir, mais au moment où j'atteignais la porte, une main se tendit vers moi et une voix me dit :
— Arrêtez ! (Le plus âgé des deux inconnus me regarda droit dans les yeux :) Je crois que vous ferez notre affaire. Nous verrons. Venez demain à Schenectady, voici ma carte. (Et comme j'allais partir :) Attendez... voici cinquante dollars pour le déplacement.
— Monsieur, dis-je en refusant le billet qu'il m'offrait, j'irai là-bas par mes propres moyens. Je ne prendrai cet argent que lorsque vous serez certain que je fais votre affaire, car dans le cas contraire, il me serait impossible de vous le rendre.
Sur ce, je quittai la pièce. Dans le Vestiaire du Personnel, je tirai de mon armoire mon maigre bagage et quittai l'hôtel. Je ne pouvais aller que dans le parc. Pas de toit. Personne à qui dire au revoir. Au cours de la nuit, une impitoyable pluie me trempa jusqu'aux os. Par chance, je parvins à garder au sec mon ‘nouveau costume’ en m'asseyant dessus.
Le lendemain matin, j'avalai une tasse de café et un sandwich et découvris que le moyen le moins coûteux d'aller de New York City à Schenectady était de prendre l'autobus. J'achetai un billet et m'assis dans le véhicule. Un passager avait laissé sur un des sièges un exemplaire du Morning Times, et je le lus pour m'empêcher de songer à mon avenir incertain. L'autobus roulait, avalant les milles (km). Dans l'après-midi, j'arrivai à destination. Je me rendis aux bains publics, mis mes vêtements propres et ayant rectifié ma tenue dans toute la mesure du possible, je sortis de l'établissement.
Les deux hommes m'attendaient aux studios de radio-diffusion. Pendant plusieurs heures, ils me bombardèrent de questions. L'un après l'autre, ils sortaient, puis revenaient. Enfin, ils furent au courant de toute mon histoire.
— Vous dites que vous avez déposé des papiers chez un ami de Shanghaï ? dit l'aîné des deux hommes. Eh bien, nous allons vous embaucher à titre provisoire et nous câblerons à Shanghaï pour qu'on nous envoie vos papiers. Dès que nous les aurons vus, vous serez engagé de façon permanente. Cent dix dollars par semaine, nous discuterons de ce salaire plus tard, lorsque les papiers seront là. Faites-les venir à nos frais.
L'autre prit la parole :
— Je crois qu'une avance lui rendrait rudement service, dit-il.
— Donnez-lui un mois de salaire d'avance, répondit le premier. Il commence à travailler après-demain.
Ainsi débuta une période heureuse de ma vie. Le travail me plaisait et je donnais toute satisfaction. Mes papiers, ma vieille boule de cristal et quelques autres affaires finirent par arriver. Les deux hommes vérifièrent le tout et m'accordèrent une augmentation de quinze dollars par semaine. Je pensais que la vie recommençait à me sourire.
Au bout d'un certain temps, pendant lequel je mis de côté la plus grande partie de mon salaire, j'eus l'impression que je ne faisais aucun progrès, que je n'avançais pas dans la tâche qui m'avait été assignée dans la vie. L'aîné des deux hommes m'avait pris en affection, j'allai le voir, lui exposai le problème et lui dis que lorsqu'il m'aurait trouvé un remplaçant, je partirais. Je restai encore trois mois de plus.
Parmi les papiers expédiés de Shanghaï se trouvait un passeport délivré par les autorités de la Concession Britannique. Aux temps lointains où les Britanniques m'avaient eu en sympathie, ils avaient fait appel à mes services. À présent... Eh bien, à présent, ils estiment que je n'ai plus rien à leur offrir. Je portai donc mon passeport et d'autres documents à l'Ambassade de Grande-Bretagne, à New York et, après pas mal de difficultés et une longue attente, je réussis à obtenir d'abord un visa, puis un permis de travail pour l'Angleterre.
Enfin, on me trouva un successeur ; je demeurai encore deux semaines pour le mettre au courant, puis je partis. L'Amérique est peut-être unique en ceci qu'un homme débrouillard peut se rendre n'importe où, sans bourse délier. Je parcourus les journaux jusqu'à ce que j'y lus, sous la rubrique "Transports", les lignes suivantes :
"Californie, Seattle, Boston, New York.
Essence gratuite, appeler 000 000 xxx Auto-Drive-away."
Des firmes américaines font livrer des voitures sur tout le continent. Bon nombre de conducteurs aiment voyager, et la méthode la plus simple et la moins onéreuse est de prendre contact avec une firme qui se charge de la livraison des voitures. Après avoir passé un simple examen de conduite, on reçoit des bons d'essence que l'on donne à certains postes situés sur la route.
Je me rendis donc à l'Auto-Drive-away et dis que je voulais conduire une voiture à Seattle.
— C'est simple, tout simple, me répondit un homme à l'accent irlandais. Je cherche un bon chauffeur pour amener une Lincoln là-bas. Baladez-moi un peu, que je vois comment vous vous en tirez.
Tandis que je roulais, il m'apprit pas mal de choses utiles. Il semblait m'avoir pris en sympathie et me dit soudain :
— J'ai reconnu votre voix, vous avez dû être Speaker.
Je répondis que oui.
— J'ai un poste à ondes courtes grâce auquel je garde le contact avec mon ancienne patrie, poursuivit-il. Il est détraqué, je n'arrive plus à prendre les ondes courtes. Les gens d'ici ne comprennent rien à ce genre de radio, et vous ?
Je lui répondis que j'examinerais son poste et il m'invita à dîner chez lui, ce soir-là. Il me prêta même une voiture pour y aller. Sa femme, d'Irlande comme lui, était douée d'un charme rare, et lorsque je les quittai, j'éprouvai à l'égard de l'Irlande un amour qui n'a fait que croître lors de mon séjour en ce pays.
Le poste de radio était un modèle anglais très connu, un remarquable Eddystone, dont la qualité est insurpassable. Le destin me fut favorable. L'Irlandais prit l'une des bobines et je vis comment il la tenait.
— Donnez-moi cela, lui dis-je, et une loupe si possible. (Il en avait une et un bref examen me montra qu'en saisissant maladroitement la bobine, il avait brisé le fil de l'une des fiches. Je le lui montrai.) Avez-vous un fer à souder et de la soudure ? lui demandai-je.
Non, mais son voisin en avait, et il partit, pour revenir bientôt avec les objets en question. Quelques minutes me suffirent pour ressouder le fil et le poste se remit à fonctionner. Je vérifiai l'ajustage et quelques pièces et la radio marcha mieux encore. Bientôt, nous pûmes écouter une émission de la B.B.C., à Londres, Angleterre.
— J'allais renvoyer ce poste en Angleterre pour le faire réparer, me dit l'Irlandais. À présent, je vais faire quelque chose pour vous. Le propriétaire de la Lincoln voulait que l'un de nos chauffeurs emmène la voiture à Seattle. C'est un homme riche ; je vais vous inscrire sur notre feuille d'émargement, afin que vous puissiez être payé. Nous vous donnerons quatre-vingts dollars et nous enverrons une note de cent vingt dollars à ce monsieur. D'accord ?
D'accord ? Certes, j'étais d'accord !
Le matin du lundi suivant, je me mis en route. Pasadena était ma première étape. Je voulais m'assurer que le Mécanicien de Navire dont j'avais utilisé les papiers était vraiment dépourvu de famille. New York, Pittsburg, Columbus, Kansas, les milles (km) s'accumulaient. Je ne me pressais pas ; je m'accordais une semaine pour faire le voyage. La nuit, je dormais dans la grande voiture pour économiser des frais d'hôtel, m'arrêtant au bord de la route, là où je le jugeais bon. Bientôt, j'atteignis les contreforts des Rocheuses ; je jouissais de cet air pur, et plus la voiture grimpait, plus cet air me faisait du bien. Après être demeuré toute une journée en montagne, je pris la direction de Pasadena. Malgré de patientes recherches, je ne découvris aucun parent au Mécanicien. Il semblait avoir été un homme renfermé qui préférait sa propre compagnie à celle des autres. Je traversai le Yosemite National Park, le Crater Lake National Park, Portland, et j'arrivai finalement à Seattle. Je conduisis la voiture au garage où elle fut soigneusement examinée, graissée et lavée. Puis le directeur du garage donna un coup de téléphone.
— Venez, me dit-il, le client veut que nous lui amenions la voiture à domicile.
Je pris la Lincoln et le directeur monta dans une autre voiture, afin que nous ayons un moyen de transport pour le retour. Bientôt nous nous arrêtâmes dans la large allée centrale menant à une maison spacieuse ; trois hommes en sortirent. Le directeur s'adressa avec beaucoup de déférence à l'homme au visage glacé qui avait acheté la Lincoln. Les deux autres étaient des mécaniciens qui se mirent en devoir d'examiner la voiture de fond en comble.
— Elle a été conduite avec beaucoup de soin, déclara le plus âgé des deux mécaniciens, vous pouvez la prendre en toute confiance, monsieur.
L'homme au visage glacé m'adressa un signe de tête condescendant.
— Venez dans mon bureau, me dit-il. Je vais vous donner une gratification de cent dollars, qui sera pour vous seul, parce que vous avez bien mené ma voiture.
— Fichtre ! me dit le directeur un peu plus tard. C'était rudement généreux de sa part, vous lui avez tapé dans l'œil.
— Je cherche un travail qui me ferait passer au Canada, lui dis-je. Pourriez-vous m'aider ?
— Eh bien, répondit le directeur, si vous voulez aller à Vancouver, je n'ai rien à vous offrir dans cette direction, mais je connais un homme qui veut une nouvelle De Soto. Il habite Oroville, juste à la frontière. Il ne lui plaît pas de faire tout ce trajet lui-même et il sera rudement content qu'on lui livre la voiture à domicile. Son crédit est bon. Je vais lui téléphoner.
— Bon sang, Hank, dit le directeur à son interlocuteur invisible, est-ce que tu as fini de marchander ? Oui ou non, veux-tu la De Soto ? (Il écouta un moment, puis interrompit :) Eh bien, c'est ce que je t'explique ; j'ai ici un gars qui va à Oroville, en route pour le Canada. Il a amené une Lincoln de New York, qu'en dis-tu, Hank ? (Hank continua à jacasser. Sa voix m'arrivait en un murmure confus. Le directeur poussa un soupir d'exaspération :) Eh bien, ce que t'es un type compliqué. Tu peux porter ton chèque à la banque, voilà vingt ans au moins que je te connais. J'ai pas peur que tu me fasses une entourloupette. (Il écouta encore un moment.) O.K., dit-il, je vais le faire. Ouais, j'ajouterai ça à la facture. (Il raccrocha et poussa un long sifflement :) Dites-moi, mister, est-ce que vous connaissez quelque chose aux femmes ? (Les femmes ? Pourquoi pensait-il que je les connaissais ? Qui les connaît ? Ce sont des énigmes, même à leurs propres yeux ! Le directeur, voyant l'expression de mon visage, poursuivit :) Hank, là-bas, il est célibataire depuis quarante ans, je le sais. Et maintenant il demande que vous lui apportiez des vêtements de dame. Eh bien, eh bien, le vieux drôle se dévergonde. Je demanderai à ma bourgeoise ce qu'il faut envoyer.
Quelques jours plus tard, je partais de Seattle dans une De Soto toute neuve et avec une cargaison de toilettes féminines. Mme la Directrice avait eu le bon sens de téléphoner à Hank pour lui demander des explications. De Seattle à Wenatchee, de Wenatchee à Oroville... Hank se montra satisfait. Je ne m'attardai pas et pris le chemin du Canada. Je restai quelques jours à Osoyoos. La chance me servit et je pus traverser le Canada, de Trail jusqu'à Ottawa, Montréal et Québec. Je n'entrerai pas dans les détails de cette randonnée, car elle fut si étrange qu'elle fera peut-être le sujet d'un autre livre.
Québec est une belle ville, le seul ennui, c'est que dans certains quartiers, on est mal vu lorsqu'on ne parle pas français. Ma connaissance de cette langue fut tout juste suffisante pour me permettre de traverser la ville. J'errai sur les quais et, ayant réussi à obtenir une carte du Syndicat des Marins, je fus engagé comme homme de pont sur un navire. L'emploi était mal payé, mais il me permettait de traverser l'Atlantique une fois de plus. Le bateau était un vieux rafiot crasseux. Le Capitaine et les Officiers avaient depuis longtemps perdu tout enthousiasme pour la mer et pour leur bâtiment. On le nettoyait rarement. Je ne fus guère populaire, car je ne jouais pas et je ne parlais pas femmes. J'étais craint, car la mauvaise tête du bateau ayant tenté de me prouver sa supériorité, je le forçai bientôt à crier merci. Deux hommes de sa bande s'en tirèrent encore plus mal et je comparus devant le Capitaine qui me reprocha d'estropier les membres de son équipage. Il ne parut pas tenir compte du fait que je m'étais tout bonnement défendu ! À part ces incidents triviaux, le voyage se passa sans encombre et bientôt le navire entra lentement dans la Manche.
J'étais au repos et me trouvais sur le pont lorsque nous franchîmes les Aiguilles et entrâmes dans le Solent, cette bande d'eau qui se trouve entre l'île de Wight et la terre ferme. Lentement, le bateau passa devant l'Hôpital Netley, avec son parc magnifique. À Woolston, nous croisâmes les ferries aux incessants va-et-vient, et arrivâmes dans le port de Southampton. L'ancre plongea avec un ‘plouf’ sonore, et la chaîne cliqueta à travers les écubiers. Le navire présenta l'avant au courant. Le télégraphe de la salle des machines se mit à résonner et la légère vibration du moteur s'arrêta. Les Autorités Portuaires montèrent à bord, examinèrent les papiers du navire et parcoururent le quartier de l'équipage. Le Médecin Sanitaire du Port nous donna l'autorisation d'aborder lentement, et le navire amarra. En tant que membre de l'équipage, je restai à bord jusqu'à ce que le déchargement fût terminé, puis, ayant touché mon salaire, je pris mon maigre bagage et descendis à terre.
— Rien à déclarer ? demanda le Douanier.
— Rien du tout, répondis-je, en ouvrant ma valise sur un signe de lui. Il regarda mes quelques affaires, referma la valise et y porta une marque à la craie.
— Combien de temps resterez-vous ici ? interrogea-t-il.
— Je veux vivre ici, répondis-je.
Il examina mes Passeport, Visa et Permis de Travail. ‘O.K.’, me dit-il en me désignant la porte. Je la franchis et me retournai pour jeter un dernier regard sur le navire que je venais de quitter. Une bourrade formidable faillit me renverser. Un autre Douanier, en retard sans doute pour prendre son service, remontait la rue en courant et m'avait si violemment heurté qu'il était tombé sur son séant. Il demeura là un moment, ahuri, et je m'approchai pour l'aider à se relever. Furieux, il voulut me frapper et je pris ma valise pour m'éloigner.
— Arrêtez ! hurla-t-il.
— Il peut partir, dit le fonctionnaire qui avait examiné ma valise. Il n'a rien et ses papiers sont en règle.
— Je vais l'interroger moi-même ! cria l'autre, qui devait être son Supérieur. Deux autres Douaniers se tenaient auprès de moi et leurs visages exprimaient la consternation. L'un d'eux essaya d'intervenir, mais il reçut l'ordre de ‘la fermer’.
On me fit passer dans une salle où entra bientôt le Douanier irascible. Il examina ma vieille valise et en jeta le contenu au sol. Puis il en tâta la doublure et le fond. Dépité de n'y rien trouver, il exigea de voir mon Passeport.
— Ah ! s'exclama-t-il, vous avez un Visa et un Permis de Travail. Les services de New York n'ont pas le droit de les délivrer. C'est à nous de le faire, ici, en Angleterre, si nous le jugeons bon.
Il exultait. D'un geste théâtral, il déchira mon passeport en deux et le jeta dans la corbeille à papiers. Puis, mû par une impulsion, il ramassa les morceaux et les enfouit dans sa poche. Il sonna et deux hommes apparurent.
— Cet homme n'a pas de papiers ! dit-il. Il devra être déporté. Emmenez-le à la Cellule de Détention.
— Mais, Monsieur, protesta l'un des Douaniers, j'ai vu ses papiers, ils étaient en règle.
— Allez-vous discuter mes ordres ? rugit son Supérieur. Faites ce que je vous dis !
Un des deux hommes me prit à regret par le bras. "Venez", me dit-il et je me retrouvai bientôt dans une cellule nue.
— Par Jupiter, mon vieux, me dit le Brillant Jeune Homme du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'il vint me voir beaucoup, beaucoup plus tard dans ma cellule. Tout cela est bien embêtant ! (Il frotta son menton imberbe et soupira bruyamment.) Vous comprenez notre position, mon vieux, elle est tout simplement désespérée. Vous aviez certainement des papiers sinon les scribes de Québec ne vous auraient pas laissé embarquer. À présent, vous n'avez plus de papiers. Ils ont dû tomber à la mer. CQFD. Hein, mon vieux ? je veux dire...
Je lui jetai un regard flamboyant.
— Mes papiers ont été délibérément détruits. J'exige qu'on me relâche et qu'on me laisse débarquer.
— Oui, oui, répondit le Brillant Jeune Homme, mais êtes-vous en mesure de le prouver ? Un petit oiseau m'a raconté exactement ce qui s'était passé. Il faut que nous soyons solidaires avec notre personnel en uniforme, sinon la presse nous sautera dessus. Loyauté et esprit de corps, etc.
— Ainsi, dis-je, vous savez la vérité, vous savez que mes papiers ont été détruits et pourtant vous, dans ce ‘Pays de la Liberté’ tant vanté, vous refusez d'intervenir pour remédier à une injustice pareille ?
— Mon cher ami, vous aviez simplement le passeport d'un résident d'un État Annexe. Vous n'êtes pas, de naissance, un membre du Commonwealth. Je crains que vous ne vous trouviez en dehors de notre orbite. À présent, Camarade, à moins que vous n'admettiez que vos papiers ont été... euh... perdus en mer, nous serons obligés de vous accuser d'immigration illégale. Cela pourrait vous valoir deux ans de taule. Si vous jouez le jeu, vous serez simplement ramené à New York.
— New York ? Pourquoi New York ? demandai-je.
— Si vous retourniez à Québec, vous pourriez nous causer des ennuis. Nous sommes à même de prouver que vous êtes parti de New York. Alors, à vous de décider. New York, ou deux ans comme Hôte de Sa Majesté. (Il ajouta, après réflexion :) Bien entendu, vous seriez déporté à votre sortie de prison, et les Autorités n'hésiteraient pas à confisquer votre argent. Notre suggestion vous permet de le garder.
Le Brillant Jeune Homme se leva et brossa un grain de poussière imaginaire sur son veston immaculé.
— Réfléchissez, mon vieux, nous vous offrons une issue absolument épatante. Sur ce, il se retourna et me laissa seul dans la cellule.
On m'apporta de la nourriture, cette pesante nourriture anglaise, que j'essayai de couper avec le couteau le plus émoussé dont je me sois jamais servi. Peut-être craignaient-ils que je ne me suicide par désespoir ? Personne n'aurait pu se suicider avec ce couteau-là !
La journée s'écoula, un Gardien bon enfant m'apporta des journaux anglais. Je n'y jetai qu'un coup d'œil : ils ne me paraissaient s'occuper que de scandales et de sexualité. À la nuit tombante, on m'apporta un bol de cacao et une tranche de pain avec de la margarine. La nuit était froide et l'humidité me fit songer aux tombes et aux corps en putréfaction.
Le Gardien de jour me salua d'un sourire qui menaça de craqueler son visage de pierre.
— Vous partez demain, m'annonça-t-il. Le Capitaine d'un navire a accepté de vous prendre à bord, si vous travaillez pour payer votre passage. À votre arrivée, vous serez remis à la Police new-yorkaise.
Plus tard dans la matinée, je fus averti officiellement de cette décision ; l'on me dit que je ferais à bord le travail le plus dur, dans les soutes d'un vieux cargo à vapeur, dépourvu de tout moyen propre à faciliter la manutention du charbon. Je ne toucherais aucun salaire et il me faudrait signer un contrat comme quoi j'acceptais ces conditions. L'après-midi je fus emmené sous bonne garde chez l'Agent Maritime où je signai le contrat en présence du Capitaine.
Vingt-quatre heures plus tard, toujours sous bonne garde, on me fit monter à bord et on m'enferma dans une petite cabine, où je devais rester, me déclara-t-on, jusqu'à ce que le navire eût franchi la limite des eaux territoriales. Bientôt le vrombissement des vieilles machines fit régner à bord une certaine animation. J'entendis un lourd piétinement au-dessus de ma tête et, par le mouvement de balançoire du pont, je compris que nous entrions dans une mer agitée. Je ne fus libéré qu'après avoir laissé Portland Bill loin à tribord arrière.
— Grouille-toi, mon bonhomme, me dit l'homme en charge des chaudières en me tendant une pelle cabossée et un râteau. Enlève ces scories, porte-les sur le pont et fiche-les à l'eau. Et en vitesse !
— Ah regardez ! brailla l'énorme bonhomme posté au gaillard d'avant, lorsqu'il m'aperçut. C'est un Chinetoque ou un Japonais. Hé toi ! me dit-il, en m'allongeant une gifle, tu te rappelles Pearl' Arber ? (Pearl Harbor — NdT)
— Laisse-le, Butch, dit un autre homme, il a déjà les flics aux trousses.
— Ha, ha ! rugit Butch, j'vais l'travailler un peu, en souvenir d'Pearl' Arber.
Il se rua vers moi en manœuvrant les poings comme des pistons et sa fureur augmenta d'autant plus qu'aucun de ses coups ne m'atteignit.
— Une vraie anguille, hein ? gronda-t-il étendant le bras pour me prendre à la gorge.
Le vieux Tzu et d'autres, dans mon lointain Tibet, m'avaient bien préparé à semblables éventualités. Je me laissai tomber et Butch fut emporté par son élan. Il s'écroula sur moi, et sa tête alla frapper le rebord de la table ; il eut la mâchoire brisée et faillit se trancher l'oreille sur un pot qu'il cassa dans sa chute. Je n'eus plus d'ennuis avec l'équipage.
Lentement, le panorama de New York apparut à mes yeux. Le navire avançait, poussif, laissant derrière lui dans le ciel une longue traînée de fumée noire due au mauvais charbon qu'il brûlait. Un Lascar (matelot indien — NdT), jetant par-dessus son épaule un regard inquiet, s'approcha de moi.
— Les flics vont venir te chercher bientôt, me dit-il. T'es un brave type, j'ai entendu le Chef répéter ce que le Capitaine lui avait dit. Faut qu'y s'tiennent à carreau. (Il me passa une blague à tabac en toile cirée :) Mets ton fric là-dedans et saute à terre avant qu'y te fassent débarquer.
Il m'expliqua à voix basse où le bateau de Police accosterait et où je pourrais me cacher comme il l'avait fait, jadis. J'écoutai attentivement les indications qu'il me fournit sur la manière d'échapper aux recherches, une fois que j'aurais sauté à l'eau. Il me donna les noms et adresses de gens capables de me rendre service et il me promit de prendre contact avec eux dès qu'il serait à terre.
— J'ai eu des ennuis comme toi, me dit-il, on m'a fait des misè' à cause d'la couleu' de ma peau.
— Eh, toi, brailla une voix venant de la Passerelle, le Capitaine veut te voir ! Grouille-toi !
Je me hâtai de monter sur la Passerelle. Le Second me désignait du pouce la Chambre des Cartes. Le Capitaine, assis à une table, examinait des papiers.
— Ah, fit-il en m'apercevant, je vous remets à la police. Avez-vous auparavant quelque chose à me dire ?
— Capitaine, déclarai-je, mes papiers étaient en règle, mais un Douanier-Chef les a déchirés.
Il me regarda et inclina la tête, jeta un coup d'œil sur ses feuillets, et finit par dire :
— Je connais l'homme dont vous parlez. J'ai eu du fil à retordre avec lui, moi aussi. Mais l'administration doit garder la face, même aux dépens des autres. Je sais que votre histoire est vraie, car j'ai un ami aux douanes qui me l'a confirmée. (De nouveau il feuilleta ses papiers :) J'ai ici une plainte contre vous, il paraît que vous avez voyagé clandestinement.
— Mais, Capitaine, m'exclamai-je, l'Ambassade Britannique à New York peut vous dire qui je suis. De même que l'Agence Maritime de Québec.
— Mon ami, me dit tristement le Capitaine, vous ne connaissez pas les mœurs occidentales. Il n'y aura pas d'enquête. Vous serez emmené à terre, mis en cellule, jugé, condamné, emprisonné. Et l'on vous oubliera. Et quand approchera le moment de vous relâcher, on vous gardera jusqu'à ce que vous puissiez être ramené en Chine.
— Ce qui équivaudra à une condamnation à mort.
Il inclina la tête :
— Oui, mais le règlement aura été appliqué. Nous en avons fait l'expérience au temps de la prohibition, l'équipage et moi. Nous avons été arrêtés sur un simple soupçon et condamnés à une grosse amende, et pourtant nous étions absolument innocents. (Il ouvrit le tiroir placé devant lui et en sortit un petit objet :) Je dirai à la Police que vous avez été injustement accusé, je vous aiderai dans la mesure du possible. Ils vous passeront peut-être les menottes mais ils ne vous fouilleront qu'une fois à terre. Voici une clef qui ouvre les menottes utilisées par la Police. Je ne vous la donne pas, mais je vais la mettre là et me détourner.
Il posa devant moi la petite clef brillante, se leva et se tourna vers la carte, accrochée derrière lui. J'empochai la clef.
— Merci, Monsieur, dis-je, votre confiance en moi m'a réconforté.
Je vis au loin un canot de la Police s'avancer vers le navire, une gerbe d'écume jaillissant de chaque côté de la proue. Il aborda avec élégance, exécuta un demi-tour et obliqua vers nous. L'échelle fut baissée et deux policiers montèrent sur la Passerelle, sous les regards hostiles de l'équipage. Le Capitaine les accueillit, leur offrit de l'alcool et des cigares. Puis il leur montra les papiers, sur son bureau.
— Cet homme m'a donné toute satisfaction par son travail ; à mon avis, il a été injustement accusé par un fonctionnaire du Gouvernement. Si on lui permettait de se rendre à l'Ambassade de Grande-Bretagne, il pourrait prouver son innocence.
Le policier en charge répondit avec cynisme :
— Tous ces types sont innocents ; les pénitenciers sont pleins d'hommes qui, à les entendre, n'ont rien à se reprocher. Tout ce que nous voulons, c'est fourrer gentiment celui-là en cellule et puis nous aurons fini notre service. (En s'adressant à moi :) Allez, viens ! (Je voulus prendre ma valise.) Bah, t'en auras pas besoin, me dit-il, en m'entraînant, puis, après réflexion, il me passa les menottes.
— Oh, vous n'avez pas besoin de faire ça, lui cria le Capitaine. Il ne peut pas s'enfuir et comment va-t-il descendre dans votre bateau ?
— S'il tombe à la flotte, on le repêchera, répondit l'agent, avec un gros rire.
Descendre l'échelle ne fut pas facile, mais j'y parvins sans encombre, au regret évident des policiers. Une fois que je fus à bord du canot, ils ne s'occupèrent plus de moi. Nous croisâmes de nombreux navires et approchâmes rapidement de la jetée réservée à la Police.
‘C'est le moment’, me dis-je et d'un bond, je plongeai et m'enfonçai dans l'eau. Non sans mal, j'introduisis la clef dans la serrure et tournai. Les menottes s'ouvrirent et coulèrent au fond de l'eau. Lentement, très lentement, je remontai à la surface. Le canot de la police était déjà loin, ses occupants me virent et ouvrirent le feu. Des balles criblèrent l'eau tout autour de moi, tandis que je m'enfonçais à nouveau. Je nageai vigoureusement jusqu'à ce que mes poumons menacent d'éclater, puis remontai en surface. Les policiers s'étaient éloignés, cherchant l'endroit où, de ‘toute évidence’, je devais aborder. Je regagnai la rive au lieu le ‘moins évident’, mais je ne le désignerai pas, pour le cas où quelque infortuné aurait cherché à s'y réfugier.
Pendant des heures, je demeurai étendu sur des planches à moitié immergées, tremblant, mal en point, environné d'eau bourbeuse. Soudain, j'entendis un grincement de tolets et un battement de rames dans l'eau. Une embarcation ayant à son bord trois policiers apparut. Je me laissai glisser de la poutre et m'enfonçai dans l'eau de façon que seules mes narines émergeassent. Bien que la poutre me dissimulât aux regards, je me tenais prêt à prendre la fuite. Le canot rôda un bon moment. Enfin, une voix rauque déclara :
— L'est sûrement claqué, à présent. On retrouvera son corps plus tard. Allons boire une tasse de café.
L'embarcation s'éloigna. J'attendis un certain temps, puis je hissai sur la poutre mon corps douloureux, secoué de frissons que je ne pouvais maîtriser.
Le crépuscule arriva ; furtivement je rampai le long de la poutre et trouvai une échelle, à moitié pourrie. J'y grimpai avec précaution et ne voyant personne, je courus me réfugier dans une sorte de cabane. J'enlevai mes vêtements et les tordis. Un homme apparut à l'autre bout du quai : c'était le Lascar. Au moment où il approchait, je sifflai tout bas. Il s'immobilisa et s'assit sur un pieu.
— Tu peux sortir, mais fais attention, me dit-il. Les flics sont sûrement en force, de l'autre côté. Bon sang ! tu leur as donné du mal, aux gars ! (Il se leva, s'étira et regarda autour de lui :) Suis-moi, mais si tu es pris, j'te connais plus. Un gentleman de couleur attend avec un camion. Quand on y sera, tu grimperas à l'arrière et tu te cacheras sous la bâche.
Il s'éloigna ; je lui laissai une bonne avance, puis le suivis en passant de l'ombre d'un bâtiment à l'ombre d'un autre. Seuls, le clapotis de l'eau autour des pilotis et le ululement lointain d'une voiture de police troublaient le silence. Soudain, j'entendis gronder un moteur de camion et des feux arrière s'allumèrent devant moi. Un énorme Noir fit un signe de tête au Lascar et m'adressa un clin d'œil amical, tout en m'indiquant l'arrière du camion. J'y grimpai péniblement et rabattis la vieille bâche sur moi. Le camion roula un moment, puis stoppa. Les deux hommes en sortirent et l'un d'eux dit :
— Faut qu'on le charge un peu, recule-toi.
Je rampai vers le siège du chauffeur et j'entendis tomber des caisses sur le plancher du véhicule.
Le camion démarra de nouveau, tressautant sur les mauvais chemins. Bientôt il s'arrêta, et une voix rude hurla :
— Qu'est-ce que vous trimbalez, les gars ?
— Rien que des détritus, m'sieur, répondit le Noir.
Des pas lourds s'approchèrent. Quelque chose sonda les caisses à l'arrière du camion.
— Ça va, dit la voix, pouvez partir.
Une porte claqua, le Noir embraya et nous repartîmes dans la nuit. J'eus l'impression que nous roulions pendant des heures, puis le camion fit un brusque virage et s'arrêta. La bâche fut soulevée et je vis le Lascar et le Noir qui me souriaient de toutes leurs dents. Je me levai péniblement et cherchai mon argent.
— Je vais vous payer, dis-je.
— Rien du tout, dit le Noir.
— Butch m'aurait tué avant qu'on arrive à New York, déclara le Lascar. Tu m'as sauvé, à présent je te sauve ; on a lutté tous les deux contre la discrimination raciale. Viens.
"La race, la religion et la couleur n'ont pas d'importance, me dis-je. Tous les hommes saignent rouge." Ils me conduisirent dans une pièce bien chauffée où se trouvaient deux mulâtresses. Bientôt, enveloppé de couvertures, je mangeai un repas chaud. Puis ils me montrèrent un endroit où je pourrais dormir et je sombrai dans le sommeil.
Chapitre Sept
Je dormis deux jours et deux nuits, mon corps épuisé flottant entre deux mondes. La vie avait toujours été dure pour moi, j'avais été victime de la souffrance et de l'incompréhension, mais, à présent, je dormais.
J'avais laissé mon corps derrière moi, sur la Terre. Alors que je commençais l'ascension, je vis l'une des femmes jeter sur mon enveloppe vide un regard empreint d'une compassion profonde. Puis elle se détourna et s'approcha d'une fenêtre pour contempler la rue sordide. Libéré des chaînes corporelles, je pouvais distinguer plus clairement encore les couleurs de l'astral. Ces gens, ces gens de couleur, qui me venaient en aide alors que les hommes de race blanche ne savaient que persécuter, étaient bons. Les souffrances et les épreuves avaient épuré leur ego et leur attitude insouciante ne cherchait qu'à dissimuler leurs sentiments intimes. Mon argent, tout ce que j'avais si péniblement, si durement amassé, était glissé sous mon oreiller, aussi en sûreté chez ces gens-là que dans la banque la plus solide.
Je montai de plus en plus haut, laissant les confins du temps et de l'espace, passant d'un plan astral à un autre. Enfin, j'atteignis le Pays de la Lumière Dorée, où m'attendait mon Guide, le Lama Mingyar Dondup.
— Tu as vraiment subi de grandes épreuves, me dit-il, mais tout ce que tu as enduré avait sa raison d'être. Nous avons étudié les habitants de la Terre, et les membres des cultes étranges, néfastes, qui t'ont persécuté et te persécuteront encore, car ils manquent de compréhension. Mais nous devons, à présent, discuter de ton avenir. Ton corps actuel touche à la fin de son existence féconde et les plans que nous avons faits en vue de cet événement doivent être exécutés.
Il marchait à mes côtés, le long d'une rivière admirable. L'eau étincelante semblait douée de vie. Chacune des rives était ornée de jardins si merveilleux que je pouvais à peine en croire mes sens. L'air lui-même donnait l'impression de vibrer. Au loin, un groupe d'hommes, vêtus de costumes tibétains, s'avançait à notre rencontre. Mon Guide me sourit.
— La réunion va être importante, dit-il, car nous allons discuter de ton avenir. Nous voulons voir comment il est possible de stimuler les recherches sur l'Aura humaine, car nous avons remarqué que lorsque le terme de ‘Aura’ est mentionné sur Terre, la plupart des gens essayent de détourner la conversation.
Le groupe approchait et je reconnus ceux qui m'avaient inspiré un respect mêlé de crainte. À présent, ils me souriaient avec bienveillance et m'accueillaient comme un égal.
— Allons nous installer dans un endroit plus confortable, dit l'un d'eux, afin de pouvoir discuter à notre aise. Nous suivîmes le sentier dans la direction d'où ces hommes étaient venus et, à un tournant, j'aperçus un Hall d'une beauté telle, qu'involontairement je m'arrêtai, avec une exclamation de plaisir. Les murs semblaient faits du cristal le plus pur, avec des tons pastel et de délicats reflets chatoyants. Le sentier était doux sous les pieds et mon Guide n'eut pas à insister pour me faire entrer.
J'eus l'impression de me trouver dans un vaste Temple, un Temple clair, propre, et l'atmosphère qui y régnait faisait comprendre que cela, c'était la Vie. Nous traversâmes le corps principal du bâtiment, et arrivâmes à ce que, sur Terre, j'aurais appelé la Chambre du Père Abbé. D'une simplicité confortable, elle s'ornait d'une seule image représentant la Réalité Supérieure. Des plantes vertes grimpaient aux murs, et par les larges fenêtres, on pouvait apercevoir un parc superbe.
Nous nous assîmes sur des coussins posés à même le sol, comme au Tibet. Je me sentais chez moi, presque heureux. Toutefois, j'étais inquiet en songeant à mon corps resté sur la Terre, car, tant que la Corde d'Argent demeurait intacte, je serais forcé de retourner en bas. L'Abbé — je lui donne ce titre, quoique le sien fût bien supérieur — jeta un regard autour de lui, et prit la parole :
— D'ici, nous avons suivi tout ce qui t'est arrivé sur Terre. Nous voulons d'abord te rappeler que tu ne souffres pas des effets d'un Karma, mais que tu es pour nous un instrument d'études. Tu seras récompensé de toutes les épreuves que tu endures actuellement. (Il me sourit et ajouta :) Bien que cette perspective soit une piètre consolation lorsque l'on souffre sur Terre ! Toutefois, poursuivit-il, nous avons beaucoup appris, mais certains problèmes attendent encore une solution. Ton corps actuel a trop souffert et te fera bientôt défaut. Nous avons établi un contact au pays d'Angleterre. Cet homme veut quitter son corps. Nous l'avons transporté sur le plan astral et avons discuté avec lui. Il désire vivement partir et fera tout ce que nous lui demanderons. Sur notre requête, il a changé son nom pour en prendre un qui te conviendra mieux. Sa vie n'a pas été heureuse, il s'est volontairement détaché de ses proches. Il ne s'est jamais fait d'amis. Il est sur la même harmonique que toi. Pour le moment, nous ne t'en parlerons pas davantage, car, plus tard, avant que tu prennes possession de son corps, tu te familiariseras avec son genre d'existence. Ta tâche présente est de faire revenir ton corps au Tibet, afin qu'il puisse être préservé. Tu as gagné de l'argent par tes efforts et tes sacrifices, tu n'as plus besoin que d'une petite somme pour payer le voyage. Tu l'obtiendras grâce à tes efforts soutenus. Mais cela suffit pour le moment. Aujourd'hui, profite de ta visite ici avant de retourner dans ton corps.
C'était le suprême bonheur, en effet, que d'être avec mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, non plus comme un enfant, mais comme un adulte, capable d'apprécier les capacités et le caractère extraordinaire de ce grand homme. Nous nous assîmes tous deux sur une colline moussue, dominant une baie où l'eau était d'un bleu intense ; les arbres se balançaient sous la brise légère et nous envoyaient les effluves des pins et des cèdres. Pendant des heures, nous nous entretînmes, discutant du passé. Mon histoire était pour lui un livre ouvert et il me parlait maintenant de la sienne. Ainsi s'écoula la journée et lorsque le crépuscule violet tomba sur moi, je compris qu'il était temps de repartir pour cette Terre d'angoisse avec ses hommes amers aux langues mauvaises, langues responsables de tous les maux de la Terre.
— Hank ! Oh, Hank ! Il est réveillé !
J'entendis une chaise racler le plancher, et en ouvrant les yeux, je vis le grand Noir qui me regardait. Il ne souriait pas, son visage exprimait le respect, et même la crainte. La femme se signa et s'inclina légèrement devant moi.
— Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? demandai-je.
— Nous avons vu un miracle. Nous l'avons tous vu.
Le grand Noir parlait d'une voix basse.
— Vous ai-je causé quelque ennui ? questionnai-je.
— Non, Maître, vous ne nous avez causé que de la joie, répondit la femme.
— Je voudrais vous faire un cadeau, dis-je en étendant ma main vers mon argent.
Le Noir dit doucement :
— Nous sommes de pauvres gens, mais nous ne prendrons pas votre argent. Cette maison est la vôtre jusqu'à ce que vous soyez prêt à partir. Nous, nous savons ce que vous faites.
— Mais j'aimerais vous prouver ma gratitude, répondis-je, sans vous, je serais mort.
— Et parti vers la Gloire Divine ! dit la femme qui ajouta : Maître, vous pouvez nous donner mieux que de l'argent. Apprenez-nous à prier !
Pendant un moment, je demeurai silencieux, stupéfait par cette requête.
— Oui, dis-je. Je vais vous apprendre à prier, comme on me l'a appris.
"Toutes les religions croient au pouvoir de la prière, mais rares sont ceux qui comprennent le mécanisme du procédé, rares sont ceux qui comprennent pourquoi les prières sont exaucées pour certains alors qu'apparemment, elles ne le sont pas pour d'autres. La plupart des Occidentaux croient que les gens de l'Est prient devant une image taillée ou qu'ils ne prient pas du tout. C'est faux dans les deux cas et je vais vous dire maintenant comment vous pouvez soustraire la prière du domaine du mysticisme et de la superstition et vous en servir pour aider les autres, car c'est, en vérité, une force très réelle, l'une des plus grandes de cette Terre lorsqu'elle est employée comme elle doit l'être.
"La plupart des religions affirment que chaque être a son Ange Gardien ou quelqu'un qui veille sur lui. Cela est vrai, mais cet Ange Gardien n'est autre que soi-même, l'autre soi-même, celui qui se trouve de l'autre côté de la vie. Rares, très rares sont ceux qui sur Terre peuvent voir cet ange, ce Gardien, mais ceux qui le peuvent sont capables de le décrire avec précision.
"Ce Gardien (nous devons lui donner un nom, appelons-le donc ainsi) ne possède pas de corps matériel pareil au nôtre. Il a une apparence spectrale ; parfois un clairvoyant le verra comme une forme bleue, scintillante, plus grande que nature et reliée au corps de chair par ce que l'on nomme la Corde d'Argent, cette Corde douée de vie qui palpite et brille en transmettant les messages d'un corps à l'autre. Quoique n'ayant pas de corps matériel, ce Gardien est cependant capable de faire certaines des choses que fait notre corps, et beaucoup d'autres dont ce dernier est incapable. Par exemple, le Gardien peut se rendre à la vitesse de l'éclair dans n'importe quelle partie du monde. C'est lui qui voyage dans l'astral et transmet au corps, grâce à la Corde d'Argent, ce dont il a besoin.
"Lorsque vous priez, c'est à vous-même que vous vous adressez, à votre autre moi, à votre Moi Supérieur. Si nous savions prier convenablement, nous enverrions ces prières par la Corde d'Argent, car la ligne téléphonique dont nous nous servons est un instrument très médiocre et nous devons nous répéter afin d'être sûrs que le message arrive à destination. Donc, quand vous priez, parlez comme vous parleriez au téléphone à un interlocuteur très éloigné, parlez avec une clarté absolue, et pensez bien à ce que vous dites. La faute, je dois le dire, nous est imputable, elle est imputable au corps imparfait qui est le nôtre sur cette Terre, et non à notre Gardien. Employez un langage simple, faites en sorte que vos requêtes soient toujours positives et jamais négatives.
"Après avoir formulé votre prière de façon absolument positive et absolument claire, pour éviter toute possibilité d'erreur, répétez cette prière à trois reprises. Prenons un exemple : supposons que vous connaissiez une personne malade et que vous vouliez faire quelque chose pour elle ; vous devriez prier pour que ses souffrances s'atténuent. Vous devriez faire trois fois exactement la même prière. Vous devriez imaginer cette forme spectrale, immatérielle, se rendant chez la personne en question en suivant la route que vous suivriez vous-même, entrant dans la maison, posant les mains sur le malade et le guérissant. Je reviendrai dans un instant sur ce point en particulier, mais laissez-moi vous dire d'abord ceci : répétez l'expérience autant de fois qu'il le faudra et, si vous y croyez sincèrement, vous obtiendrez un résultat.
"Parlons de la guérison complète : si un homme a été amputé d'une jambe, aucune prière ne lui rendra cette jambe. Mais s'il a un cancer ou quelque autre maladie grave, alors cela peut être arrêté. Il est évident que plus le mal est bénin, plus la guérison par la prière est facile. Tout le monde a entendu parler de guérisons miraculeuses survenues dans l'histoire de notre planète. Lourdes et de nombreux autres endroits sont réputés dans ce domaine ; ces résultats sont obtenus par l'autre soi-même, par le Gardien du malade, et aussi grâce à la renommée du lieu. Lourdes, par exemple, est connu dans le monde entier comme une ville où des miracles se produisent, et les gens s'y rendent avec la ferme conviction qu'ils vont guérir ; cette conviction est très souvent transmise au Gardien de la personne, de sorte que la guérison s'effectue très, très facilement. Certains aiment à penser qu'elle est due à un saint, à un ange ou à quelque ancienne relique, mais en réalité, chacun se guérit lui-même et si un guérisseur se met en rapport avec un malade avec la ferme intention de lui venir en aide, la guérison a lieu simplement par l'intermédiaire du Gardien de ce malade. Comme je vous l'ai dit, tout se ramène à vous-même, à ce Moi réel que vous deviendrez lorsque vous quitterez cette vie brumeuse pour entrer dans la Réalité Supérieure. Pendant notre séjour sur Terre, nous nous imaginons que seule cette vie compte, mais la Terre, ce monde... non, c'est le Monde de l'Illusion, un monde d'épreuves, où nous venons apprendre les leçons qu'il est plus malaisé d'apprendre dans les mondes meilleurs, plus nobles, où nous retournerons.
"Vous pouvez avoir vous-même quelque infirmité, vous pouvez être malade, ou être dépourvu du pouvoir ésotérique que vous désireriez avoir. Il est possible de remédier à tout cela, si vous avez la foi et si vous le voulez véritablement. Supposons que vous éprouviez le désir ardent d'aider les autres ; que vous vouliez devenir guérisseur. Alors, priez dans le secret de votre chambre. Il faut que vous preniez la position où vous vous sentirez le plus détendu, les pieds joints, de préférence, les doigts croisés, non point dans l'attitude habituelle de la prière, mais entrecroisés. De cette façon, vous gardez et vous amplifiez le circuit magnétique du corps et l'Aura se fortifie, la Corde d'Argent est capable de transmettre les messages avec plus de précision. Puis, vous étant mis dans la position voulue et dans l'état d'esprit voulu, vous prierez.
"Vous pourrez dire par exemple : ‘Donne-moi le pouvoir de guérir, afin que je puisse guérir mon prochain. Donne-moi le pouvoir de guérir, afin que je puisse guérir mon prochain. Donne-moi le pouvoir de guérir, afin que je puisse guérir mon prochain.’ Puis, demeurez quelques instants dans cette attitude de détente, et imaginez-vous englobé dans le contour ombragé de votre propre corps.
"Ainsi que je vous l'ai dit précédemment, vous devez évoquer mentalement la route que vous prendriez pour aller chez le malade, et faire alors voyager en imagination ce corps jusqu'au domicile de la personne que vous désirez guérir. Imaginez votre Moi Supérieur arrivé dans cette maison, en présence du malade que vous voulez aider. Imaginez que vous tendez le bras, la main, que vous touchez cette personne. Imaginez un flot d'énergie qui donne la vie passant dans votre bras, dans vos doigts, et se transmettant au malade comme une intense lumière bleue. Imaginez que la personne guérit, graduellement. Avec la foi et un peu de pratique, on parvient à ce résultat ; en Extrême-Orient, on y arrive, chaque jour.
"Il est bon de placer, en esprit, une main sur la nuque du malade et l'autre sur la partie malade ou au-dessus. Il vous faudra prier votre propre Moi un certain nombre de fois, chaque jour, par groupe de trois prières, jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat désiré. Et si vous avez la foi, vous réussirez. Mais laissez-moi vous donner un grave, un très grave avertissement : ce n'est pas de cette façon que vous gagnerez de l'argent. Il existe une très ancienne loi occulte qui interdit que l'on tire profit des prières intéressées. Vous ne pourrez rien obtenir si vous ne cherchez pas à venir en aide aux autres et si vous n'êtes pas persuadés que vous viendrez en aide aux autres. Je connais le cas d'un homme qui jouissait d'une bonne aisance ; il se disait que s'il gagnait au Sweepstake irlandais, il en ferait profiter les autres, il deviendrait un bienfaiteur de l'humanité.
"Ayant quelques notions, insuffisantes toutefois, des sujets ésotériques, il établit ses plans ; il commença par exécuter un programme de prières soigneusement établi. Il pria pendant deux mois selon les principes énoncés dans ce chapitre ; il demanda de tomber sur le gagnant du Sweepstake irlandais. Pendant deux mois, il dit trois prières à la suite, trois fois par jour, soit neuf en tout, quotidiennement. Comme il s'y attendait, il gagna l'un des lots les plus importants du Sweepstake.
"Cet argent lui monta à la tête. Il oublia ses bonnes intentions, ses promesses. Il oublia tout, sauf qu'il possédait cette fortune et qu'il pouvait se permettre tout ce dont il avait envie. Et il la consacra à satisfaire ses propres désirs. Pendant quelques mois, il s'amusa royalement, temps durant lequel il s'endurcit de plus en plus, et alors la loi inexorable entra en action. Au lieu de garder cet argent et aider les autres, il le perdit entièrement et il perdit aussi tout ce qu'il possédait auparavant. Finalement il mourut et fut enterré dans la fosse commune.
"Je vous le dis, si vous utilisez convenablement le pouvoir de la prière, sans songer à votre propre intérêt, sans ambition personnelle, vous aurez puisé à l'une des plus grandes sources d'énergie de l'univers, une force si grande que si une poignée de gens sincères se réunissaient et priaient pour la paix, la paix régnerait, les guerres et les pensées de guerre disparaîtraient."
Je me tus et le silence tomba, pendant que mes hôtes réfléchissaient à ce que je venais de leur dire. Puis la femme s'adressa à moi :
— Je souhaiterais que vous restiez ici encore un certain temps et que vous nous appreniez encore bien des choses ! Nous avons été témoins d'un miracle, mais Quelqu'un est venu et nous a dit de ne pas en parler.
Je me reposai encore quelques heures, puis m'habillai et écrivis à mes amis haut placés de Shanghaï. Je leur racontai ce qu'il était advenu de mes papiers. Ils m'envoyèrent par avion un nouveau passeport qui me fut d'un grand secours. Et je reçus aussi, par avion, une lettre d'une femme très riche :
"Il y a un certain temps que je cherche à trouver votre adresse, m'écrivait-elle. Ma fille, que vous avez sauvée des Japonais, est maintenant avec moi, complètement rétablie. Vous lui avez épargné le viol ou pis encore et je voudrais payer, au moins en partie, notre dette envers vous. Dites-moi ce que je peux faire pour vous."
Je lui répondis que je voulais rentrer chez moi, au Tibet, pour y mourir.
"J'ai de quoi acheter un billet pour un port des Indes, écrivis-je, mais pas assez pour traverser ce pays. Si vous voulez vraiment me rendre service, procurez-moi un billet de Bombay à Kalimpong." Je n'avais pas pris la chose au sérieux, mais deux semaines plus tard, je reçus une lettre contenant un billet de première classe pour le bateau et des billets de train pour le trajet jusqu'à Kalimpong. J'écrivis aussitôt à cette femme pour lui exprimer ma gratitude, et je lui dis que j'avais l'intention de donner mon autre argent aux Noirs qui avaient été si bons pour moi.
Mes amis Noirs étaient tristes de me voir partir, mais ils se réjouissaient de savoir que, pour une fois dans ma vie, je pourrais voyager confortablement. J'eus beaucoup de mal à leur faire accepter l'argent et, en fin de compte, nous le partageâmes ! La femme Noire me dit :
— Vous saviez que cette somme devait arriver parce que c'était pour une bonne cause. Avez-vous envoyé ce que vous appelez une ‘forme-pensée’ ?
— Non, répondis-je, c'est une source très éloignée de ce monde qui a dû agir.
Elle parut intriguée :
— Vous avez dit que vous nous parleriez des formes-pensées avant votre départ. En aurez-vous le temps ?
— Oui, répondis-je, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire.
Elle s'assit et joignit les mains. Son mari éteignit la lumière et s'adossa à son fauteuil. Je commençai :
— Près des sables brûlants, parmi les bâtiments de pierre grise, éclairés par le soleil implacable, un petit groupe d'hommes longeait les rues étroites. Ils s'arrêtèrent, quelques instants plus tard, devant une porte d'aspect misérable, frappèrent et entrèrent. Quelques phrases furent prononcées à voix basse et les hommes reçurent des torches qui grésillaient et crachaient des gouttes de résine. Lentement, ils suivirent les corridors, s'enfonçant de plus en plus dans les sables d'Égypte. L'atmosphère était étouffante, écœurante. Elle s'insinuait dans les narines, collait aux muqueuses d'une manière qui donnait la nausée.
"La seule lumière venait des porteurs de torches qui marchaient en tête de la petite procession. Au fur et à mesure qu'ils pénétraient dans la salle souterraine, l'odeur s'accentuait : l'odeur de l'Encens, de la Myrrhe, et des étranges herbes exotiques de l'Orient. Il flottait aussi un relent de mort, de décrépitude, de végétation pourrissante.
Contre le mur du fond se trouvait une collection de vases canopes, contenant les cœurs et les entrailles de gens que l'on embaumait. Ces vases étaient soigneusement étiquetés, afin que l'on en sût le contenu exact et la date de l'apposition des scellés. La procession passa devant sans émotion et continua son chemin jusqu'aux bains de Nitre, où les corps devaient demeurer immergés quatre-vingt-dix jours. Des cadavres y flottaient et, de temps à autre, un aide en retournait un à l'aide d'une longue perche. Jetant à peine un regard à ces corps flottants, la procession entra dans la chambre intérieure. Là, le corps du Pharaon défunt, emmailloté de bandelettes de toile, poudré d'herbes parfumées, et oint d'onguents, était étendu sur des planches de bois odoriférants.
"Les hommes entrèrent ; quatre porteurs prirent le cadavre et le placèrent dans un cercueil provisoire, en bois léger, qui avait été posé contre le mur. Le hissant sur leurs épaules, ils se tournèrent et, suivant les porteurs de torches, sortirent de la chambre souterraine, repassèrent devant les bains de nitre et quittèrent les salles des embaumeurs d'Égypte. Plus près de la surface du sol, le corps fut transporté jusqu'à une autre pièce, où la lumière du jour ne pénétrait que faiblement. Là, il fut sorti du cercueil de bois grossier et placé dans un autre, ayant la forme exacte du corps. Les mains furent croisées sur la poitrine et étroitement enveloppées de bandages. On y noua un papyrus relatant l'histoire du mort.
"Quelques jours plus tard, arrivèrent dans cette salle les prêtres d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Ils chantèrent les prières préliminaires, afin de conduire l'âme à travers les Enfers. C'est là aussi que sorciers et magiciens de l'ancienne Égypte préparaient leurs Formes-Pensées, Formes-Pensées qui veilleraient sur le corps du mort et empêcheraient les vandales de profaner la tombe et d'en troubler la paix.
"Dans tout le pays d'Égypte, on proclamait ensuite les châtiments que subirait quiconque profanerait la tombe : d'abord on lui arracherait la langue, on lui couperait les deux mains ; quelques jours plus tard, il serait éviscéré et enterré jusqu'au cou dans le sable brûlant où se terminerait son agonie.
"La tombe de Toutânkhamon est célèbre à cause de la malédiction qui s'abattit sur ses profanateurs. Tous ceux qui sont entrés dans la sépulture de Tout Ankh Amon sont morts ou ont souffert de mystérieuses et incurables maladies.
"Les prêtres de l'Égypte possédaient une science que le monde actuel a perdue, le pouvoir de créer des Formes-Pensées pour accomplir des tâches au-delà des capacités du corps humain. Mais cette science aurait fort bien pu ne pas s'éteindre, car n'importe qui, avec un peu de pratique et de persévérance, peut créer une forme-pensée qui agira pour le bien ou pour le mal.
"Quel est le poète qui a écrit : ‘Je suis le capitaine de mon âme’ ? Cet homme a dit là une vérité profonde, plus profonde qu'il ne le croyait, peut-être, car l'être humain est, en fait, le capitaine de son âme. Les Occidentaux s'intéressent aux choses matérielles, aux choses mécaniques, à tout ce qui touche au monde terrestre. Ils ont essayé d'explorer l'Espace, mais ils n'ont pas réussi à explorer le plus profond de tous les mystères : le sub-conscient de l'Homme ; car l'Homme est, pour les neuf dixièmes, sub-conscient, ce qui revient à dire qu'il n'est que pour un dixième dirigé par le conscient. Un dixième seulement du potentiel de l'être humain est soumis aux commandements de sa volonté. Si le conscient absorbe un dixième et demi de sa personnalité, alors l'homme est un génie, mais, sur cette Terre, les génies ne sont tels qu'en un seul domaine. Ils sont souvent très déficients dans les autres.
"Les Égyptiens qui vivaient aux temps des Pharaons connaissaient bien le pouvoir du sub-conscient. Ils enterraient leurs Pharaons dans des tombes profondes et grâce à leurs arts, à leur connaissance de l'humanité, ils forgeaient des sortilèges. Ils créaient des Formes-Pensées qui gardaient les sépulcres des Pharaons défunts et empêchaient les intrus d'y entrer, sous peine de graves maladies.
"Vous pouvez créer des Formes-Pensées qui feront le bien, mais faites en sorte qu'elles soient vraiment bénéfiques, car une Forme-Pensée ne peut distinguer le bien du mal. Elle servira l'un comme l'autre mais, en fin de compte, la Forme-Pensée maléfique attirera la vengeance sur son créateur.
"Le conte d'Aladin n'est autre que l'histoire d'une Forme-Pensée que l'on a pu faire apparaître. Elle est fondée sur une des vieilles légendes chinoises, qui sont littéralement vraies.
"L'imagination est la plus grande force de la Terre. Malheureusement ce terme est mal compris. Quand on parle d'imagination, on pense aussitôt à un être frustré, en proie à des névroses, alors que rien n'est plus éloigné de la vérité. Tous les grands artistes, tous les grands peintres, tous les grands écrivains doivent posséder une imagination brillante, maîtrisée, sinon ils seraient incapables de se représenter sous sa forme définitive la chose qu'ils s'efforcent de créer.
"Si, dans la vie quotidienne, nous exploitions l'imagination, nous accomplirions ce que nous considérons à présent comme des miracles. Il peut arriver, par exemple, qu'un être qui nous est cher souffre d'une maladie à laquelle la médecine n'a pas encore trouvé remède. Cette personne est susceptible de guérir, si l'on crée une Forme-Pensée qui entrera en contact avec le Moi Supérieur du malade et qui aidera ce Moi Supérieur à se matérialiser pour créer de nouvelles parties d'organes. C'est ainsi qu'un diabétique pourrait, avec l'aide adéquate, recréer les parties endommagées du pancréas qui ont causé le mal.
"Comment pouvons-nous créer une Forme-Pensée ? Eh bien, c'est facile. Nous allons en parler maintenant. Il faut d'abord décider ce que l'on veut obtenir et être certain que cela soit pour le bien. Puis il faut faire entrer l'imagination en jeu, visualiser avec exactitude le résultat cherché. Supposons qu'une personne ait un organe attaqué par la maladie. Si nous voulons créer une Forme-Pensée qui lui vienne en aide, nous devons visualiser avec exactitude cette personne debout devant nous. Nous devons essayer de visualiser l'organe affecté. Ayant l'organe affecté en image devant nous, nous devons le visualiser en train de guérir et nous devons transmettre une affirmation positive. Ainsi, nous créons cette Forme-Pensée en visualisant la personne, nous imaginons la Forme-Pensée debout à côté de la personne atteinte et avec des pouvoirs supra-normaux, pénétrant à l'intérieur du corps de cette personne malade et faisant disparaître la maladie par un contact qui guérit.
"À tout moment nous devons parler d'une voix ferme et positive à la Forme-Pensée que nous avons créée. À aucun moment il ne doit y avoir le moindre soupçon de négativité, ni d'indécision. Nous devons employer le langage le plus simple possible et de la manière la plus directe possible. Nous devons lui parler comme si nous nous adressions à un enfant très retardé, parce que cette Forme-Pensée est dépourvue de raison et ne peut accepter qu'un commandement direct ou une simple déclaration.
"S'il y a une plaie sur un organe, nous devons dire à la Forme-Pensée : ‘À présent, tu vas guérir tel ou tel organe. Le tissu est en train de se reconstituer.’ Il faut répéter ces mots plusieurs fois par jour et si vous visualisez votre Forme-Pensée en train d'agir, alors elle agira. Elle le faisait chez les Égyptiens, elle peut le faire à l'époque actuelle.
"On connaît de nombreux cas authentiques où les tombes ont été hantées par une silhouette spectrale. Cela s'explique par le fait que les morts, ou d'autres gens, ont pensé avec une force telle qu'ils ont véritablement créé un ectoplasme. Aux temps des Pharaons, les Égyptiens enterraient le corps embaumé des monarques, mais ils avaient recours à des mesures extrêmes afin que, même après des millénaires, leurs Formes-Pensées gardent leur pouvoir. Ils infligeaient à des esclaves une mort lente et cruelle, leur affirmant qu'ils cesseraient de souffrir dans l'autre monde si, en mourant, ils fournissaient la substance nécessaire à la création d'une Forme-Pensée solide. Les documents archéologiques font état de cas de hantises et de malédictions dont les profanateurs de tombes ont été victimes. Ces phénomènes ne sont que le résultat de lois absolument naturelles, absolument normales.
"N'importe qui, avec un peu de pratique, est en mesure d'émettre des Formes-Pensées, mais c'est le Bien qu'il faut vouloir, car si vous cherchez à faire le Mal, la Forme-Pensée se retournera contre vous et vous causera le plus grand tort, sur les plans physique, mental ou astral."
Les jours suivants s'écoulèrent dans la fièvre ; il me fallait obtenir les visas de transit, faire mes derniers préparatifs, expédier diverses choses à mes amis de Shanghaï. J'emballai soigneusement ma boule de cristal et l'envoyai là-bas, où je comptais m'en resservir ; je fis de même pour mes papiers chinois, que, soit dit en passant, un grand nombre de gens dignes de foi ont eus sous les yeux.
Je ne gardai que le minimum de mes possessions personnelles, c'est-à-dire un complet et quelques sous-vêtements. Ayant perdu toute confiance en l'administration, je fis faire des photocopies de tout — passeport, billet, certificats médicaux et tout !
— Me conduirez-vous au bateau ? demandai-je à mes amis noirs.
— Non, me répondirent-ils, nous ne serions pas admis là-bas, à cause des lois raciales.
Le jour du départ arriva et je me rendis aux docks par l'autobus. Au moment où, muni de ma petite valise, je présentais mon billet, on me demanda où se trouvait le reste de mes bagages.
— C'est tout ce que j'ai, répondis-je.
Le fonctionnaire me jeta un regard stupéfait... et soupçonneux. "Attendez ici", murmura-t-il et il se précipita vers son bureau. Quelques minutes plus tard, il revenait accompagné d'un sous-chef.
— Est-ce là tout ce que vous avez comme bagages, monsieur ? me demanda-t-il.
— Oui, dis-je.
Fronçant les sourcils, il examina mes billets, vérifia sur un registre, puis s'éloigna en emportant le tout. Dix minutes plus tard, il revenait, l'air fort perplexe, et me rendait mes billets ainsi que d'autres papiers, en disant :
— Tout ceci est très irrégulier... aller aux Indes sans bagages...
L'autre employé avait apparemment décidé de se laver les mains de toute cette affaire, car il se détourna et refusa de me répondre lorsque je lui demandai l'emplacement du bateau.
Je regardai les papiers que je venais de recevoir et vis que parmi eux se trouvait une Carte d'Embarquement, donnant tous les détails voulus.
Le trajet jusqu'au navire était assez long et lorsque j'arrivai à l'embarcadère, je vis que plusieurs policiers y observaient attentivement les passagers. J'avançai, montrai mon billet et grimpai la passerelle. Une heure plus tard environ, deux hommes entrèrent dans ma cabine et me demandèrent pourquoi je n'avais pas de bagages.
— Mais, mes chers amis, leur dis-je, je croyais que les États-Unis étaient le pays de la liberté ? Pourquoi faudrait-il que je m'embarrasse de bagages ? Ce que j'emporte me regarde, non ?
L'un d'eux murmura quelque chose, tripota des papiers et répondit finalement :
— Nous devons nous assurer que tout est en règle. L'employé a cru que vous essayiez d'échapper à la justice, parce que vous n'aviez pas de bagages. Il faisait simplement son travail.
Je montrai ma valise :
— Tout ce dont j'ai besoin est là-dedans ; cela me suffira jusqu'à mon arrivée aux Indes ; là-bas m'attendent d'autres bagages.
Il parut soulagé :
— Ah ! donc, vous avez d'autres bagages aux Indes ? Alors, ça va bien.
Je souris en moi-même, car je pensai : "Les seules fois où j'ai du mal à entrer dans un pays ou à le quitter, c'est lorsque je le fais légalement, en possession de tous les papiers exigés par le Sacro-Saint règlement."
La vie à bord fut monotone : les autres passagers avaient un complexe de classe, et le fait que je n'aie apporté ‘qu'une seule valise’ me mettait apparemment au ban de la société. Parce que je ne me conformais pas aux canons du snobisme, j'étais aussi solitaire qu'un prisonnier dans sa cellule, mais du moins pouvais-je aller et venir à ma guise. Et cela m'amusait de voir les autres passagers demander à un steward d'installer leurs transatlantiques un peu plus loin du mien.
Nous entrâmes dans le détroit de Gibraltar, traversâmes la Méditerranée, fîmes escale à Alexandrie, touchâmes Port-Saïd, prîmes le Canal de Suez et pénétrâmes en Mer Rouge. La chaleur m'incommodait fortement, la Mer Rouge semblait bouillonner, mais le bateau finit par en sortir et il traversa la Mer d'Oman pour jeter l'ancre à Bombay, but de la traversée. J'avais quelques amis dans cette ville, des prêtres Bouddhistes et autres, et je passai une semaine en leur compagnie avant de continuer mon voyage à travers l'Inde, vers Kalimpong. Kalimpong fourmillait d'espions Communistes et de journalistes. Les nouveaux arrivants avaient la vie empoisonnée par les questions incessantes et ineptes qu'on leur posait ; quant à moi je les laissai sans réponse et continuai ce que j'avais à faire. Ce penchant des Occidentaux à s'occuper des affaires des autres m'a toujours stupéfié. Je ne l'ai jamais compris.
Je fus heureux de quitter Kalimpong et d'entrer dans mon propre pays, le Tibet. On m'y attendait et je fus accueilli par un groupe de lamas déguisés en moines mendiants et en marchands. Ma santé déclinait rapidement et nécessitait des haltes fréquentes. Enfin, dix semaines plus tard environ, nous atteignîmes une lamaserie isolée, sur les hauteurs de l'Himalaya, et dominant la vallée de Lhassa, une lamaserie si petite et si inaccessible que les Communistes chinois s'en désintéressaient.
Je me reposai là quelques jours, essayant de reprendre un peu de forces ; je me reposai et méditai. J'étais chez moi à présent, et heureux pour la première fois depuis des années. Les mensonges, les trahisons des Occidentaux ne me semblaient plus être qu'un cauchemar. Quotidiennement, de petits groupes d'hommes venaient me trouver pour m'informer des événements survenus au Tibet et moi je leur racontais les mœurs étranges et impitoyables du monde qui s'étendait au-delà de nos frontières.
J'assistai à tous les Services, puisant le réconfort et la consolation dans les rites familiers. Pourtant, j'étais un homme à part, un homme sur le point de mourir et de revivre à nouveau. Un homme sur le point de connaître l'une des plus étranges expériences qui puissent arriver à une créature humaine. Pourtant, était-elle si étrange ? Beaucoup de nos Adeptes supérieurs la faisaient, au cours de leurs vies successives. Le Dalaï-Lama lui-même prenait, à chaque nouvelle existence, le corps d'un nouveau-né. Mais moi, j'allais prendre le corps d'un adulte et le modeler sur le mien, en changeant non seulement l'ego, mais le corps tout entier, molécule par molécule. Bien que n'étant pas Chrétien, mes études à Lhassa m'avaient obligé à lire la Bible et à écouter des conférences à son sujet. Je savais qu'il y est dit que le corps de Jésus, fils de Marie et de Joseph, fut envahi par ‘l'Esprit du Fils de Dieu’ et devint le Christ. Je savais aussi que les prêtres Chrétiens s’étaient réunis en Concile en l'an soixante A.D. (abrév. Anno Domini : après J.-C. — NdT) et interdirent certains enseignements du Christ. La Réincarnation fut mise à l'index, la prise en charge du corps d'un autre fut aussi mise à l'index, tout comme de très nombreuses autres doctrines enseignées par le Christ.
Par ma fenêtre sans carreaux, je regardais la cité de Lhassa, tout en bas. J'avais du mal à réaliser que les Communistes exécrés en étaient les maîtres. Ils s'efforçaient par de magnifiques promesses de se concilier la jeunesse tibétaine. Nous appelions cela ‘le miel sur le couteau’ : plus on léchait le miel, plus vite on découvrait la lame tranchante. Des soldats chinois gardaient le Pargo Kaling, des soldats chinois étaient postés à l'entrée de nos temples, comme des piquets de grève dans le monde Occidental, et ils tournaient en ridicule notre religion millénaire. Ils insultaient les moines, les maltraitaient souvent, et on encourageait les paysans et les bergers illettrés à faire de même.
Ici, tout en haut de ce précipice presque inaccessible, nous étions à l'abri des Communistes. Toute la région environnante était parsemée de grottes et un seul sentier faisait le tour de l'extrême bord des falaises ; un faux pas et l'on tombait d'une hauteur de plus de deux mille pieds (610 m) dans le vide. Lorsque nous nous hasardions à sortir, nous portions des robes grises qui se fondaient avec la paroi rocheuse. Des robes grises qui nous dissimulaient aux yeux des Chinois, pourvus de jumelles.
Tout au loin, j'apercevais les spécialistes chinois armés de théodolites et de chaînes d'arpenteur. Ils s'affairaient comme des fourmis, enfonçant des piquets dans la terre, prenant des notes. Un moine passa devant un soldat, le Chinois lui donna un coup de baïonnette dans la jambe. Avec les jumelles aux verres vingt fois grossissants que j'avais ramenées d'Occident (mon seul luxe), je pus voir le sang jaillir et le sourire sadique du Chinois. Ces verres étaient bons ; ils me permettaient de distinguer le fier Potala et mon propre Chakpori. Mais j'étais intrigué : quelque chose manquait. Je rajustai les jumelles et regardai de nouveau. Rien ne bougeait sur le Lac du Temple du Serpent. Dans les rues de Lhassa, aucun chien ne flairait les piles de détritus. Pas de gibier d'eau, pas de chiens ! Je me retournai vers le moine qui se tenait à mes côtés. "Les Communistes les ont tous tués pour les manger", me dit-il. Les chiens ne travaillent pas, par conséquent, d'après les Communistes, ils n'ont pas le droit de manger, mais ils serviront à la nourriture des hommes. C'est un délit, à présent, que d'avoir un chien, un chat ou un animal familier. Je regardai le moine, horrifié. Un délit que d'avoir chez soi une bête amie ! Instinctivement, je tournai de nouveau les yeux vers le Chakpori. "Que sont devenus nos chats ?" demandai-je. "Tués et mangés", fut la réponse.
Je soupirai et songeai : "Ah ! si je pouvais dire au monde la vérité sur le Communisme, sur la façon dont ils traitent réellement les gens ! Si seulement les Occidentaux n'avaient pas les nerfs si sensibles !"
Je songeai à cette communauté de nonnes dont m'avait parlé un grand lama qui, au cours d'un voyage, en avait rencontré l'unique survivante. Celle-ci, avant de mourir dans ses bras, lui raconta la tragédie de cette communauté, dont le cloître avait été envahi par une bande déchaînée de soldats chinois. Ceux-ci profanèrent les Objets Sacrés et volèrent tout ce qui avait de la valeur. Ils dépouillèrent la vieille Supérieure de ses vêtements et l'enduisirent de beurre. Puis ils y mirent le feu et écoutèrent, avec des rires et des hurlements, ses cris de douleur. Lorsque, enfin, ce pauvre corps noirci fut étendu, immobile, sur le sol, un soldat l'ouvrit avec sa baïonnette pour s'assurer que la mort avait fait son œuvre.
Les religieuses les plus âgées, mises à nu et transpercées avec des lames chauffées à blanc, moururent dans d'atroces souffrances. Les nonnes les plus jeunes furent violées les unes devant les autres, et les soldats s'acharnèrent vingt à trente fois sur chacune d'elles pendant les trois jours où ils occupèrent le cloître. Lorsqu'ils furent las de ce ‘sport’ ou épuisés, ils eurent un dernier sursaut de sauvagerie. Ils mutilèrent certaines des femmes, en éventrèrent d'autres. D'autres, toujours nues, furent entraînées au-dehors dans le froid glacial.
Un petit groupe de moines qui se rendaient à Lhassa tomba sur elles et tentèrent de venir au secours de ces femmes en leur donnant leurs propres vêtements, dans l'espoir de conserver une faible lueur de vie chez ces malheureuses. Les soldats Communistes chinois, qui allaient eux aussi à Lhassa, se ruèrent sur les moines et les traitèrent avec une telle brutalité que certains faits ne peuvent être rapportés ici. Les moines, horriblement mutilés, nus, perdant leur sang, ne tardèrent pas à mourir. Une seule femme survécut ; elle était tombée dans un fossé et les bannières de prière, arrachées de leurs mâts par les Chinois, l'avaient dissimulée. Finalement, le lama et son acolyte arrivèrent sur la scène du drame et c'est des lèvres de la moribonde qu'ils apprirent toute l'histoire.
"Oh ! mettre le monde Occidental au courant des terreurs du Communisme", me dis-je, mais je découvris plus tard, à mes dépens, que l'on ne peut écrire ou dire la vérité en Occident. Toutes les horreurs doivent être édulcorées, recouvertes d'un vernis de ‘décence’. Les Communistes sont-ils ‘décents’ lorsqu'ils violent, mutilent et assassinent ? Si les Occidentaux voulaient écouter les comptes rendus véridiques de ceux qui ont souffert, ils s'épargneraient, en fait, semblables horreurs, car, pareil au cancer, le Communisme est insidieux, et tant que les gens considéreront cet abominable culte comme une simple politique différente, les peuples du monde seront en danger. En tant que victime du Communisme, je vous dis : "Montrez aux gens par les mots et par l'image (si horribles soient-ils) ce qui se passe derrière le ‘Rideau de Fer’."
Tandis que je ruminais ces choses, et que je scrutais périodiquement le paysage s'étendant sous mes yeux, un vieil homme, courbé et marchant avec une canne, entra dans ma chambre. Son visage était creusé par la souffrance, ses os saillaient sous une peau desséchée, tendue comme du parchemin. Voyant qu'il était aveugle, je me levai pour lui prendre le bras. Ses orbites luisaient comme des trous rouges et ses mouvements incertains trahissaient une cécité récente. Je l'assis auprès de moi et lui tins doucement la main, songeant que dans ce pays envahi, nous n'avions plus rien pour soulager ses souffrances et atténuer la douleur de ses orbites enflammées. Il sourit avec résignation et dit :
— Tu te demandes ce qui est arrivé à mes yeux, Frère. J'étais sur le Chemin Sacré, agenouillé devant un Reliquaire. Au moment où je me relevai, je regardai le Potala et par malheur un officier chinois se trouvait dans mon champ de vision. Il m'accusa de l'avoir fixé avec insolence. Je fus attaché par une corde à l'arrière de sa voiture et traîné le long du sol jusqu'à la place. Là, on rassembla des passants et, devant eux, on m'arracha les yeux et on me les jeta au visage. Je porte, ainsi que tu peux le voir, de nombreuses blessures à moitié guéries. J'ai été amené ici par d'autres et je suis heureux de t'accueillir.
Il ouvrit sa robe et je poussai une exclamation d'horreur, car son corps n'était qu'une plaie rouge. Je connaissais bien cet homme ; j'avais, comme Acolyte, étudié sous son égide les choses de l'esprit. Et, lorsque j'étais devenu lama, il avait été l'un de mes répondants. Il avait fait partie du groupe de lamas qui m'avaient accompagné loin au-dessous du Potala pour y subir la Cérémonie de la Petite Mort. À présent, il était à mes côtés et je savais que sa mort était proche.
— Tu as voyagé loin, et tu as vu et enduré bien des choses, me dit-il. À présent ma dernière tâche, dans cette Incarnation, est de t'aider à obtenir des aperçus, grâce aux Archives Akashiques, de la vie d'un certain Anglais qui a hâte de quitter son corps afin de pouvoir te le donner. Tu n'auras que de brèves visions de son existence, car cela demande beaucoup d'énergie et nous sommes tous deux à bout de forces. (Il se tut un instant et reprit, un léger sourire aux lèvres :) Cet effort mettra fin à ma propre vie et je suis heureux d'avoir, grâce à cette dernière tâche, l'occasion d'acquérir du mérite. Merci à toi, Frère, qui rends la chose possible. Lorsque tu reviendras ici de ton voyage dans l'Astral, je serai mort à tes côtés.
Les Archives Akashiques ! Quelle source merveilleuse de connaissance elles représentent ! Quelle pitié que les hommes n'aient pas exploré leurs possibilités au lieu de jouer avec les bombes atomiques. Tout ce que nous faisons, tout ce qui arrive est inscrit de façon indélébile sur l'Akasha, ce médium subtil qui imprègne toute matière. Tous les événements qui ont eu lieu sur Terre depuis que la Terre existe sont là, à la disposition de ceux qui ont la formation intellectuelle appropriée pour en prendre connaissance. L'histoire du monde s'y étale devant quiconque a les ‘yeux’ ouverts. D'après une ancienne prédiction, au siècle prochain, les savants seront capables d'utiliser les Archives Akashiques pour étudier l'Histoire. Il serait intéressant de savoir ce que Cléopâtre a vraiment dit à Marc-Antoine et quelles étaient les célèbres remarques de Mr Gladstone. Pour moi, ce serait un ravissement de voir la tête de mes critiques lorsqu'ils s'apercevront de leur stupidité, lorsqu'ils seront obligés d'admettre que j'avais bien écrit la vérité ; malheureusement, ni eux ni moi ne serons plus là.
Mais pouvons-nous expliquer plus clairement ce Registre Akashique ? Tout événement ‘impressionne’ ce médium qui imprègne jusqu'à l'air lui-même. Un son, dès qu'il est émis, un acte, dès qu'il est ébauché, y sont inscrits pour toujours. Avec les instruments adéquats, n'importe qui pourrait le voir. Considérez-le en termes de lumière ou de ces vibrations que nous appelons la lumière et la vue. La lumière voyage à une certaine vitesse. Comme le savent tous les hommes de science, nous voyons la nuit des étoiles qui n'existent peut-être plus. Certaines de ces étoiles sont tellement éloignées que la lumière émanant d'elles et nous arrivant aujourd'hui a peut-être commencé son voyage avant la création de cette Terre. Nous n'avons aucun moyen de savoir si l'étoile est morte il y a un million d'années, par exemple, car sa lumière nous atteindra encore dans un million d'années, peut-être. La comparaison avec le son est peut-être plus facile à comprendre. Nous voyons l'éclair et nous entendons le son un peu plus tard. C'est la lenteur de la propagation du son qui est cause du fait que nous l'entendons après avoir vu l'éclair. Eh bien, c'est la lenteur de la propagation de la lumière qui peut rendre possible un instrument pour ‘voir’ le passé.
Si nous étions capables de nous rendre instantanément sur une planète tellement éloignée de la nôtre qu'il faudrait un an à la lumière pour l'atteindre, nous verrions la lumière qui en est partie un an avant nous. Si nous possédions un télescope ultra-puissant, ultra-sensible, avec lequel nous pourrions distinguer n'importe quelle partie de la Terre, nous y verrions des événements qui s'y sont passés un an plus tôt. Et en admettant que nous ayons la possibilité de nous déplacer avec ce super-télescope jusqu'à une planète si éloignée que la lumière émanant de la Terre prendrait un million d'années pour l'atteindre, nous pourrions voir la Terre, telle qu'elle était il y a un million d'années. En avançant de plus en plus loin, instantanément, bien entendu, nous atteindrions éventuellement un point à partir duquel nous serions en mesure d'assister à la naissance de la Terre, et même du Soleil.
C'est cela que les Archives Akashiques nous permettent de réaliser. Après avoir reçu un entraînement spécial, nous pouvons voyager dans le monde astral où le Temps et l'Espace n'existent pas et où d'autres ‘dimensions’ les remplacent. Alors on peut tout voir. D'autres Temps et Espace ? Eh bien, prenons un exemple simple : supposez que vous ayez un mille (km) de fil fin, du coton à repriser si vous voulez. Vous devez aller d'un côté et d'un autre de ce fil. Sur Terre, vous ne pouvez pas vous déplacer à travers le coton, ni autour de sa circonférence. Il faut que vous suiviez la surface du fil pendant un mille (km) et que, arrivé au bout, vous parcouriez un autre mille (km) de l'autre côté. C'est un long parcours. Dans l'astral, nous nous déplacerons tout bonnement à travers ce fil. L'exemple est simple, mais se déplacer à travers les Archives Akashiques est tout aussi simple, lorsqu'on sait comment s'y prendre !
Les Archives Akashiques ne peuvent être utilisées à des fins mauvaises, elles ne peuvent être employées pour obtenir des informations propres à nuire à quelqu'un. Sauf dispense spéciale, on ne peut pas non plus voir les faits et gestes d'une personne, ni en discuter par la suite. On peut évidemment être témoin et discuter des événements qui appartiennent à l'Histoire. À présent j'allais avoir un aperçu de la vie privée d'un autre homme et il me faudrait décider si je voulais ou non remplacer mon corps par le sien. Mon organisme s'épuisait rapidement et pour accomplir la tâche qui m'était imposée, il me faudrait avoir un corps pour ‘passer le cap’ jusqu'à ce que je puisse transformer ses molécules, faire, des siennes, les miennes.
Je m'assis et attendis que le lama aveugle prît la parole.
Chapitre Huit
Lentement le soleil disparut derrière les montagnes, et son ultime éclat mit en relief les hautes cimes. La légère écume flottant autour des pics altiers captait la lumière moribonde et reflétait une myriade de nuances qui changeaient et se transformaient selon les caprices de la douce brise vespérale. Des ombres violettes surgissaient des dépressions, telles des créatures nocturnes sorties de leur repaire pour s'ébattre. Peu à peu, les ténèbres veloutées envahirent la base du Potala et montèrent de plus en plus haut, jusqu'à ce que, seuls, les toits d'or réfléchissent un dernier rayon avant d'être à leur tour submergés par l'obscurité envahissante. Une par une, de petites lueurs apparurent, semblables à des joyaux que l'on aurait placés sur un fond sombre, pour en faire ressortir l'éclat.
La paroi montagneuse de la Vallée se dressait, âpre et austère, et la lumière, derrière elle, diminuait d'intensité. De notre demeure rocheuse, nous captions un dernier rayon de soleil moribond qui illuminait un défilé rocheux. Enfin nous fûmes, à notre tour, plongés dans les ténèbres. Aucune lumière pour nous, toute lampe nous étant interdite, de crainte de révéler l'emplacement de notre sanctuaire. Pour nous, il n'y avait que la sombre nuit et nos sombres pensées, tandis que nous contemplions notre pays traîtreusement envahi.
— Frère, dit le lama aveugle, dont j'avais presque oublié la présence, plongé que j'étais dans ma triste songerie, Frère, partons-nous ?
Ensemble, nous nous assîmes dans la position du lotus et méditâmes sur ce que nous allions faire. Le vent léger de la nuit gémissait doucement, comme en extase, tout en jouant autour des varappes et des pics rocheux et il murmurait à notre fenêtre. Avec le sursaut assez agréable qui accompagne souvent cette délivrance, le lama aveugle — qui avait cessé de l'être — et moi nous élançâmes hors de nos corps terrestres pour gagner la liberté d'un autre plan.
— C'est bon de voir à nouveau, dit le lama, car on n'apprécie la vue que lorsqu'on l'a perdue. Nous flottions ensemble, sur le sentier familier conduisant à cet endroit que nous appelions la Salle des Souvenirs. Nous y entrâmes en silence et vîmes que d'autres étudiaient les Archives Akashiques, mais ce qu'ils voyaient était invisible pour nous, de même que les scènes qui se dérouleraient devant nous seraient invisibles pour eux.
— Par où commencerons-nous, Frère ? demanda le vieux lama.
— Nous ne voulons pas être indiscrets, répondis-je, mais il faut que nous sachions à quel genre d'homme nous avons affaire.
Pendant un moment, nous restâmes silencieux ; des images se formaient, claires et précises, sous nos yeux.
— Eek ! m'exclamai-je, avec un sursaut d'inquiétude. Il est marié ! Que vais-je faire ? Je suis un moine voué au célibat. Non, je refuse !
Je voulus m'enfuir, mais je m'immobilisai en voyant mon compagnon éclater de rire. Pendant un moment, son hilarité fut si grande qu'il ne put prononcer un mot.
— Frère Lobsang, dit-il enfin, tu auras vraiment réjoui mes derniers jours. En te voyant sauter en l'air j'ai d'abord cru que toute une légion de diables t'avaient mordu. Non, Frère, ce n'est pas un obstacle, mais laisse-moi d'abord me ‘payer’ amicalement ta tête. Tu m'as parlé de l'Occident et de ses étranges croyances. Permets-moi de te citer ce passage de leur Bible : ‘Le mariage est en tout point honorable.’ (Hébreux, chapitre XIII, verset IV) De nouveau, il fut secoué par le rire et plus je le regardais sombrement, plus il riait. Finalement, le souffle lui manqua.
— Frère, reprit-il, dès qu'il fut capable de parler, ceux qui nous guident et nous aident ont pensé à ce problème. Toi et cette femme pouvez vivre comme de bons compagnons. Nos propres moines et nonnes n'habitent-ils pas parfois sous le même toit ? Ne cherchons pas de difficultés là où il n'y en a point. Et continuons à regarder le Registre.
J'inclinai la tête en soupirant. J'étais à court de paroles. Plus je réfléchissais à cette situation, moins elle me plaisait. Je songeai à mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, assis confortablement quelque part au Pays de la Lumière Dorée. Mon visage dut s'assombrir encore, car le vieux lama se mit de nouveau à rire.
Enfin, calmés tous les deux, nous regardâmes ensemble les vivantes images des Archives Akashiques. J'eus sous les yeux l'homme dont on espérait que je prendrais le corps. Très intéressé, je vis qu'il travaillait au montage d'appareils de chirurgie. Je fus ravi de constater qu'il connaissait évidemment son métier, que c'était un technicien compétent, et j'inclinai machinalement la tête en signe d'approbation, tandis que je le regardais résoudre l'une après l'autre les difficultés qui se présentaient.
La vision changea et nous pûmes voir la ville de Londres, en Angleterre, comme si nous avions été mêlés à ses habitants. Les énormes autobus rouges rugissaient le long des rues, se faufilant parmi la masse compacte des voitures, avec leur cargaison de passagers. Un ululement infernal éclata et nous vîmes les gens se précipiter vers d'étranges constructions en pierre, érigées dans les rues. On entendait l'incessant ‘crup-crup’ des obus antiaériens et le ronronnement des avions de chasse traversant le ciel. Instinctivement, nous baissâmes la tête au moment où des bombes tombaient en sifflant. Pendant quelques instants, il y eut un silence, puis de formidables bang ! Des maisons explosèrent en l'air et retombèrent en une pluie de débris et de gravats.
Dans les profondeurs du métro, les gens vivaient une étrange existence de troglodytes. Le soir, ils se rendaient dans les abris, dont ils émergeaient le matin, pareils à des taupes. Des familles entières vivaient là. Elles dormaient sur des couchettes improvisées, et s'efforçaient de conserver un peu d'intimité en drapant des couvertures sur n'importe quelle saillie des murs recouverts de carreaux en faïence.
J'eus l'impression d'être debout sur une plate-forme de fer, dominant les toits de Londres, et je distinguai parfaitement le bâtiment que les gens appellent ‘le Palais’. Un avion solitaire surgit des nuages et trois bombes tombèrent sur la maison du Roi d'Angleterre. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Quand on regarde à travers les Archives Akashiques, on ‘voit’ aussi bien que le personnage principal, de sorte que le vieux lama et moi vîmes tous les deux comme si nous avions été les héros de l'histoire. Il me semblait que j'étais debout sur un escalier de secours s'étirant au-dessus des toits londoniens. J'avais déjà vu pareilles choses auparavant, mais je dus les expliquer à mon compagnon. Puis je compris : lui — l'homme que j'observais — s'efforçait de repérer les appareils ennemis, afin de les signaler en cas de danger imminent aux gens demeurés au sol. Les sirènes hurlèrent de nouveau pour annoncer la fin de l'alerte et je vis l'homme descendre l'escalier et ôter son casque d'acier de Surveillant d'Attaque Aérienne.
Le vieux lama se tourna vers moi avec un sourire :
— C'est très intéressant, me dit-il. Je n'ai jamais fait attention aux événements survenus en occident, je ne me suis intéressé qu'à notre propre pays. Je comprends à présent ce que tu voulais dire lorsque tu affirmais qu'une ‘image vaut un millier de mots’. Il faut que nous regardions de nouveau.
Nous regardâmes : les rues de Londres étaient plongées dans l'obscurité, les phares des voitures étaient camouflés. Les gens se heurtaient aux réverbères, et les uns aux autres. Lorsque les voitures du métro remontaient en surface, les lampes s'éteignaient et de tristes ampoules bleuâtres les remplaçaient. Les faisceaux des projecteurs fouillaient le ciel nocturne et illuminaient parfois les flancs gris des ballons du barrage. Le vieux lama contemplait ces ballons avec des yeux fascinés. Les voyages astraux lui étaient familiers, mais ces monstres gris, flottant dans les airs au bout de leurs câbles en acier et s'agitant sans cesse sous le vent de la nuit, le stupéfiaient. J'avoue que je trouvai l'expression de mon compagnon aussi intéressante à observer que les Archives Akashiques.
Nous regardâmes l'homme sortir du train et marcher dans les rues sombres jusqu'à un grand pâté d'immeubles. Il y entra, mais nous ne le suivîmes pas. Nous contemplâmes l'activité qui régnait au-dehors. Les bombes avaient détruit plusieurs maisons et les hommes creusaient encore dans l'espoir de retrouver les vivants et les morts. La plainte des sirènes interrompit les opérations de sauvetage. Dans le ciel, telles des mites voletant autour d'une lampe, les bombardiers ennemis étaient pris sous le feu croisé des projecteurs. Une lumière scintillant au flanc de l'un des appareils attira notre attention, puis nous nous aperçûmes qu'il s'agissait d'un chapelet de bombes. L'une d'elles tomba avec fracas sur un angle du bloc d'habitations. Il y eut une lueur fulgurante et la maçonnerie vola en éclats. Un flot de gens sortit précipitamment des maisons pour gagner la douteuse sécurité des rues.
— As-tu connu pire que cela à Shanghaï, mon Frère ? demanda le vieux lama.
— Bien pire, répondis-je. Nous n'avions aucun moyen de défense et pas d'abris. Comme tu le sais, je suis resté un certain temps enterré sous des décombres et j'ai eu le plus grand mal à en sortir.
— Si nous avancions un peu dans le temps ? demanda mon compagnon. Il ne faut pas que nous regardions indéfiniment, car notre santé à tous les deux est chancelante.
J'acquiesçai avec empressement. J'avais simplement besoin de savoir quel genre de personne j'allais remplacer. Pour moi il n'y avait pas le moindre intérêt à fouiller dans les affaires d'un autre. Nous avançâmes le long du Registre, nous arrêtant de temps en temps pour faire le point. Le ciel du matin était obscurci par la fumée de nombreux foyers d'incendie. La nuit avait été un enfer. La moitié de Londres semblait brûler. L'homme descendit la rue jonchée de débris, une rue durement bombardée. À une barrière provisoire, un agent de police de la Réserve de Guerre l'arrêta en disant :
— Vous ne pouvez pas aller plus loin, monsieur, les immeubles sont dangereux.
Nous vîmes arriver le Gérant. Il s'entretint avec l'homme que nous observions. Puis il dit un mot à l'agent et, passant sous la corde, tous deux se dirigèrent vers le bâtiment en ruine. L'eau giclait partout des conduites éclatées. Canalisations et fils électriques étaient inextricablement entremêlés, tel un peloton de laine avec lequel aurait joué un chaton. Un coffre-fort inclinait de façon inquiétante au bord d'une énorme brèche. Des lambeaux d'étoffe détrempés flottaient lamentablement au vent, et d'un bâtiment voisin, des morceaux de papier brûlés tombaient en tournoyant comme des flocons de neige noire. Moi, qui connaissais pourtant mieux que la plupart des gens la guerre et la souffrance, j'étais écœuré par cette destruction insensée. Le Registre continuait à se dérouler...
Le chômage, dans le Londres du temps de guerre ! L'homme voulut s'engager comme agent de police de la Réserve de Guerre. En vain. Ses certificats médicaux portaient le Numéro Quatre : inapte au service. À présent, ayant perdu sa situation à cause des bombardements, il errait dans les rues à la recherche d'un travail. Une firme après l'autre refusait de l'employer. Il ne semblait y avoir pour lui aucun espoir, aucune lueur dans les ténèbres de sa dure existence.
Enfin, après une visite à une École par Correspondance, dont il avait impressionné les professeurs par son intelligence et son application, on lui proposa un poste dans les bureaux de l'école située aux environs de Londres pour toute la durée de la guerre.
— L'endroit est très beau, dit l'homme qui faisait cette offre. Prenez l'autobus de la ligne verte. Voyez Joe, il doit arriver à une heure, mais les autres s'occuperont de vous. Emmenez votre femme avec vous. J'ai moi-même essayé de me faire transférer là-bas.
Le village était, en fait, un endroit sordide. Il n'avait rien de beau, contrairement à ce que cet homme avait affirmé. On y fabriquait des avions, on les mettait à l'essai et on les expédiait en d'autres régions du pays.
La vie dans une École par Correspondance n'avait vraiment rien d'amusant. Autant que nous pouvions en juger par les Archives Akashiques, elle consistait à lire des formulaires et des lettres et à indiquer aux gens quel cours ils devraient suivre. Pour ma part, j'estimais que l'enseignement par correspondance était une perte d'argent, à moins que l'on ne pût effectuer en même temps des travaux pratiques.
Un bruit étrange, semblable à celui d'un moteur de motocyclette défaillant, nous parvint aux oreilles. Et nous aperçûmes un curieux engin aérien démuni de pilote. Il émit une toux spasmodique, le moteur s'arrêta, l'appareil plongea et explosa juste au-dessus du sol.
— C'était un avion-robot allemand, dis-je au vieux lama. Ces V1 et ces V2 semblent avoir été des engins bien déplaisants.
Un autre avion-robot tomba près de la maison qu'habitaient l'homme et sa femme. Il brisa quelques fenêtres et fendit un mur.
— Ces gens ne semblent pas avoir beaucoup d'amis, dit le vieux lama. Je crois qu'ils ont des possibilités spirituelles qui échapperaient à un observateur superficiel et j'ai l'impression qu'ils vivent ensemble plus comme frère et sœur que comme mari et femme. Voilà qui devrait te rassurer, Frère, conclut le vieil homme en étouffant un rire !
Les Archives Akashiques continuaient, déroulant l'existence d'un homme à la vitesse de la pensée. Nous pouvions sauter d'un moment à l'autre de cette vie, laissant certaines parties de côté, et revoyant d'autres plusieurs fois. L'homme s'aperçut qu'une série de coïncidences tournaient ses pensées de plus en plus vers l'Orient. Des ‘rêves’ lui montraient la vie au Tibet, rêves qui étaient en fait des voyages astraux accomplis sous l'égide du vieux lama.
— L'une de nos petites difficultés, me dit le vieil homme, c'était qu'il tenait à employer le terme de ‘Maître’, chaque fois qu'il s'adressait à l'un de nous.
— Oh ! répondis-je, c'est là l'une des erreurs communes des gens de l'Occident, ils aiment à employer les termes qui impliquent la domination exercée par un être sur les autres. Que lui avez-vous dit ?
Le vieux lama sourit :
— Je lui ai fait un petit discours. Je me suis aussi efforcé de l'inciter à poser moins de questions. Je vais te répéter ce que je lui ai dit, car cela te servira pour comprendre sa nature profonde. Je lui ai dit : ‘Maître’, c'est un mot qui me fait horreur, comme à tous les Orientaux. Il suppose qu'un être s'efforce de dominer les autres, que l'on cherche la suprématie sur ceux qui n'ont pas le droit d'employer ce terme. Pour nous, ‘Maître’ signifie Maître du Savoir, une source de connaissances, ou celui qui a maîtrisé les tentations de la chair. Nous préférons le mot Guru ou Adepte. Car aucun Maître, dans le sens où nous l'entendons, ne chercherait à influencer un étudiant, ni à lui imposer ses propres opinions. En Occident, il existe certains petits groupes et cultes qui s'imaginent être les seuls à avoir la clef des Champs Célestes. Certaines religions ont employé la torture pour se gagner des fidèles. Je lui ai rappelé ces mots sculptés au fronton d'une de nos lamaseries : ‘Un millier de moines, un millier de religions.’
"Il parut me comprendre fort bien, poursuivit le vieux lama, aussi ai-je continué mon petit discours, pensant qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. En Inde, en Chine et dans le Japon d'autrefois, lui ai-je dit encore, le futur élève s'assied au pied de son Guru, cherchant à s'informer, mais ne posant pas de questions, car l'élève doué de sagesse ne pose jamais de questions, de crainte qu'on ne le renvoie. Être interrogé est, pour le Guru, la preuve certaine que l'étudiant n'est pas encore préparé à recevoir les réponses à ses questions. Certains ont attendu jusqu'à sept ans que réponse leur soit donnée à une question non formulée. Pendant ce temps, l'étudiant subvient aux besoins matériels du Guru. Il fournit les vêtements, la nourriture, et les quelques rares choses qui lui sont nécessaires. Il ne cesse de tendre l'oreille pour recueillir des renseignements, car en s'informant, en entendant peut-être ce qui est confié à d'autres gens, l'étudiant intelligent peut déduire, peut conclure, et quand le Guru, dans sa sagesse, voit que son élève fait des progrès, il le questionne, en temps voulu et selon sa manière, et s'il découvre que les connaissances de l'étudiant sont erronées ou incomplètes, il corrige, toujours en temps voulu, les omissions et les déficiences.
"En Occident, les gens disent : ‘Maintenant, expliquez-moi... Mme Blavatsky affirme... L'évêque Leadbetter affirme... Billy Graham affirme... Vous, qu'en dites-vous ? Je crois que vous vous trompez.’ Les Occidentaux posent des questions pour le plaisir de parler, sans savoir ce qu'ils veulent dire, ni ce qu'ils veulent entendre, mais si un Guru bienveillant répond à une question et que l'élève ergote : ‘Mais, j'ai entendu un tel dire ceci ou cela...’
"Si l'étudiant interroge le Guru, cela implique forcément que l'étudiant ne connaît pas la réponse à sa question, mais estime que le Guru la sait, lui ; donc s'il met la réponse en doute immédiatement, cela prouve qu'il est ignorant, et qu'il a, sur le décorum et sur la plus élémentaire politesse, des idées préconçues et totalement erronées. Je vous déclare que le seul moyen d'obtenir des réponses à vos questions, c'est de les laisser sans réponse, de recueillir des renseignements, de déduire et de conclure, puis, en temps voulu, si vous avez le cœur pur, vous serez capable de faire des voyages astraux, de connaître les formes les plus ésotériques de méditation, et de consulter les Archives Akashiques qui ne peuvent mentir, ne peuvent donner une réponse étrangère au contexte, ne peuvent formuler une opinion ni une information teintée par des préjugés personnels. L'éponge humaine souffre d'indigestion mentale et elle retarde son évolution et son développement spirituels. Quelle est la seule voix qui conduise au progrès ? Celle de la patience : Wait and see. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a aucun moyen d'accélérer votre développement, sauf sur l'invitation expresse d'un Guru qui vous connaît bien et qui, vous connaissant bien, hâtera votre évolution s'il vous en juge digne."
J'avais l'impression que la majorité des Occidentaux profiterait d'un pareil enseignement. Toutefois, nous n'étions pas là pour enseigner, mais pour observer le déroulement des principaux événements de la vie d'un homme qui, bientôt, abandonnerait son enveloppe terrestre.
— Voici qui est intéressant, dit le vieux lama, attirant mon attention sur une scène des Archives Akashiques. Cela a soulevé pas mal de complications, mais lorsqu'il en a compris la nécessité, il a donné son accord.
Intrigué, je considérai la scène, puis je compris. Oui ! ce bureau était celui d'un homme de loi. Ce document était un acte constatant le changement de nom. Oui, il était exact qu'il avait changé de nom, car les vibrations du sien, d'après notre Science des Nombres, n'étaient pas bonnes. Je lus le papier avec intérêt, et vis qu'il n'était pas tout à fait correct, mais presque.
Les épreuves ne manquaient pas à cet homme. Une visite à un dentiste lui avait causé de nombreux ennuis, au point qu'il avait dû être transporté dans une clinique pour y subir une opération. Par intérêt technique, j'observai très attentivement le processus.
L'homme dont je regardais la vie avait l'impression que son patron se souciait peu de lui. Nous étions aussi de son avis, le vieux lama et moi, et nous fûmes satisfaits de voir qu'il avait démissionné de son poste de l'école par correspondance. Le mobilier fut chargé dans un camion, une partie fut vendue, l'homme et sa femme partirent pour une région entièrement différente. Pendant un certain temps, ils vécurent dans la maison d'une étrange vieille femme qui disait ‘la bonne aventure’ et avait une opinion surprenante de ses capacités. L'homme s'efforça par tous les moyens de trouver une situation. N'importe quoi qui lui permît de gagner honnêtement sa vie.
Le vieux lama me dit :
— Nous approchons maintenant de l'instant crucial. Comme tu peux le voir, il se plaint continuellement de son sort. Il n'a pas de patience et je crains qu'il ne quitte brusquement la vie, si nous ne faisons pas diligence.
— Que voulez-vous que je fasse ? demandai-je.
— C'est à toi de décider, mais j'aimerais que tu le rencontres dans l'astral pour savoir ce que tu penses de lui.
— Certainement, dis-je, nous irons ensemble. (Je réfléchis quelques instants et ajoutai :) À Lhassa, il est deux heures du matin ; en Angleterre, il doit être huit heures du soir, car leur temps retarde sur le nôtre. Nous allons nous reposer trois heures, puis nous attirerons cet homme dans l'astral.
— Oui, dit le vieux lama. Il dort seul dans une chambre, donc cela sera possible. Pour le moment, reposons-nous, car nous sommes las.
Nous réintégrâmes nos corps, et nous assîmes côte à côte à la sombre clarté des étoiles. Les lumières de Lhassa étaient éteintes, on ne voyait que les faibles lueurs des demeures occupées par les moines et les lueurs plus vives des postes de garde chinois. Le murmure du ruisselet qui coulait sous nos murs paraissait étrangement sonore, dans le silence de la nuit. D'en haut nous parvint le crépitement d'une petite averse de cailloux, chassés par le grand vent. Ils rebondirent près de nous en détachant des pierres plus grosses, et roulèrent le long des pentes montagneuses, pour atterrir bruyamment près d'un casernement chinois. Des lumières s'allumèrent, des coups de feu éclatèrent, et les soldats coururent en tous sens, craignant sans doute d'être attaqués par les moines de Lhassa. Mais le tumulte s'apaisa bientôt, la nuit redevint paisible et silencieuse.
Le vieux lama rit doucement et dit :
— Il me paraît vraiment curieux que les gens habitant en dehors de nos frontières ne parviennent pas à comprendre les voyages astraux ! Comme c'est étrange qu'ils y voient un phénomène d'imagination pure. Ne peut-on leur faire admettre que changer son corps pour un autre équivaut à échanger une automobile contre une autre ? Il semble inconcevable que des peuples arrivés à un tel degré de progrès technique soient si aveugles aux choses de l'esprit.
Moi qui avais quelque expérience de l'Ouest, je lui répondis :
— À part une petite minorité, les Occidentaux ne sont pas doués pour les choses spirituelles. Tout ce qui les intéresse, c'est la guerre, la sexualité, le sadisme et le droit de s'immiscer dans les affaires des autres.
La longue nuit continua ; nous nous reposâmes et nous rafraîchîmes avec du thé et de la tsampa.
Enfin les premiers et faibles rayons de l'aube illuminèrent derrière nous les pics montagneux. Mais à nos pieds, la vallée était toujours dans les ténèbres. Quelque part, un yak se mit à meugler, comme s'il sentait l'approche d'un nouveau jour. "Cinq heures du matin au Tibet. Environ onze heures en Angleterre", me dis-je. Je secouai doucement le vieux lama, qui somnolait.
— Il est temps de partir pour l'astral, lui dis-je.
— Ce sera mon dernier voyage, répondit-il, je ne réintégrerai pas mon corps.
Lentement, sans hâte aucune, nous entrâmes de nouveau dans l'état astral. Nous arrivâmes dans cette maison d'Angleterre. L'homme était étendu, endormi, se retournant parfois sur son lit, et son visage exprimait une amertume profonde. Sa forme astrale enveloppait son corps physique et n'en était pas encore séparée.
— Venez-vous ? demandai-je dans l'astral.
— Venez-vous ? répéta le vieux lama.
Lentement, presque de mauvais gré, la forme astrale de l'homme s'éleva au-dessus de son corps. S'éleva et flotta, à l'envers, la tête en bas, selon la règle. Le corps astral oscilla et s'agita. Le brusque rugissement d'un train filant dans le voisinage faillit le renvoyer dans son enveloppe matérielle. Puis, comme s'il avait pris une décision soudaine, il se retourna et se tint devant nous. Se frottant les yeux comme quelqu'un qui s'éveille, il nous regarda.
— Ainsi vous voulez quitter votre corps ? lui dis-je.
— Oui, je hais cette vie ! s'exclama-t-il avec violence.
Nous nous contemplions mutuellement. Il me semblait être un homme qui, en Angleterre, ne parviendrait pas à s'imposer, mais qui, au Tibet, aurait eu des chances de réussir.
Il eut un rire amer :
— Ainsi c'est vous qui désirez avoir mon corps ? Eh bien, vous le regretterez. En Angleterre peu importe ce que vous savez, l'important c'est qui vous connaissez. Je ne peux pas trouver d'emploi, je ne peux même pas m'inscrire au chômage. Voyez si vous êtes capable de faire mieux.
— Chut, mon ami, lui dit le vieux lama, vous ignorez à qui vous parlez. Peut-être votre truculence vous a-t-elle empêché de trouver du travail ?
— Il faudra vous laisser pousser la barbe, dis-je, car si j'occupe votre corps, le mien s'y substituera bientôt et je veux avoir une barbe pour cacher les cicatrices de ma mâchoire.
— Oui, monsieur, je laisserai pousser ma barbe, me répondit-il.
— Très bien, dis-je, je reviendrai ici dans un mois. Je m'intégrerai dans votre corps et je vous délivrerai, de sorte que mon propre corps pourra éventuellement remplacer celui que j'aurai pris. Expliquez-moi, poursuivis-je, comment mes compagnons sont entrés en contact avec vous.
— Depuis longtemps, monsieur, dit-il, je déteste la vie qu'on mène en Angleterre, son injustice, le favoritisme. Toute ma vie, je me suis intéressé au Tibet et aux pays d'Extrême-Orient. Toute ma vie j'ai eu des rêves où je voyais, ou croyais voir le Tibet, la Chine et d'autres pays que je ne connaissais pas. Il y a un certain temps, j'ai eu envie de changer de nom ; je l'ai fait.
— Oui, je sais tout cela, mais comment a-t-on pris contact avec vous récemment et qu'avez-vous vu ?
Il réfléchit un moment :
— Pour vous l'expliquer, je dois le faire à ma manière et certaines des informations que je possède semblent incorrectes, à la lumière de ce que j'ai ultérieurement appris.
— Eh bien, répondis-je, racontez-moi cela à votre manière, nous pourrons corriger les erreurs par la suite. Il me faut mieux vous connaître si je décide de prendre votre corps et ce sera là un moyen d'y parvenir.
— Je peux peut-être commencer par le premier ‘contact’ véritable. Après, je serai plus à même de rassembler mes pensées.
De la gare, en haut de la rue, monta le bruit d'un train qui ramenait de Londres les derniers banlieusards et dont les freins brusquement serrés grincèrent atrocement. Peu après, le train redémarra et ‘l'homme’ commença son histoire, que le lama et moi-même écoutâmes avec attention.
— Rose Croft, à Thames Ditton, était un endroit très agréable. La maison était située en retrait de la rue, avec un petit jardin sur le devant et un autre beaucoup plus grand, derrière. Du balcon, on avait une très jolie vue sur la campagne. Je passais beaucoup de temps dans ce jardin, surtout dans celui du devant, car il avait été assez longtemps abandonné et je voulais l'arranger un peu. L'herbe y atteignait plusieurs pieds de haut (1 m = 3,28 pieds) et la couper n'était pas facile. J'en avais déjà rasé la moitié avec un vieux couteau gurkha. C'était tout un travail parce que je devais me mettre à genoux pour faucher l'herbe et aiguiser le couteau toutes les cinq minutes. Je m'intéressais également à la photographie. J'avais essayé de photographier un hibou qui nichait dans un vieux sapin proche, un sapin recouvert de lierre. Mon attention fut attirée par un battement d'ailes sur une branche, non loin au-dessus de ma tête. Je levai les yeux, et à mon ravissement, vis un jeune hibou qui, aveuglé par le soleil, s'accrochait à la branche en agitant les ailes. Silencieusement je posai mon couteau et entrai dans la maison pour y prendre mon appareil photographique. L'appareil en main, je m'approchai de l'arbre et aussi silencieusement que possible, commençai à y grimper jusqu'à la première branche. L'oiseau, incapable de me voir sous cette lumière vive mais devinant ma présence, s'éloigna vers l'extrémité de la branche. Sans me soucier du danger, j'avançai toujours, et, à chacun de mes mouvements, le hibou s'éloignait de plus en plus jusqu'à ce qu'il fût presque arrivé au bout de la branche, qui ployait maintenant sous mon poids de façon inquiétante.
"Soudain, ayant fait un geste brusque, j'entendis un craquement, et sentis le parfum du bois pulvérulent. La branche était pourrie, elle avait cédé. Cette chute de quelques pieds (m) me parut durer une éternité. Je me rappelle que l'herbe ne m'avait jamais paru plus verte et qu'elle me semblait plus grande que nature. Je pouvais en distinguer chaque brin, et les petits insectes dessus. Je me rappelle aussi qu'une coccinelle s'enfuit à mon approche. Puis, je ressentis une douleur fulgurante, il y eut une sorte d'éclair et ce fut la nuit. J'ignore combien de temps je demeurai là, comme une masse inerte, mais soudain je me rendis compte que je me détachais de mon corps physique, que je voyais les choses plus nettement : les couleurs me semblaient nouvelles et étonnamment lumineuses.
"Avec précaution, je me relevai et regardai autour de moi. À ma surprise horrifiée, je vis que mon corps était étendu sur le sol. Il ne portait pas trace de sang, simplement une grosse bosse à la tempe droite. J'étais fort déconcerté, car il respirait bruyamment et donnait des signes de détresse. ‘C'est la mort, me dis-je, je suis mort, à présent, je ne reviendrai jamais sur Terre.’
"Je vis une mince corde de fumée montant du corps, de la tête du corps vers moi ; la corde ne bougeait pas, ne vibrait pas et la panique m'envahit. Je me demandais que faire. La peur, ou une autre raison peut-être, me paralysait. Puis un mouvement soudain, le seul dans l'étrange univers qui était devenu le mien, attira mon regard et je faillis crier, ou j'aurais crié si j'avais eu une voix. Un lama tibétain, vêtu de la robe safran de l'Ordre Supérieur, traversait la pelouse dans ma direction. Ses pieds étaient à plusieurs pouces (cm) du sol et pourtant il s'avançait vers moi d'un pas ferme. Je le contemplai, stupéfait.
"Il étendit la main et me sourit. ‘Vous n'avez rien à craindre, dit-il, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.’ J'eus l'impression qu'il parlait dans une autre langue que la mienne, du tibétain, peut-être et pourtant je la comprenais ; et je n'entendais pas un son ! Je n'entendais même pas les oiseaux chanter et le vent siffler dans les arbres. ‘Oui, reprit-il, devinant mes pensées, nous n'avons pas recours au langage, mais bien à la télépathie. Je vous parle par télépathie.’ Nous nous regardâmes, puis nous regardâmes le corps étendu sur le sol, entre nous. Le Lama releva la tête et sourit : ‘Ma présence vous surprend, dit-il, je suis ici parce que j'ai été attiré vers vous. J'ai laissé mon corps à cet instant précis et j'ai été attiré vers vous parce que vos propres vibrations vitales sont un harmonique fondamental de celui pour lequel j'agis. Je suis donc venu, je suis venu parce que j'ai besoin de votre corps pour quelqu'un qui doit continuer à vivre dans le monde Occidental, car il doit accomplir une tâche qui ne souffre pas d'interruption.’
"Je le considérai, épouvanté. Cet homme était fou ! Il avait besoin de mon corps ! Moi aussi ! C'était le mien. Je ne tolérerais pas qu'on me l'enlève. J'avais été chassé contre mon gré du véhicule physique et j'allais y retourner. Mais le Tibétain devina de nouveau mes pensées. Il me dit : ‘Qu'avez-vous à attendre de l'existence ? Le chômage, la maladie, les épreuves, une vie médiocre dans un milieu médiocre, puis dans un avenir assez rapproché, la mort ; et tout recommence à nouveau. Avez-vous réussi dans la vie ? Avez-vous accompli quoi que ce soit dont vous puissiez être fier ? Réfléchissez.’
"Je réfléchis. Je songeai au passé ; oui, j'ai été déçu, incompris, malheureux. Il reprit : ‘Voudriez-vous connaître la satisfaction de savoir que votre Karma a été effacé, que vous avez matériellement contribué à une tâche qui rendra grand service à l'humanité ?’ Je répondis : ‘Je ne sais pas. L'humanité ne m'a jamais fait beaucoup de bien. Pourquoi m'inquiéterais-je d'elle ?’
‘— Non, dit-il, sur cette Terre, vous êtes aveugle à la réalité véritable. Vous ne savez pas ce que vous dites, mais avec le temps, et dans une sphère différente, vous comprendrez les possibilités que vous avez manquées. Je veux votre corps pour un autre.’
‘— Eh bien, que puis-je faire ? répliquai-je. Je ne peux pas errer éternellement comme un spectre, et nous ne pouvons pas avoir tous deux le même corps.’
"Vous comprenez, je prenais cette demande au pied de la lettre. Il y avait, chez cet homme, quelque chose qui imposait le respect et qui faisait croire à sa sincérité. Je ne doutai pas un moment qu'il ne fût capable de prendre mon corps et de me laisser partir quelque part ailleurs, mais je voulais m'informer plus avant. Je voulais savoir ce que je faisais. Il me sourit et me dit d'un ton rassurant : ‘Vous, mon ami, vous aurez votre récompense, vous échapperez à votre Karma, vous irez dans une sphère d'activité différente, et tous vos péchés vous seront remis à cause de ce que vous avez fait. Mais votre corps ne vous sera pas enlevé contre votre volonté.’
"Cette perspective ne me plaisait guère. Ce corps était le mien depuis quelque quarante ans, j'y étais très attaché, je ne tenais pas à ce qu'on me l'enlève. En outre que dirait ma femme si elle devait vivre avec un étranger, sans être au courant de rien ? Le lama me regarda de nouveau et reprit : ‘N'avez-vous aucune sympathie pour l'humanité ? N'êtes-vous pas disposé à faire quelque chose pour réparer vos propres fautes, pour donner un but à votre vie médiocre ? C'est vous qui y gagnerez. Celui pour lequel j'agis sera forcé de continuer votre dure existence.’
"Je regardai autour de moi. Je regardai le corps étendu entre nous et je songeai : ‘Bah, qu'est-ce que ça peut faire ? Il est vrai que ma vie est dure. Je ne perdrai rien à la quitter.’ Je dis donc : ‘Bon, laissez-moi voir en quel genre d'endroit j'irai et si cela me plaît, j'accepterai.’ Aussitôt j'eus une vision glorieuse, si glorieuse que les mots ne sauraient la décrire. Satisfait, je déclarai que j'étais disposé, entièrement disposé à être délivré le plus tôt possible."
Le vieux lama se mit à rire et dit :
— Nous avons dû l'avertir que tout ne se ferait pas aussi rapidement que cela, que ce serait à toi, Frère, de le voir et de prendre la décision finale. Après tout, si pour lui c'était une délivrance heureuse, pour toi c'était une nouvelle épreuve.
Je les regardai tous les deux.
— Très bien, répondis-je finalement, je reviendrai dans un mois. Si d'ici là vous avez laissé pousser votre barbe et que vous êtes absolument décidé à accepter, je vous délivrerai et vous pourrez partir.
Il poussa un soupir de satisfaction et une expression de béatitude se peignit sur son visage, cependant qu'il réintégrait lentement son corps physique. Le vieux lama et moi nous levâmes et retournâmes au Tibet.
Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Lorsque je repris mon corps physique, l'enveloppe vide du vieux lama était étendue, inerte, sur le sol. "Lui, me dis-je, a retrouvé la paix après une longue et honorable existence. Moi, par la Dent Sacrée du Bouddha... à quoi m'étais-je engagé ?"
Des messagers se rendirent, par les hautes terres montagneuses, jusqu'à la Nouvelle Demeure pour y porter mon acceptation écrite : j'étais prêt à accomplir la tâche dont on voulait me charger. Les messagers revinrent, me rapportant, en signe de gracieuse amitié, quelques-uns de ces petits gâteaux indiens qui m'avaient si souvent induit en tentation lorsque j'étais au Chakpori. J'étais virtuellement prisonnier dans ma demeure montagneuse. On ne voulut pas me permettre d'aller, même déguisé, voir une dernière fois mon bien-aimé Chakpori.
— Tu pourrais être victime des envahisseurs, mon Frère, me dit-on, car ils n'hésitent pas une seconde à appuyer sur la détente lorsque leurs soupçons sont éveillés.
— Vous êtes malade, Révérend Abbé, me dit un autre. Si vous descendiez dans la vallée, peut-être n'auriez-vous pas la force de remonter jusqu'ici. Si votre Corde d'Argent est tranchée, la Tâche ne sera pas accomplie.
La Tâche ! Il me semblait stupéfiant que cette ‘tâche’ existât. Distinguer l'Aura humaine ne présentait pas pour moi plus de difficulté qu'il n'y en avait, pour un homme doué d'une vue normale, à voir une personne se tenant à quelques pieds (m) de lui. Je méditai sur la différence entre l'Est et l'Ouest, songeant combien il était facile d'intéresser un Occidental à un nouvel aliment énergétique, et combien il était facile d'intéresser un Oriental à un phénomène nouveau dans le domaine spirituel.
Le temps passa. Je me reposais comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Puis, peu de temps avant la fin du mois, peu de temps avant le moment où je devais retourner en Angleterre, on m'appela de nouveau au Pays de la Lumière Dorée.
Assis en face de tous ces Hauts Personnages, je pensai assez irrespectueusement que cela ressemblait à un briefing pendant la guerre ! Ma pensée fut captée par les autres, dont l'un dit en souriant :
— Oui, c'est bien un briefing ! Et qui est l'ennemi ? La Puissance du Mal qui cherche à empêcher l'accomplissement de notre tâche.
— Tu rencontreras beaucoup d'hostilité, tu seras en butte aux calomnies, dit l'un.
— Tes pouvoirs métaphysiques ne seront ni altérés, ni perdus pendant ta transformation, déclara un autre.
— Ceci est ta dernière incarnation, me dit mon Guide bien-aimé, le Lama Mingyar Dondup, quand tu seras au terme de l'existence que tu vas prendre, tu retourneras chez toi... chez nous.
Je reconnaissais bien mon Guide à cette conclusion encourageante. Ils continuèrent à m'expliquer ce qui allait arriver. Trois lamas, voyageurs de l'astral, m'accompagneraient jusqu'en Angleterre et effectueraient l'opération consistant à couper la Corde d'Argent de cet homme pour me l'attacher, à moi. La difficulté était de ne pas perdre la liaison avec mon propre corps, toujours au Tibet, car je voulais que mes propres ‘molécules de chair’ fussent éventuellement transférées. Je retournai donc sur Terre, et, avec mes trois compagnons je me rendis astralement en Angleterre.
L'homme m'y attendait.
— Je suis décidé à aller jusqu'au bout, dit-il.
L'un des lamas se tourna vers lui :
— Il va falloir que vous vous laissiez tomber brusquement de cet arbre, comme vous l'avez fait la première fois que nous avons pris contact avec vous. Il faut que le choc soit rude, car votre Corde est très fortement attachée.
L'homme grimpa à quelques pieds (m) du sol, puis se laissa tomber et atterrit avec un ‘bang’ satisfaisant. Pendant un instant, j'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Une voiture qui passait s'immobilisa, un oiseau qui volait demeura figé dans l'espace. Un cheval qui tirait une charrette stoppa, les deux sabots levés, et ne les posa pas. Puis tout se remit en mouvement. La voiture repartit brusquement, à bonne allure. Le cheval se mit à trotter et l'oiseau, au-dessus de nos têtes, fila comme une flèche. Les feuilles frémirent et s'agitèrent, l'herbe, balayée par le vent, ondula.
En face, au Cottage Hospital, une ambulance s'était arrêtée. Deux hommes descendirent, se dirigèrent vers l'arrière du véhicule et en sortirent une civière où une vieille femme était allongée. Sans hâte, les deux ambulanciers la tournèrent et la portèrent à l'intérieur de l'hôpital.
— Ah, dit l'homme, elle va à l'hôpital, moi je vais vers la liberté. (Il regarda la rue de haut en bas et ajouta :) Ma femme est au courant. Je lui ai tout expliqué et elle est d'accord. (Il jeta un coup d'œil vers la maison et étendit la main :) Voilà sa chambre, la vôtre est là. À présent, je suis prêt.
L'un des lamas saisit la forme astrale de l'homme et passa la main le long de la Corde d'Argent. Il semblait la nouer, comme on noue le cordon ombilical d'un bébé à sa naissance.
— Prêt ! dit l'un des prêtres.
L'homme, libéré de sa Corde, s'éloigna en flottant dans les airs en compagnie du prêtre qui l'assistait. Je sentis une douleur crucifiante, une souffrance indicible que j'espère ne jamais éprouver de nouveau, puis le plus âgé des lamas me dit :
— Lobsang, peux-tu t'intégrer dans ce corps ? Nous allons t'aider.
Le monde s'assombrit. J'étais plongé dans d'épaisses et poisseuses ténèbres d'un noir rougeâtre. Je suffoquais. Je sentis que l'on me forçait à entrer dans quelque chose de trop petit pour moi. Emprisonné dans ce corps, je l'explorais avec l'impression d'être un pilote aveugle dans un avion très complexe, et je me demandais comment le faire agir. "Que se passera-t-il, si j'échoue ?" me disais-je, accablé. Désespérément, je palpai, je tâtonnai au hasard. Enfin, j'aperçus des lueurs rouges, puis vertes. Rassuré, j'intensifiai mes efforts, puis ce fut comme si une persienne s'était ouverte. Je voyais ! Ma vue était la même qu'auparavant, je pouvais distinguer les Auras des gens qui passaient dans la rue. Mais j'étais incapable de bouger.
Les deux lamas se tenaient auprès de moi. Désormais, comme j'allais le découvrir, je pourrais toujours voir les formes astrales aussi bien que les formes physiques et je pourrais également garder un contact encore plus étroit avec mes compagnons restés au Tibet. "Un prix de consolation, me disais-je souvent, pour avoir été obligé de rester en Occident."
Les deux lamas considéraient mon immobilité avec inquiétude. Je m'acharnais désespérément, me reprochant de ne pas avoir cherché à connaître et à dominer les différences existant entre un corps Oriental et un corps Occidental.
— Lobsang, tes doigts remuent ! s'écria l'un des lamas.
Fébrilement, je continuai mon exploration. Un faux mouvement me rendit momentanément aveugle. Avec l'aide des lamas, j'abandonnai de nouveau le corps, l'étudiai et le réintégrai avec précaution. Cette fois, j'eus plus de succès. Je pouvais voir, remuer un bras, et une jambe. Faisant un immense effort, je me mis à genoux, chancelai, et retombai sur le ventre. Avec l'impression de soulever tout le poids du monde, je me remis péniblement sur pied.
Une femme sortit en courant de la maison, en disant :
— Oh ! qu'est-ce que tu as fait ? Tu devrais rentrer et t'étendre.
Elle me regarda et une expression de stupeur se peignit sur son visage ; je crus qu'elle allait se mettre à hurler. Mais elle se domina, et, me passant un bras autour de l'épaule, elle m'aida à traverser la pelouse. Je longeai un petit sentier recouvert de graviers, montai une marche de pierre, passai sous un porche de bois, et entrai dans un petit vestibule. Là, les choses se compliquèrent, car il me fallut gravir de nombreuses marches et mes mouvements étaient encore gauches et maladroits.
La maison comprenait deux appartements et celui que je devais occuper se trouvait à l'étage supérieur. Il me parut fort étrange d'entrer ainsi dans une maison anglaise, de grimper cet escalier assez raide en me cramponnant à la rampe pour ne pas tomber en arrière. Mes membres semblaient être en caoutchouc, comme si j'avais été incapable d'exercer sur eux un contrôle total... ce qui était le cas d'ailleurs, car il me fallut plusieurs jours pour faire agir à ma guise ce corps emprunté. Les deux lamas demeuraient là, très inquiets, mais, bien entendu, ils ne pouvaient m'être d'aucun secours. Ils me quittèrent bientôt, promettant de revenir à l'aube.
Lentement, chancelant comme un somnambule, j'entrai dans la chambre qui était désormais la mienne et mes mouvements étaient saccadés comme ceux d'un automate. Avec un soupir de soulagement, je m'écroulai sur le lit. "Au moins, me dis-je, je ne pourrai plus tomber !" Mes fenêtres donnaient à la fois sur l'avant et sur l'arrière de la maison. En tournant la tête à droite, je pouvais voir le petit jardin, la route, et le Cottage Hospital, ce qui, dans l'état où je me trouvais, ne me réconfortait guère.
De l'autre côté de la chambre, s'ouvrait la fenêtre par laquelle, en tournant la tête à gauche, je pouvais voir le jardin de derrière, plus grand que l'autre, mal tenu, avec des herbes dures qui croissaient par petites touffes, comme dans une prairie. Des haies séparaient chaque jardin de son voisin. À l'extrémité de la pelouse s'élevaient une rangée d'arbres maladifs et une barrière en fil de fer. Au-delà, je distinguais les contours d'une ferme et un troupeau de vaches en train de paître.
J'entendis des voix au-dehors, mais elles étaient tellement ‘British’, qu'il m'était presque impossible de comprendre ce qu'elles disaient. L'anglais que je connaissais était surtout celui des Américains et des Canadiens, et les syllabes curieusement accentuées de la Vieille École (Oxford ; l'accent des Oxfordiens, ou de leurs imitateurs, est très particulier — NdT) me laissaient désemparé. Je m'aperçus que j'avais moi-même du mal à m'exprimer ; je n'émettais qu'un croassement sourd. Mes cordes vocales semblaient s'être épaissies. J'appris à parler lentement et à me représenter tout d'abord l'image du mot que j'allais dire. J'avais tendance à prononcer ‘cha’ au lieu de ‘j’, je disais ‘chon’ pour ‘John’, entre autres. Parfois je pouvais à peine comprendre ce que je disais !
Cette nuit-là, les lamas voyageurs de l'astral revinrent et me réconfortèrent en me déclarant que désormais il me serait encore plus facile de me déplacer astralement. Ils me dirent aussi que mon corps tibétain était bien à l'abri dans un cercueil de pierre, sous la garde constante de trois moines. Des recherches faites dans les vieux textes avaient montré qu'il me serait facile de retrouver mon propre corps mais que le transfert demanderait un certain temps.
Pendant trois jours je restai dans ma chambre, me reposant ou faisant quelques exercices, et je commençai à m'habituer à ce changement d'existence. Le soir du troisième jour à la faveur de l'obscurité je me promenai dans le jardin. Je m'aperçus que j'étais capable de faire agir ce corps à ma guise, bien qu'à certains moments imprévisibles un bras ou une jambe refusassent de m'obéir.
Le lendemain matin, la femme qui passait pour être la mienne me dit :
— Il faudra que tu ailles au Bureau de Placement pour voir s'ils ont une place à t'offrir.
Le Bureau de Placement ? Sur le moment je ne saisis pas ce qu'elle voulait dire. Puis elle employa le terme de ‘Ministère du Travail’, et je compris. Je n'avais jamais été en pareil endroit, et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait y faire. D'après ce que cette femme m'avait dit, cela se trouvait près de Hampton Court, à Molesey.
Pour une raison qui m'échappa, à l'époque, je n'avais pas droit à l'allocation au chômage. Plus tard j'appris que si une personne quittait son emploi volontairement, si déplaisant qu'il fût, elle n'avait droit à aucune compensation, même si elle avait payé pendant vingt ans sa cotisation au fonds de chômage.
Le Bureau de Placement ! Je dis :
— Aide-moi à sortir la bicyclette et j'irai.
Nous descendîmes ensemble l'escalier, entrâmes dans le garage, encombré maintenant de vieux meubles, et j'y trouvai la bicyclette, cet instrument de torture que j'avais utilisé une seule fois auparavant, à Chongqing, où j'avais descendu la colline la tête la première, avant de trouver les freins. Avec précaution, j'enfourchai l'engin et m'éloignai le long de la rue, vers le pont du chemin de fer d'où je tournai à gauche. Un homme agita gaiement la main sur mon passage, et je faillis tomber en lui rendant son salut.
— Vous n'avez pas l'air bien du tout, cria-t-il. Allez-y doucement.
Je continuai à pédaler, les jambes douloureuses. Puis je tournai enfin à droite, comme on me l'avait indiqué, pour gagner la large route menant à Hampton Court. Brusquement, mes jambes refusèrent de m'obéir et, en roue libre, je parvins tout juste à traverser la route, pour m'effondrer sur l'herbe du bas-côté ; la bicyclette s'abattit sur moi. Pendant un moment je demeurai étendu là, assommé par la chute, et une femme, qui avait été occupée à secouer ses paillassons devant sa porte, se précipita vers moi en criant :
— Vous devriez avoir honte d'être déjà soûl à cette heure-ci ! Je vous ai vu. J'ai bien envie d'appeler la police !
Elle me jeta un regard méprisant, puis revint rapidement à sa maison, prit les paillassons et claqua la porte derrière elle.
"Si elle savait, me dis-je, si elle savait !"
Je demeurai étendu une vingtaine de minutes. Des gens ouvrirent leurs portes pour me regarder. D'autres écartèrent les rideaux de leurs fenêtres. Deux femmes allèrent jusqu'au fond de leurs jardins et échangèrent, d'une voix rauque et sonore, des remarques sur mon compte. Mais personne ne parut songer un instant que j'avais pu être pris d'un malaise et avoir besoin de soins.
Enfin, au prix d'un immense effort, je me remis sur pied, remontai en selle et repris la direction de Hampton Court.
Chapitre Neuf
Le Bureau de Placement était un bâtiment lugubre, situé dans une rue latérale. Je mis pied à terre et me dirigeai vers l'entrée.
— Vous tenez à vous faire voler votre bicyclette ? demanda une voix derrière moi.
Je me retournai vers l'homme qui avait parlé.
— Mais les chômeurs ne se volent sûrement pas les uns les autres ? dis-je.
— Vous devez être nouveau par ici ; mettez une chaîne et un cadenas à votre vélo, sinon vous rentrerez chez vous à pied.
Sur ce, l'homme haussa les épaules et pénétra dans le bâtiment. Je revins sur mes pas, et fouillai dans la trousse de la bicyclette. Oui, elle contenait un cadenas et une chaîne. J'allais mettre celle-ci autour de la roue, comme j'avais vu d'autres le faire, quand une pensée horrible me frappa : Où était le clef ? Je fouillai dans ces poches si peu familières et en tirai un trousseau de clefs. Les essayant l'une après l'autre, je finis par trouver la bonne.
J'entrai dans le bâtiment. Des flèches dessinées à l'encre noire sur des panneaux en carton indiquaient le chemin. Je tournai à droite et entrai dans une pièce où se trouvaient quantité de chaises en bois, en rangs serrés.
— Allo, Prof ! dit une voix. Venez vous asseoir à côté de moi en attendant votre tour.
Je m'approchai de l'homme qui avait parlé et pris la chaise voisine de la sienne.
— Vous n'êtes pas le même ce matin, continua-t-il. Que vous est-il arrivé ?
Je le laissai parler, glanant des bribes d'informations. L'employé appela des noms, des hommes allèrent s'asseoir devant sa table. Il cria un nom qui me parut vaguement familier. "Quelqu'un que je connais ?" me demandai-je. Personne ne broncha. Il appela de nouveau.
— Allez-y, c'est à vous, me dit mon nouvel ami.
Je me dirigeai vers le bureau et m'assis, ainsi que j'avais vu les autres le faire.
— Qu'est-ce que vous avez, ce matin ? me demanda l'employé. Je vous ai vu entrer, puis je vous ai perdu de vue et j'ai cru que vous étiez reparti. (Il me regarda attentivement :) Vous avez changé, on dirait. Ça ne peut pas être une question de coiffure, puisque vous n'avez pas de cheveux. (Puis, il se redressa et ajouta :) Non, je n'ai rien pour vous malheureusement. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Au suivant, s'il vous plaît.
Je sortis mélancoliquement, et revins à bicyclette à Hampton Court ; là, j'achetai un journal et continuai mon chemin, le long des rives de la Tamise. C'était un très bel endroit, un site favori des Londoniens en vacances. Je m'assis sur la berge herbeuse et parcourus dans le journal la page des ‘Offres d'emploi’.
— Vous trouverez jamais d'place par le Bureau de Placement, dit une voix, et un homme se laissa tomber sur l'herbe à côté de moi. Prenant un brin d'herbe, il le mâchonna songeusement en le faisant rouler entre ses lèvres.
— Ils vous paient pas d'allocation, v'comprenez ? Alors ils cherchent pas à vous trouver quelque chose. Ils donnent les emplois à ceux qu'ils sont obligés de payer. Comme ça, ils font des économies, v'comprenez ? S'ils vous donnaient un boulot, ils devraient payer à quelqu'un d'autre l'allocation de chômage et le gouvernement ronchonnerait, v'comprenez ?
Je réfléchis. Ces paroles, malgré leur grammaire défectueuse, me parurent pleines de bon sens.
— Eh bien, que feriez-vous à ma place ? demandai-je.
— Moi ! Bon sang, j'cherche pas de travail, j'vais simplement là-bas pour toucher l'allocation, elle m'fait vivre, ça et les petites bricoles que j'fais à côté. Eh bien, patron, si vous voulez vraiment du travail, allez voir pour un d'ces Emplos... ici... laissez-moi voir.
Il me prit le journal des mains, tandis que je me demandais ce que pouvait bien être un ‘Emplo’.
"J'ai vraiment beaucoup à apprendre", me dis-je. Que j'étais ignorant de tout ce qui concernait l'Occident !
Se léchant les doigts et murmurant les lettres de l'alphabet, l'homme feuilletait le journal.
— Voilà, s'exclama-t-il triomphalement. Emplos, ici, regardez vous-même.
Je parcourus rapidement la colonne nettement indiquée par l'empreinte crasseuse de son pouce. Celle des offres d'emploi.
— Mais, c'est pour femmes ! dis-je avec mépris.
— Bon sang, répliqua-t-il, savez pas lire ? C'est écrit : Hommes et femmes. Allez les voir et vous laissez pas faire, sans quoi, ils vous feront tourner en bourrique. Dites-leur que vous voulez du travail, sinon !...
Cet après-midi-là, je me rendis au centre de Londres, et je grimpai l'escalier sale, menant à un bureau délabré, dans une rue de Soho. Une femme trop maquillée, aux cheveux oxygénés et aux ongles écarlates, était assise devant un bureau de métal, dans une pièce si petite qu'elle avait dû autrefois servir de placard.
— Je cherche du travail, lui dis-je.
Elle s'adossa à sa chaise et m'observa d'un œil froid. Puis elle bâilla largement, montrant des dents gâtées et une langue chargée.
— ‘Ooaryer ?’ (Who are you ? Qui êtes-vous ? — NdT) demanda-t-elle. (Je la regardai bouche bée.) ‘Ooaryer ?’ répéta-t-elle.
— Excusez-moi, dis-je, mais je n'ai pas compris votre question.
— ‘Oogawd !’ (Oh God ! Oh, mon Dieu ! — NdT) soupira-t-elle. Il cause même pas l'anglais. Tenez, emplissez c'formulaire.
Elle me jeta un questionnaire, prit sa plume, sa montre, un livre et son sac, et disparut dans une pièce du fond. Je m'assis et m'efforçai de répondre de mon mieux aux questions. Au bout d'un long moment, la femme réapparut et me désigna du pouce la porte par laquelle elle venait de sortir.
— Entrez là, ordonna-t-elle.
Je me levai et pénétrai dans une pièce un peu plus vaste. Un homme était assis devant un bureau maculé et couvert de papiers en désordre. Il mâchonnait le bout d'un cigare malodorant et un melon couvert de taches était perché en arrière sur son crâne. Il me fit signe de m'asseoir devant lui.
— V'z'avez l'argent de l'inscription ? me demanda-t-il. (Je cherchai dans ma poche et lui tendis la somme mentionnée sur le formulaire. L'homme prit l'argent, le compta, le recompta, et l'empocha.) Où avez-vous attendu ? demanda-t-il.
— Dans l'autre bureau, répondis-je innocemment.
À ma consternation, il éclata de rire.
— Ha, ha, ha ! rugit-il. Je lui dis : "Où c'est que vous avez attendu" et y me répond : "Dans l'autre bureau !" (S'essuyant les yeux, il se domina avec un effort visible, et reprit :) Écoutez, mon gars, v'z êtes un vrai clown, mais j'ai pas d'temps à perdre. Z'avez été garçon de café ou kékchose ?
— Non, répondis-je. Je cherche une situation dans les domaines suivants (je lui tendis la liste de tout ce que je savais faire)... maintenant, êtes-vous ou non en mesure de me venir en aide ?
Il fronça les sourcils en parcourant la liste :
— Eh bien, j'sais pas... vous parlez comme un duc... écoutez, j'vais voir c'que j'peux faire. Revenez dans une semaine.
Sur ce, il ralluma son cigare éteint, planta les pieds sur son bureau en étendant la main vers un journal de courses. Je sortis, déçu, passai devant la femme peinte, qui salua mon départ d'un regard et d'un reniflement de mépris, puis redescendis les escaliers grinçants et me retrouvai dans la rue lugubre.
Non loin il y avait une autre agence ; j'y dirigeai mes pas. À la vue de l'entrée, mon cœur se serra : une porte latérale, des escaliers de bois nu, des murs sales où la peinture s'écaillait. Au second étage, j'ouvris une porte marquée ‘Entrez’. Elle donnait sur une vaste pièce qui occupait toute la largeur de l'immeuble. Il y avait là des tables branlantes et derrière chacune était assis un homme ou une femme qui consultait des fichiers placés devant lui ou elle.
— Oui ? Qu'y a-t-il pour votre service ? me demanda une voix.
Je me retournai et vis une femme qui devait avoir dans les soixante-dix ans, bien qu'elle parût encore plus âgée. Sans attendre ma réponse, elle me tendit un questionnaire en me demandant de le remplir et de le remettre à la jeune fille assise au bureau. Je fournis donc tous les nombreux détails, d'ordre très personnel, et remis le formulaire à l'employé comme on me l'avait indiqué. Sans y jeter un regard, elle me dit :
— Vous pouvez me régler les frais d'inscription tout de suite.
J'obéis en songeant qu'ils avaient trouvé là un moyen commode de gagner de l'argent. Elle compta la somme avec soin, la passa par un guichet à une autre femme, qui la recompta, et j'eus droit à un reçu. La jeune fille se leva, et cria :
— Y a-t-il quelqu'un de libre ?
Un homme, assis à un bureau au fond de la pièce, leva une main nonchalante. L'employée se tourna vers moi :
— Ce monsieur, là-bas, va vous voir.
Je me frayai un passage jusqu'à lui parmi les tables. Pendant un moment, il ne fit aucune attention à moi et continua à écrire, puis il tendit la main. Je la pris et la serrai, mais il la retira en disant d'un ton irrité :
— Non, non, je veux voir votre reçu, votre reçu, vous comprenez. (L'examinant avec soin, il le retourna et en regarda le côté vierge. Puis il relut l'autre côté, décida apparemment que le reçu était valable, après tout, car il me dit :) Voulez-vous vous asseoir ?
À ma grande surprise, il prit un nouveau formulaire et me posa toutes les questions auxquelles je venais de répondre. Laissant tomber mon formulaire dans la corbeille à papiers et mettant le sien dans un tiroir, il dit :
— Revenez dans une semaine, nous verrons ce que nous pouvons faire.
Il se remit à écrire. Et ce qu'il écrivait, c'était une lettre personnelle à une femme !
— Hé, dis-je d'une voix sonore, je veux qu'on s'occupe de moi tout de suite !
— Mon cher ami, rétorqua-t-il, il est absolument impossible de faire les choses si vite, il faut procéder avec méthode, vous comprenez, avec méthode !
— Eh bien, dis-je, je veux du travail maintenant ou qu'on me rende mon argent !
— Mon Dieu, mon Dieu ! soupira-t-il, mais c'est épouvantable !
Jetant un coup d'œil sur mon visage obstiné, il soupira de nouveau et se mit à ouvrir tiroir après tiroir, comme pour gagner du temps, semblait-il, avant de prendre une décision. Mais il ouvrit un tiroir un peu trop à fond. Il y eut un bang et tout un flot d'objets personnels s'éparpillèrent sur le plancher. Une boîte de trombones cracha son contenu. Nous ramassâmes le tout et le posâmes en vrac sur le bureau. Enfin, tout reprit sa place dans le tiroir.
— Ce sacré tiroir ! dit l'homme d'un ton résigné. Il tombe perpétuellement !
Pendant un moment, il examina ses fiches, puis feuilletant un monceau de paperasses il secoua la tête négativement, les écarta, et en prit d'autres.
— Ah ! dit-il enfin. (Puis après un silence de plusieurs minutes, il reprit :) Oui, j'ai un travail pour vous !
Il feuilleta de nouveau des papiers, changea de lunettes et étendit la main vers une pile de fiches. Prenant celle du dessus, il la plaça devant lui et commença lentement à écrire.
— Où est-ce donc ? Ah ! Clapham, vous connaissez Clapham ? (Sans attendre ma réponse, il continua :) C'est une firme de travaux photographiques. Vous travaillerez de nuit. Les photographes ambulants du West End apportent leurs négatifs le soir, et viennent chercher les épreuves le lendemain matin. Humm... oui... laissez-moi voir. (Il se remit à tripoter les papiers.) Il faudra parfois que vous travailliez vous-même dans le West End pour remplacer un photographe. Maintenant, prenez cette carte, et allez voir ce type-là, conclut-il en me désignant de son crayon le nom qu'il avait écrit sur la carte.
Clapham n'était pas un des districts les plus salubres de Londres : l'adresse à laquelle je me rendis, dans une rue écartée et sordide de taudis proches de la gare, n'était vraiment pas engageante. Je frappai à la porte d'une maison dont la peinture s'écaillait et où une fenêtre brisée avait été ‘réparée’ avec du papier collant. La porte s'ouvrit. Une femme mal tenue me jeta un coup d'œil ; ses cheveux broussailleux lui tombaient sur le visage.
— Ouais ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Je le lui dis ; elle se retourna et hurla :
— 'Arry ! Y a un type qui veut te voir !
Puis elle referma la porte, me laissant dans la rue. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un homme à l'aspect vulgaire apparut ; pas rasé, sans cravate, un mégot collé à sa lèvre inférieure. Ses doigts de pied sortaient de ses pantoufles trouées.
— Qu'est-ce que vous voulez, mon vieux ? demanda-t-il. (Je lui tendis la carte du Bureau de Placement. Il la prit, l'examina sous tous ses angles, me regarda et dit :) Un étranger, hein ? Y en a des tas à Clapham. Ils sont moins difficiles que nous autres Anglais.
— Voudriez-vous me parler de cet emploi ? demandai-je.
— Pas tout de suite. Faut d'abord que je vous voie un peu. Entrez, j'suis au sous-sol.
Sur ces mots, il tourna les talons et disparut. Fort déconcerté, j'entrai dans la maison. Comment pouvait-il se trouver au sous-sol puisqu'il avait été juste devant moi ?
Le vestibule était obscur. Je restai là, ne sachant quelle direction prendre, et je sursautai lorsqu'une voix hurla près de moi, et à mes pieds, semblait-il :
— Alors, mon vieux, vous descendez, oui ou non ? Un bruit de pas et la tête de l'homme apparut d'une porte de sous-sol faiblement éclairé que je n'avais pas remarquée. Je descendis quelques marches de bois branlantes, craignant à chaque instant de tomber.
— L'atelier, me dit l'homme, fièrement.
Une ampoule jaune répandait une lueur pâle à travers un brouillard de fumée de cigarette. L'atmosphère était étouffante. Le long du mur se trouvait un banc, pourvu d'un tuyau d'écoulement d'eau sur toute sa longueur. Des cuvettes y étaient placées, à intervalles réguliers. Sur une table, dans un coin, se dressait un vieil agrandisseur, et une autre table, couverte d'une feuille de plomb, portait un certain nombre de grandes bouteilles.
— Je suis 'Arry, dit l'homme. Préparez-moi des solutions, afin que j'puisse voir c'que vous savez faire.
'Arry s'écarta et gratta une allumette sur le fond de son pantalon, pour griller une cigarette. Rapidement, je préparai les solutions, le bain d'arrêt et le bain de fixage.
— O.K., dit-il. Maintenant prenez ce rouleau de pellicules et tirez-moi quelques épreuves. (Je voulus faire un essai, mais il m'en empêcha :) Non, ne gâchez pas de papier, accordez-leur cinq secondes.
'Arry parut satisfait de mon travail.
— On paie tous les mois, me dit-il. Faites pas de nus. J'veux pas d'ennuis avec les flics. Vous me donnez tous les nus. Parfois les gars en font en douce pour des clients spéciaux. Vous me les passez tous, compris ? Vous commencez ici à dix heures du soir et vous partez à sept heures du matin. O.K. ? Alors c'est d'accord !
Ce soir-là, juste avant dix heures, je longeai la rue lugubre, m'efforçant de lire les numéros dans l'obscurité environnante. J'atteignis enfin la maison et grimpai les marches grisâtres menant à la porte couverte d'éraflures, je frappai et attendis. L'attente fut brève. La porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds rouillés. Et je vis apparaître la femme qui m'avait reçu, quelques heures plus tôt. La même femme, mais combien différente ! Son visage était poudré et maquillé, ses cheveux soigneusement ondulés et sa robe presque transparente, qu'éclairait la lumière du vestibule, derrière elle, dessinait nettement sa silhouette dodue. Elle m'adressa un sourire qui montra toutes ses dents et me dit :
— Entrez, mon chou, j'suis Marie. Qui est-ce qui vous envoie ? (Sans attendre ma réponse, elle se pencha vers moi, sa robe décolletée bâillant dangereusement, et reprit :) C'est trente shillings la demi-heure, ou trois livres dix pour la nuit complète. Et j'connais la musique, mon chou !
Comme elle s'écartait pour me laisser entrer, la lumière du vestibule éclaira mon visage. Elle aperçut ma barbe et me jeta un regard courroucé.
— Ah, c'est vous ! dit-elle d'un ton glacial. (Et le sourire s'effaça de sa figure, comme la craie est effacée d'un tableau noir par un chiffon humide.) Vous me faites perdre mon temps ! glapit-elle. Quel toupet ! Faudra que vous ayez une clé, pass'qu'à c't'heure-ci, j'suis généralement occupée.
Je me retournai, fermai la porte donnant sur la rue et descendis au lamentable sous-sol. Il y avait des caisses entières de films à développer et j'eus l'impression que tous les photographes de Londres avaient apporté là leurs rouleaux de pellicules. Je travaillai dans les ténèbres du Styx, déballant les caisses, fixant des pinces à une extrémité des films et les plongeant dans les cuvettes. Le compteur de laboratoire faisait : ‘Clack, clack, clack.’ Brusquement la sonnerie retentit, m'avertissant que les films étaient prêts pour le bain d'arrêt. Ce son inattendu me fit bondir et je me heurtai la tête contre une poutre basse. Je sortis les films et les plongeai quelques minutes dans le bain. Puis je les ressortis pour les mettre dans le bain de fixage où ils devaient mariner un quart d'heure. Un autre plongeon, cette fois dans l'éliminateur à hyposulfite, et les films furent prêts pour le lavage. Pendant cette dernière opération, j'allumai l'ampoule jaune et fis quelques agrandissements.
Deux heures plus tard, tous les films étaient développés, fixés, lavés et séchés dans de l'alcool à brûler. Quatre heures s'écoulèrent et mon travail avançait rapidement. Et je commençais à avoir faim. Je jetai un regard autour de moi, mais ne vis rien qui permît de faire bouillir de l'eau. D'ailleurs, il n'y avait pas de bouilloire. Je m'assis, sortis mes sandwiches et lavai soigneusement un verre gradué où je versai de l'eau. Je songeai à la femme, en haut, me demandant si elle buvait du bon thé, bien chaud, et souhaitant qu'elle m'en apportât une tasse.
La porte, en haut de l'escalier du sous-sol, s'ouvrit brusquement, laissant passer un flot de lumière. Je me hâtai de couvrir un paquet ouvert de papier au citrate, afin que la lumière ne l'abîmât pas ; une voix me cria :
— Hé, vous là-dedans ? Voulez une tasse de thé ? Le bizeness marche pas, ce soir, et je me suis fait du thé avant d'aller me pieuter. J'pensais à vous tout le temps. Ça doit être de la télépathie.
Elle se mit à rire de sa plaisanterie et descendit l'escalier en faisant claquer ses talons. Elle posa le plateau et s'assit sur le banc de bois, en respirant bruyamment :
— Hou ! c'qu'il peut faire chaud ici ! (Elle défit la ceinture de sa robe de chambre et l'ouvrit... et, à ma grande horreur, je vis qu'elle n'avait rien en dessous ! Surprenant mon regard, elle gloussa :) J'essaye pas de vous séduire, vous avez assez de travail comme ça ce soir. (Elle se leva en laissant tomber le peignoir au sol, et alla regarder la pile d'épreuves en train de sécher.)
Mince ! s'exclama-t-elle, quelles binettes ! Je me demande pourquoi ces gars-là se font photographier.
Elle se rassit, sans prendre le mal de remettre son peignoir. Oui, il faisait chaud dans la pièce et moi j'avais encore plus chaud !
— Croyez-vous à la télépathie ? questionna-t-elle.
— Bien sûr, répondis-je.
— Eh bien ! j'ai vu un spectacle au Palladium (célèbre music-hall londonien — NdT) et ils ont fait des expériences de télépathie. Moi je disais que c'était sérieux, mais le type qui m'accompagnait disait que c'était arrangé à l'avance.
Une légende orientale raconte qu'un voyageur traversait le grand désert de Gobi. Son chameau était mort, et lui rampait sur le sable, presque mort de soif. Soudain, il aperçut à quelques pieds (m) de lui ce qui semblait être une outre en peau de chèvre, comme celles dans lesquelles les voyageurs emportent de l'eau. Se hâtant désespérément, il l'ouvrit et pencha la tête pour boire ; mais la peau de chèvre ne contenait que des diamants magnifiques qu'un voyageur altéré avait jetés derrière lui pour s'alléger et avancer plus aisément. Cette légende peut symboliser le mode de vie Occidental : les gens veulent les biens matériels, le progrès technique, des fusées de plus en plus fortes, des avions sans pilote, la conquête de l'espace. Les véritables valeurs, les voyages astraux, la clairvoyance, la télépathie... tout cela n'éveille que leur méfiance, ils considèrent ces expériences comme des ‘tours’ de music-hall.
Quand les Anglais occupaient les Indes, on savait que les Indiens étaient capables d'envoyer des messages d'un point à l'autre du pays, pour annoncer les révoltes, les arrivées, ou n'importe quelle nouvelle intéressante. Ce même phénomène avait lieu en Afrique où on l'appelait ‘le télégraphe de la Brousse’. Avec l'entraînement approprié, les fils télégraphiques deviendraient superflus ! Plus de téléphone pour nous irriter les nerfs, les gens pourraient envoyer des messages par leurs propres moyens. En Orient, il y a des siècles que l'on étudie ces phénomènes ; les pays Orientaux ‘sympathisent’ avec ces idées, et aucune pensée négative n'empêche le fonctionnement des dons de la Nature.
— Marie, dis-je, je vais vous montrer un petit truc qui vous prouvera que la télépathie existe et que l'Esprit domine sur la Matière. C'est moi qui serai l'Esprit, et vous la Matière.
Elle me regarda avec méfiance, et même avec une certaine hostilité, puis elle répondit :
— D'accord, n'importe quoi pour rigoler un peu.
Je concentrai mes pensées sur sa nuque, et j'imaginai qu'un moustique la piquait. Brusquement, Marie se donna une tape dans le cou, en qualifiant l'insecte importun d'un très vilain nom. J'imaginai alors que la piqûre se faisait plus douloureuse. Marie me regarda et se mit à rire :
— Bon sang, dit-elle, si je pouvais arriver à faire ce truc-là, je m'amuserais bien aux dépens des types qui viennent me rendre visite !
Soir après soir, je me rendis à cette maison minable, dans cette triste rue écartée. Souvent, lorsque Marie n'était pas occupée, elle venait me trouver, armée d'une théière, et nous bavardions. Peu à peu, je me rendis compte que sous cet extérieur grossier, et en dépit de la vie qu'elle avait menée, elle était très bonne envers les gens dans le besoin. Elle me parla de mon employeur et me conseilla d'arriver de bonne heure, le dernier jour du mois.
Soir après soir, je développai, tirai des épreuves et préparai toute la collection pour le lendemain matin. Pendant un mois entier je ne vis que Marie, puis, le trente et un, je restai à l'atelier plus tard que d'habitude. Vers neuf heures, un individu à l'air sournois descendit bruyamment l'escalier démuni de tapis. Arrivé en bas, il me considéra avec une hostilité évidente.
— Vous croyez qu'vous allez vous faire payer le premier, hein ! glapit-il. Vous êtes l'employé de nuit, fichez le camp d'ici !
— Je partirai quand j'aurai fini, pas avant, répondis-je.
— Espèce de !... dit-il, j'vais vous apprendre la politesse !
Il saisit une bouteille, en brisa le goulot contre un mur et se rua vers moi, dirigeant vers ma figure le verre acéré. J'étais fatigué et la colère me prit. Quelques-uns des plus grands Maîtres de l'Orient m'avaient appris l'art de combattre. Je désarmai le misérable petit bonhomme — tâche fort aisée — et le mettant en travers de mes genoux, je lui donnai la plus belle correction de sa vie. Marie en entendant ses cris, bondit de son lit et alla s'asseoir sur l'escalier pour jouir du spectacle ! L'individu s'était mis à pleurer et pour effacer la trace de ses larmes et arrêter le flot d'obscénités, je lui enfonçai la tête dans la cuvette servant au lavage des épreuves. Enfin, je le lâchai et lui dis :
— Allez vous mettre dans ce coin. Si vous bronchez avant que je ne vous y autorise, je recommence !
Il ne broncha pas !
— Oh là là ! Ça faisait plaisir de voir ça, dit Marie. Ce petit salaud est le chef d'un des gangs de Soho. Vous lui avez fait peur, lui qui se prenait pour un dur de dur !
Je m'assis et attendis. Environ une heure plus tard, l'homme qui m'employait arriva et pâlit en me voyant en compagnie du gangster.
— Je veux mon salaire, lui dis-je.
— Le mois a été mauvais, je n'ai pas d'argent, il faut que je lui paie sa protection, me dit-il en désignant le truand.
Je le regardai.
— Croyez-vous que j'aurai travaillé pour rien dans ce trou infect ?
Donnez-moi quelques jours, je vais voir si je peux trouver un peu d'argent. C'est lui (il montrait le gangster du doigt) qui me prend tout, et si je refuse de payer, il cause des ennuis à mes hommes.
Pas d'argent et pas grand espoir d'en toucher ! J'acceptai de continuer pendant deux semaines encore pour donner au ‘Patron’ le temps de trouver quelques fonds. Et, découragé, je quittai la maison en me disant que j'avais encore de la chance d'être allé à Clapham à bicyclette et d'avoir ainsi économisé les frais de transport. Au moment où j'enlevai la chaîne du vélo, le truand s'approcha furtivement de moi.
— Dites donc, Patron, murmura-t-il d'une voix rauque, voulez-vous un bon boulot ? Si vous vous occupiez de moi ? Vingt livres par semaine ?
— Fichez le camp, espèce de petit morveux, grommelai-je.
— Vingt-cinq livres !
Comme je me tournais vers lui, exaspéré, il s'éloigna vivement, non sans ajouter :
— J'irai jusqu'à trente, et v'z'aurez toutes les femmes que vous voudrez et tout l'alcool que vous pourrez boire, allons, soyez chic !
Voyant mon expression, il enjamba la grille du sous-sol et disparut dans un des logements. J'enfourchai ma bicyclette et m'éloignai.
Je continuai à faire ce métier pendant près de trois mois, tantôt travaillant à l'atelier, tantôt dans la rue, comme photographe ambulant, mais ni moi ni les autres ne fûmes jamais payés. Finalement, à bout de patience, nous donnâmes tous notre démission.
Entre-temps, j'avais déménagé et nous habitions sur l'une de ces places sans grâce du quartier de Bayswater ; j'allai de Bureau de Placement en Bureau de Placement, à la recherche d'une situation. Enfin, sans doute pour se débarrasser de moi, un employé me dit :
— Pourquoi n'allez-vous pas au service des Emplois Supérieurs, place Tavistock ? Je vais vous donner une carte.
Plein d'espoir, je m'y rendis. On me fit de superbes promesses. En voici un échantillon :
— Oui, nous avons exactement ce qu'il vous faut. Nous cherchons un homme pour la nouvelle station de recherches atomiques à Caithness, en Écosse. Voulez-vous aller vous y présenter ?
Ce disant, l'employé feuilleta vigoureusement ses papiers. Je demandai :
— Me paierez-vous le déplacement ?
— Grands dieux non ! me fut-il répondu. Le voyage est à vos frais.
Une autre fois, j'allai, à mes frais, à Cardigan, au pays de Galles. On y demandait un ingénieur civil. La gare de Cardigan était terriblement éloignée de l'endroit où je devais me présenter. Je marchai le long des rues et atteignis l'autre côté de la ville.
— Mon Dieu, c'est encore loin, vous savez, me dit l'aimable femme à qui je demandai mon chemin.
À force de marcher, j'atteignis l'entrée d'une maison cachée par les arbres. L'allée centrale était bien entretenue. Elle était aussi très longue et en pente. Enfin, j'entrai dans la maison. L'homme affable qui me reçut regarda mes papiers (que je m'étais fait expédier de Shanghaï) et eut un hochement de tête approbateur.
— Avec de telles références, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver une situation, me dit-il. Malheureusement, vous n'avez pas travaillé comme ingénieur civil en Angleterre même. Par conséquent, je ne peux pas vous offrir un emploi ici. Mais dites-moi, ajouta-t-il, vous avez votre diplôme de médecin. Pourquoi avez-vous fait aussi des études qui vous ont valu le diplôme d'ingénieur civil ?
— En tant que médecin, je devais aller dans des régions assez écartées et je voulais être capable de construire mon propre hôpital, répondis-je.
— Hum, grommela-t-il. Je voudrais pouvoir vous aider, mais ça ne m'est pas possible.
Je retraversai tout Cardigan, et regagnai la morne gare. J'attendis le train deux heures, et lorsque j'arrivai enfin chez moi, ce fut pour annoncer, une fois de plus, que je n'avais pas trouvé de travail. Le lendemain, je retournai à un Bureau de Placement. L'Employé, assis devant sa table ("la quittait-il jamais ?" me demandai-je) me déclara :
— Écoutez, mon vieux, il est impossible de se parler ici. Emmenez-moi déjeuner, et je pourrai peut-être vous apprendre quelque chose, d'accord ?
Pendant plus d'une heure, j'errai dans la rue, regardant de temps à autre les fenêtres de l'agence de placement, et maudissant mes pieds douloureux. De l'autre côté de la rue un policier m'observait avec suspicion, apparemment incapable de décider si j'étais un individu inoffensif ou un éventuel voleur de banque. Peut-être avait-il lui aussi mal aux pieds ! Enfin, l'Employé s'arracha à sa table et descendit l'escalier qui gémit sous ses pas.
— Le 79, mon vieux, on va prendre l'autobus 79. Je connais un gentil petit restaurant où les prix sont très raisonnables.
Nous prîmes donc l'autobus 79 et atteignîmes bientôt notre destination, un de ces restaurants situés dans une rue latérale, et qui sont d'autant plus chers que la salle est plus exiguë. L'Homme Arraché à son Bureau et moi déjeunâmes, moi, très frugalement, lui, très copieusement. Enfin, poussant un soupir de satisfaction, il me dit :
— Écoutez, mon vieux, vous autres, vous espérez trouver de bonnes situations, mais si les situations qu'on offre étaient si bonnes que ça, vous pensez bien que ce serait nous, le personnel de l'agence, qui sauterions dessus les premiers. Nous ne gagnons pas de quoi vivre confortablement, vous savez !
— Il doit tout de même bien y avoir un moyen de trouver du travail dans cette cité de ténèbres, ou dans ses environs, lui dis-je.
— L'ennui, chez vous, c'est que vous n'êtes pas comme les autres, vous attirez l'attention. Et vous avez l'air malade. Peut-être que vous devriez vous raser la barbe. (Il me regarda pensivement, se demandant sans doute comment prendre congé de moi avec élégance. Soudain, il jeta un coup d'œil à sa montre et bondit de sa chaise :) Mon vieux, il faut que je file, le Garde-Chiourme surveille nos heures d'arrivée, v'savez. (Il me tapota le bras et conclut :) Ne gaspillez pas votre argent chez nous, nous n'avons d'emploi que pour les garçons de café ou pour des gens de même calibre.
Sur ce, il tourna les talons et disparut, me laissant payer la note qui était fort élevée.
Je sortis du restaurant et errai dans la rue. Ne sachant que faire de moi-même, je regardai les petites annonces collées sur la vitrine d'une boutique : ‘Jeune veuve avec enfant cherche du travail...’ ‘Homme capable d'exécuter des travaux de sculpture, même difficiles, cherche commandes.’ ‘Masseuse fait traitements à domicile.’ (Je n'en doute pas ! songeai-je.) Tout en m'éloignant, je réfléchis : puisque les agences, bureaux de placement, etc., sont incapables de me venir en aide, pourquoi ne mettrais-je pas une annonce dans une vitrine. "Pourquoi pas ?" dirent mes pauvres pieds fourbus, qui résonnaient sourdement sur le dur pavé hostile.
Ce soir-là, chez moi, je me creusai la cervelle à chercher une solution me permettant de vivre et de gagner assez d'argent pour continuer mes recherches sur l'Aura. Finalement, je tapai à la machine, sur six cartes postales, le texte suivant :
‘Docteur en Médecine (Diplôme Étranger) offre ses services pour toutes questions relatives à la psychologie. S'adresser ici.’
J'en tapai six autres, où on pouvait lire :
‘Professionnel, ayant beaucoup voyagé, connaissances scientifiques, offre ses services pour tout emploi inhabituel. Excellentes références. Écrire : boîte n°...’
Le lendemain, ayant placé les annonces bien en vue dans certaines vitrines londoniennes situées dans des rues fréquentées, j'attendis chez moi les résultats. Il y en eut, je réussis à obtenir assez de travaux de psychologie pour me faire vivre et pour alimenter de mieux en mieux le feu vacillant de nos finances. En outre, je fis quelques travaux de publicité à domicile et une grande firme de produits pharmaceutiques m'employa à mi-temps. Le Directeur, un médecin, homme très humain et très généreux, m'aurait embauché à titre définitif, mais la Législation des Assurances pour le Personnel ne le lui permettait pas. J'étais trop vieux et trop malade. La tension nerveuse qu'exigeait l'adaptation à un corps emprunté était terrible. Et la substitution de mes propres molécules à celles du corps ‘nouveau’ était presque au-dessus de mes forces ; néanmoins, je tins bon, dans l'intérêt de la science. Plus fréquemment qu'avant, je me rendais astralement au Tibet durant la nuit ou pendant les week-ends, où je savais que je ne serais pas dérangé, car déranger le corps d'un homme en train de se déplacer astralement peut lui être fatal. Ma consolation était de me retrouver en compagnie de ces grands lamas qui pouvaient me voir dans l'astral et ma récompense était de les entendre me féliciter de ma conduite. Au cours d'une de ces visites, comme je déplorais la mort d'un animal que j'avais beaucoup aimé, un chat dont l'intelligence était bien supérieure à celle de bon nombre d'êtres humains, un vieux lama me sourit avec compassion et me dit :
— Mon Frère, as-tu oublié l'histoire de la Graine de Moutarde ?
(La parabole de la Graine de Moutarde)
La Graine de Moutarde ! Non, je n'avais pas oublié cette histoire, l'une des paraboles de notre Foi...
Une pauvre jeune femme avait perdu son premier-né. Folle de douleur, elle errait dans les rues de la ville, suppliant qu'on lui ramenât son fils à la vie. Certains se détournaient, pleins de compassion, d'autres se moquaient d'elle en la traitant de démente, car qui pouvait ressusciter un enfant mort ? Elle refusait toute consolation, et nul ne savait trouver les mots capables d'atténuer sa douleur. Enfin, un vieux prêtre, ému de son désespoir, lui dit :
— Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse venir à ton secours. C'est le Parfait, le Bouddha qui demeure au sommet de cette montagne. Va le trouver.
La jeune mère, meurtrie par le poids de son chagrin, gravit lentement le rude sentier de la montagne jusqu'à ce que, à un tournant, elle aperçut le Bouddha, assis sur un rocher. Se prosternant, elle s'écria :
— Oh ! Bouddha ! Ramène mon fils à la vie !
Le Bouddha se leva et toucha doucement la pauvre femme :
— Retourne dans la ville, va de maison en maison et rapporte-moi une graine de moutarde d'une maison où nul n'est jamais mort.
La jeune femme se redressa avec un cri de joie et redescendit en hâte la montagne. Elle alla frapper à la première maison et dit :
— Le Bouddha m'a demandé de lui apporter une graine de moutarde d'une maison qui n'a jamais connu la mort.
— Bien des gens sont morts dans cette maison, lui fut-il répondu.
Dans la demeure voisine, on lui dit :
— Il est impossible de dire combien de personnes sont mortes ici, car la maison est vieille.
Elle erra de maison en maison, de rue en rue. Prenant à peine le temps de se reposer ou de se restaurer, elle traversa la ville de bout en bout, mais ne put trouver une seule demeure qui n'ait pas été, à un moment quelconque, visitée par la mort.
Lentement, elle gravit de nouveau le sentier de la montagne. La Bouddha était là, toujours assis dans l'attitude de la méditation.
— As-tu apporté la graine de moutarde ? demanda-t-il.
— Non, et je ne chercherai plus, répondit-elle. La douleur m'avait aveuglée et je croyais être la seule à avoir souffert et pleuré.
— Alors, pourquoi es-tu revenue me trouver ? questionna le Bouddha.
— Pour te demander de m'enseigner la vérité.
Et Bouddha lui dit :
— Dans le monde de l'homme et dans le monde des Dieux, il n'est qu'une seule Loi : Toutes les choses sont transitoires.
Oui, je connaissais tous les Enseignements, mais la perte d'une créature aimée n'en était pas moins douloureuse. Le vieux lama sourit de nouveau et me dit :
— Une ravissante Petite Personne va venir égayer ton existence extraordinairement dure et pénible. Sois patient !
Quelque temps après, plusieurs mois plus tard, nous adoptions Lady Ku'ei. C'était une petite chatte Siamoise d'une beauté et d'une intelligence extraordinaires. Élevée par nous comme un être humain, elle réagit comme le ferait un bon être humain. Et il est vrai qu'elle nous consola de nos épreuves et des trahisons humaines.
Travailler en cavalier seul, sans avoir de statut légal, était vraiment une entreprise difficile. Les malades me prouvaient la véracité du dicton : ‘Quand le Diable est souffrant, il se fait ermite ; quand il se porte bien, il reste le Diable !’ Les histoires que racontaient les clients malhonnêtes pour expliquer leur manque de probité empliraient des volumes, et obligeraient les critiques à faire des heures supplémentaires. Je continuai à chercher un emploi permanent. Un ami me dit :
— Vous pourriez faire du journalisme indépendant ou servir de ‘nègre’ à un auteur. Y aviez-vous songé ? Un de mes amis a écrit un certain nombre de livres, je vais vous donner une introduction pour lui.
J'allai donc dans l'un des grands Musées de Londres voir l'homme en question. On me fit entrer dans un bureau où je me crus tout d'abord dans les réserves du Musée ! Je craignais de bouger, de peur de renverser quelque chose : je m'assis et j'attendis. Enfin ‘l'Ami’ arriva.
— Des livres ? me dit-il. Je vais vous mettre en rapport avec mon agent. Il sera peut-être capable de vous trouver quelque chose.
Il griffonna énergiquement une adresse sur un papier qu'il me tendit. Presque avant de savoir ce qui m'arrivait, je me retrouvai dehors.
"Eh bien, songeai-je, vais-je encore faire chou blanc ?"
Je regardai le papier que je tenais à la main. Regent Street ? À quel endroit de cette rue se trouvait ce numéro ? Je sortis du métro à Oxford Circus et, avec ma chance habituelle, m'aperçus que j'étais au mauvais bout de la rue ! Regent Street était noire de monde, les gens semblaient s'agglomérer devant l'entrée des grands magasins. Un orchestre de la B.B.C. ou de l'Armée du Salut, je ne sais plus lequel, se dirigeait bruyamment vers Conduit Street. Je continuai mon chemin passant devant la maison de la Compagnie des Orfèvres et des Joailliers, me disant qu'un tout petit nombre de leurs articles me permettrait de continuer mes recherches. À l'endroit où la rue s'incurvait pour entrer dans Piccadilly Circus, je traversai et cherchai ce sacré numéro. Une agence de voyages, un bottier, mais pas d'agence littéraire. Enfin, j'aperçus la maison, encastrée entre deux boutiques. J'entrai dans un petit vestibule au fond duquel se trouvait un ascenseur. Il y avait une sonnette et j'appuyai dessus. Rien ne se produisit. J'attendis pendant environ cinq minutes, puis appuyai derechef.
Un bruit de pas.
— Vous m'avez fait remonter de la cave, me dit une voix. J'étais en train de boire mon thé. À quel étage voulez-vous aller ?
— M. B..., répondis-je. Je ne connais pas l'étage.
— Au troisième, dit l'homme. Il est là, je l'ai fait monter... Voilà, ajouta-t-il quelques instants plus tard, en ouvrant la porte de fer. Tournez à droite, c'est cette porte-là.
Sur ce, il disparut pour aller finir sa tasse de thé, sans doute refroidie.
Je poussai la porte indiquée et me dirigeai vers un petit comptoir.
— M. B..., dis-je. J'ai rendez-vous.
Tandis qu'une jeune fille brune allait chercher M. B..., je regardai autour de moi. De l'autre côté du comptoir, des dames buvaient du thé. Un homme d'un certain âge recevait des instructions quant à la livraison d'un paquet. Il y avait, derrière moi, une table chargée de revues — "comme chez un dentiste", me dis-je — et sur le mur étaient accrochés des placards publicitaires pour des maisons d'édition. Le bureau semblait bondé de piles de livres, et des manuscrits, récemment ouverts, étaient rangés en ordre contre le mur du fond.
— M. B... arrive dans un instant, dit une voix et je me retournai pour remercier d'un sourire la jeune fille brune.
À ce moment une porte latérale s'ouvrit, et M. B... entra. Je le regardai avec intérêt, car il était le premier Agent Littéraire que je voyais. Il avait une barbe et je l'imaginais aisément en vieux Mandarin chinois. Quoiqu'Anglais, il avait la courtoisie et la dignité d'un Chinois de bonne éducation, et ceux-ci n'ont guère leurs pareils en Occident.
Il me salua, me serra la main et me fit passer dans une très petite pièce, qui me rappela une cellule sans barreaux.
— Et que puis-je faire pour vous ? me demanda-t-il.
— Je cherche une situation, lui dis-je.
Il me posa des questions sur moi-même, mais je compris, à son Aura, qu'il n'avait rien à m'offrir et qu'il se montrait courtois par amitié pour l'homme qui m'avait adressé à lui. Je lui montrai mes papiers chinois, et son Aura vibra de curiosité. Il les examina avec le plus grand soin et me dit :
— Vous devriez écrire un livre. Je crois que je pourrais vous trouver un éditeur. (Je faillis tomber de surprise. Moi, écrire, un livre ? Moi ? Sur ma propre vie ? J'observai son Aura pour voir s'il parlait sérieusement ou s'il s'agissait d'une fin de non-recevoir présentée avec politesse. Elle me révéla qu'il était sincère, mais qu'il doutait de mes capacités d'écrivain. Au moment où je pris congé de lui, ses dernières paroles furent encore :) Vous devriez vraiment écrire un livre.
— Ah ! faites pas cette tête-là ! me dit le garçon d'ascenseur. Le soleil brille... M. B... n'a pas voulu de votre livre ?
— Si, justement, voilà l'ennui, répliquai-je en sortant de l'ascenseur.
Je me promenai le long de Regent Street, en me disant que tout le monde était fou. Moi, écrire un livre ! Quelle idée absurde ! Tout ce que je voulais, c'était assez d'argent pour nous faire vivre et pour me permettre, en outre, de me livrer à des recherches sur l'Aura. Et voilà qu'on me proposait d'écrire un livre sur moi-même !
Quelque temps auparavant, j'avais répondu à une annonce demandant un Technicien capable d'écrire des ouvrages de vulgarisation sur l'aviation. Au courrier du soir, je reçus une lettre me priant de me présenter le lendemain.
— Ah, me dis-je, je finirai peut-être tout de même par obtenir ce poste à Crawley !
Le lendemain matin, de bonne heure, au moment où je prenais mon petit déjeuner avant de partir pour Crawley, une lettre m'arriva. Elle était de M. B...
"Vous devriez écrire un livre, me disait cette lettre. Réfléchissez bien et revenez me voir."
"Pah ! pensai-je. Je détesterais écrire un livre !" Et je me rendis à la gare de Clapham où je pris le train pour Crawley.
Le train me donna l'impression d'être d'une effroyable lenteur. Il semblait lambiner à chaque gare et se traîner le long du parcours comme si la locomotive ou le chauffeur avaient été à la dernière extrémité. Enfin, j'arrivai à Crawley. Il faisait une chaleur caniculaire et je venais de rater l'autobus. Le suivant arriverait trop tard. Je marchai pesamment le long des rues, recevant de mauvaises directives d'une personne à l'autre, car la firme où je me rendais se trouvait dans un endroit perdu. Enfin, presque trop exténué pour me soucier de ce qui pourrait arriver, j'arrivai devant une longue ruelle mal entretenue. Je la suivis et atteignis une maison délabrée qui donnait l'impression d'avoir servi d'abri à tout un régiment.
— Vous avez écrit une lettre exceptionnellement bonne, me dit celui qui me reçut. Nous voulions voir quel genre d'homme était capable d'écrire une lettre pareille !
Je demeurai interdit à la pensée qu'il m'avait fait faire tout ce chemin simplement pour satisfaire une curiosité oiseuse.
— Mais vous avez demandé un Rédacteur Technique, dis-je. Je suis prêt à faire un essai.
— Ah, oui, répondit-il, mais nous avons eu beaucoup d'ennuis depuis la parution de cette annonce, nous nous réorganisons et nous n'engagerons personne pendant au moins six mois. Nous avons pensé, toutefois, que cela vous intéresserait de voir notre firme.
— J'estime que vous devriez me rembourser mes frais de déplacement, rétorquai-je, puisque vous m'avez fait venir ici pour rien.
— Oh ! c'est impossible, me dit-il. Vous avez offert de venir vous présenter. Nous n'avons fait qu'accepter votre offre.
J'étais tellement déprimé que l'interminable trajet de retour jusqu'à la gare me parut plus interminable encore. L'inévitable attente du train ; le lent voyage. Les roues du wagon semblaient répéter : "Tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre." À Paris habite un autre lama tibétain qui est venu en Occident dans une intention bien définie. Contrairement à moi, il est tenu d'éviter toute publicité. Il exécute son travail et rares sont ceux à savoir qu'il fut naguère un lama, vivant au pied du Potala. Je lui avais écrit pour solliciter son opinion et — j'anticipe un peu — il me répondit que ce serait peu judicieux d'écrire un livre.
Dans l'état d'esprit où je me trouvais, la gare de Clapham me parut plus sale et plus lugubre que jamais. Je rentrai chez moi. Ma femme jeta un coup d'œil sur mon visage et s'abstint de me questionner. Le déjeuner pris, bien que je n'eusse pas faim, elle me dit :
— J'ai téléphoné à M. B... ce matin. Il m'a dit que tu devrais faire un résumé et le lui apporter.
Un résumé ! Cette seule pensée me donnait la migraine. Puis je lus le courrier qui était arrivé le matin. Deux lettres pour m'annoncer que ‘le poste était déjà pris. Merci de nous avoir écrit’ et une lettre de mon ami, le lama résidant en France.
Je m'assis devant la vieille machine à écrire que j'avais ‘héritée’ de mon prédécesseur et me mis à taper. Écrire est pour moi une tâche pénible et désagréable. Je ne suis ni ‘inspiré’ ni doué, je travaille simplement avec plus d'acharnement que la plupart des gens et plus le sujet me déplaît, plus je travaille fort et vite afin d'en avoir terminé plus tôt.
La morne journée toucha à sa fin, les ombres du crépuscule emplirent les rues et furent chassées par la lumière brutale que jetèrent les réverbères sur les maisons et sur les gens. Ma femme alluma la lumière et tira les rideaux. Je tapais toujours. Enfin, les doigts gourds, je m'arrêtai. J'avais devant moi une pile d'une trentaine de pages, aux lignes serrées.
— Voilà ! m'exclamai-je. S'il n'est pas content avec ça, j'abandonne tout et j'espère qu'il ne sera pas content !
L'après-midi suivant, j'allai revoir M. B... Il regarda de nouveau mes papiers, puis lut le résumé. De temps à autre, il hochait la tête d'un air approbateur, et lorsqu'il eut terminé, il me dit, avec beaucoup de prudence :
— Je crois que nous pourrons trouver un éditeur. Laissez-moi ça. Et, entre-temps, écrivez le premier chapitre.
Je ne savais s'il fallait m'attrister ou me réjouir, tandis que je redescendais Regent Street, en direction de Piccadilly Circus. Le niveau de mes finances était dangereusement bas, néanmoins l'idée d'écrire sur moi-même me déplaisait toujours autant.
Deux jours plus tard, je recevais une lettre de M. B... qui me demandait de venir le voir, car il avait de bonnes nouvelles à m'annoncer. Mon cœur se serra. J'allais être obligé d'écrire ce livre, en fin de compte !
M. B... rayonnait de bienveillance.
— J'ai un contrat pour vous, me dit-il, mais je voudrais d'abord vous emmener voir l'éditeur.
Nous allâmes donc ensemble dans un autre quartier de Londres, et pénétrâmes dans une rue aux maisons hautes, jadis fort élégantes. Elles servaient aujourd'hui de bureaux et ceux qui auraient dû y habiter étaient relégués dans des quartiers suburbains. Nous nous arrêtâmes devant l'une d'elles, d'aspect banal.
— Nous y voici, dit M. B...
Nous entrâmes dans un vestibule sombre, et gravîmes jusqu'au premier étage l'escalier en spirale. Et nous fûmes introduits dans le bureau de M. l'Éditeur, qui au premier abord me parut un peu désabusé, puis qui se dégela peu à peu. L'entretien fut bref et bientôt nous nous retrouvâmes dans la rue.
— Revenez à mon bureau... mon Dieu, où sont mes lunettes ? dit M. B..., fouillant fébrilement dans ses poches à la recherche de ses verres. (Les ayant trouvés, il poussa un soupir de satisfaction, et répéta :) Venez à mon bureau. Le contrat est prêt à être signé.
Enfin, c'était là quelque chose de défini : un contrat par lequel je m'engageais à écrire un livre. Je décidai de faire consciencieusement ma part en espérant que l'éditeur agirait de même. À coup sûr, Le Troisième Œil a permis à M. l'Éditeur de ‘mettre un peu de beurre dans les épinards’.
Le livre avança peu à peu. Je rédigeais un chapitre à la fois et le portais à M. B... À plusieurs reprises, je lui rendis visite, à lui et à sa femme, dans leur charmante demeure, et je tiens à rendre ici hommage à Mme B... Elle m'a accueilli amicalement et rares sont les Anglais qui l'ont fait. Elle m'a encouragé et elle a été la seule Anglaise à agir ainsi. Elle m'a toujours donné l'impression que j'étais le bienvenu chez elle, c'est pourquoi... je vous remercie, madame B... !
Le climat londonien avait été funeste à ma santé. Je m'efforçai de tenir bon jusqu'à ce que le livre fût terminé, et je mis toutes mes facultés en œuvre pour faire provisoirement échec à la maladie. Le livre terminé, j'eus ma première attaque de thrombose coronaire et je faillis mourir. Le personnel médical d'un très célèbre hôpital londonien fut fort intrigué par un certain nombre de choses me concernant, mais je ne leur fournis aucune explication. Peut-être ce livre leur en donnera-t-il !
— Il faut que vous quittiez Londres, dit le spécialiste. Votre vie est en danger ici. Allez habiter sous un climat différent.
"Quitter Londres ? me dis-je. Mais pour aller où ?" À la maison, nous eûmes une discussion sur les endroits où nous pourrions nous installer et sur les conditions de vie. Quelques jours plus tard, je dus retourner à l'hôpital pour un dernier examen.
— Quand partez-vous ? me demanda le spécialiste. Ici, votre état ne peut pas s'améliorer.
— Je n'en sais rien, répondis-je. Il y a tant de problèmes qui se posent.
— Il n'y a qu'un seul problème qui se pose, rétorqua-t-il. Si vous restez ici, vous mourrez. Si vous partez, vous vivrez un peu plus longtemps. Vous ne comprenez donc pas que votre état est grave ?
De nouveau, je me trouvais devant un grave problème à résoudre.
Chapitre Dix
— Lobsang ! Lobsang !
Je me retournai fiévreusement dans mon sommeil. Une douleur aiguë me perçait la poitrine, douleur causée par le caillot de sang. Haletant, je repris conscience. Et, j'entendis de nouveau : "Lobsang !"
"Mon Dieu ! songeai-je, comme je me sens mal !"
— Lobsang, reprit la voix, écoute-moi, étends-toi et écoute-moi.
Je me laissai retomber sur l'oreiller. Mon cœur battait à grands coups, et ma poitrine haletait par sympathie. Peu à peu, dans les ténèbres de ma chambre solitaire, une forme se dessina. D'abord une lueur bleue qui vira au jaune, puis la silhouette matérialisée d'un homme de mon âge.
— Je ne puis voyager astralement cette nuit, dis-je, sinon mon cœur cessera de battre et ma tâche n'est pas encore terminée.
— Frère, nous connaissons bien quel est ton état de santé, et c'est pourquoi je suis venu vers toi. Écoute simplement, tu n'as pas besoin de parler.
Je m'appuyai contre la tête du lit, mon souffle ressemblant à un râle. Respirer m'était pénible, mais il le fallait bien.
— Nous avons discuté ton cas, me dit le lama. Il y a au large de la côte anglaise, une île qui a fait jadis partie du continent perdu de l'Atlantide. Va là-bas dès que possible. Repose-toi quelque temps dans ce pays ami avant de partir pour l'Amérique du Nord. Ne va pas sur la côte occidentale, qui est balayée par l'océan turbulent. Installe-toi dans la cité verte et ensuite tu iras au-delà.
L'Irlande ? Oui ! Un endroit idéal. Je m'étais toujours bien entendu avec les Irlandais. La cité verte ? Puis la réponse me vint. Dublin, vu d'en haut, semblait verdoyer grâce au Phœnix Parc, et au Liffey qui descend des montagnes avant de se jeter dans la mer.
Le lama eut un sourire approbateur.
— Tu dois reprendre des forces, car ta santé subira une nouvelle attaque. Nous aimerions que tu continues à vivre afin que la Tâche puisse progresser, afin que la Science de l'Aura puisse devenir plus près de se réaliser. Maintenant, je vais partir, mais, quand tu iras mieux, nous désirons que tu visites à nouveau le Pays de la Lumière Dorée.
La vision s'évanouit et la chambre me parut plus sombre, plus solitaire encore. J'avais éprouvé bien des souffrances, plus que la majorité des gens n'auraient été capables de supporter ou de comprendre. Adossé à l'oreiller, je jetai par la fenêtre un regard distrait.
Qu'avaient-ils dit au cours d'une de mes récentes visites astrales à Lhassa ? Ah ! oui ! "Tu as du mal à trouver une situation ? Rien d'étonnant à cela, mon Frère, car tu ne fais pas partie du monde Occidental, tu y vis en sursis. L'homme dont tu as pris l'espace vital serait mort de toute façon. Le fait que tu aies eu temporairement besoin de son corps et, de façon plus permanente de son espace vital, a eu pour résultat qu'il a pu quitter la Terre honorablement et avantageusement pour lui. Cela n'est pas le Karma, mon frère, mais une tâche que tu accomplis pendant ta dernière existence sur Terre" "Et c'est aussi une vie bien dure", me dis-je.
Le lendemain matin, je provoquai une certaine consternation ou une certaine surprise en annonçant :
— Nous allons vivre en Irlande. D'abord à Dublin, puis à l'extérieur de Dublin.
Je ne pus guère aider au déménagement, j'étais très malade et je craignais, en remuant, de provoquer une crise cardiaque. Les caisses furent emballées, les billets achetés et nous partîmes enfin. Il était bon d'être de nouveau dans les airs et je m'aperçus que je respirais beaucoup plus facilement. La compagnie d'aviation, sachant qu'il y avait à bord un ‘cardiaque’, avait pris soin de placer un cylindre à oxygène dans le filet, au-dessus de ma tête.
L'avion perdit de l'altitude et tournoya au-dessus d'un pays d'un vert ardent, frangé d'écume laiteuse. L'appareil descendit plus bas encore, et j'entendis le bruit que fait le train d'atterrissage en sortant, bientôt suivi par le crissement des pneus sur la piste d'arrivée.
Alors je songeai à mon premier contact avec l'Angleterre et à la façon dont les employés de la Douane m'avaient reçu.
"Comment cela va-t-il se passer cette fois ?" me demandai-je. L'avion roula jusqu'aux bâtiments de l'aéroport et je fus assez mortifié de voir qu'une chaise roulante m'y attendait. Les douaniers me dévisagèrent attentivement et demandèrent :
— Combien de temps avez-vous l'intention de rester en Irlande ?
— Nous sommes venus y vivre, répondis-je.
Tout se passa sans difficulté ; ils n'examinèrent même pas nos bagages. Lady Ku'ei les avait fascinés ; sereine et imperturbable, elle veillait sur nos valises. Ces chats siamois, lorsqu'on les traite comme des êtres humains et non simplement comme des animaux, possèdent une intelligence supérieure. Je préfère certainement l'amitié et la loyauté de Lady Ku'ei à celle des gens ; elle reste à côté de moi, la nuit, et quand j'ai un malaise, elle va réveiller ma femme !
Nos bagages furent mis dans un taxi qui prit la direction de Dublin. Il y régnait une atmosphère amicale ; les gens semblaient avoir le temps de se rendre mutuellement service. Je m'étendis sur mon lit, dans une chambre donnant sur le parc de Trinity College. Sur la route, en bas de ma fenêtre, les voitures roulaient sans hâte.
Il me fallut un certain temps pour me remettre de mon voyage, mais lorsque je fus capable de me déplacer, les aimables autorités de Trinity College me donnèrent un laissez-passer qui me permit d'entrer dans leur parc et de profiter de leur admirable bibliothèque.
Dublin est une ville surprenante ; on peut y acheter presque n'importe quoi. J'y ai vu une plus grande variété de marchandises qu'à Windsor, au Canada, ou à Détroit, aux États-Unis. Quelques mois plus tard, pendant que j'écrivais Docteur de Lhassa (Lama Médecin), nous décidâmes d'aller vivre dans un ravissant village de pêcheurs, à une douzaine de milles (19 km) de la capitale. Nous eûmes la chance d'y trouver une maison dominant Balscadden Bay, avec une vue vraiment splendide.
J'étais obligé de me reposer beaucoup, et il m'était impossible de voir par la fenêtre avec les jumelles à cause de l'effet de distorsion des vitres. Un entrepreneur de construction, Brud Campbell, dont j'étais devenu l'ami, suggéra une plaque de verre. Ayant suivi ce conseil, je pus, de mon lit, observer les bateaux de pêche évoluant dans la baie. Toute l'étendue du port se trouvait dans mon champ de vision, avec le Yacht Club, le bureau du capitaine de port et le phare comme principaux points de repère. Par temps clair, je pouvais voir les montagnes de Mourne, dans l'Irlande occupée par les Anglais, et, de Howth Head, je distinguais vaguement les monts du pays de Galles, au-delà de la mer d'Irlande.
Nous achetâmes une voiture d'occasion et fîmes de fréquentes promenades dans les montagnes entourant Dublin, jouissant de l'air pur et du superbe paysage. Au cours d'une de ces randonnées, nous apprîmes qu'une chatte Siamoise, déjà âgée, se mourait d'une énorme tumeur interne. Après beaucoup de pression, nous réussîmes à la prendre dans notre famille. Le meilleur vétérinaire de toute l'Irlande l'examina, et déclara qu'elle n'avait plus que quelques heures à vivre. À ma demande, il l'opéra pour enlever la tumeur due à la négligence et à de trop nombreuses maternités. Elle se rétablit et devint l'être le plus charmant que j'aie jamais connu, aussi bien chez les humains que chez les animaux. En ce moment, pendant que j'écris, elle se promène comme la douce vieille dame qu'elle est. Bien qu'aveugles, ses beaux yeux bleus rayonnent d'intelligence et de bienveillance. Lady Ku'ei se promène à ses côtés, ou la dirige par télépathie, afin qu'elle ne se heurte pas aux objets. Nous l'appelons Granny Greywhiskers (Grand-maman moustaches grises — NdT), car elle ressemble tout à fait à une vieille grand-mère qui profite de ses dernières années d'existence, après avoir élevé de nombreuses familles !
La vie à Howth me fit connaître un bonheur que je n'avais jamais éprouvé auparavant. M. Loftus, l'agent de police, ou le ‘garde’, ainsi qu'on les appelle en Irlande, venait fréquemment bavarder avec moi. Il était toujours le bienvenu. Homme grand et fort, aussi élégant qu'un garde de Buckingham Palace, il avait la réputation d'être aussi juste que courageux. Pendant ses heures de liberté, il venait me voir, et nous parlions des pays lointains. L'entendre me répéter : "Mon Dieu, Docteur, vous avez de la cervelle à revendre !" me mettait le cœur en joie. En divers pays j'avais été assez malmené par la police, mais le garde Loftus, du village de Howth, en Irlande, me prouva qu'il existait aussi de bons policiers.
Mon cœur donnait à nouveau des signes de détresse, et ma femme voulut faire installer le téléphone. Malheureusement, toutes les lignes de ‘La Colline’ étaient employées, de sorte que nous ne pûmes en obtenir une. Un après-midi, on frappa à la porte. C'était une voisine, Mme O'Grady, qui était venue pour nous dire : "J'ai appris que vous vouliez faire installer le téléphone et que ça n'a pas été possible : vous pouvez vous servir du nôtre à n'importe quel moment. Voici la clef de la maison !" Les Irlandais nous traitèrent fort bien. M. et Mme O'Grady ne savaient que faire pour nous être agréables et pour nous rendre le séjour dans leur pays encore plus plaisant. Nous avons eu la joie et le privilège de recevoir Mme O'Grady chez nous, au Canada, pour une visite, hélas, beaucoup trop brève.
Subitement, je tombai très gravement malade. Les années passées en prison, les terribles épreuves que j'avais subies et les expériences extraordinaires que j'avais faites, tout cela se combina pour aggraver encore mon état cardiaque. Ma femme se précipita chez les O'Grady et téléphona à un médecin. Celui-ci, le Dr Chapman, fit très vite irruption dans ma chambre et, avec la dextérité que seules donnent des années de pratique, emplit une seringue hypodermique. Le Dr Chapman était un médecin de la ‘vieille école’, le ‘médecin de famille’ qui a plus de discernement dans son petit doigt qu'une demi-douzaine de ces spécimens ‘produits en série’ avec l'aide de l'État, et qui sont si populaires aujourd'hui. Entre le Dr Chapman et moi ce fut un cas ‘d'amitié instantané’ ; peu à peu, grâce à ses soins, je me remis suffisamment pour sortir de mon lit. Et j'allai faire le tour des spécialistes de Dublin. Quelqu'un m'avait dit, en Angleterre, de ne jamais me fier à un médecin irlandais. Moi, j'ai eu confiance, et j'ai été mieux soigné en Irlande qu'en n'importe quel autre pays du monde. Le malade y est traité comme un être humain et cela lui réussit mieux que la froideur impersonnelle des jeunes médecins.
Brud Campbell avait érigé un solide mur de pierre autour de notre maison, pour remplacer le vieux qui tombait en ruine, parce que nous étions souvent dérangés par des touristes d'Angleterre. Les excursionnistes de Liverpool avaient l'habitude d'entrer dans les jardins des habitants de Howth, et d'y camper ! Une de ces ‘touristes’ nous amusa fort. Un matin, on frappa lourdement à la porte. Ma femme alla ouvrir et se trouva face à face avec une Allemande. Celle-ci essaya d'entrer de force dans la maison, mais ma femme lui barra le passage. Alors, elle annonça qu'elle camperait sur notre seuil jusqu'à ce qu'on lui permît ‘de s'asseoir aux pieds de Lobsang Rampa’. Comme j'étais au lit et que je ne tenais pas du tout à ce qu'on s'assît à mes pieds, elle fut priée de repartir. L'après-midi, elle était encore là. Finalement M. Loftus arriva, l'air féroce et décidé et, par sa force de persuasion, il obligea l'intruse à descendre la colline, à reprendre le car pour Dublin et à ne plus revenir !
Les jours passèrent, bien remplis, quoique je m'efforçasse de ne pas abuser de mes forces. Docteur de Lhassa (Lama Médecin) était terminé, mais des lettres m'arrivaient de tous les coins du monde. Pat, le facteur, frappait à notre porte, tout hors d'haleine, après avoir gravi le long chemin escarpé.
— Ah ! bien le bonjour, disait-il à quiconque venait lui ouvrir. Et comment va Sa Seigneurie, aujourd'hui ? Pour sûr que toutes ces lettres me rompent l'échine !
Un soir que, étendu sur mon lit, j'observais les lumières scintillantes de Portmarnock et des navires, croisant au large, je me rendis brusquement compte qu'un vieil homme était assis dans la chambre, les yeux fixés sur moi. Il sourit lorsque je tournai la tête vers lui.
— Je suis venu, me dit-il, pour voir si tu fais des progrès, car il est souhaitable que tu retournes au Pays de la Lumière Dorée. Comment te sens-tu ?
— Je crois que je pourrai y arriver, avec un petit effort, répondis-je. M'accompagneras-tu ?
— Non, répondit-il, car ton corps a plus de valeur encore qu'avant et je suis ici pour veiller sur lui.
Au cours des mois précédents, j'avais beaucoup souffert. Et sans doute un Occidental sourira-t-il avec incrédulité si je dis que l'une des causes de mes souffrances était due au fait que mon organisme original s'était totalement substitué à l'autre. Le corps emprunté avait été téléporté ailleurs, pour y tomber en poussière. Pour ceux qui s'intéressent sincèrement à ces problèmes, j'ajouterai que c'est là un art Oriental très ancien, dont parlent certains ouvrages.
Je restai quelque instant étendu, rassemblant mes forces. Dehors, un bateau de pêche attardé passa avec un halètement régulier. Les étoiles étincelaient et Ireland's Eye baignait dans le clair de lune. Le vieil homme sourit et dit :
— Tu as une jolie vue d'ici !
J'inclinai silencieusement la tête, redressai l'épine dorsale, pliai les jambes sous moi et me mis à flotter dans l'air comme une volute de fumée. Pendant un certain temps, je planai au-dessus du promontoire, regardant le paysage illuminé par la lune : Ireland's Eye, l'île au large de la côte, et plus loin, l'île de Lambay. Derrière brillaient les lumières de Dublin, cité moderne et bien éclairée. Au fur et à mesure que je m'élevais, je voyais la courbe magnifique de Killiney Bay qui ressemble tant à celle de Naples, et plus loin encore Greystones et Wicklow. Je flottais toujours plus haut, hors de cette Terre, hors de l'espace et du temps, jusqu'à un plan d'existence qui ne peut être décrit dans le langage de ce monde à trois dimensions.
J'avais l'impression de passer des ténèbres au soleil. Mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'attendait.
— Tu as accompli tant de choses, Lobsang, et tu as tant souffert ! me dit-il. Bientôt, tu viendras ici pour ne jamais en repartir. La lutte n'aura pas été vaine.
Nous traversâmes ensemble l'admirable paysage, puis entrâmes dans le Hall aux Souvenirs, où il y avait encore beaucoup à apprendre.
Pendant un certain temps, nous restâmes assis à discuter, mon Guide, un auguste groupe et moi-même.
— Bientôt, dit l'un des membres du groupe, tu iras au Pays des Indiens Rouges, où t'attend une autre tâche. Mais reprends des forces pendant les brèves heures que tu passeras ici, car les épreuves de ces derniers temps t'ont beaucoup fatigué.
— Oui, dit un autre, et ne t'attriste pas des critiques formulées à ton égard, car ces gens-là ne savent de quoi ils parlent, aveuglés qu'ils sont par l'ignorance que l'Occident s'impose à lui-même. Quand la Mort leur fermera les yeux et qu'ils naîtront à la Vie Supérieure, ils regretteront amèrement les ennuis et les peines qu'ils t'auront causés sans raison.
Lorsque je revins en Irlande, le pays était encore plongé dans l'obscurité ; seuls quelques faibles rais de lumière striaient le ciel du matin. Sur la longue plage sablonneuse de Clontarf, le ressac se brisait en gémissant. Head's Howth surgit, forme noire se détachant dans la pénombre précédant l'aube.
"Mon Dieu, me dis-je, les mouettes ont courbé mes antennes. Il faudra que je demande à Brud Campbell de les redresser."
Le vieil homme était toujours assis à mon chevet. Mme Fifi Greywhiskers se trouvait au pied du lit, comme pour monter la garde. Dès que j'eus réintégré et réanimé mon corps, elle s'approcha et se frotta contre moi en ronronnant. Entendant son miaulement, Lady Ku'ei sauta sur le lit et vint s'installer sur mes genoux. Le vieillard contempla les deux chattes avec affection et dit :
— Ce sont vraiment des entités d'ordre supérieur. Il faut que je parte, mon frère.
Le courrier du matin apporta une imposition sauvage du Service des Impôts sur le Revenu. Les seuls Irlandais qui m'aient déplu sont les fonctionnaires du fisc. Ils m'ont paru faire preuve à la fois d'incompréhension et d'un zèle excessif. Les écrivains habitant l'Irlande sont accablés d'impôts, ce qui est dramatique, car le pays aurait besoin de gens fortunés. Malgré ces ennuis, je préférerais vivre en Irlande plutôt que dans n'importe quel autre pays du monde, sauf le Tibet.
— Nous allons partir pour le Canada, annonçai-je. (Cette déclaration fut accueillie par des regards attristés.)
— Et les chattes ? Comment les emmènerons-nous ?
— En avion, bien sûr, elles voyageront avec nous, répondis-je.
Les formalités furent nombreuses, et les délais fort longs. L'administration irlandaise se montra très serviable, tout au contraire des fonctionnaires canadiens. En fait, le Consulat américain nous fut d'un beaucoup plus grand secours que le Consulat canadien. On nous soumit à un interrogatoire, on prit nos empreintes digitales, puis nous subîmes un examen médical. Je n'y fus pas reçu.
— Trop de cicatrices, dit le médecin. Il va falloir qu'on vous radiographie.
Le praticien irlandais, qui me fit passer à la radio, me considéra avec pitié :
— Vous avez dû mener une vie terrible, me dit-il. Ces cicatrices... ! Je vais être obligé de faire un rapport à l'Office de Santé canadien. Étant donné votre âge, je suppose qu'on vous laissera entrer au Canada sous certaines conditions.
Un vétérinaire examina Lady Ku'ei et Mme Fifi Greywhiskers et les déclara en bonne santé. Sans attendre que l'on ait statué sur mon sort, nous nous renseignâmes sur la manière dont nous pourrions emmener les chattes dans l'avion avec nous. Seule la Swissair accepta de les prendre, et nous retînmes provisoirement les places sur un appareil de cette compagnie.
Quelques jours plus tard, on me convoqua à l'Ambassade du Canada. Un employé me reçut sans aménité.
— Vous êtes malade ! dit-il. Je dois m'assurer que vous ne tomberez pas à la charge de notre pays. (Il tergiversa longtemps, puis, comme si la chose exigeait de lui un immense effort, il reprit :) Montréal vous autorise à entrer, à condition que vous vous présentiez dès votre arrivée au Service de la Santé et que vous vous soumettiez au traitement, quel qu'il soit, qu'on vous indiquera. Si vous refusez, vous n'entrerez pas au Canada, conclut-il, plein d'espoir.
J'ai toujours trouvé très curieux que les employés des ambassades se montrent si souvent désagréables, sans raison aucune. Après tout, ce ne sont que des ‘serviteurs’ payés pour leur travail, mais on ne peut pas toujours leur appliquer l'épithète de ‘civil’ (en anglais, fonctionnaire se dit : ‘civil servant’, et ‘servant’ signifie également ‘serviteur’ — NdT).
Nous gardâmes le silence sur nos projets ; seuls nos amis intimes savaient que nous partions et où nous allions. Comme nous l'avions appris à nos dépens, nous ne pouvions plus éternuer sans qu'un journaliste accoure et nous demande la cause de cet éternuement. Pour la dernière fois, nous fîmes en voiture le tour de Dublin et des plus jolis coins de Howth. La seule pensée du départ nous serrait le cœur, mais aucun de nous n'est ici-bas pour son plaisir. Une compagnie dublinoise avait accepté de nous conduire à Shannon, par autobus, nous, les chattes et les bagages.
Quelques jours avant Noël, nous fûmes prêts à partir. Notre vieil ami, M. Loftus, vint nous dire au revoir. Il m'a bien semblé voir des larmes dans ses yeux. Quant à moi, j'avais l'impression de quitter un ami très cher. M. et Mme O'Grady vinrent, eux aussi, M. O'Grady ayant pris, dans cette intention, un jour de congé. ‘Ve O'G’ était visiblement désolée, quant à Paddy, il s'efforçait de cacher son émotion sous une jovialité qui ne trompa personne. Je fermai la porte, en donnai la clef à M. O'Grady, avec prière de l'envoyer au gérant, montai dans l'autobus et nous quittâmes ce pays où j'avais passé les meilleures heures de mon existence depuis mon départ du Tibet et où vivaient les gens les plus sympathiques que j'eusse connus depuis de très, très nombreuses années.
L'autobus prit la grand-route menant à Dublin, puis se mêla à la circulation courtoise de la capitale. Enfin, il arriva dans la campagne, au pied des montagnes. Pendant des heures, nous continuâmes à rouler : le chauffeur, homme aimable, connaissant bien son métier, nous désignait les curiosités de la région et se montrait plein de sollicitude à notre égard. À mi-chemin, nous nous arrêtâmes pour prendre le thé. Lady Ku'ei aime être assise le plus haut possible, pour observer la circulation et hurler des encouragements au conducteur. Mme Fifi Greywhiskers préfère être confortablement installée et réfléchir. Quand l'autobus s'arrêta, à l'heure du thé, grande consternation chez les chattes. Pourquoi nous étions-nous arrêtés ? Est-ce que tout allait bien ?
Nous reprîmes notre chemin, car la route était longue jusqu'à Shannon. La nuit tomba sur nous et ralentit notre allure. Tard dans la soirée, nous arrivâmes à l'aérodrome de Shannon, y laissâmes nos principaux bagages et nous rendîmes à l'hôtel où nous avions retenu des chambres pour la nuit et le lendemain. À cause de ma santé et des deux chattes, nous restâmes à Shannon une nuit et une journée et repartîmes la nuit suivante. Nous avions chacun notre chambre, une porte les faisait communiquer, heureusement, car les chattes allaient et venaient sans arrêt, ne sachant où se mettre. Elles reniflaient comme des aspirateurs, ‘lisant’ tous les détails de la personnalité des gens qui avaient habité ces pièces avant nous. Finalement, elles se calmèrent et s'endormirent.
Le lendemain, je me reposai et allai jeter un coup d'œil sur l'aérodrome. La boutique des objets ‘exempts de droits de douane’ m'intéressa, mais je n'en compris pas la nécessité. Si l'on achetait un objet, il fallait bien le déclarer quelque part et en payer la douane, alors qu'y gagnait-on ?
Les employés de la Swissair se montrèrent fort serviables, les formalités furent rapidement terminées et nous n'attendions plus que l'avion. Minuit, puis une heure, sonnèrent. À une heure et demie, nous montions à bord d'un gros appareil de la Swissair. Les gens furent très impressionnés par l'attitude digne et sereine des deux chattes que même le bruit des moteurs ne semblait pas déranger. Bientôt, nous roulâmes de plus en plus vite sur la piste d'envol ; le sol s'éloigna, le rivière Shannon coula un instant sous une aile et disparut. Devant nous, s'étendait l'immense Atlantique, laissant une écume blanche le long de la côte irlandaise. Le moteur émit un son différent, de longues flammes jaillirent des tuyères d'échappement incandescentes. L'appareil piqua légèrement du nez. Les deux chattes me regardèrent silencieusement. Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? me demandaient ces regards. C'était la septième fois que je traversais l'Atlantique, et je leur adressai un sourire rassurant. Bientôt elles se pelotonnèrent sur elles-mêmes et s'endormirent.
La longue nuit s'écoulait lentement. Nous voyagions avec les ténèbres qui, pour nous, allaient durer douze heures. Les lampes de la cabine s'affaiblirent, nous laissant une faible lueur bleue et l'espoir de dormir un peu. Les moteurs ronronnants continuaient à nous porter vers l'Amérique, à plus de trente-cinq mille pieds (10 000 m) au-dessus de la mer grise et houleuse. Lentement, les constellations changèrent. Peu à peu une faible lueur éclaira le ciel à la lisière de la courbe terrestre. J'entendis remuer dans la cuisine, cliqueter des assiettes et, graduellement, comme une plante qui s'épanouit, les lumières revinrent. L'aimable Commissaire, toujours soucieux du bien-être des passagers, traversa la cabine et les stewards bien stylés apportèrent le petit déjeuner. Aucune nation n'est supérieure à la Suisse lorsqu'il s'agit de la maîtrise des airs, du confort des voyageurs et de l'excellence des repas. Les chattes s'assirent, tout attentives à l'idée de manger de nouveau.
Tout au loin, vers la droite, se dessina une ligne grise et brumeuse qui s'élargit rapidement. New York ! Je ne pus m'empêcher de songer à mon premier voyage aux États-Unis alors que j'avais payé la traversée en travaillant comme mécanicien sur un cargo. Les gratte-ciel de Manhattan s'élançant vers la nue m'avaient alors écrasé de toute leur hauteur. Où étaient-ils à présent ? Étaient-ce vraiment ces petits points gris ? Le grand avion se mit à tourner, incliné sur une aile. Les moteurs changèrent de tonalité. Nous perdîmes graduellement de l'altitude. Peu à peu les bâtiments prirent forme au sol et ce qui nous avait paru être un désert désolé se transforma en un aéroport, l'Idlewild International Airport. Le pilote atterrit sans encombre, dans un faible grincement de pneus. L'appareil roula sans hâte le long de la piste jusqu'aux bâtiments de l'aérodrome.
— Restez assis, je vous prie ! dit le Commissaire.
Avec un bruit sourd la passerelle mobile vint s'accoler au fuselage et la porte de la carlingue s'ouvrit.
— Au revoir, nous dit l'équipage aligné près de la porte. Nous espérons que vous voyagerez de nouveau avec nous.
Nous descendîmes lentement la passerelle et entrâmes dans les Bureaux de l'Administration.
Idlewild ressemblait à une gare en proie à la démence. Les gens couraient dans tous les sens, bousculant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Un employé s'avança :
— Par ici. Il vous faut passer d'abord à la douane.
On nous fit ranger le long de plates-formes roulantes. Des amas de bagages apparurent subitement, entraînés par le ruban mobile qui s'étendait de l'entrée jusqu'au douanier. Les employés allaient et venaient, fouillant les valises ouvertes.
— D'où venez-vous ? me demanda l'un d'eux.
— De Dublin, en Irlande, répondis-je.
— Où allez-vous ?
— À Windsor, au Canada.
— O.K. V'z'avez des photos pornographiques ? questionna-t-il brusquement.
Après l'avoir quitté, nous dûmes montrer nos Passeports et nos Visas. La façon dont on faisait ‘circuler’ les gens me rappelait une usine de conserves de viande, à Chicago.
Avant de quitter l'Irlande, nous avions loué des places pour Détroit sur un avion américain. La compagnie avait accepté de prendre les chattes. Et voilà qu'à présent, elle décidait d'annuler nos billets et de refuser nos deux chattes qui venaient de traverser l'Atlantique sans nous causer le moindre ennui ! Nous eûmes l'impression que nous allions être immobilisés à New York, car les employés de la Compagnie se désintéressaient totalement de la question. Puis j'aperçus un panneau publicitaire pour des ‘Taxis aériens toutes directions’, à partir de l'aérodrome de La Guardia. Nous prîmes une limousine qui nous conduisit à un motel situé près de La Guardia.
— Acceptez-vous nos chattes ? demandai-je à l'employé de la réception.
Il jeta un coup d'œil sur les deux petites dames qui se tenaient là, l'air réservé, et répondit :
— Oui, oui, elles sont les bienvenues !
Lady Ku'ei et Mme Fifi Greywhiskers furent enchantées de se balader un peu et d'examiner deux nouvelles chambres.
Je commençais à ressentir la fatigue du voyage et j'allai me coucher. Ma femme se rendit à l'aérodrome pour s'informer du coût des taxis aériens et des heures de départ. Finalement, elle revint, l'air préoccupé.
— Cela va nous coûter une fortune ! déclara-t-elle.
— Il faut bien que nous partions d'ici, répondis-je.
Elle donna un coup de téléphone et il fut bientôt décidé que nous prendrions le lendemain un avion-taxi pour le Canada.
Nous dormîmes bien cette nuit-là. Les chattes étaient parfaitement calmes, elles semblaient même prendre plaisir à la situation. Le matin, après le petit déjeuner, on nous conduisit jusqu'à l'aérodrome. La Guardia est immense ; toutes les minutes, un avion en décolle ou y atterrit. Enfin, nous trouvâmes l'endroit d'où nous devions partir, nous fûmes placés avec chattes et bagages, dans un petit bimoteur. Le pilote, un petit homme au crâne complètement rasé, nous adressa un bref signe de tête, et l'appareil se mit à rouler vers une piste d'envol. Il roula ainsi pendant près de deux milles (3 km), puis s'arrêta sur une piste d'évitement, pour attendre son tour de décoller. Le pilote d'un gros appareil intercontinental nous fit signe et parla vivement dans son microphone. Notre pilote grommela quelques mots que je ne puis répéter et nous dit :
— Nous avons crevé !
Un hurlement de sirène déchira l'air et une voiture de police survint à toute allure pour s'arrêter près de nous dans un terrible grincement de pneus.
"La police ? Qu'avons-nous encore fait ?" me demandai-je. D'autres sirènes retentirent ; celles des pompiers, cette fois, qui sautaient à terre tous en même temps. Les policiers vinrent parler à notre pilote ; puis ils se dirigèrent vers la voiture de pompiers. Finalement, tout le monde repartit. Une voiture de réparation arriva à son tour, s'arrêta le long de notre avion, enleva la roue malade et s'en alla. Nous dûmes attendre deux heures le retour de la roue. Enfin, elle fut remise en place, et l'appareil décolla. Nous survolâmes bientôt les Allegbanys en direction de Pittsburg. Juste au-dessus des montagnes, l'indicateur de carburant, qui se trouvait en face de moi, tomba à zéro. Le pilote ne parut pas s'en apercevoir. Quand j'attirai son attention sur la chose, il me répondit à voix basse :
— Oh ! on peut toujours redescendre !
Quelques minutes plus tard, nous arrivâmes à un plateau, au cœur des montagnes, où de nombreux avions légers étaient stationnés. L'appareil tourna une fois, puis se posa et roula jusqu'au poste d'essence. Nous nous arrêtâmes juste le temps nécessaire pour faire le plein, puis l'appareil décolla de nouveau de la piste glacée. Des tas de neige la bordaient, et des amoncellements neigeux s'élevaient dans les vallées. Bientôt nous survolâmes Pittsburg. Nous nous sentions las, le froid nous engourdissait. Seule Lady Ku'ei était en pleine forme ; elle regardait par la vitre et semblait ravie de tout ce qu'elle voyait.
Une fois Cleveland dépassé, nous aperçûmes le Lac Érié, devant nous. De gros blocs de glace parsemaient sa surface qui était striée de fissures fantastiques. Le pilote, ne voulant pas courir de risques, prit la direction de l'île Pelée, à mi-chemin en travers du lac. De là, il vola jusqu'à Amberstburg et jusqu'à l'aérodrome de Windsor. Ce dernier semblait étrangement silencieux. Il n'y régnait aucune activité. L'appareil s'arrêta devant les Bureaux de la Douane où nous entrâmes. Un seul douanier était là, qui allait terminer son service, car il était plus de six heures du soir. Il contempla nos bagages d'un œil sombre.
— Le fonctionnaire du service de l'Immigration n'est pas là, dit-il. Il faut que vous attendiez son arrivée. Nous nous assîmes donc et attendîmes. Les minutes s'écoulèrent lentement. Une demi-heure. Le temps lui-même parut s'arrêter ; depuis huit heures du matin, nous n'avions ni mangé ni bu. La pendule sonna sept coups. Un autre douanier apparut et fit quelques tours dans le bureau.
— Je ne peux rien pour vous tant que le fonctionnaire de l'Immigration ne vous aura pas délivré le visa d'entrée, nous dit-il.
Le temps passa, plus lentement encore. Sept heures et demie. Un homme de haute taille pénétra dans le bureau de l'Immigration. L'air agacé, le visage empourpré, il en ressortit bientôt et vint trouver le douanier.
— Je ne peux pas ouvrir le tiroir du bureau, annonça-t-il.
Pendant quelques instants, son collègue et lui se consultèrent à voix basse, puis ils essayèrent plusieurs clefs, poussèrent, frappèrent du poing le tiroir récalcitrant. En désespoir de cause, ils prirent un tournevis et firent sauter la serrure. Ils s'étaient trompés de bureau, le tiroir était vide.
On finit par trouver les formulaires. Exténués, nous les emplîmes, signant ici, signant là. L'Agent d'Immigration tamponna nos Passeports ‘Immigrant Reçu’.
— À présent, allez voir le douanier, nous dit-il.
Des caisses à ouvrir, des clefs à chercher, des formulaires à montrer, donnant les détails de nos possessions en tant que ‘colons’. Nouveaux coups de tampon et nous étions enfin autorisés à entrer au Canada, par Windsor, Ontario. Le douanier s'était considérablement amadoué en apprenant que nous venions d'Irlande. Il était lui-même de descendance irlandaise et ses parents vivaient encore là-bas. Il nous posa quantité de questions et, merveille des merveilles, nous aida à transporter nos bagages dans la voiture qui nous attendait.
Dehors, il faisait froid, une épaisse couche de neige recouvrait le sol. Au-delà de la rivière Détroit, se dressaient les gratte-ciel, constellés de petites lumières car, en prévision de Noël, tous les bureaux et toutes les pièces étaient illuminés.
Nous descendîmes la large Avenue Ouellette, artère principale de Windsor. La rivière était invisible et nous eûmes l'impression de retourner tout droit en Amérique. Le chauffeur ne paraissait pas très bien connaître sa direction. Il rata un croisement important et effectua une manœuvre si remarquable que nos cheveux se dressèrent sur nos têtes. Nous finîmes néanmoins par arriver devant la maison que nous avions louée, bien heureux de pouvoir enfin nous reposer.
Je reçus bientôt une convocation du Service de la Santé, me menaçant de châtiments terribles, y compris la déportation, si je ne me présentais pas. Il semble, malheureusement, que menacer les gens soit la distraction favorite des autorités d'Ontario, c'est pourquoi nous avons l'intention d'aller habiter une Province plus accueillante.
Au Service de la Santé, on me passa une radiographie, on me posa de nouvelles questions, puis on m'autorisa enfin à retourner chez moi. Étant donné le terrible climat de Windsor et l'attitude de ses autorités, nous étions décidés à partir de cette ville dès que j'aurais eu terminé ce livre.
À présent l'Histoire de Rampa est terminée. J'y ai dit la vérité, comme dans mes deux autres ouvrages. Il y a bien des choses que je pourrais raconter au monde Occidental, car en parlant de voyages astraux, je n'ai fait qu'effleurer le domaine des choses possibles. Pourquoi envoyer des avions espions, avec tous les risques que cela comporte, alors qu'on peut se déplacer dans l'astral, et voir à l'intérieur d'une salle de conseil ? Oui, on peut voir et on peut se rappeler. Dans certaines conditions, on peut téléporter des objets, si c'est dans une bonne intention. Mais l'Occidental tourne en ridicule ce qu'il ne comprend pas, il traite de ‘faiseur’ ceux qui possèdent des facultés inconnues de lui, et il se met en fureur contre ceux qui osent être ‘différents’ de lui, d'une manière quelconque.
Joyeusement, je rangeai ma machine à écrire et me mis à jouer avec Lady Ku'ei et l'aveugle Mme Fifi Greywhiskers, qui avaient montré toutes deux tant de patience.
Cette nuit-là, le Message arriva de nouveau, télépathiquement.
— Lobsang ! Tu n'as pas encore terminé ton livre !
Mon cœur se serra ; je déteste écrire, sachant que rares sont les gens capables de percevoir la vérité. Je parle de choses que l'esprit humain peut accomplir. On mettra en doute même les stades élémentaires décrits dans cet ouvrage, et pourtant si l'on disait aux gens que les Russes ont envoyé un homme sur Mars, ça, les gens le croiraient ! L'Homme redoute les pouvoirs de son propre esprit, et ne s'intéresse qu'à des choses sans valeur, telles que les fusées et les satellites de l'espace. On pourrait obtenir de meilleurs résultats grâce à des procédés mentaux.
— Lobsang ! la Vérité ? Te rappelles-tu la légende hébraïque ? Écris-la, Lobsang, et raconte aussi comment les choses pourraient être, au Tibet !
On demandait un jour à un rabbin, célèbre pour son savoir et son esprit, pourquoi il illustrait si souvent une grande vérité en racontant une simple histoire.
— Je peux expliquer cela par une parabole, répondit le Sage Rabbin, une parabole sur une Parabole. Il fut un temps où la Vérité se promenait sans voiles parmi la foule, c'était la Vérité toute nue. Ceux qui la voyaient se détournaient d'elle, par honte ou par crainte, car ils étaient incapables de la regarder en face. La Vérité, mal accueillie, inopportune, détestée, errait donc parmi les peuples de la Terre. Un jour, seule et sans amis, elle rencontra la Parabole qui marchait gaiement, vêtue de beaux vêtements multicolores. "Vérité, pourquoi sembles-tu si triste et si misérable ?" demanda la Parabole, avec un sourire allègre. "Parce que je suis si vieille et si laide que les gens se détournent de moi", répondit-elle amèrement. "Allons donc !" dit la Parabole en riant. "Ce n'est pas pour cette raison que les gens t'évitent. Prends quelques-uns de mes vêtements, promène-toi et tu verras." La Vérité mit donc quelques-uns des beaux vêtements de la Parabole et partout où elle alla, elle fut bien accueillie.
Le vieux et Sage Rabbin conclut avec un sourire :
— Les hommes ne peuvent regarder en face la Vérité nue, ils la préfèrent de beaucoup déguisée en Parabole.
— Oui, oui, Lobsang ! c'est là une bonne traduction de notre pensée. Et maintenant, le Récit.
Les chats allèrent s'installer sur leurs lits et attendirent que j'eusse vraiment fini. Je repris la machine à écrire, j'y glissai une feuille de papier et continuai...
De très loin arriva l'Observateur, rayonnant d'un bleu spectral, tandis qu'il survolait les continents et les océans, quittant le côté ensoleillé de la Terre pour entrer dans les ténèbres. Dans son état astral, il ne pouvait être vu que par les clairvoyants, mais lui pouvait tout voir, et tout se rappeler lorsqu'il réintégrait son corps. Indifférent au froid et à l'air raréfié il se laissa tomber, à l'abri d'un sommet et attendit.
Les premiers rayons du soleil étincelèrent un instant sur les hautes cimes rocheuses, les dorèrent et reflétèrent une myriade de couleurs sur la neige des crevasses. De légères bandes de lumière strièrent le ciel tandis que, lentement, le soleil montait à l'horizon.
En bas, dans la vallée, se déroulaient d'étranges événements. Des lumières soigneusement camouflées erraient çà et là, comme si elles avaient été montées sur des remorques. Le fil d'argent de la Rivière Heureuse brillait faiblement, reflétant des taches lumineuses. Une grande activité régnait, une activité insolite et secrète. Les légitimes habitants de Lhassa demeuraient à l'abri chez eux, ou étaient gardés dans les baraquements réservés aux travailleurs forcés.
Peu à peu, le soleil accomplit son périple. Bientôt, les premiers rayons tombant à la verticale, étincelèrent sur une forme étrange qui dominait toute la Vallée. Au fur et à mesure que la lumière s'intensifiait, l'Observateur distinguait cette forme avec plus de netteté. C'était un énorme cylindre et sur son extrémité conique, tournée vers le ciel, étaient peints des yeux et une bouche armée de dents effroyables. Pendant des siècles, les marins chinois ont peint des yeux sur leurs navires. Et ceux de ce Monstre étincelaient de haine.
Le soleil continua son ascension. Bientôt toute la vallée fut baignée de lumière. D'étranges structures métalliques étaient tirées à distance du Monstre, qui n'était plus que partiellement enveloppé sur ses assises. L'immense fusée, dominant son empennage, semblait sinistre, mortellement dangereuse. À sa base, des techniciens munis d'écouteurs s'agitaient comme une colonie de fourmis. Une sirène poussa un hurlement aigu dont l'écho se répercuta de roche en roche, de paroi montagneuse en paroi montagneuse, pour se prolonger en une effroyable cacophonie, de plus en plus déchirante. Soldats, gardes, ouvriers tournèrent aussitôt les talons et coururent à toutes jambes se réfugier dans des roches lointaines.
Sur le flanc de la montagne, à mi-chemin du sommet, la lumière éclaira un petit groupe d'hommes réunis autour d'un matériel de radio. Un des hommes prit un microphone et s'adressa aux occupants d'un grand abri de béton et d'acier, à demi dissimulé à environ un mille (1,6 km) de la fusée. Une voix monocorde compta les secondes, puis se tut.
Pendant quelques instants, rien ne se produisit, tout demeura paisible. Seules bougeaient les vrilles paresseuses de fumée qui s'exhalaient de la fusée. Un jet de vapeur, et un grondement qui s'intensifia de plus en plus, déclencha de petites chutes de pierre. La terre elle-même parut vibrer et gémir. Le son s'amplifia au point de donner l'impression à celui qui l'entendait que ses tympans allaient éclater. Un grand jet de flamme et la vapeur jaillit de la base de la fusée, obscurcissant tout ce qui se trouvait au sol. Lentement, comme par un immense et fantastique effort, la fusée s'éleva. Pendant un instant, elle parut rester immobile sur sa queue incandescente, puis elle prit de la vitesse et, jetant à l'humanité un rugissement de défi, elle s'élança vers les cieux frémissants. Elle montait, toujours plus haut, laissant derrière elle une longue traînée de vapeur et de fumée. Son cri continua à vibrer au cœur des cimes bien après qu'elle eut disparu de la vue.
Le groupe de techniciens, réunis dans la montagne, observaient intensément leurs écrans radar, hurlaient dans leurs microphones ou scrutaient le ciel avec de puissantes jumelles. Loin, très loin dans le ciel, une lueur vagabonde étincela : l'énorme fusée s'était inclinée et placée sur son orbite.
Des visages effarés apparurent derrière les rochers. De petits groupes s'assemblèrent ; pendant un moment, toute distinction fut abolie entre gardiens et ouvriers esclaves. Les minutes s'écoulèrent et les techniciens arrêtèrent leurs radars, car la fusée était parvenue bien au-delà de leur portée. Les minutes passèrent.
Soudain, les techniciens bondirent de leurs sièges en gesticulant comme des fous, oubliant, dans leur émotion, de brancher leurs microphones. La fusée, avec sa tête porteuse atomique, avait atterri dans une pacifique contrée lointaine. Le pays n'était plus que cendres, les cités étaient transformées en un amas de décombres, leurs habitants en gaz incandescents. Les Communistes chinois hurlèrent leur joie dans les haut-parleurs, oubliant toute réserve tant ils étaient heureux d'avoir obtenu cet effroyable résultat. La première étape de la guerre venait de se terminer, la seconde était sur le point de commencer. Des techniciens triomphants se précipitèrent pour préparer la seconde fusée.
Est-ce là de l'imagination pure ?
Ce pourrait être la réalité ! Plus une fusée est lancée haut, moins elle est soumise à la résistance de l'air, sa consommation de carburant est donc énormément réduite. Une fusée ayant pour point de départ les plateaux du Tibet, à dix-sept mille pieds (5 182 m) au-dessus du niveau de la mer, serait beaucoup plus efficace qu'une fusée lancée des basses-terres ; par conséquent, les Communistes ont un avantage incalculable sur le reste du monde, puisqu'ils contrôlent les plus hautes régions du globe, d'où ils pourraient lancer des fusées soit dans l'espace, soit sur d'autres pays.
La Chine a attaqué le Tibet — elle ne l'a pas conquis — de sorte qu'elle possède ce grand avantage sur les puissances Occidentales. La Chine a attaqué le Tibet afin d'avoir accès aux Indes et de déferler sur l'Europe en passant par ce pays lorsqu'elle sera prête. Il est possible que Chinois et Russes s'allient pour former une tenaille capable d'écraser tous les pays libres qui leur feraient obstacle. Oui, cela est possible — à moins que l'on n'agisse rapidement. La Pologne ? Pearl Harbor ? Le Tibet ? Les ‘experts’ ont dit que pareilles énormités ne pouvaient se produire. Ils se sont trompés ! Vont-ils se tromper une fois encore ?
Service d'entraide pour les éditeurs
Pendant des années, depuis la parution du ‘Troisième Œil’, j'ai reçu un courrier considérable et jusqu'à ce jour je me suis toujours appliqué à répondre à chaque lettre. Maintenant, à mon grand regret, ce n'est plus possible ; je suis dans l'impossibilité de répondre à moins que mes correspondants n'envoient des timbres-réponses, ou des coupons-réponses internationaux. Alors je vous en conjure, n'écrivez PLUS à mon Éditeur pour qu'il me fasse suivre le courrier, car je lui ai demandé avec insistance de ne rien m'envoyer.
Les lecteurs oublient trop souvent qu'ils ont payé le prix d'un LIVRE, et NON celui d'un service de conseils gratuit. Les Éditeurs sont des ÉDITEURS, et non des services de renvoi du courrier.
Je reçois des lettres du monde entier, certaines même d'au-delà du Rideau de Fer, mais pas une personne sur mille n'a l'idée d'inclure des timbres pour la réponse, et le prix de cette correspondance devient tellement élevé que je me vois dans l'impossibilité de continuer à répondre.
Les gens posent aussi des questions invraisemblables, me réclament n'importe quoi ! Voici quelques exemples :
J'ai reçu d'Australie une lettre désespérée, qui m'a suivi alors que j'étais en Irlande. L'affaire étant (apparemment) extrêmement urgente, j'ai envoyé à mes frais un câble (télégramme — NdT) en Australie, et je n'ai même pas reçu un petit mot de remerciement.
Un certain monsieur, des États-Unis, m'a écrit une lettre EXIGEANT que j'écrive immédiatement pour lui une thèse et que je la lui fasse parvenir aussitôt par avion. Il voulait s'en servir comme s'il en était l'auteur, afin d'obtenir son Doctorat de Philosophie Orientale. Inutile de dire qu'il n'envoyait pas de coupon-réponse et que sa lettre était presque menaçante !
Un Anglais m'a écrit une lettre très, très hautaine, à la troisième personne, réclamant mes références parce que s'il les trouvait tout à fait satisfaisantes, il envisagerait de devenir mon élève à condition que je ne le fasse pas payer. Autrement dit, c'était un honneur pour moi ! (Je ne crois pas qu'il aurait beaucoup aimé ma réponse, si je lui en avais envoyé une)
Un autre m'a écrit pour me dire que si ‘mes copains’ et moi pouvions descendre du Tibet pour se réunir autour de son lit la nuit, il n'aurait plus peur de voyager dans l'astral.
D'autres gens m'écrivent pour me demander des choses inimaginables, allant des questions les plus ésotériques (auxquelles je puis répondre si le cœur m'en dit) au moyen d'élever des poules, en passant par la meilleure méthode pour garder son mari ! Les gens s'imaginent qu'ils ont le droit de m'écrire tant qu'ils le veulent, et se vexent s'ils ne reçoivent pas de réponse par retour du courrier.
Alors je vous prie instamment de ne PAS déranger mes Éditeurs, car je leur ai demandé de ne pas me faire suivre ce courrier. Pour ceux qui ont réellement besoin d'un secours, d'une réponse (encore que je ne recherche pas ces lettres) ils peuvent écrire à l'adresse suivante, mais uniquement si leur souci est d'une extrême urgence :
Dr T Lobsang Rampa,
BM/TLR,
London W.C.I., England
Je ne promets pas de vous répondre, et si vous écrivez à cette adresse il vous faudra inclure suffisamment de timbres ou de coupons-réponses internationaux, car ces lettres me seront renvoyées et si elles ne sont pas suffisamment affranchies il me faudra payer le port, ce qui fait que je ne serai pas de très bonne humeur pour vous répondre (T.L.R. nous a quitté en 1981 — NdT).
![]()