T. LOBSANG RAMPA
LA ROBE SAFRAN
Titre original : The Saffron Robe
(Édition : 22/04/2020,
paru précédemment sous le titre
La Robe de Sagesse)
La Robe Safran — (Initialement publié en 1966) Une pénétration plus avant dans la vie lamastique de Lobsang avec son guide le Grand Lama Mingyar Dondup. Des sujets comme les origines du bouddhisme, l'histoire véridique du Prince Gautama, comment ce dernier devint ‘le Bouddha’, ses quatre nobles vérités, y sont détaillés.
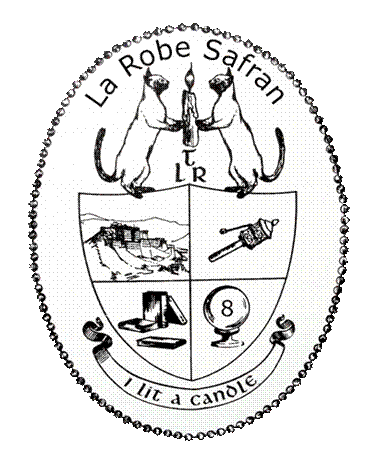
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
À
Sheelagh M. Rouse
Honni soit qui mal y pense —
Gaudet tentamine virtus
(Honte à celui qui en pense du mal —
La vertu se réjouit dans l'épreuve — NdT)
Table des matières
Chapitre Un
DES OMBRES étranges se mouvaient sous mes yeux, ondulant comme les fantômes multicolores d'un univers lointain et plaisant. L'eau éclaboussée de soleil était paisible, à quelques pouces (cm) de mon visage.
Je glissai doucement un bras sous la surface, observant les petites vagues paresseuses provoquées par ce geste. Clignant des yeux, je contemplai les profondeurs. Oui, cette grosse pierre... C'était là qu'il vivait — et voici qu'il sortait pour venir me saluer ! Je laissai distraitement glisser ma main le long du flanc du poisson immobile ; seules ses nageoires s'agitaient légèrement.
Nous étions de vieux amis et je venais bien souvent lui apporter à manger, avant de le caresser. Nous nous comprenions comme seuls peuvent le faire deux êtres qui ne se craignent pas. À cette époque, je ne savais même pas que les poissons étaient comestibles ! Les bouddhistes ne prennent pas la vie des autres, n'infligent pas la souffrance.
J'aspirai profondément et enfonçai ma tête sous l'eau, avide de contempler de plus près un autre univers. Je me prenais presque pour un dieu inspectant une forme de vie très différente. Un courant invisible agitait lentement de grands feuillages, des plantes aquatiques se dressaient comme les arbres géants d'une forêt. Un chemin de sable sinueux ressemblait à un serpent, entre des plantes vert pâle qui évoquaient à s'y méprendre une pelouse bien tondue.
De tout petits poissons multicolores, à grosse tête, passaient comme des éclairs, allant et venant entre les plantes pour chercher leur nourriture, ou s'amuser. Une énorme limace d'eau glissa lentement le long du rocher gris afin d'aller nettoyer le sable.
Mais j'étouffais déjà ; le soleil de midi me brûlait la nuque, les cailloux pointus de la berge me déchiraient la poitrine. Jetant un dernier coup d'œil autour de moi je me redressai pour aspirer profondément l'air embaumé. Là, dans MON univers, tout était bien différent de ce monde paisible que je venais d'examiner. L'animation et le bruit y étaient maîtres. Titubant un peu, à cause d'une blessure à la jambe gauche, je m'adossai à un vieil arbre de mes amis et regardai à droite et à gauche.
Le Norbu Linga n'était qu'un éclaboussement de couleurs, le vert vif des osiers, l'or et l'écarlate du Temple de l'Ile, le bleu profond du ciel et le blanc pur des nuages légers venant de l'Inde par-dessus les montagnes. Les eaux calmes du lac reflétaient ces couleurs en les intensifiant et lorsqu'une brise vagabonde provoquait un friselis, les images se brouillaient. Ici, tout était paisible, mais je savais qu'au-delà du mur il en était autrement.
Des moines, en robe couleur de rouille, portaient des piles de linge à laver, d'autres, penchés sur le ruisseau étincelant, tordaient, battaient et rinçaient leurs vêtements afin qu'ils fussent bien propres. Les têtes rasées luisaient au soleil et, tandis que le jour avançait, les crânes rougissaient. De petits acolytes récemment accueillis à la lamaserie s'acharnaient sur leur linge avec de gros cailloux ronds afin de l'user, pour donner l'impression qu'ils portaient ces robes depuis longtemps !
De temps en temps, le soleil allumait des reflets éblouissants à la longue robe jaune or de quelque auguste lama voyageant entre le Potala et le Pargo Kaling. La plupart étaient des hommes très dignes, au service du Temple depuis leur enfance, d'autres, très rares, étaient de jeunes gens, des Incarnations Reconnues ou bien des moines que leur mérite avait portés très haut.
Marchant à grandes enjambées, l'air très alerte et féroce, venaient les Maîtres de Discipline, hommes de grande taille de la Province de Kham, chargés de maintenir la discipline. Droits et corpulents, ils portaient d'énormes matraques en signe de leur fonction. Non pas des intellectuels, ceux-là, mais des hommes musclés et intègres, choisis seulement pour cela. L'un d'eux s'approcha de moi en me regardant de travers d'un air interrogateur. Me reconnaissant tardivement, il s'éloigna à la recherche de coupables dignes de son attention.
Derrière moi, le Potala — ‘la Maison du Dieu’ — dressait vers le ciel sa masse imposante et glorieuse. Ses pierres de toutes couleurs luisaient doucement et se reflétaient dans les eaux calmes. Dans la brume de chaleur, les sculptures polychromes de sa base semblaient bouger comme un groupe de personnes discutant avec animation. De grands rayons de lumière jaune se reflétant sur les Tombes d'Or du toit du Potala projetaient des lueurs jusque dans les anfractuosités des montagnes.
Un bruit sourd et le craquement d'une branche me fit tourner la tête vers ce nouveau pôle d'attraction. Un vieil oiseau gris, plus vieux que le plus vieux des acolytes, venait de se poser dans l'arbre, derrière moi. Ses petits yeux brillants me considérèrent avec curiosité, puis il se retourna, allongea le cou, battit des ailes et expédia dans ma direction un ‘cadeau’ déplaisant, avec une force et une précision remarquables. Je dus faire un grand bond de côté pour éviter ce présent. L'oiseau me fit face à nouveau et me dit : ‘Crouaak ! Crouaak !’ avant de se désintéresser de ma personne.
La brise m'apporta soudain les sons d'un groupe de marchands arrivant de l'Inde, le meuglement des yaks, la plainte asthmatique des vieux harnais de cuir desséché, le grondement de pas nombreux et le tintement musical des petits cailloux déplacés par la caravane. J'aperçus bientôt les énormes buffles chargés de paquets ; leurs cornes immenses se balançaient au rythme de leur marche lente. Les marchands suivaient ; certains portaient un turban, d'autres de vieilles toques de fourrure, certains des calottes de feutre mitées.
— La charité, pour l'amour de Dieu, la charité ! crièrent les mendiants.
Mais comme la caravane passa sans s'arrêter ils proférèrent des insultes :
— Ta mère est une vache engrossée par un bouc, tes rejetons sont les enfants de Sheitan, tes sœurs se vendent sur la place du marché !
D'étranges senteurs vinrent chatouiller ma narine, me faisant d'abord aspirer profondément — et éternuer. Je humai au passage les odeurs de l'Inde, celle du thé de Chine, la vieille poussière tombant des ballots juchés sur les yaks. Le bruit de leurs cloches s'éloigna et s'estompa enfin, avec les cris des marchands et les imprécations des mendiants. Bientôt les dames de Lhassa ouvriraient leur porte à de riches visiteurs. Bientôt les boutiquiers marchanderaient avidement avec les colporteurs, hausseraient les sourcils, élèveraient la voix, protesteraient contre l'inexplicable augmentation des prix. Bientôt il me faudrait rentrer au Potala.
Distraitement, je contemplai les moines à leurs ablutions ; deux d'entre eux se disputaient et s'éclaboussaient. Ils allaient en venir aux mains lorsque les Maîtres de Discipline intervinrent rapidement ; deux de ces ‘Gardiens de la Paix’ emmenèrent les moines penauds.
Mais qu'était-ce là ? Mon regard fouilla les buissons. Deux petits yeux brillants me regardaient peureusement, deux petites oreilles grises se pointaient dans ma direction. Un corps minuscule était ramassé sur lui-même, prêt à fuir... La souris grise se demandait si elle pourrait passer entre la berge et moi pour rentrer chez elle. Soudain elle s'élança, mais sans me quitter des yeux. Aussi, ne voyant pas où elle allait, elle se jeta la tête la première contre une branche morte et — avec un léger cri de terreur — fit un bond immense et tomba dans le lac. La pauvre bête allait se noyer, elle était en grand danger d'être saisie par un poisson, quand j'entrai dans l'eau jusqu'aux genoux et la recueillis.
Je l'essuyai soigneusement avec un pan de ma robe, revins sur la berge et posai la petite boule de poils frissonnante sur le sol. En un éclair, elle disparut, heureuse sans doute de se tirer à si bon compte de sa mésaventure. Au-dessus de ma tête, le vieil oiseau poussa un ‘Crouaak !’ méprisant et s'envola lourdement dans la direction de Lhassa.
La direction de Lhassa ? Cela me rappela que je devais prendre celle du Potala ! Au-delà du mur du Norbu Linga des moines se baissaient, examinaient leur lessive étalée sur le sol. Tout devait être observé avec soin avant d'être ramassé. Petit Frère Scarabée se promenait peut-être sur le linge et, en roulant en paquet les vêtements, on risquait d'écraser Petit Frère — un crime qui faisait frémir un prêtre de Bouddha.
Un petit ver avait pu s'abriter du soleil sous le linge d'un grand lama, alors Petit Ver devait être porté en lieu sûr afin que sa destinée ne fût pas troublée par l'Homme. Partout les moines se baissaient, tâtonnaient, poussaient des soupirs de soulagement quand ils sauvaient d'une mort certaine une minuscule créature.
Lentement, les tas de linge lavé montaient. De petits acolytes partaient vers le Potala, fléchissant sous le poids des grands paquets de linge. Certains ne voyaient pas au-dessus de leur fardeau et alors c'était un cri, la chute, et tout le linge propre tombait dans la poussière ou même la boue de la berge.
Du sommet du toit jaillit soudain le grand bourdonnement des conques et l'éclat des longues trompettes. La montagne renvoyait leurs échos, et souvent ces vibrations vous assourdissaient pendant plusieurs minutes. Et puis soudain c'était le silence, si profond que l'on entendait le battement de son propre cœur.
Je quittai l'ombre de l'arbre amical et me dirigeai péniblement vers une brèche de la haie. Mes jambes supportaient à peine mon poids ; quelque temps plus tôt, j'avais souffert d'une grave brûlure à la jambe gauche, et la blessure se refermait mal ; et puis je m'étais brisé les deux jambes quand une rafale de vent m'avait soulevé du toit du Potala et projeté au flanc de la montagne. Je boitais donc et, pendant quelques jours, je fus exempté de mes corvées habituelles. Ma joie dura peu, car en échange je dus étudier davantage, ‘pour que la dette soit rectifiée’, me dit-on. Mais aujourd'hui — jour de lessive — j'avais obtenu l'autorisation de me reposer et de me promener au Norbu Linga.
Il n'était pas question pour moi de rentrer par la grande porte, où l'on rencontrait tous les grands lamas et les abbés, ni de gravir les hautes marches si pénibles que je comptais machinalement... ‘Quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, cent, cent un...’ Je m'arrêtai au bord de la route pour laisser passer les lamas, les moines, les pèlerins. La procession s'interrompit, et j'en profitai pour traverser la route et me jeter dans les buissons. Je grimpai ensuite au flanc de la montagne, contournai le village de Shö et rejoignis un petit chemin entre la Cour de Justice et le Potala.
Le sentier était précaire, mais admirable avec sa profusion de fleurs sauvages. Il faisait plus frais, mes jambes devenaient de plus en plus douloureuses. Je ramenai autour de moi ma robe en lambeaux et m'assis sur un rocher afin de reprendre mes forces et mon souffle. Là-bas, dans la direction de Lhassa, j'apercevais de petits feux clignotants — les marchands campaient en plein air, comme le faisaient souvent les Indiens, plutôt que d'aller dans une des nombreuses hostelleries. Plus loin, sur la droite, je distinguais le large fleuve étincelant partant pour son interminable voyage, jusqu'au golfe du Bengale.
— Our-rorr, our-roor, fit une voix grave, et une tête velue se heurta à mes genoux.
— Our-rorr, our-roor, répondis-je aimablement.
Un gros chat noir sauta sur mes jambes et avança sa figure tout contre la mienne.
— Honorable Minou, dis-je, la bouche sur sa fourrure épaisse, ta gentillesse m'étouffe.
Avec douceur, je posai mes mains sur ses épaules et l'écartai un peu de moi pour le regarder. De grands yeux bleus, un peu louchons, me dévisagèrent. Il avait les dents aussi blanches que les nuages légers, et ses oreilles dressées guettaient le moindre son.
Honorable Minou était un vieil et précieux ami. Souvent, nous nous nichions ensemble à l'abri d'un buisson et nous nous confiions nos craintes, nos déceptions, toutes les mésaventures de nos vies si dures. À présent, il me montrait son affection en me pétrissant les genoux avec ses longues griffes, en ronronnant de plus en plus fort. Nous restâmes ainsi un moment et puis, d'un commun accord, nous pensâmes qu'il était temps de repartir.
Tandis que je me traînais péniblement sur mes pauvres jambes, Honorable Minou bondissait devant moi, la queue dressée, se cachait derrière un rocher, bondissait sur moi au passage pour jouer avec les pans de ma longue robe.
— Allons, allons, protestai-je, est-ce ainsi que doit se conduire le chef de la Garde du Joyau du Chat ?
Pour toute réponse, il coucha ses oreilles, escalada le devant de ma robe, atteignit mon épaule et sauta de là dans un buisson.
Nos chats m'amusaient. Ils étaient nos chats de garde car un ‘Siamois’ bien dressé est plus féroce qu'un chien méchant. Ils restaient couchés, apparemment endormis, près des Objets Sacrés, mais si jamais un pèlerin tentait d'y toucher, d'en voler un, les chats — toujours par deux — s'emparaient de lui et menaçaient sa gorge. Ils étaient FÉROCES, et cependant je pouvais faire d'eux ce que je voulais, et, grâce à la télépathie, nous pouvions converser sans difficulté.
J'arrivai enfin à la petite porte. Honorable Minou m'y attendait déjà, arrachant énergiquement de longues échardes de bois au poteau dressé près de l'entrée. Quand je soulevai le loquet il poussa la porte de sa tête solide et disparut dans la pénombre. Je le suivis plus lentement.
Je me trouvais enfin dans mon foyer provisoire. Les blessures de mes jambes étaient telles, que l'on m'avait envoyé du Chakpori au Potala. À présent, en suivant le corridor, je me sentis accueilli par des odeurs familières, l'arôme omniprésent de l'encens, les différents parfums, selon l'heure et l'occasion, l'âcre senteur piquante du beurre de yak que l'on brûlait dans nos lampes ou dans nos réchauds et que l'on sculptait quand il faisait froid. Nous avions beau frotter (mais nous ne frottions pas très fort !) l'odeur persistait, imprégnant tout. Il y avait aussi le relent moins agréable de la bouse de yak qui, séchée, servait à chauffer les cellules des vieux moines et des malades. Je boitillai en longeant le corridor, passant devant la lumière vacillante des lampes à beurre qui rendait les sombres corridors encore plus sombres.
Un autre ‘parfum’ encore était toujours présent dans toutes les lamaseries, si familier que l'on ne le percevait plus si la faim n'aiguisait pas votre odorat. La tsampa ! Cela sentait l'orge grillé, le thé sec de Chine, le beurre chaud. On les mélangeait et l'on obtenait l'inévitable, l'éternelle tsampa. Certains Tibétains n'ont jamais mangé autre chose que la tsampa ; c'est leur premier et leur dernier aliment. C'est leur nourriture, leur boisson, leur consolation. La tsampa les soutient et leur permet d'accomplir le labeur le plus pénible, et elle nourrit leur cerveau. Mais j'ai toujours pensé qu'elle anéantit aussi tout intérêt sexuel ; ainsi le Tibet peut sans peine rester une nation chaste, une terre de moines où les naissances se font de plus en plus rares.
La faim avait certainement aiguisé MON odorat car je pus distinguer les trois odeurs de la tsampa. Je suivis lentement le long couloir faiblement éclairé par les lampes à beurre et tournai à gauche, où le ‘parfum’ était le plus fort. Là, dans d'immenses chaudrons de cuivre, les moines-cuisiniers versaient de l'orge grillé et pilé dans le thé bouillonnant. L'un d'eux coupait plusieurs livres (kg) de beurre de yak qu'il jetait dans un des chaudrons, un autre y versait d'un sac de cuir du sel apporté par les membres d'une tribu des Hauts Lacs. Un autre encore, avec une ‘pagaie’ de dix pieds (3 m), remuait et mélangeait le tout ensemble. Le chaudron bouillonnait, une écume se formait à la surface où montaient des branches de thé sec que le moine écumait avec sa pagaie.
La bouse de yak séchée qui brûlait sous la marmite dégageait une senteur âcre qui se mêlait à la fumée noire. La suie recouvrait les murs, et les figures noires des moines-cuisiniers évoquaient des êtres surgis du plus profond de l'enfer. Souvent, le moine à la pagaie recueillait du beurre fondu flottant à la surface du chaudron et le jetait dans le feu. On entendait un grésillement, une flamme jaillissait et il y avait une nouvelle puanteur !
— Ah, Lobsang ! me cria un moine. Tu as encore faim, on dirait ? Viens, sers-toi, mon garçon.
Je pris sous ma robe le petit sac de cuir dans lequel les moines conservent leur ration quotidienne d'orge. Je le secouai, en fis tomber la poussière et le remplis d'orge pilé nouvellement grillé. Puis je tirai aussi de ma robe mon bol, que j'examinai avec soin. Il me parut sale. Dans la grande caisse poussée contre le mur je ramassai une poignée de sable très fin et frottai consciencieusement mon bol. Cela me nettoya les mains, par la même occasion. Enfin satisfait, je pris mon sac à thé ; il était presque vide, et je le retournai complètement pour en faire tomber les brindilles et autres saletés que l'on trouve toujours dans le thé. Je ramassai enfin un marteau, et cassai un grand morceau d'une des briques de thé sec.
Enfin, c'était mon tour ! Je tendis mon bol propre. Un moine plongea une louche et me le remplit de tsampa, à ras bord. J'allai m'asseoir dans un coin, sur un vieux sac, et mangeai goulûment, tout en regardant autour de moi. La cuisine était pleine des badauds habituels, des oisifs échangeant des potins, révélant le dernier scandale, les rumeurs qui couraient.
— Oui, Lama Tenching s'en va à la Barrière de Roses... On dit qu'il s'est disputé avec le Père Abbé. Mon ami a tout entendu et il a dit...
On se fait généralement une idée bien fausse des lamaseries et des monastères ; on s'imagine que les moines passent leurs journées en prières, en méditation, en contemplation. En principe, une lamaserie est un lieu où des religieux se réunissent pour adorer et méditer afin de purifier leur esprit. En principe ! En pratique, la robe ne fait pas le moine. Dans une communauté de plusieurs milliers d'hommes, il y a ceux qui s'occupent du ménage, des réparations, de l'entretien ; d'autres veillent aux comptes, enseignent, prêchent... En somme, une lamaserie ressemble à une grande ville dont la population serait exclusivement masculine. Les travailleurs qui appartiennent à la plus basse classe ne s'intéressent guère aux aspects religieux de l'existence et bien souvent ne sont jamais entrés dans un Temple, sauf pour laver le sol !
Dans une grande lamaserie il peut y avoir le Temple proprement dit, et puis des écoles, un hôpital, des magasins, des cuisines, des auberges, des prisons, presque tout ce que l'on peut trouver dans une ville ‘profane’. La seule différence c'est que dans une lamaserie, tout y est masculin et — en principe — tout le monde se consacre à l'instruction et l'action religieuses. Les lamaseries sont peuplées d'hommes intelligents et travailleurs, mais aussi de paresseux et d'imbéciles. Les plus grandes sont immenses avec de nombreux bâtiments, des parcs, parfois entourées d'un grand mur. D'autres sont petites, n'ont qu'une centaine de moines habitant le même bâtiment. Dans certaines régions reculées il existe de très petites lamaseries qui n'ont guère que dix moines. Ainsi les lamaseries sont innombrables, de dix ou dix mille moines, grands ou petits, maigres ou gras, bons ou mauvais, paresseux ou énergiques. La vie n'y est ni meilleure ni pire que dans toute autre communauté, souvent pire je dois le dire, à cela près que la DISCIPLINE lamastique y est souvent quasi militaire — selon l'abbé en charge. Il en est de bons, prévenants et tolérants, mais il existe aussi des tyrans.
J'étouffai un bâillement et quittai la cuisine. Mon attention fut attirée par du bruit dans une des alcôves à provisions bordant le corridor. J'aperçus une longue queue noire disparaissant derrière des sacs de grain. Les chats ‘gardaient’ le grain et attrapaient leur souper de souris. Juché sur un des sacs, je vis un gros chat placide qui se pourléchait et semblait SOURIRE de satisfaction.
Les trompettes retentirent, leurs échos se répercutèrent dans les couloirs, et puis elles sonnèrent une deuxième fois. Je fis demi-tour et me dirigeai vers le Temple Intérieur où je me mêlai bientôt à la foule des moines en sandales ou pieds nus.
Le soir tombait, les ombres violettes rampaient sur le sol et bordaient d'ébène les hautes colonnes. Les derniers rayons du soleil doraient les fenêtres et venaient caresser notre demeure. Des nuages d'encens tournoyaient, et le soleil y révélait des myriades de fines poussières scintillantes, presque vivantes.
Moines, lamas, humbles acolytes pénétrèrent dans le Temple et s'assirent par terre, formant une palette bariolée ; il y avait les robes d'or des lamas du Potala, les robes rouges ou safran des autres, la bure brune des moines, les vêtements décolorés par le soleil de ceux qui travaillaient dehors. Ils s'assirent tous en rangs, dans la position traditionnelle. Comme mes jambes douloureuses m'interdisaient de m'asseoir ainsi, je fus relégué dans le fond, derrière une colonne, afin de ne pas ‘détruire le motif’.
Je regardai autour de moi les garçons, les hommes, les très vieux sages, chacun accomplissant ses dévotions selon son degré de compréhension. Je songeai à ma mère, la mère qui ne m'avait même pas dit au revoir lorsque j'avais quitté la maison — comme il y avait longtemps, me semblait-il ! — pour entrer à la Lamaserie Chakpori. Des hommes, rien que des hommes. Comment pouvaient être les FEMMES ? me demandai-je. Je savais que, dans certaines régions du Tibet, il y avait des monastères où moines et nonnes vivaient ensemble, se mariaient, élevaient leurs enfants.
L'encens tourbillonnait, l'office continuait, et les ombres de la nuit n'étaient plus percées que par la flamme vacillante des lampes à beurre et des brûleurs d'encens.
Des hommes ! Était-ce vraiment souhaitable que des hommes vécussent ensemble, sans jamais avoir le moindre rapport avec des femmes ? Et comment étaient les femmes ? Pensaient-elles comme nous ? D'après le peu que j'en savais, elles bavardaient comme des pies, ne parlant que de mode, de coiffure et de choses stupides. Et elles étaient affreuses, aussi, avec tout le fard dont elles se barbouillaient.
L'office prit fin et je m'adossai à la colonne afin de ne pas être renversé par la foule qui sortait en trombe. Enfin je m'engageai dans le couloir et gagnai le dortoir.
Un vent glacé pénétrait par les fenêtres, soufflant tout droit de l'Himalaya. Les étoiles brillaient froidement dans la nuit claire. Par une fenêtre ouverte à l'étage inférieur me parvint une voix chevrotante qui récitait :
— Voici maintenant la Noble Vérité sur l'origine de la souffrance. C'est la soif insatiable qui provoque le renouvellement des désirs, des envies...
Demain, me rappelai-je, et pour plusieurs jours sans doute, nous assisterions à des conférences spéciales sur le bouddhisme, données par un des grands Maîtres de l'Inde. Notre bouddhisme, le lamaïsme, était une forme du bouddhisme indien, un peu comme dans la religion chrétienne il y a le protestantisme et le catholicisme.
Je me détournai de la fenêtre glacée. Autour de moi, des acolytes dormaient déjà, certains ronflaient, d'autres se tournaient et se retournaient, et quelques fidèles particulièrement vigoureux tentaient de mettre en pratique la position lamastique correcte du sommeil — assis tout droit dans la position du Lotus. Nous n'avions pas de lit, naturellement, ni de matelas. Le sol était notre table et notre lit.
J'ôtai ma robe, grelottai et m'enveloppai rapidement dans la couverture que tous les moines tibétains portent roulée sur une épaule et retenue à la ceinture. Je m'allongeai avec précaution de crainte d'être trahi par mes mauvaises jambes, roulai ma robe en boule pour m'en faire un oreiller et m'endormis aussitôt.
Chapitre Deux
— TOI, oui, toi ! Assieds-toi correctement !
La voix était comme un tonnerre grondant ; deux lourdes mains me giflèrent violemment, à droite, à gauche. Je crus un instant que tous les gongs du Temple retentissaient en même temps. Je vis plus d'étoiles qu'il ne peut y en avoir dans la nuit la plus claire. Une main saisit le col de ma robe, me souleva et me secoua comme un chiffon à poussière.
— RÉPONDS-MOI ! RÉPONDS-MOI ! glapit la voix furieuse.
Mais je ne pouvais répondre car il me secouait tant que mes dents claquaient ; mon bol tomba et roula sur le sol, puis mon sac d'orge se détacha, laissant tomber une averse de grain. Satisfait enfin, l'Homme Féroce me rejeta de côté comme une poupée de chiffons.
Un profond silence régnait. Prudemment, je tâtai le bas de ma robe, derrière ma jambe gauche. Un mince filet de sang suintait de ma plaie rouverte. Le silence ? Je levai les yeux. Un abbé se tenait sur le seuil de la salle, face à l'Homme Féroce.
— Cet enfant a été grièvement blessé, dit-il. Il a l'autorisation spéciale, accordée par le Grand Initié, de s'asseoir comme il le juge préférable. Il a l'autorisation de répondre à une question sans se lever.
L'abbé se pencha sur moi, vit mes doigts rougis de sang.
— Si le sang ne s'arrête pas de couler, tu iras à l'infirmerie, me dit-il.
Puis il sortit, en saluant sèchement l'Homme Féroce.
— Je suis venu spécialement de notre Mère l'Inde, reprit l'Homme Féroce, pour vous enseigner la Vérité du Bouddhisme. Vous vous êtes écartés de nos dogmes, dans ce pays, et vous avez formé ce que vous appelez le ‘Lamaïsme’. Je suis venu vous enseigner les Vérités Originelles.
Il me foudroya du regard, comme si j'étais son ennemi mortel, puis il dit à un des garçons de me donner mon bol et mon sac d'orge, vide à présent. Pendant que l'on balayait l'orge renversé, il marcha à grands pas autour de la salle, comme s'il cherchait une nouvelle victime. Il était grand, maigre, très brun de peau, avec un grand nez en bec d'aigle. Il portait l'habit d'un très ancien Ordre de l'Inde, et il semblait nous mépriser tous !
Enfin le Maître venu de l'Inde monta sur l'estrade. Il arrangea soigneusement le lutrin selon sa convenance, puis il fouilla dans un sac de cuir aux bords rigides et aux coins carrés pour en tirer des feuilles de papier extraordinaires, très fines, rectangulaires, qui ne ressemblaient pas du tout à nos très longues feuilles épaisses. Elles étaient si fines qu'elles paraissaient translucides et souples comme de l'étoffe. L'étrange sac de cuir me fascinait. Il était remarquablement ciré et, au milieu d'un des côtés étroits, il y avait un morceau de métal brillant qui s'ouvrait avec un déclic quand on poussait un bouton. Un morceau de cuir formait une poignée fort commode, et je me promis d'avoir un jour un sac de cuir comme celui-ci.
L'Indien étala ses papiers devant lui, nous regarda sévèrement, et nous raconta la vieille histoire que nous connaissions par cœur depuis longtemps. J'observais pour me distraire la pointe de son long nez qui s'agitait quand il parlait.
— Il y a deux mille cinq cents ans, le peuple de l'Inde fut déçu par sa religion ; les prêtres hindous étaient dégénérés, ils ne pensaient qu'aux plaisirs terrestres, au profit personnel. Le peuple qu'ils auraient dû aider se détournait de ses vieilles croyances et ne savait où trouver une lueur d'espoir. Les prophètes et les charlatans parcouraient le pays en annonçant la fin du monde, les malheurs et les fléaux. Les amoureux des animaux décidèrent que les bêtes étaient meilleures que les hommes et ils en firent des dieux qu'ils adorèrent.
"Les Indiens les plus cultivés, les grands penseurs, craignant pour l'avenir de leur pays, se détournèrent de la religion de leurs ancêtres et se penchèrent avec inquiétude sur le triste état de l'âme humaine. Un de ces hommes était un riche radjah hindou, un roi guerrier fabuleusement riche. Il s'inquiétait beaucoup de l'avenir de son fils unique, Gautama, qui venait de naître dans ce monde troublé.
"Le père, et toute la famille, avaient le plus grand désir de faire de Gautama un prince guerrier, qui hériterait plus tard le royaume de son père. Un vieux devin, à qui l'on demandait une prédiction, répondit que le jeune homme deviendrait un prophète de grand renom. Le père accablé pensa que c'était là ‘un sort pire que la mort’. Autour de lui, il avait vu beaucoup de jeunes gens de haut rang qui renonçaient à une vie de luxe pour parcourir les chemins, pieds nus et en loques, afin de chercher une nouvelle vie spirituelle. Le père résolut de tout faire pour que la prophétie du devin ne se réalisât pas. Il avait un projet...
"Gautama était un jeune homme plein de sensibilité, aux goûts artistiques et à l'intelligence profonde. Autocrate par sa naissance et par son éducation, il avait cependant de la considération pour ses inférieurs. Sa pénétration d'esprit était telle qu'il s'aperçut bientôt qu'on le guidait soigneusement, qu'on l'écartait du reste du monde, qu'on ne lui permettait de fréquenter que ses serviteurs personnels ou des personnes de sa caste.
"À l'époque de la prophétie du devin, le père donna des ordres très stricts afin que son fils fût à tout moment protégé des maux et des fléaux qui bouleversaient l'Inde, au-delà des murs du Palais. L'enfant n'avait pas le droit de sortir seul, ses voyages devaient être surveillés et jamais il ne devait voir de gens pauvres ou souffrants. Il devait vivre dans le luxe, uniquement dans le luxe. Tout ce que l'argent pouvait acheter était à lui. Tout ce qui était déplaisant était écarté sans pitié.
"Mais la vie ne pouvait continuer ainsi. Gautama avait l'esprit vif, et de la détermination. Un jour, à l'insu de ses parents et de ses tuteurs, il sortit du Palais et, avec un serviteur dévoué, il partit en voiture au-delà des jardins fermés. Pour la première fois de sa vie il apprit comment vivaient les êtres des castes inférieures. Quatre incidents éveillèrent chez lui les pensées les plus profondes, et changèrent ainsi le cours de l'histoire religieuse.
"Au début de sa randonnée, il vit un vieillard, tremblant sous le poids de l'âge, qui se traînait en s'appuyant lourdement sur deux bâtons. Édenté, aveuglé par la cataracte, sénile, le vieillard tourna vers le jeune prince un visage morne. Pour la première fois de sa vie, Gautama comprit que la vieillesse frappait tous les hommes, qu'avec le poids des ans on cessait d'être agile et actif.
"Bouleversé, le jeune prince poursuivit son chemin, l'esprit agité de pensées étranges et morbides. Mais un nouveau choc l'attendait. Comme ses chevaux se mettaient au pas, le regard horrifié de Gautama se posa par hasard sur une misérable créature assise au bord du chemin, qui se balançait en gémissant. C'était un homme couvert de plaies suppurantes, émacié, horrible à voir.
"Le jeune Gautama fut accablé. Le cœur lourd, malade — peut-être même physiquement malade aussi — il se posa des questions troublantes. Doit-on souffrir ? Tout le monde peut-il souffrir ? La souffrance est-elle inéluctable ? Il se tourna vers son serviteur, qui conduisait les chevaux. Pourquoi est-il si calme ? se demanda le jeune prince. Si le cocher ne semblait pas s'inquiéter, c'était donc que de tels spectacles étaient communs ? Pour cela sans doute son père l'avait toujours si jalousement protégé !
"Ils poursuivirent leur chemin, car Gautama était trop bouleversé pour donner l'ordre de rentrer au Palais. Cependant, le Destin lui réservait une nouvelle surprise. Obéissant à un cri de son maître, le cocher arrêta les chevaux. Là, sur le bord de la route, gisait un cadavre horrible, complètement nu, le corps enflé par la chaleur. Un coup de fouet du cocher et un nuage de mouches s'éleva en tournoyant. Le cadavre blême et malodorant fut alors entièrement révélé au jeune homme. Comme il observait, une mouche s'échappa de la bouche du mort, bourdonna, et s'y réinstalla.
"Pour la première fois de sa vie, Gautama contemplait la mort, comprenait que la mort attendait tous les êtres vivants. Il fit signe au cocher de rentrer au Palais, et il se laissa emporter au galop des chevaux en songeant à la brièveté de la vie, à la beauté que guettait la décomposition. La beauté était-elle si temporaire ? se demanda-t-il.
"Les roues de la voiture tournaient, la poussière s'élevait en nuage derrière elle. Le jeune prince restait plongé dans ses pensées moroses. Par hasard, ou parce que le Destin le voulut, il leva soudain les yeux et vit un moine serein et bien vêtu, marchant au bord du chemin. Ce moine calme et tranquille semblait être nimbé d'une auréole de paix, de bien-être, d'amour de ses semblables. Gautama reçut alors un nouveau choc. La paix, le contentement, la tranquillité, toutes les vertus en somme, ne pouvaient-elles être découvertes que si l'on se retirait du monde pour se consacrer à la religion ? Si l'on devenait un moine ? Un membre d'un certain Ordre mystique ? Sur l'instant, Gautama résolut de se faire moine, de renoncer à la vie du Palais, d'abandonner toutes ses richesses.
"Son père tempêta, sa mère le supplia en pleurant. Le fidèle cocher fut banni et dut quitter le royaume. Gautama s'enferma dans sa chambre et médita longtemps. Il songeait inlassablement aux choses qu'il avait vues, et se disait que si, dans une courte excursion — sa SEULE excursion — il avait pu rencontrer autant d'horreurs, alors combien la misère et la souffrance devaient être grandes ! Il refusa de manger, il s'étiola et se demanda comment il pourrait fuir le Palais pour devenir moine.
"Son père fit tout pour délivrer le jeune prince de son affliction. Les plus grands musiciens vinrent le charmer, afin que la musique empêchât le jeune homme de méditer. On engagea des jongleurs, des acrobates, on chercha les plus belles jeunes filles du royaume, et aussi des filles habiles aux arts de l'amour afin que la passion détournât Gautama de ses sombres pensées.
"Les musiciens jouèrent jusqu'à tomber d'épuisement. Les jeunes filles dansèrent et répétèrent leurs exercices érotiques jusqu'à ce qu'elles, aussi, s'effondrent d'épuisement. Alors seulement Gautama les remarqua. Avec horreur, il contempla les postures embarrassantes des musiciens tombés. En état de choc, il regarda les jeunes filles nues, pâles de la pâleur de l'effondrement, sous le fard qui ressortait de façon vive et laide maintenant que l'éclat de la santé avait disparu.
"Une fois encore, il réfléchit au caractère éphémère de la beauté, à quel point elle était passagère, si rapidement envolée. Combien triste, combien laide était la Vie. Combien voyantes et de mauvais goût étaient ces femmes peintes quand leur activité immédiate avait pris fin. Il résolut de partir, résolut de rejeter tout ce qu'il avait connu, et de chercher la tranquillité là où il pourrait la trouver.
"Son père furieux, doubla la Garde du Palais, la tripla. Sa mère poussa des hurlements et devint hystérique. Sa pauvre femme, effondrée, sanglota avec ses dames d'honneur. Le jeune fils de Gautama, trop petit pour comprendre, criait et hurlait lui aussi devant tant de désolation. Les Conseillers du Palais conseillèrent en vain.
"Pendant des jours et des jours, Gautama chercha comment il pourrait s'enfuir. Les gardes du Palais le connaissaient bien, mais le peuple ne l'avait jamais vu, aussi se dit-il qu'il lui suffirait de se déguiser pour tromper la surveillance des gardes. Grâce à un fidèle serviteur, qui fut bien rémunéré et quitta aussitôt le royaume, Gautama se procura une défroque de mendiant. Un soir, à la tombée de la nuit, avant la fermeture des portes du Palais, il se revêtit de ses loques et, les cheveux décoiffés, la figure et les mains couvertes de terre, il sortit en traînant les pieds avec la foule des mendiants que l'on chassait pour la nuit.
"Il partit dans la forêt, loin des chemins battus, craignant d'être trahi par son ignorance des coutumes du peuple. Il erra toute la nuit, sans craindre les tigres et les bêtes sauvages qui hantaient la forêt, car sa vie avait été si protégée qu'il IGNORAIT le danger.
"Cependant, au Palais, on avait découvert sa fuite. On fouilla tous les bâtiments, les communs, les jardins. Le roi allait et venait, glapissant des ordres, des hommes armés se tenaient en alerte. Enfin, tout le monde alla se coucher jusqu’à la levée du jour, où l'on pourrait organiser des recherches à l'extérieur. Au quartier des femmes, c'était un concert de lamentations tant la colère du roi effrayait tout le monde.
"Gautama s'enfonçait dans la forêt, évitant les rencontres, ne répondant pas aux questions des rares personnes qu'il trouvait sur son chemin. Dans les champs, il prit sa nourriture, vivant de grains, de baies et de fruits, buvant l'eau froide des clairs ruisseaux. Mais, finalement, l'existence de l'étrange vagabond qui ne se comportait pas comme un vagabond fut connue au Palais. Les soldats du roi envahirent la forêt, mais ne purent saisir le fugitif qui se cachait dans d'épais fourrés où les chevaux ne pouvaient pénétrer.
"Enfin le roi envoya les danseuses dans la forêt et les lança à la poursuite de Gautama afin qu'elles tentassent de l'attirer par leurs charmes. Pendant des jours elles dansèrent dans les clairières, sous les yeux de Gautama, séductrices comme des sirènes. Mais le jour vint où le jeune prince atteignit les frontières du royaume. Alors il s'avança et déclara qu'il partait par le monde à la recherche de la spiritualité et ne reviendrait jamais. Sa femme se précipita vers lui, leur bébé dans les bras. Gautama refusa d'écouter ses supplications. Il se détourna et poursuivit son chemin."
Le Maître de l'Inde, interrompant ce récit que nous connaissions aussi bien que lui, nous dit alors :
— À ce moment une nouvelle Croyance naquit, surgissant de la religion hindoue décadente, une nouvelle Croyance qui allait apporter l'espoir et le réconfort à de nombreuses personnes. La leçon est finie pour le moment. Nous la reprendrons cet après-midi. Vous pouvez sortir !
Mes camarades se levèrent, s'inclinèrent avec respect devant le Maître et s'en allèrent. Mais j'avais des ennuis ; le sang avait collé ma robe à ma plaie. Le Maître sortit sans m'accorder un regard. J'avais atrocement mal, je ne pouvais me relever et je me demandais que faire lorsqu'un vieux moine-balayeur entra et me considéra avec étonnement.
— J'ai vu sortir le Maître et je suis venu nettoyer. Que t'arrive-t-il ?
Je le lui expliquai et lui montrai comment la grande cicatrice s'était rouverte, comment le sang avait jailli, et comment j'avais ‘bouché le trou’ avec ma robe. Le vieil homme murmura ‘Tsk ! Tsk !’ et partit aussi vite que le lui permettaient ses jambes déformées. Il revint bientôt avec l'Infirmier.
La douleur me brûlait ; j'avais l'impression qu'un feu intense me rongeait les chairs jusqu'à l'os.
— Ah, mon fils ! s'exclama l'Infirmier. Tu auras donc toujours des ennuis ? Mais aussi, POURQUOI certains de ces Grands Maîtres sont-ils aussi durs, alors qu'ils auraient dû apprendre à être compatissants ?
Il appliqua sur ma blessure un cataplasme d'herbes et m'aida à me relever en m'assurant qu'à présent tout allait bien, mais je ne pus retenir un gémissement.
— Ne t'inquiète pas, tu seras vite guéri. Maintenant tu vas ôter cette robe souillée, et je t'en donnerai une neuve.
— Ah ! Maître Vénérable ! m'exclamai-je en tremblant. Je ne veux pas d'une ROBE NEUVE ! On croira que je suis un nouveau ! Non, j'aime mieux garder celle-ci.
Le vieil Infirmier éclata de rire.
— Allons, viens, petit, viens et nous allons examiner ce cas tragique.
Nous suivîmes lentement le corridor menant à l'infirmerie. Dans cette salle, sur des tables et des étagères, il y avait des bocaux contenant des simples, des poudres, des objets que je n'avais jamais vus. Les Tibétains ne se faisaient soigner que lorsque cela s'imposait. Il n'y avait pas de trousses de Premiers Secours chez nous, comme ils en ont en Occident ! Nous faisions ce que nous pouvions, avec l'aide de la Nature. Les fractures étaient réduites, naturellement, et les plaies profondes recousues. On employait pour cela les crins de la queue d'un cheval, soigneusement bouillis. Pour recoudre les tissus profonds, nous avions les longues et fines fibres de bambou. Le bambou servait aussi à drainer le pus d'une plaie infectée. La mousse de Sphaigne bien lavée était une éponge fort utile que l'on employait également en compresses, avec ou sans cataplasmes d'herbes.
L'Infirmier me fit entrer dans une petite pièce que je ne connaissais pas. Il prit une vieille robe, propre mais rapiécée, sur une pile et la déplia. Elle était si décolorée par le soleil que je retrouvai mon sourire. Une telle robe prouverait que j'étais à la Lamaserie depuis très longtemps ! L'Infirmier me fit déshabiller et m'examina pour voir si j'avais d'autres blessures.
— Hum, fit-il. Maigre, malingre. Tu devrais être plus solide pour ton âge. Quel âge as-tu, petit ?
Je le lui dis et il s'exclama :
— Vraiment ? Je te donnais trois ans de plus. Presque un homme, hé ? Bon, maintenant, essaye cette robe.
Je bombai le torse, je m'efforçai de me tenir très droit pour paraître plus grand et plus fort, mais mes jambes refusaient de se redresser. La robe était un peu grande pour moi.
— Allons, dit l'Infirmier, tu vas bientôt grandir et grossir, et elle t'ira bien. Garde-la. Au revoir.
Il était temps de déjeuner, à présent, avant la classe de l'après-midi. J'avais déjà perdu beaucoup de temps, aussi allai-je à la cuisine où je racontai mes malheurs.
— Mange, MANGE, petit, me répondit le brave moine-cuisinier au visage de suie, en me servant une portion généreuse !
Le soleil ruisselait par la fenêtre ouverte. J'allai m'y accouder, et contemplai le paysage tout en mangeant. Par moments, je cédais à la tentation et jetais de petites cuillerées de tsampa sur quelque pauvre moine, tout en bas.
— Tu en veux encore ! s'exclama le moine-cuisinier, stupéfait. Tu dois vraiment avoir le ventre creux... À moins — ajouta-t-il en clignant malicieusement de l'œil — que tu n'en fasses un peu profiter le crâne de nos Frères ?
Je dus rougir, ou prendre un air coupable, car il éclata de rire et me proposa :
— Mêlons-y un peu de suie, ce sera plus amusant.
Cependant, les amusements ont une fin. Mon bol était de nouveau vide. Au pied du mur, un groupe de moines furieux essuyaient leur crâne noirci et regardaient autour d'eux avec méfiance. L'un d'eux leva même les yeux, et je reculai vivement. Je sortis nonchalamment de la cuisine. Comme j'arrivais au bout du corridor un moine, rouge de colère, apparut et s'arrêta en me voyant.
— Montre-moi ton bol ! gronda-t-il.
Prenant mon expression la plus innocente, je plongeai une main sous ma robe et lui tendis le bol en demandant :
— Que vous arrive-t-il, mon frère ? Ce bol EST bien le mien.
Le moine l'examina attentivement, cherchant des traces de suie, mais je l'avais soigneusement lavé. Il me regarda fixement, en me rendant mon bol.
— Ah, c'est toi qui es blessé. Tu n'aurais pas pu grimper sur le toit. Quelqu'un nous a jeté de la suie DU HAUT DU TOIT — mais je vais l'attraper !
Sur quoi il tourna les talons et courut vers le toit. Je poussai un soupir de soulagement, mais j'entendis derrière moi un gros rire. C'était le moine-cuisinier.
— Bien joué, petit. Tu aurais dû être un acteur. Je ne te dénoncerai pas, sinon je pourrais bien être la prochaine victime !
Il disparut rapidement dans une des alcôves à provisions, et je poursuivis mon chemin à contrecœur. J'arrivai le premier dans la salle de classe et j'en profitai pour m'installer à la fenêtre. J'étais toujours fasciné par ce panorama grandiose et j'aurais pu rester des heures à contempler les mendiants du Pargo Kaling (ou Portail de l'Ouest) et les plumets de neige légère que le vent soulevait aux plus hauts sommets de l'Himalaya.
Ces immenses montagnes, l'épine dorsale du continent, formaient autour de la région de Lhassa une espèce de fer à cheval. Comme j'avais tout mon temps, je regardai attentivement, en en faisant un jeu. Au-dessous de moi les murs blanchis à la chaux du Potala se confondaient graduellement avec le rocher et la lave durcie d'un ancien volcan. Le blanc des murailles érigées par l'homme devenait gris et brun prenant les couleurs de la montagne, et nul ne pouvait dire où finissait l'un et où l'autre commençait. Tout en bas, les pentes étaient recouvertes de petits buissons rabougris où nous nous cachions souvent pour échapper à la colère d'un lama. Plus bas encore, c'était le Village de Shö avec son imposante Cour de Justice, les bâtiments officiels, l'imprimerie du gouvernement, les Archives, et la prison.
Le spectacle était animé ; des pèlerins montaient lentement, en rampant, en se prosternant tous les dix pas dans l'espoir d'acquérir la vertu. De la hauteur où j'étais, c'était fort amusant. Entre les maisons, des moines allaient et venaient, toujours pressés, et des lamas cheminaient à cheval, l'air solennel. Un abbé et sa suite gravissaient lentement le chemin abrupt menant à la porte principale de notre monastère. Un groupe de diseurs de bonne aventure arrêtait les passants pour leur promettre bonheur et prospérité.
Le vert vif des osiers du marécage, de l'autre côté de la route, attira mon attention ; les branches se balançaient doucement à la brise. Des flaques d'eau, des mares et des bassins reflétaient les nuages et changeaient de couleur selon celles des passants. Un diseur de bonne aventure s'était établi au bord d'un grand bassin et feignait de ‘lire l'avenir’ de ses clients dans ‘l'eau sacrée au pied du Potala’. Les affaires marchaient bien !
Le Pargo Kaling était encombré d'une foule grouillante. De petites échoppes se dressaient ici et là, et les colporteurs vendaient des provisions et des douceurs aux pèlerins. Une profusion d'amulettes et de boîtes de talismans étaient drapés à l'extrémité d'une de ces baraques, et le soleil faisait étinceler l'or et les turquoises. Des Indiens en turbans bariolés, à la barbe noire et au regard brillant, cherchaient à acheter à bon compte et marchandaient avec les boutiquiers.
En face de moi se dressait le Chakpori — la Montagne de Fer — un peu plus élevé que le Potala mais bien moins orné, bien moins beau. Le Chakpori était austère, gris, sombre, lugubre même, mais c'était la Maison des Guérisons, alors que Potala était la Maison du Dieu. Au-delà du Chakpori la Rivière Heureuse descendait en bondissant joyeusement vers le golfe du Bengale. En abritant mes yeux, je pus apercevoir un passeur qui transportait des passagers d'une berge à l'autre dans son bateau de peau de yak. Ce bateau me fascinait depuis longtemps, et je commençais à me demander si je n'aurais pas dû être batelier, au lieu de rester petit acolyte dans une grande lamaserie. Mais il n'en était pas question ; je devais d'abord terminer mes études, et d'ailleurs était-ce possible qu'un moine devînt batelier ?
Très loin sur la gauche brillait le toit d'or du Jo Kang, la Cathédrale de Lhassa. Je contemplai la Rivière Heureuse suivant son cours sinueux parmi les marécages et entre les bosquets de saules verdoyants où un petit affluent passait sous le Pont de Turquoises. Vers l'horizon, la rivière n'était plus qu'un mince fil d'argent.
La journée était certes animée ; en me penchant à la fenêtre — au risque de tomber d'une grande hauteur — je vis de nouveaux marchands arrivant par la route de Drepung qui descendait des montagnes. Mais je savais qu'il me faudrait attendre très longtemps avant de pouvoir distinguer les détails de leur caravane ; et la classe aurait déjà commencé.
Les flancs de la montagne étaient piquetés de lamaseries, des petites qui semblaient se cramponner aux sommets rocheux, des grandes qui ressemblaient à des villes. Les plus petites, les plus dangereusement érigées, étaient les ermitages de moines ayant renoncé au monde qui vivaient jusqu'à la fin de leur vie murés dans leur cellule. Était-ce VRAIMENT bon, me demandai-je, d'être aussi détaché du monde ? Est-ce que cela pouvait être d'un quelconque secours quand un homme jeune, sain, se murait dans une minuscule cellule pour y passer quarante ans peut-être dans l'obscurité totale, dans le silence accablant, en méditant sur la vie et en essayant de se libérer des liens de la chair ? Je me dis que cela devait être bien étrange de ne plus jamais voir, de ne plus jamais parler, de ne plus jamais marcher et de ne manger qu'un jour sur deux.
Chapitre Trois
JE PENSAIS à mon Guide, le lama Mingyar Dondup, qui avait dû partir brusquement pour Pari, très, très loin ; je songeais à toutes les questions qui me tourmentaient, auxquelles lui seul pourrait répondre. Mais cette longue attente était bientôt finie ; demain, il reviendrait et je serais bien heureux de retourner au Chakpori. Ici, au Potala, il y avait trop de solennité, trop de cérémonial, trop de bureaucratie. Oh oui ! Bien des questions m'agitaient et j'avais hâte d'obtenir des réponses.
Depuis quelques instants mes pensées étaient troublées par un sourd grondement ; le bruit se rapprocha et me rappela un troupeau de yaks affolés. Tous les garçons firent irruption dans la classe, en criant, en se poursuivant ! Je reculai vers le fond de la salle et m'assis contre le mur, à l'abri de ceux qui couraient en tous sens.
Ils jouaient à saute-mouton, leurs robes s'envolaient, ils glapissaient de joie. Soudain, j'entendis un bruit sourd — WHUUMPF ! — et un cri. Le silence tomba soudain, les garçons s'immobilisèrent, figés comme les statues du Temple. Horrifié, je vis notre Maître indien assis par terre, bouche bée. C'était maintenant SON bol et son orge qui étaient renversés, observai-je avec satisfaction. Il se releva lentement, s'appuya contre le mur et regarda autour de lui. J'étais le seul à être assis, donc je ne pouvais être coupable. Ah, la merveilleuse sensation que l'on éprouve quand on a la conscience nette ! Je me sentais GONFLÉ de vertu, assis là.
Sur le sol, étourdi ou pétrifié de peur, je vis le garçon qui s'était jeté la tête la première contre le ventre plat du Maître. Il saignait du nez mais l'Indien lui décocha un coup de pied et glapit :
— DEBOUT !
Puis il se pencha, saisit le garçon par les oreilles et le releva sans ménagements.
— Vous n'avez pas honte ! Petits voyous tibétains ! rugit-il en giflant le garçon avec violence. Je vous apprendrai à respecter un Gentilhomme, un Maître de l'Inde ! Je vous enseignerai le yoga qui mortifiera votre chair pour libérer votre esprit !
Je me promis de demander à mon Guide pourquoi certains des Grands Maîtres venus d'autres pays étaient aussi sauvages.
L'Indien, fatigué de taper sur le garçon, nous déclara de sa voix tonnante :
— Vous resterez tous en retenue pour vous apprendre que vous devez étudier au lieu de faire les fous. À vos places !
— Mais, Honorable Maître, protestai-je, je n'ai rien fait et il n'est pas juste que je reste en retenue.
L'Indien tourna vers moi son regard féroce.
— Toi ! toi, tu es pire que les autres. Tu es infirme et inutile mais cela n'empêche pas que tu sois puni pour tes pensées. Tu resteras, comme les autres.
Il ramassa ses papiers épars et je fus désolé de voir que son beau sac de cuir avec la poignée et le bouton brillant qui l'ouvrait avait été éraflé par son contact avec notre sol rugueux. L'Indien le remarqua et grommela :
— On me le paiera cher ! J'en réclamerai un semblable au Potala.
Il monta sur l'estrade, étala ses papiers et lorsqu'il fut installé à sa satisfaction, il commença.
— Ce matin, nous nous sommes interrompus au moment où Gautama déclarait qu'il renonçait à sa vie de luxe et qu'il partait à la recherche de la Vérité. Poursuivons.
"Or, lorsque Gautama quitta le palais du roi son père, il avait l'esprit bouleversé. Il venait de subir un choc terrible en voyant les ravages de la maladie alors qu'il ne savait pas que la maladie existait, en voyant la mort alors qu'il ignorait ce que c'était, et en voyant ensuite la paix, la tranquillité, le bonheur profond. Ayant vu que l'homme paisible et heureux était un moine, il pensait que le contentement et la paix du cœur ne pourraient se trouver que sous l'habit religieux, et ainsi était-il parti à la recherche de cette paix et de la signification de la vie.
"Quittant le royaume de son père il erra longtemps, recherchant les sages et les ermites. Il écouta les leçons des meilleurs Maîtres qu'il put trouver, étudia partout où il y avait quelque chose à apprendre. Une fois qu'un Maître lui avait inculpé tout son savoir il repartait en quête d'autres connaissances, en quête, inlassablement, de la chose la plus précieuse de la Terre — la paix de l'esprit, la tranquillité.
"Gautama était un élève très doué. Favorisé par le destin, il avait l'esprit vif, l'intelligence aiguë. Il retenait tout, triait ses connaissances et repoussait ce qui lui semblait inutile pour ne garder que ce qui paraissait précieux. Un des Grands Maîtres, impressionné par la bonne volonté et l'acuité d'esprit de Gautama, lui demanda de rester auprès de lui pour enseigner aussi. Mais Gautama ne put s'y résoudre, car — raisonna~t-il — comment pourrait-il enseigner ce qu'il ne comprenait pas encore ? Comment pourrait-il donner des leçons à d'autres alors qu'il recherchait encore la Vérité ? Il connaissait les Écritures, les Commentaires des Écritures, mais si les Écritures apportaient une certaine paix, il y avait encore et toujours des questions et des problèmes qui l'empêchaient d'accéder à cette tranquillité dont il rêvait. Aussi Gautama reprit-il son chemin errant.
"Il était obsédé, poussé par un violent désir de connaître, de découvrir la Vérité, et ce désir l'empêchait de se reposer. Un ermite lui dit que seule une vie ascétique pourrait le conduire à la tranquillité, et Gautama, pourtant impétueux de nature, tenta de devenir un ascète. Depuis longtemps déjà, il avait renoncé à tous les biens matériels, à tous les plaisirs et ne vivait que pour la recherche d'une signification de la vie. Mais à présent il s'efforça de manger de moins en moins et, comme le racontent les très vieilles histoires, il finit par ne subsister que d'un grain de riz par jour.
"Il passait tout son temps en méditations, assis immobile à l'ombre d'un banyan. Mais son corps finit par le trahir. Épuisé par le jeûne et la mortification, il faillit succomber. Pendant longtemps il resta entre la vie et la mort, mais aucune lumière ne vint éblouir son esprit, il n'avait toujours pas trouvé le secret de la tranquillité, il n'avait toujours pas trouvé la signification derrière la chose la plus insaisissable sur Terre — la paix de l'esprit, la tranquillité.
"Certains ‘amis’ s'étaient réunis autour de lui pendant ses jours de jeûne, pensant que c'était un miracle, un spectacle, ce moine qui ne vivait que d'un grain de riz par jour ! Ils croyaient qu'en s'associant à un homme aussi extraordinaire, ils en tireraient de grands avantages. Mais comme tous les 'amis' du monde, ils l'abandonnèrent alors qu'il avait besoin d'eux. Alors que Gautama, sans forces, gisait sur le sol et mourait de faim, ils s'en allèrent chercher d'autres distractions. Gautama se retrouva seul, libéré de ses amis, libéré de ses disciples, libre de recommencer à méditer sur la signification de la vie.
"Cet épisode fut le tournant de sa carrière. Pendant des années il avait pratiqué le yoga afin de pouvoir, en mortifiant la chair, libérer son esprit des liens du corps, mais à présent il découvrait que le yoga ne pouvait rien pour lui, ce n'était qu'un moyen de discipliner tant soit peu un corps récalcitrant et ne permettait pas d'accéder à la spiritualité. Il s'aperçut aussi qu'il était inutile de mener une vie aussi austère, car elle ne pourrait que causer sa mort avant qu'il parvînt au terme de ses recherches ou trouvât la réponse aux questions qu'il se posait. Il médita aussi longuement sur ce problème et finit par comprendre que ce qu'il avait fait jusque-là était aussi futile que d'essayer de vider le lit du Gange avec une passoire ou de faire des nœuds avec de l'air.
"Gautama méditait donc, assis sous un arbre, faible et tremblant comme tous ceux qui ont jeûné trop longtemps et qui ont échappé de peu à la mort. Il songeait longuement au malheur et à la souffrance. Ce fut alors qu'il prit la résolution, puisque plus de six ans de quête du savoir ne lui avaient rien apporté, de rester assis et de méditer sans bouger jusqu'à ce qu'il ait découvert la solution.
"Gautama resta assis sous son arbre, le soleil se coucha, la nuit tomba, les bêtes nocturnes sortirent de leurs tanières. Gautama ne bougeait pas. L'aube apparut, le ciel s'éclaircit, et Gautama méditait toujours, sans bouger.
"Toutes les créatures de la Nature avaient été témoins le jour précédent des souffrances de Gautama, épuisé, assis seul sous le grand arbre. Elles le plaignaient, elles le comprenaient et se demandaient comment elles pourraient aider l'humanité à se tirer de l'abîme dans lequel elle était tombée.
"Les tigres cessèrent de rugir afin que leurs cris ne troublent pas la méditation de Gautama ; les singes cessèrent de glapir et de se balancer aux branches des arbres mais s'y assirent, silencieux, pleins d'espoir. Les oiseaux se turent et s'assirent en battant plutôt des ailes dans l'espoir d'aider Gautama en lui envoyant des ondes de tendresse et aussi un peu de vent frais. Les chiens, qui aboyaient et couraient en tous sens, ne firent plus de bruit et allèrent se cacher sous les buissons où les rayons du soleil ne pourraient les brûler. Le roi des escargots, regardant autour de lui, vit les chiens se tapir à l'ombre et pensa que lui et les siens pourraient peut-être aider Gautama. Rassemblant son peuple, le roi des escargots le conduisit vers Gautama, le fit lentement glisser sur son dos, sur sa nuque, et se réunir sur sa tête rougie par le soleil afin de la protéger et de la tenir au frais. Jadis les bêtes étaient les amies de l'Homme et ne le craignaient point, et avant que l'Homme ne se conduisît mal et les trahît, le peuple de la Nature se dévouait toujours pour l'aider.
"La journée avança et Gautama restait immobile, assis comme une statue sous son arbre. La nuit tomba de nouveau, et puis, encore une fois, l'aube vint rougir le ciel et le soleil se leva à l'horizon. Mais cette fois il apportait l'illumination de Bouddha. Une pensée frappa Gautama comme la foudre, il avait une réponse, partielle peut-être, aux questions qui le troublaient. Une connaissance nouvelle l'éblouissait, il était devenu soudain ‘L'Éveillé’, ce qui en indien se dit ‘le Bouddha’.
"Son esprit avait été illuminé par ce qui s'était produit durant sa méditation sur le plan astral, il avait acquis une compréhension et il se rappelait ce qu'il y avait vu. Désormais, pensait-il, il serait libéré des malheurs de la vie terrestre, libéré de ce retour éternel sur Terre et du cycle inéluctable de la naissance, de la mort et de la réincarnation. Il avait appris pourquoi l'Homme doit souffrir, ce qui cause la souffrance, sa nature, et comment on pouvait y mettre fin.
"Gautama, à partir de ce moment-là, devint Gautama l'Éveillé, ou, pour employer la phraséologie indienne, Gautama, le Bouddha. Il se remit à méditer pour savoir ce qu'il devait faire. Il avait souffert, il avait étudié, et donc il se demanda s'il devait simplement enseigner ses connaissances aux autres ou s'il devait les laisser trouver d'eux-mêmes par les moyens par lesquels il avait lui-même fait ses découvertes ? Il s'inquiéta : pourrait-on croire les expériences qu'il avait vécues ? Mais il décida que le seul moyen de le savoir était de parler aux autres, de leur raconter la bonne nouvelle de son illumination.
"Il se leva et, emportant un peu d'eau et quelques vivres, il partit pour Bénarès où il espérait retrouver cinq des anciens compagnons qui l'avaient abandonné quand il avait désespérément besoin d'aide — qui l'avaient abandonné quand il avait décidé de renoncer à son jeûne.
"Après un long, très long voyage, car Gautama était encore très affaibli par les privations et marchait lentement, il arriva à Bénarès et retrouva les cinq personnes qu'il cherchait. Il leur parla et leur donna ce qui a traversé l'histoire comme ‘Le Sermon sur la Rotation de la Roue de la Loi’. Il parla à son auditoire de la cause de la souffrance, de la nature de la souffrance, il leur expliqua comment surmonter la souffrance ; il leur parla d'une nouvelle religion que l'on connaît sous le nom de bouddhisme. Le mot ‘bouddhisme’ signifie la religion de ceux qui cherchent à se réveiller."
Bon, me dis-je, Gautama a connu la faim. Mais moi aussi ! Je souhaitais que ce Maître pût être plus compréhensif car nous, les petits, nous n'avions pas grand-chose à manger, nous n'avions guère de temps à nous, et tandis qu'il parlait, parlait inlassablement de sa voix monotone alors que la classe aurait dû être terminée depuis longtemps, nous avions faim, nous étions fatigués, nous en avions assez et nous étions trop las pour comprendre ce qu'il disait et l'importance de son propos.
Le garçon qui avait renversé le Maître indien en jouant à saute-mouton reniflait bruyamment ; peut-être avait-il le nez cassé mais il devait rester assis là, portant de temps en temps un pan de sa robe à son nez pour étancher le sang, en évitant d'exaspérer le Maître. Je me demandai alors : "À quoi bon tout cela ? Pourquoi ces souffrances, pourquoi ceux qui devraient être indulgents, compatissants, et compréhensifs — POURQUOI, au contraire, se comportent-ils de façon sadique ?" Je me promis, dès que mon Guide serait de retour, d'étudier plus profondément ces problèmes qui me troublaient. Cependant, je constatai avec plaisir que le Maître indien paraissait fatigué, affamé, assoiffé ; il était debout, et se dandinait d'un pied sur l'autre. Nous étions assis par terre, les jambes croisées (sauf moi) bien en rangs. Les autres Maîtres faisaient le tour de la classe, passaient derrière nous, si bien que nous ne savions jamais d'où on nous observait, mais cet Indien restait sur l'estrade et regardait de temps en temps par la fenêtre, comme pour voir s'allonger les ombres du soir, et passer les heures. Il prit enfin une décision, se redressa et nous déclara :
— C'est bon. Vous aurez votre récréation. Je vois que vous ne m'écoutez plus, que votre attention s'égare et ne comprend plus mes paroles, des paroles qui peuvent influer sur votre vie actuelle et toutes vos vies pour des éternités à venir. Nous allons nous reposer pendant une demi-heure. Vous pourrez aller vous alimenter et puis vous reviendrez ici tranquillement, sans faire les fous, et je reprendrai mon cours.
Il fourra rapidement ses papiers dans son sac de cuir, puis il sortit, dans un envol de robe jaune. Nous étions tous un peu sidérés par ce départ soudain et nous restâmes pétrifiés. Et puis les autres se relevèrent avec alacrité tandis que je me mettais péniblement debout. J'avais les jambes raides et je dus m'appuyer au mur pour ne pas tomber. Ce fut en me soutenant ainsi que je gagnai le domaine du brave moine-cuisinier et lui expliquai comment moi, pauvre innocent, j'étais puni pour les méfaits des autres. Il me rit au nez.
— Ah ! Mais que penses-tu donc de ce jeune garçon qui jetait des cuillerées de suie sur la tête des moines ? N'était-ce pas un méfait ? Ton Karma te rattrape, il me semble. Et dis-moi... Si tes jambes n'étaient pas malades, n'aurais-tu pas été le chef de file des joueurs ?
Il se moqua de moi gentiment et puis il me dit avec douceur :
— Va, sers-toi ! Tu n'as pas besoin de moi, tu as toujours su te servir toi-même ! Mange bien et retourne vite en classe avant que cet homme affreux se mette encore en colère.
Je pris donc mon repas, le même que j'avais pris au petit déjeuner, et au déjeuner — de la tsampa. La tsampa ! Pendant des années je ne mangerais rien d'autre !
Au Tibet, nous n'avions ni montres ni pendules. Je n'imaginais pas qu'il pût exister des montres-bracelets. Mais nous savions toujours l'heure, instinctivement. Les personnes qui doivent dépendre uniquement d'elles-mêmes et ne sont aidées par aucun moyen mécanique ont des pouvoirs différents. Ainsi mes camarades et moi pouvions estimer le passage du temps avec autant de précision que ceux qui portent des montres. Bien avant la fin de la demi-heure, nous regagnâmes notre salle de classe, prudemment, silencieusement, comme les souris qui s'engraissaient avec notre orge dans les garde-manger.
Nous entrâmes en rangs, bien en ordre, tous sauf le garçon qui saignait du nez. Il était allé à l'infirmerie, le pauvre, où l'on constata qu'il avait le nez cassé et où on le garda. On m'avait confié pour mission de présenter au Maître de l'Inde un bâton fendu au bout duquel on avait inséré un morceau de papier portant la raison pour laquelle le garçon — maintenant un patient — ne pouvait assister à la leçon.
Les autres s'assirent et nous attendîmes ; je restai debout, adossé au mur, mon bâton à la main et je l'agitais distraitement en regardant le morceau de papier bruissant. Soudain, le Maître indien apparut, nous examina tous en fronçant les sourcils et se tourna enfin vers moi, plus furieux encore.
— Toi, petit... Toi ! Que fais-tu là, à jouer avec ce bâton ?
— Maître, répondis-je non sans inquiétude, c'est un message de l'Infirmier.
Je lui tendis le bâton ; il le regarda fixement, comme s'il ne savait ce qu'il devait en faire, et puis il me l'arracha des mains brusquement, en détacha le papier et le lut. Sa figure s'assombrit. Furieux, il froissa le papier, le roula en boule et le jeta dans un coin, un délit grave pour nous autres Tibétains, car chez nous le papier était sacré ; c'était grâce au papier que nous pouvions lire, apprendre l'histoire, et cet homme, ce Sage venu de l'Inde, avait jeté avec mépris le papier sacré.
— Eh bien ! Pourquoi me regardes-tu ainsi bouche bée ! glapit-il.
Je ne pouvais m'empêcher de le dévisager, car je ne comprenais pas du tout son attitude. Je me dis que si c'était ainsi que se comportait un Maître je ne voulais certes pas en devenir un. Il me fit signe de m'asseoir. Sur quoi il retourna à l'estrade et reprit la parole :
"Gautama, poursuivit-il, avait découvert un moyen différent pour atteindre la réalité des choses, un chemin appelé ‘La Voie du Milieu’. Sans aucun doute, les expériences de Gautama avaient été doubles : prince de naissance, élevé dans le maximum de luxe et de confort, mangeant à sa faim et buvant à sa soif, entouré de belles danseuses lascives (le regard du Maître se fit nostalgique !), il avait connu ensuite la pauvreté la plus atroce, les souffrances, les privations et avait côtoyé la mort. Mais comme Gautama le comprit bien vite, ni les richesses ni les privations ne pouvaient apporter la clef à l'éternel problème de l'Homme. La réponse devait donc se trouver entre les deux.
On considère souvent le bouddhisme comme une religion mais ce n'en est pas une, au sens propre du terme. Le bouddhisme est un mode de vie, un code de vie par lequel, à condition que l'on suive le code précisément, certains résultats peuvent être obtenus. Par commodité le bouddhisme peut être appelé une ‘religion’, bien que pour ceux d'entre nous qui sommes de véritables prêtres bouddhistes, le mot ‘religion’ soit erroné, le seul terme étant ‘La Voie du Milieu’.
Le bouddhisme a été fondé à partir des Enseignements de la religion hindoue. Les philosophes hindoue et les Maîtres religieux ont enseigné que le chemin de la connaissance de soi, la connaissance de l'esprit, et des tâches confrontant l'humanité, était semblable au fil d'un rasoir ; il fallait marcher droit sous peine de tomber d'un côté ou de l'autre.
Gautama connaissait par cœur toutes les Écritures des Hindous car c'était ainsi qu'il avait été instruit. Mais grâce à sa persévérance il découvrit une Voie du Milieu.
L'extrême abnégation est mauvaise, elle conduit à une distorsion de point de vue ; l'indulgence extrême est tout aussi mauvaise, car elle conduit tout autant à un point de vue déformé. On peut, avec profit, comparer ces conditions à celles d'un instrument que l'on accorde. Si l'on persiste à tendre les cordes d'un instrument, une guitare par exemple, il vient un moment où cette corde atteint le point de rupture, ce qui fait que la touche la plus légère la fera céder, et il y a donc, dans ce resserrement excessif, un manque d'harmonie.
Si l'on relâche toute tension des cordes de l'instrument, on s'aperçoit encore d'un manque d'harmonie ; on ne peut obtenir l'harmonie que quand les cordes sont correctement et bien rigidement accordées. C'est ainsi qu'il en est pour l'humanité où l'indulgence ou l'excès de souffrance provoquent un manque d'harmonie.
Gautama formula la croyance en la Voie du Milieu et mit au point les préceptes permettant d'atteindre le bonheur, car un de ses dictons fut : ‘Celui qui cherche le bonheur peut le trouver, s'il pratique la recherche’.
Une des premières questions qu'une personne se pose c’est : ‘Pourquoi suis-je malheureux ?’ C'est la question la plus fréquemment posée. Gautama le Bouddha se demanda pourquoi il était malheureux ; il réfléchit, et réfléchit, pensa à la chose, y pensa en en faisant tout le tour. Il en vint à la conclusion que même un nouveau-né souffre, un nouveau-né pleure à cause de l'épreuve de la naissance, à cause de la douleur et du manque de confort en naissant et en quittant le monde confortable qui était le sien. Quand les bébés sont mal à l'aise ils pleurent, et en grandissant ils peuvent ne pas pleurer, mais ils trouvent toujours d'autres moyens pour exprimer leur mécontentement, leur manque de satisfaction, et leur douleur même. Mais un bébé ne se demande pas pourquoi il pleure ; il pleure tout simplement, il réagit tout simplement comme un automate. Certains stimuli feront pleurer une personne, d'autres stimuli la feront rire, mais la souffrance — la douleur — ne devient un problème que quand une personne se demande pourquoi elle souffre, pourquoi elle est malheureuse ?
Les recherches ont révélé que la plupart des gens ont souffert dans une certaine mesure avant d'avoir dix ans et qu'ils se sont demandé pourquoi ils avaient eu à souffrir. Mais cela ne pouvait s'appliquer à Gautama, car ses parents avaient tout fait pour le protéger des duretés de la vie, et il avait déjà trente ans lorsqu'il sut ce qu'était la souffrance. Les gens qui ont été surprotégés et trop gâtés ne savent pas ce que c'est que de faire face au malheur, de sorte que quand le malheur finit par s'imposer à eux, ils ne sont pas dans une position pour l'affronter et sombrent souvent dans la dépression nerveuse ou mentale.
Toute personne à un moment donné doit faire face à la souffrance et faire face à la raison de la souffrance. Toute personne doit endurer la douleur physique, ou mentale, ou spirituelle, car sans la douleur il ne pourrait y avoir sur la Terre aucun apprentissage, il ne pourrait y avoir aucune purification ou de nettoyage de la crasse qui entoure à présent l'esprit de l'Homme.
Gautama ne fonda pas une nouvelle religion ; tous ses enseignements, tout ce qu'il a apporté à la somme des connaissances humaines concernent uniquement le problème de la douleur et du bonheur. Durant sa méditation, tandis que les créatures de la nature se taisaient afin de ne pas le troubler et que les escargots protégeaient sa tête des rayons du soleil brûlant, Gautama comprit la douleur, comprit la raison de la souffrance, et en vint à croire qu'il savait comment la souffrance pourrait être surmontée. Il enseigna ces choses à ses cinq compagnons, et ses enseignements devinrent les quatre principes sur lesquels repose toute la structure bouddhique. Ce sont les Quatre Nobles Vérités, dont nous reparlerons plus tard."
Les ombres s'allongeaient, la nuit tombait, si rapidement que nous ne pouvions plus voir nos plus proches camarades. Le Maître venu de l'Inde parlait toujours, cependant, oubliant que nous devions nous lever à minuit pour les prières de l'aube, oubliant que nous devrions nous relever pour l'office de 4 heures, et encore une fois à 6 heures du matin. Peut-être s'en moquait-il.
Il finit quand même par être fatigué lui-même, par s'apercevoir qu'il faisait nuit et sans doute pensa-t-il qu'il perdait son temps puisque nous ne pouvions plus le voir et que lui-même ne savait si nous l'écoutions ou si nous dormions.
Soudain il abattit ses deux mains sur le lutrin, et le bruit nous fit sursauter. Il nous contempla pendant quelques instants, puis il sortit de la salle. Je me dis qu'il avait bien de la chance ; il pouvait aller se reposer si cela lui plaisait, il bénéficiait des privilèges de son état, personne n'oserait jamais rappeler à l'ordre un Maître venu de loin. Mais nous devions aller au Temple, pour l'office du soir.
Nous nous relevâmes péniblement, les membres ankylosés, et nous sortîmes de la classe sombre pour suivre le corridor obscur. Jamais nos cours ne duraient aussi longtemps, aussi n'avait-on pas prévu de lumière ; cependant, nous connaissions bien nos corridors et nous les suivîmes à tâtons jusqu'au grand couloir central où brûlaient en permanence les lampes à beurre vacillantes que deux moines étaient chargés de moucher et de remplir.
Arrivé dans le dortoir, je me jetai sur le sol tout habillé, afin d'essayer de dormir un peu avant d'être réveillé par les trompettes et les conques nous appelant pour l'office de minuit.
Chapitre Quatre
ACCROUPI au pied de l'énorme parapet, je me faisais aussi petit que possible tout en m'efforçant de regarder par une minuscule ouverture. Mes jambes étaient atrocement douloureuses et j'avais l'impression qu'un feu les brûlait et que le sang allait surgir soudain. Mais il FALLAIT que je reste là, il FALLAIT que je supporte mes souffrances et ma terreur, tandis que je contemplais l'horizon lointain. Ici, j'étais presque sur le toit du monde ! Je n'aurais pu monter plus haut sans ailes ou — l'idée me séduisait — sans être emporté par un puissant cerf-volant. Le vent hurlait et tourbillonnait, faisait claquer les Drapeaux de Prière, gémissait sous les toits des Tombes d'Or et chassait en pluie la fine poussière des montagnes sur ma tête nue.
Ce matin-là, à l'aurore, je m'étais glissé hors du dortoir, le cœur battant, prenant des couloirs et des escaliers peu fréquentés, m'arrêtant à chaque pas pour tendre l'oreille au moindre bruit, et j'étais à présent sur le Toit Sacré, le Toit où seul le Grand Initié et ses très proches amis avaient le droit de monter. Il y avait du DANGER, ici. Je tremblais de peur en y songeant. Si j'y étais surpris, je serais chassé, expulsé de l'Ordre, disgracié. Expulsé ! Pris de panique, je fus sur le point de redescendre vers les bas étages, à ma place. Mon bon sens me retint. Ce serait vraiment un échec que de redescendre tout de suite, alors que ma mission n'était pas accomplie.
Disgracié ? Que FERAIS-je alors ? Je n'avais plus de foyer, mon père m'en avait chassé en disant que je devais à présent vivre comme je l'entendais. Mon regard éperdu aperçut soudain le scintillement de la Rivière Heureuse, chercha le passeur et son bateau de peaux de yak, et je repris mes sens. VOILÀ ce que je ferais ! Je serais batelier. Afin de me mettre à l'abri, je glissai le long du Toit d'Or, pour me cacher au cas où le Grand Initié s'y aventurerait par ce vent violent. Mes jambes me soutenaient à peine, la faim crispait mon estomac. Un crépitement de pluie résolut un de mes problèmes ; je me penchai et lapai l'eau d'une petite mare qui venait de se former.
Ne viendrait-il donc JAMAIS, lui ? Anxieux, je scrutai l'horizon... Oui ! Je me frottai les yeux mais je ne m'étais pas trompé. Il y avait bien un nuage de poussière ! Venant de Pari ! J'oubliai mes jambes douloureuses, le danger que je courais si j'étais surpris sur le toit. Je me mis debout et fixai l'horizon. Tout au loin un petit groupe de cavaliers descendait vers la Vallée de Lhassa. La tempête faisait rage et le nuage de poussière de la petite caravane était emporté dès qu'il se formait. Clignant des yeux, je voulais tout voir.
Le vent pliait les arbres, des feuilles voletaient follement, rasaient le sol et se laissaient emporter vers l'inconnu. À côté du Temple du Serpent, le lac avait perdu sa placidité ; des vagues bouillonnantes allaient se briser sur la berge éloignée. Les sages oiseaux, habitués à ces brusques tempêtes, cherchaient un abri. Les drisses des Drapeaux de Prière claquaient contre les mâts tandis que les énormes trompettes fixées sur le toit en dessous hululaient lugubrement. Ici, sur la partie la plus élevée du Toit d'Or, je pouvais sentir les tremblements, les grattements étranges, et les brusques rafales de poussière ancienne chassée des chevrons plus bas.
J'éprouvai soudain comme un pressentiment et me retournai, juste à temps pour voir une forme noire, fantomatique, se ruer sur moi. Des bras poisseux m'enlacèrent, m'étouffèrent, me frappèrent. Je ne pouvais pas crier — j'avais le souffle coupé ! Un nuage noir nauséabond m'enveloppa, dont l'odeur me souleva le cœur. Pas de lumière, une obscurité hurlante, et l'ODEUR ! Pas d'air, rien que ce gaz nauséabond !
Je frémis. J'étais puni pour mes péchés ! Un Esprit Mauvais venait de m'attaquer et cherchait à m'emporter. "Ah ! marmonnai-je, POURQUOI ai-je désobéi à la Loi et suis-je monté sur le Toit Sacré ?" Et puis ma colère prit le dessus. Non ! Je ne me laisserais PAS emporter par les Démons ! J'allais me battre et BATTRE absolument n'importe qui ! Frénétiquement, de panique aveugle et colère furieuse, je donnai de terribles coups de poing, arrachant de grands lambeaux de peau au ‘Diable’. Le soulagement m'inonda et j'éclatai d'un rire aigu de quasi-hystérie. Ce qui m'avait fait si peur, c'était une vieille, très vieille tente de peau de chèvre que le vent avait chassée vers moi. À présent, en lambeaux, elle repartait sur les ailes du vent, vers Lhassa !
Cependant, la tempête se calmait, mais pas avant d'avoir eu le dernier mot. Dans un rugissement de triomphe, une rafale me fit glisser sur le toit. Mes mains affolées cherchèrent en vain une prise, j'essayai de me cramponner plus fermement au toit, mais sans succès. Je me retrouvai tout au bord, vacillai, vacillai, et tombai avec la légèreté d'une plume dans les bras d'un vieux moine ébahi qui me regarda bouche bée tandis que j'apparaissais — lui sembla-t-il — venant du ciel lui-même, porté par le vent !
Comme toutes les tempêtes de Lhassa, celle-ci se calma d'un coup ; le vent soufflait maintenant avec tendresse et jouait avec les trompettes qu'il faisait rire. Dans le ciel, les nuages se poursuivaient toujours aussi follement, emportés par lambeaux par-dessus les montagnes. Je n'éprouvais cependant pas ce ‘calme’ après la tempête, loin de là ! ATTRAPÉ ! murmurai-je en moi-même. ATTRAPÉ comme le plus grand imbécile de la lamaserie. Maintenant il me faudrait bien devenir batelier ou bien conduire des troupeaux de yaks. J'étais maintenant RÉELLEMENT perdu !
— Seigneur, murmurai-je d'une voix chevrotante, grand lama Gardien des Tombes, j'étais...
— Mais oui, mais oui, mon fils, j'ai tout vu, assura le vieux lama d'une voix apaisante. Je t'ai vu être soulevé du sol par la tempête. Tu es béni des Dieux !
Je le regardai avec stupéfaction. Il me serrait toujours dans ses bras — trop suffoqué pour faire un geste, mais il se ressaisit et me posa par terre avec douceur. Je me retournai, pour regarder dans la direction de Pari. Mais je ne pouvais plus les voir. Sans doute s'étaient-ils arrêtés... je...
— Honorable Gardien ! glapit une voix. Avez-vous vu cet enfant volant par-dessus la montagne ? Les Dieux l'ont emporté, paix à son âme !
J'aperçus alors, sur le seuil d'une alcôve, un vieux moine à l'esprit simple que l'on appelait Timon. C'était un de ceux qui balayaient les Temples ; il s'occupait des petites corvées. Nous étions de vieux amis. Il me reconnut soudain et ouvrit de grands yeux étonnés.
— Que notre sainte mère Dolma te protège ! s'exclama-t-il. C'était donc toi !!! Il y a quelques jours, la tempête t'a fait tomber du toit et aujourd'hui une autre rafale de vent t'y rejette. C'est un miracle, vraiment !
— Mais j'étais...
Le vieux Lama me coupa la parole :
— Oui, oui ! Nous savons, nous avons tout vu ! Puisque c'est une de mes tâches, je suis venu voir si tout était bien, et tu T'ES ENVOLÉ SUR LE TOIT DEVANT MES YEUX !
Je fus un peu chagriné. Ainsi, une vieille tente de peau de chèvre pouvait être prise pour MOI ! "Oh, après tout, me dis-je, qu'ils pensent ce qu'ils veulent." Et puis je pensai soudain à ma terreur, à l'impression que j'avais eue de lutter contre des esprits mauvais. Prudemment, je regardai autour de moi pour chercher les lambeaux de la vieille peau de bique. Mais en me débattant je l'avais mise en lambeaux, et le vent avait emporté les morceaux.
— Regardez ! Regardez ! glapit Timon. Voilà la preuve ! REGARDEZ-LE !
Il me montrait du doigt. Je baissai les yeux et m'aperçus qu'une des drisses des Drapeaux de Prière s'était enroulée autour de ma taille et que mes doigts se crispaient encore machinalement sur un lambeau de fanion. Le vieux lama se mit à rire, à rire, et voulut m'entraîner. Mais poussé par je ne sais quel désir, je le retins et me dégageai pour courir au parapet et regarder vers la montagne dans l'espoir d'apercevoir mon Guide bien-aimé, le lama Mingyar Dondup. Mais l'horizon était à présent complètement bouché par la tempête furieuse qui venait de nous quitter pour aller balayer les vallées et les flancs des montagnes. Je ne vis que des tourbillons de poussière, de feuilles mortes et de débris, parmi lesquels, certainement, les lambeaux de la vieille tente de peau de chèvre.
Le vieux Gardien des Tombes revint sur ses pas pour se pencher au parapet, avec moi.
— Oui, assurément, dit-il. Je t'ai vu t'élever de l'autre côté de ce mur, tu volais sous mes yeux, porté par le vent, et puis je t'ai vu retomber du plus haut sommet du Toit d'Or sacré ; je t'ai vu lutter contre la rafale et j'ai eu si peur que j'ai mis mes mains sur mes yeux.
Je m'en félicitai, certes, car sans cela il m'aurait vu me débattre avec la vieille peau de chèvre et il aurait bien compris que je n'avais pas été emporté sur le toit par le vent mais que j'y étais monté de moi-même, au mépris de toutes les règles. Et j'aurais eu alors bien des ennuis.
Lorsque nous descendîmes enfin, nous vîmes un groupe de lamas et de moines parlant avec animation de ce qu'ils avaient vu. Ils étaient tous certains que j'avais été soulevé de terre alors que je me trouvais sur le bas chemin, ils m'avaient vu voler en battant des bras et ils avaient été sûrs que j'irais m'écraser contre la muraille ou que je serais emporté bien loin, par-dessus les toits du Potala ; ils n'espéraient pas me revoir en vie. Pas un seul d'entre eux n'avait pu discerner, dans la poussière tourbillonnante et le vent violent que ce n'était pas moi qui étais emporté, mais simplement un lambeau de vieille peau de chèvre.
— Je l'ai vu de mes yeux ! s'exclama un moine. Il était là, il cherchait à s'abriter du vent derrière un buisson et soudain... le vent l'emporta et il vola au-dessus de moi les bras écartés. Je n'ai jamais rien vu de pareil !
— Parfaitement, affirma un autre moine. Je regardais par la fenêtre, me demandant ce que signifiait tout ce bruit, et soudain je vis ce garçon volant vers moi. Et puis la poussière m'aveugla.
— Ce n'est rien ! cria un troisième homme. Il m'a frappé ! Il a failli m'assommer. J'étais sur le rempart quand le vent l'a jeté sur moi, j'ai voulu le saisir mais il a été emporté alors qu'il saisissait ma robe pour se retenir. Il l'a remontée par-dessus ma tête et pendant quelques instants je n'ai rien vu. Je me suis dit que son heure était venue, mais je constate à présent qu'il est toujours parmi nous.
On me passa de main en main, comme si j'étais une statue de beurre primée. Les moines me palpèrent, les lamas me réconfortèrent, et aucun ne me permit d'expliquer que je n'avais PAS été projeté sur le toit par le vent mais que, au contraire, j'avais failli en être EMPORTÉ.
— Un miracle ! s'écria un vieillard.
— Attention ! Voici le Père Abbé ! dit une autre voix ; sur quoi tout le monde s'écarta respectueusement pour faire place à l'imposante silhouette revêtue d'or.
— Que se passe-t-il ? Pourquoi êtes-vous rassemblés ainsi ?
Il se tourna vers le plus ancien des lamas.
— Expliquez-moi !
Tout le monde se mit à parler en même temps mais finalement l'affaire fut ‘expliquée’. J'étais dans mes petits souliers, j'aurais voulu voir la terre s'ouvrir sous mes pieds pour me précipiter dans les sous-sols... à la cuisine ! J'étais affamé, car je n'avais rien mangé depuis la veille.
— Viens, ordonna le Père Abbé.
Le vieux lama me prit par le bras et me soutint car j'étais fatigué, effrayé, j'avais mal et j'avais faim. Il me conduisit dans une vaste salle que je ne connaissais pas encore. Le Père Abbé s'assit et réfléchit à ce qu'on lui avait raconté. Puis il pria le vieux lama de lui répéter ce singulier miracle, sans rien omettre. Une fois de plus, j'entendis le récit de mon vol miraculeux, depuis la terre jusqu'au Tombeau du Saint Homme. À ce moment précis, mon ventre se rappela à moi en grondant bruyamment. Notre Père Abbé retint un sourire.
— Emmenez-le, il doit avoir faim après une telle épreuve. Et puis l'Honorable Lama Herboriste Chin l'examinera pour voir s'il est blessé. Mais qu'il mange avant tout.
De la nourriture ! Que c'était BON !
— Tu connais vraiment des hauts et des bas, observa mon ami le moine-cuisinier. D'abord le vent te précipite du toit sur la montagne, et voilà qu'à présent tu es soulevé des rochers et emporté sur le toit ! Des hauts et des bas, et que le Diable aille y reconnaître les siens !
Il partit en riant de sa propre plaisanterie. Je n'étais certes pas fâché par ses moqueries, car il avait toujours été bon pour moi et m'avait aidé en toutes circonstances dans la mesure de ses moyens. Un autre ami vint me rendre visite ; un ronron rauque, une tête dure contre mes jambes me firent baisser les yeux. Un des chats venait réclamer des caresses. Distraitement, je lui grattai le crâne et il ronronna de plus belle. Mais un faible bruit, dans les alcôves à grain, le fit détaler comme une flèche.
J'allai à la fenêtre et contemplai la route de Lhassa mais je ne pus distinguer la petite caravane du Lama Mingyar Dondup, mon Guide. Avait-elle été surprise par la tempête ? Je me demandai si j'allais l'attendre longtemps encore.
— ... demain alors ?
Je me retournai. Un des éternels oisifs qui passaient leur temps à la cuisine venait de dire quelque chose mais je n'avais entendu que la fin de son propos.
— Oui, dit un autre. À ce qu'on dit ils sont restés à la Barrière de Roses et ne rentreront que demain.
— Ah ! m'exclamai-je. Vous parlez de mon Guide ? Le Lama Mingyar Dondup ?
— Parfaitement. Il semble que nous ayons à te supporter un jour de plus, Lobsang. Au fait, je crois que l'Honorable Infirmier t'attend et tu ferais bien de te dépêcher !
Je partis, traînant les pieds, en pensant que la vie était dure et pleine de soucis. Pourquoi mon Guide devait-il interrompre son voyage et rester à la Lamaserie de la Barrière de Roses pendant un jour, peut-être deux ? Il faut dire que j'étais bien jeune et que je pensais que seules mes affaires avaient de l'importance ; je ne me rendais pas très bien compte de tout ce que faisait pour les autres le Lama Mingyar Dondup. J'arrivai enfin à l'infirmerie, au moment où l'Infirmier en sortait. Il me saisit par le bras.
— Qu'as-tu encore fait ? Chaque fois que tu viens au Potala, il faut qu'il t'arrive quelque chose !
De mauvaise grâce, je lui racontai ce que tous les témoins avaient dit mais je me gardai bien d'avouer que j'étais sur le Toit d'Or car, j'en étais sûr, il irait immédiatement me dénoncer au Grand Initié.
— Bon, bon, enlève ta robe, nous allons voir ça.
Je me déshabillai, l'Infirmier se pencha sur moi et m'examina, tâtant ici, massant là, pour voir si je n'avais rien de cassé. Il fut assez étonné de constater qu'à part mes jambes déjà blessées je n'étais guère que meurtri, couvert d'ecchymoses bleues virant au jaune !
— Tiens, prends ceci, me dit-il en me tendant un bocal de cuir plein d'une pommade nauséabonde. Et ne te masse pas ici, je n'ai pas envie de suffoquer. Ce sont tes meurtrissures, après tout.
— Honorable Infirmier, est-il vrai que mon Guide soit obligé de s'arrêter à la Lamaserie de la Barrière de Roses ?
— Oui. Il doit soigner l'abbé et je ne pense pas qu'il puisse arriver avant demain, dans la soirée. Alors nous allons être obligés de te supporter un peu plus longtemps. Tu auras ainsi l'occasion de bénéficier des cours de notre visiteur, le Maître venu de l'Inde, ajouta-t-il avec un sourire sournois.
J'eus l'impression que notre vieil Infirmier n'aimait pas plus que moi ce Maître indien. Cependant, je n'avais pas le temps de lui en parler car le soleil annonçait qu'il était midi et il était temps pour moi de rentrer en classe.
J'allai d'abord au dortoir où j'ôtai de nouveau ma robe pour m'enduire de cette embrocation puante. Je m'essuyai les mains sur un pan de ma robe, la remis et me rendis à la salle de classe où je m'assis le plus loin possible de l'estrade.
Les autres garçons — petits, moyens et grands — entrèrent, s'entassant comme des sardines parce que ceci était un événement spécial, la visite d'un éminent Professeur indien, et l'on pensait que nous, les garçons, gagnerions à entendre parler du Bouddhisme venant d'une autre culture.
Au bout de quelques instants ceux qui étaient assis près de moi se mirent à renifler bruyamment et s'écartèrent peu à peu, si bien que lorsque le Maître arriva j'étais assis contre le mur dans une splendide solitude, une douzaine de pieds (3,6 m) au moins me séparant d'un demi-cercle de garçons.
Le Maître indien entra, portant son beau sac de cuir, et renifla aussi. Au milieu de la salle, il regarda autour de lui et s'aperçut que j'étais seul dans mon coin. Il vint vers moi mais s'arrêta net et recula ; il faisait chaud, et ma pommade empestait de plus en plus.
— Mon garçon, me dit le Maître en fronçant ses sourcils redoutables, je crois bien que tu es le plus grand fauteur de troubles de ce malheureux pays. Tu bouleverses nos croyances en volant du haut et du bas du versant d'une montagne. J'ai tout vu de mes propres yeux, je t'ai vu t'envoler dans le lointain. Tu dois prendre des leçons du diable à tes moments perdus, ou je ne sais quoi. Et maintenant — pouah ! — TU EMPESTES !!
— Honorable Maître venu de l'Inde, répondis-je, ce n'est pas ma faute, je me suis simplement enduit de la pommade que m'a donnée l'Honorable Infirmier et, ajoutai-je avec grande hardiesse, c'est bien pire pour moi parce que ça s'évapore de ma personne.
Pas même l'ombre d'un sourire n'effleura ses lèvres ; il me tourna le dos d'un air méprisant et monta sur l'estrade.
— Allons, dit-il, reprenons notre cours et finissons-en vite, car je serai heureux de vous quitter pour regagner mon pays plus civilisé.
Il étala ses papiers, nous examina tous pour voir si nous l'écoutions et reprit l'histoire où il l'avait interrompue :
— Gautama avait beaucoup médité pendant ses voyages. Il avait erré pendant six ans, passant le plus clair de son temps en quête de la Vérité, à la recherche de la Vérité, cherchant ce qu'était le but de la vie. Il souffrit de la faim, des privations, et une de ses premières questions était : ‘Pourquoi suis-je malheureux ?’
"Gautama cherchait inlassablement une réponse à cette question, et elle lui apparut quand les créatures de la Nature vinrent à son aide, les escargots rafraîchissant son crâne, les oiseaux battant des ailes pour l'éventer, toutes les autres bêtes observant le plus parfait silence afin de ne pas troubler sa méditation. Il décida qu'il y avait Quatre Grandes Vérités, qu'il appela les Quatre Nobles Vérités, qui étaient les lois du séjour de l'Homme sur Terre.
"La naissance est souffrance, dit le Bouddha. La naissance cause de la douleur à la mère et de la douleur au bébé ; ce n'est que dans la douleur que l'on peut naître sur cette Terre, et le fait de naître provoque de la douleur et de la souffrance aux autres. La décrépitude est souffrance ; en vieillissant, comme les cellules du corps d'un homme ne peuvent pas se reconstituer suivant la configuration familière, la décrépitude s'installe, les organes ne fonctionnent plus correctement, le changement prend place, et il y a de la douleur. On ne peut pas vieillir sans souffrir. La maladie est souffrance ; avec la défaillance d'un organe vient la douleur, la souffrance, l'organe obligeant le corps à s'adapter à une nouvelle condition. C'est donc pourquoi la maladie suscite la douleur et la souffrance. La mort met fin à la maladie ; la mort suscite la souffrance, non pas l'acte de mourir lui-même, mais les conditions qui entraînent la mort sont en elles-mêmes douloureuses. Par conséquent, nous sommes malheureux.
"La souffrance est causée par la présence d'objets que nous détestons. Nous sommes tendus, frustrés, horripilés par la présence de ceux que nous n'aimons pas. Nous sommes malheureux quand nous sommes séparés des objets de notre amour ; quand nous sommes séparés d'un être cher, peut-être sans savoir quand nous pourrons de nouveau être ensemble, nous souffrons, nous sommes frustrés, ce qui fait que nous sommes malheureux.
"Désirer, et ne pas obtenir ce que nous désirons, est la cause de la souffrance, est la cause de la perte du bonheur, la cause de la misère. C'est donc ainsi que le fait de désirer et de ne pas obtenir nous fait plutôt souffrir et nous rend malheureux.
"La mort seule apporte la paix, la mort seule délivre de la souffrance. Il est donc évident qu'en se cramponnant à l'existence on se cramponne à la souffrance, et se cramponner à l'existence est ce qui nous rend malheureux.
Le Maître venu de l'Inde nous regarda et nous déclara :
— Le Bouddha, notre Bienheureux Gautama, n'était pas pessimiste mais réaliste. Gautama s'est rendu compte que tant que l'on ne peut accepter les faits, on ne peut pas bannir la souffrance. Tant que l'on ne peut comprendre pourquoi la souffrance existe, on ne peut pas progresser le long de la Voie du Milieu.
Je songeai que les Écritures insistaient beaucoup sur la souffrance, mais je me rappelai les paroles de mon Guide bien-aimé, le lama Mingyar Dondup. Il m'avait conseillé de réfléchir à ce que Gautama avait vraiment dit : "Il ne dit pas que tout cause la souffrance. Qu'importe ce que disent les Écritures, qu'importe ce que disent les Grands Maîtres, à aucun moment Gautama n'a déclaré que tout n'était que souffrance. En réalité il a dit que tout détient la POSSIBILITÉ de souffrance, à partir de quoi il est clair que chaque incident de la vie peut entraîner des douleurs, des sensations pénibles, ou de l'inharmonie. PEUT ! Il n'est dit nulle part que tout DOIT causer de la douleur."
Il y a tellement de malentendus au sujet de ce que les Grands Hommes ont dit ou n'ont pas dit. Gautama avait la conviction que la souffrance, la douleur, allait bien au-delà de la simple souffrance physique, la simple douleur physique. Il insista à tout moment sur le fait que les souffrances de l'esprit dues aux troubles émotionnels étaient une plus grande souffrance, un plus grand déséquilibre, qu'une simple douleur physique ou qu'un mécontentement pouvaient l'être.
Gautama enseigna : "Si je suis malheureux, c'est parce que je ne vis pas heureusement, je ne vis pas en harmonie avec la nature. Si je ne vis pas harmonieusement, c'est parce que je n'ai pas appris à accepter le monde tel qu'il est, avec tous ses désavantages et ses POSSIBILITÉS de souffrance. Je ne puis atteindre le bonheur qu'en comprenant les causes du malheur et en évitant ces causes."
Je songeais à tout cela, et aussi à la puanteur infecte de ma pommade, quand le Maître de l'Inde abattit de nouveau son poing sur son lutrin et dit :
— C'est la Première des Quatre Nobles Vérités. Passons maintenant à la Seconde Noble Vérité.
"Gautama fit son sermon à ses disciples, ceux qui l'avaient précédemment quitté quand beaucoup de ce qui faisait la sensation de l'Enseignement avait disparu, mais qui étaient maintenant redevenus ses disciples. Il leur dit : "Je n'enseigne que deux choses, la souffrance et la délivrance de la souffrance. Voici maintenant la Noble Vérité sur l'origine de la souffrance. C'est la soif insatiable qui provoque le renouvellement des désirs, des envies ; la soif insatiable du désir est accompagnée par les plaisirs sensuels et elle recherche la satisfaction tantôt ici, tantôt là. Elle prend la forme du désir insatiable pour la satisfaction des sens, ou du désir insatiable des richesses et des biens matériels.
"Comme on nous l'a enseigné, la souffrance suit quelque chose de mal que nous avons fait, elle est le résultat d'une mauvaise attitude envers le reste du monde. Le monde en lui-même n'est pas un mauvais endroit, mais certains de ses habitants le font paraître mauvais, et c'est notre propre attitude, nos propres défauts, qui font paraître le monde si mauvais. Chacun a des désirs, ou des envies, ou des convoitises, qui lui font faire certaines choses qui, dans un état d'esprit plus équilibré, libéré de telles envies et convoitises, il ne ferait pas.
"Le Grand Enseignement de Bouddha était que celui qui éprouve une grande envie ne peut pas être libre, et une personne qui n'est pas libre ne peut pas être heureuse. Par conséquent, surmonter ses désirs c'est faire un grand pas en avant vers le bonheur.
"Gautama enseignait que chacun doit découvrir son propre bonheur. Il disait qu'il y a un certain bonheur qui n'apporte pas le contentement, qu'il s'agit simplement d'une chose passagère et c'est le type de bonheur qu'une personne obtient quand elle désire toujours le changement, désire toujours aller ailleurs voir de nouveaux endroits, connaître de nouvelles gens. C'est un bonheur transitoire. Le vrai bonheur est celui qui apporte à la personne un profond contentement, qui libère son âme de l'insatisfaction. Gautama disait : "Quand en poursuivant le bonheur je perçois que les mauvaises qualités se développent et que les bonnes qualités diminuent, alors ce genre de bonheur est à éviter. Quand en poursuivant le bonheur je perçois que les mauvaises qualités diminuent et que les bonnes qualités se développent, ce bonheur-là doit être poursuivi."
"Nous devons, donc, cesser de courir derrière les choses futiles de la chair, les choses qui ne survivent pas dans l'autre monde, nous devons cesser d'essayer de satisfaire les envies qui augmentent au fur et à mesure que nous les alimentons et, au contraire, il nous faut réfléchir à ce que nous recherchons vraiment ; et comment allons-nous y parvenir ? Nous devons réfléchir à la nature de nos envies, à leur cause, et connaissant la cause de nos envies, nous pouvons chercher à supprimer cette cause.
Notre Maître s'interrompit. Il devait être incommodé par l'odeur de ma pommade car il dit :
— Nous allons nous reposer pendant quelques instants car je ne voudrais pas fatiguer votre intellect qui me semble d'un niveau bien plus bas que celui de mes élèves indiens.
Il rassembla ses papiers, les rangea dans son sac de cuir, et sortit en retenant sa respiration quand il passa près de moi. Pendant quelques minutes mes camarades écoutèrent le bruit de ses pas qui s'éloignaient puis l'un d'eux se tourna vers moi en faisant une grimace.
— Tu empestes, Lobsang ! Ce doit être parce que tu as commercé avec les démons pour voler avec eux vers le ciel.
Je répliquai, fort raisonnablement :
— Si j'avais commercé avec des démons, ils ne m'auraient certainement pas transporté au ciel, mais au plus profond des enfers. Or, tout le monde sait que je suis monté dans les airs. On m'a vu.
Ils sortirent de la classe et se dispersèrent tandis que j'allais à la fenêtre, pour me demander ce que mon Guide pouvait bien faire à la Lamaserie de la Barrière de Roses, et comment je passerais le temps avant le retour de ce Maître de l'Inde que je détestais. Je me dis que s'il était aussi bon bouddhiste qu'il le croyait, il serait plus compréhensif et n'oserait tourmenter de jeunes garçons. Comme j'étais plongé dans mes réflexions, un jeune lama entra en trombe et courut vers moi.
— Lobsang ! Viens vite, le Grand Initié veut te voir.
Puis il s'arrêta net et recula en faisant une affreuse grimace.
— Pouah ! Qu'as-tu donc fait pour sentir à ce point ?
Je lui expliquai que l'Infirmier m'avait ordonné de me masser avec une pommade aux herbes.
— Allons vite le voir, me dit-il, pour lui demander s'il connaît un moyen de te débarrasser de cette puanteur avant que tu te présentes devant le Grand Initié. Viens vite !
Chapitre Cinq
NOUS courûmes vers l'infirmerie, ou plutôt le jeune lama s'y précipita tandis que je le suivais péniblement ; il empoigna le devant de ma robe et me tira tandis que je protestais tout bas. Comment ! pensais-je, je suis soulevé de terre et porté sur le toit et tout le monde ose me bousculer ! Puis je me ravisai. Voilà que j'en étais presque à CROIRE moi-même le récit des témoins qui n'avaient rien vu ! Je me demandai ce que pensait le Grand Initié — ou ce qu'il savait !
Je fus traîné vaille que vaille dans le corridor et poussé dans l'infirmerie. L'Infirmier était en train de déjeuner ; il leva les yeux de son bol de tsampa et parut stupéfait de me revoir.
— Encore toi ? Qu'as-tu fait, cette fois ?
Le jeune lama, haletant et anxieux, déversa un flot de paroles.
— Le Grand Initié... Il veut voir Lobsang... TOUT DE SUITE. Que pouvons-nous faire ?
L'Infirmier posa son bol en soupirant et s'essuya les doigts sur sa robe.
— Non seulement il le VERRAIT mais il le SENTIRAIT si je le lui amenais dans cet état, reprit le jeune lama affolé. Que faire ? Que faire ?
L'Infirmier étouffa un rire mais il reprit vite son sérieux en pensant au Grand Initié.
— Aïe ! Ce n'était qu'une plaisanterie. Je voulais essayer un nouvel onguent, et Lobsang était là. Nous nous servons de cette pommade dont nous frottons les murs afin d'empêcher les chiens de s'approcher, mais elle guérit aussi les douleurs. Attends... Laisse-moi réfléchir...
Le jeune lama et moi échangeâmes un regard atterré. Les chiens ! Le vieil Infirmier m'avait fait une farce mais c'était lui qui en pâtissait à présent. Comment pourrait-il me débarrasser de cette puanteur avant que le Dalaï-Lama en fût informé ? Il bondit soudain en claquant des doigts :
— J'ai trouvé ! Déshabille-toi.
Docilement, j'ôtai ma robe tandis que l'Infirmier disparaissait dans un cagibi pour en ressortir quelques secondes plus tard avec un petit seau de cuir plein d'un liquide parfumé avec lequel il m'arrosa.
Je fis un bond ; le liquide était astringent, et je crus que ma peau serait emportée. Saisissant vivement un chiffon l'Infirmier m'essuya en frottant, laissant mon corps rougi et piquant, mais sans odeur.
— Voilà ! s'exclama-t-il avec satisfaction. Tu m'as causé tant d'ennuis qu'un traitement douloureux te découragera peut-être de venir me déranger à tout propos.
Il disparut de nouveau et revint avec une robe propre :
— Rhabille-toi. Nous ne pouvons te laisser te présenter au Grand Initié comme un vagabond.
Je m'habillai tant bien que mal. Le tissu rugueux de la robe accrut mes démangeaisons, mais ni l'Infirmier ni le jeune lama ne s'en soucièrent.
— Vite ! Vite ! dit ce dernier. Ne perdons plus de temps.
Il me saisit par le bras et me traîna vers la porte. Je le suivis à contrecœur, laissant sur les dalles des empreintes de pas parfumées.
— Attends ! cria l'Infirmier. Il lui faut des sandales !
En un éclair il plongea dans son cagibi et reparut avec une paire de sandales. Je les chaussai. Elles étaient deux fois trop grandes.
— Oh non ! m'écriai-je, pris de panique. Je vais les perdre, je vais tomber ! Je veux mes sandales.
— Ah, ce garçon ! grommela l'Infirmier. Tu ne nous causeras donc jamais que des ennuis ? Mais tu as raison, tu ne peux pas tomber en présence du Grand Initié, tu me ferais honte.
Il fouilla et farfouilla et trouva enfin une paire de sandales qui m'allaient presque.
— Et maintenant file ! cria-t-il. Et ne reviens pas à moins que tu ne sois à l'article de la mort !
Il reprit son repas interrompu ; le jeune lama me saisit par le bras en grommelant.
— Seigneur, seigneur, comment vais-je expliquer ce retard ? demanda-t-il comme si j'étais capable de lui donner une réponse.
Nous nous précipitâmes dans le corridor et rencontrâmes bientôt un autre jeune lama.
— Que faisiez-vous ? s'exclama-t-il, exaspéré. Le Grand Initié attend — et il n'aime PAS qu'on le fasse attendre !
Nous n'avions certes pas le temps de lui donner des explications.
Nous nous ruâmes dans les corridors, gravîmes trois étages et arrivâmes enfin, haletants, devant la grande porte gardée par deux surveillants. Reconnaissant les deux lamas, ils s'écartèrent et nous pénétrâmes dans les appartements particuliers du Dalaï-Lama. Soudain, le premier des jeunes lamas s'arrêta brusquement et me poussa contre le mur :
— Ne bouge pas, je dois m'assurer que ta tenue est correcte.
Il m'examina, tira sur un pan de ma robe, arrangea un pli, puis il me fit pivoter, face au mur. Il tira de nouveau ma robe, l'arrangea à sa convenance, la remonta sur mes épaules.
— C'est toi qui a les jambes blessées ? Le Grand Initié le sait. S'il te demande de t'asseoir, fais-le aussi gracieusement que possible. Bon, tu peux te retourner.
Je m'aperçus que l'autre lama était parti. Et nous attendîmes. Nous attendîmes si longtemps que je crus que mes jambes ne pourraient plus me soutenir. Toute cette précipitation, pensai-je, pour attendre ? Ah, POURQUOI fallait-il que je fusse moine ?
Enfin la porte du saint des saints s'ouvrit et un vieux lama apparut. Le jeune lama s'inclina très bas et se retira. Le vieillard me considéra des pieds à la tête et me demanda :
— Peux-tu marcher sans aide ?
— Oui, Saint Maître, mais lentement.
— Viens, alors.
Il me conduisit dans une vaste pièce puis dans un couloir où il frappa à une porte et entra en me faisant signe d'attendre.
— Votre Sainteté, dit-il, le jeune Lobsang est là. Il marche difficilement. L'Infirmier nous dit qu'il a été grièvement blessé et que ses blessures se referment mal.
Je n'entendis pas la réponse, mais le vieux lama sortit et me chuchota :
— Entre, maintenant. Salue trois fois et puis avance. Marche avec prudence, ne tombe pas. Allez, va !
Il me prit le bras et me conduisit jusqu'à la porte.
— Le jeune Lobsang, Votre Sainteté, dit-il avant de refermer la porte derrière moi.
Aveuglé par la terreur, ébloui par l'émotion, je saluai trois fois comme on me l'avait ordonné.
— Viens ! Viens, mon garçon, et assieds-toi ici, me dit une voix grave, chaleureuse.
Je levai les yeux et ne vit d'abord que la Robe Safran que le soleil teignait d'or. La Robe Safran ! J'osai regarder plus haut et je vis un visage bienveillant mais sérieux, la figure d'un être habitué à prendre des décisions, d'un homme profondément BON, celle de notre Dieu sur Terre.
Il était assis sur une petite estrade, soutenu par des coussins écarlates dont la couleur contrastait avec le safran de sa robe, dans la position du lotus, les mains croisées sur les genoux, les pieds recouverts d'un tissu d'or. Devant lui, sur une table basse, il y avait une clochette, une Boîte de Charmes, un Moulin à Prières et des documents. À cette époque, il portait une moustache dont les pointes descendaient plus bas que son menton. Il souriait mais sa figure exprimait aussi la souffrance. Je vis, à côté de la table basse, deux coussins qu'il me désigna en disant :
— Je connais ton infirmité, installe-toi de ton mieux.
Je m'assis avec joie car toute cette précipitation m'avait tant énervé que je tremblais de fatigue.
— Ainsi, me dit Sa Sainteté, il paraît que tu as eu des aventures ? On m'en a beaucoup parlé. Tu as dû avoir grand-peur ?
Je regardai le Dalaï-Lama, le grand homme si sage et si bon, et je compris que je DEVAIS lui dire la vérité. Je serais alors chassé, je m'en doutais, pour avoir enfreint la Loi. Peu importait. Je deviendrais batelier, ou bien je fabriquerais des cerfs-volants ou même — mais cette seule pensée me faisait horreur — je serais marchand et m'en irais en Inde.
Le Grand Initié me regardait fixement et je sursautai en m'apercevant soudain qu'il m'avait parlé.
— Votre Sainteté, dis-je, mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, m'a dit que vous êtes le plus grand homme du monde et je ne puis vous dissimuler la vérité...
Une boule se forma dans ma gorge, que j'avalai avec difficulté, et je poursuivis d'une petite voix anxieuse :
— Votre Sainteté, je me suis levé ce matin à l'aube et suis monté sur le...
— Lobsang ! interrompit le Grand Initié avec un sourire heureux. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qui s'est passé car moi aussi j'ai été petit garçon, oh ! il y a SI longtemps. Je vais donc te demander une chose. Ne parle jamais de cette affaire, ne révèle jamais ce qui s'est RÉELLEMENT passé. Sinon tu seras renvoyé comme l'exige la Loi.
Il s'interrompit et resta plongé dans ses pensées pendant plusieurs minutes, puis il murmura :
— Il est bon, parfois, d'avoir un ‘miracle’ car cela renforce dans leur foi nos Frères plus faibles. Ils ont besoin de ce qu'ils imaginent être une preuve, mais la ‘preuve’ examinée de près s'avère souvent n'être qu'une illusion, tandis que ‘l'Illusion’ pour laquelle une ‘preuve’ a été cherchée est vraiment la Réalité.
Le soleil matinal inondait la pièce de sa lumière dorée. La robe safran du Grand Initié luisait et dansait comme une flamme quand un souffle de vent osait déranger ses plis. Les coussins rouges étaient nimbés, apparemment, et projetaient des reflets rutilants sur le plancher ciré. La brise fit tourner un petit Moulin à Prières et ses ornements de turquoises scintillèrent comme de petits rayons de lumière bleue au soleil. Distraitement, le Grand Initié se pencha et prit le Moulin à Prières qu'il examina pensivement avant de le reposer sur la table.
— Mingyar Dondup, ton Guide et mon Saint Frère, a une très, très haute opinion de toi, me dit Sa Sainteté. Comme tous ceux qui te connaissent bien. Tu as une grande tâche à accomplir et tu seras de plus en plus aidé par ton Guide et par des hommes comme lui, aussi allons-nous te retirer de la classe pour te confier à des précepteurs... Cependant, ajouta le Grand Initié en souriant, il te faudra continuer de suivre les cours de notre visiteur de l'Inde.
J'en fus bien navré ; j'avais entrevu un instant l'espoir d'échapper à cet homme terrifiant, mais le Grand Initié poursuivit :
— Ton Guide arrivera cette nuit ou demain matin de bonne heure, il me fera son rapport, et tu retourneras avec lui à la Montagne de Fer afin d'y poursuivre des études spéciales. Les Sages ont déterminé ton avenir ; ce sera toujours dur, mais plus tu étudieras MAINTENANT, plus grandes seront tes chances, plus tard.
Il me sourit encore en inclinant la tête, puis il se pencha pour saisir la clochette qu'il secoua. Entendant le son cristallin, le vieux lama entra et se prosterna. Je me relevai péniblement, saluai trois fois, sans grâce aucune, serrant un bras sur ma poitrine afin que mon bol et mon sac d'orge ne tombent pas, et sortis à reculons en priant le ciel de ne pas trébucher.
Dans le couloir, appuyé contre le mur, épongeant mon front en sueur, je me demandai CE QUI ALLAIT ENCORE M'ARRIVER. Le vieux lama me souriait — car j'avais été béni par le Grand Initié — et me dit gentiment :
— Voilà une bien longue entrevue pour un aussi petit garçon. Mais tu as plu à Sa Sainteté. Maintenant, il est temps pour toi d'aller manger avant de retourner au Cours de Bouddhisme de notre Visiteur indien. Tu peux aller.
Le jeune lama qui était venu me chercher dans la salle de classe apparut et m'entraîna. Je titubais car cette journée à peine commencée me semblait déjà plus longue qu'une semaine entière.
Je retournai à la cuisine pour mendier un peu de tsampa. Cette fois, je fus traité avec RESPECT. J'avais été reçu par le Grand Initié, et déjà le bruit courait que je lui avais plu ! Je mangeai en hâte et, débarrassé de ma puanteur, tout parfumé, je me rendis à la salle de classe.
Notre Maître était déjà sur l'estrade.
— Nous en venons, disait-il, à la Troisième Noble Vérité, l'une des plus courtes et des plus simples.
"Comme l'a dit Gautama, quand on cesse de désirer ardemment une chose, on cesse d'en souffrir, et ainsi la souffrance cesse avec la cessation complète des désirs ardents.
"L'individu qui désire, convoite généralement le bien d'autrui, il est obsédé par les choses que possède son voisin et, lorsqu'il ne peut les avoir, son ressentiment le pousse à détester ce voisin. Cette attitude provoque la frustration, la colère et la souffrance.
"Si l'on convoite une chose qu'il nous est impossible d'obtenir, on est malheureux. Les actes inspirés par la convoitise rendent un être malheureux. Le bonheur est atteint lorsqu'on cesse de désirer, lorsque l'on prend la vie comme elle vient, le bon et le mauvais à la fois.
L'Indien tourna quelques pages, arrangea ses feuillets, et reprit :
"Nous arrivons à présent à la Quatrième des Quatre Nobles Vérités, qui se divise en huit parties appelées la Sainte Voie des Huit. Il y a huit étapes que l'on peut suivre pour obtenir la libération de la chair, afin d'obtenir la libération des désirs ardents. Je vais vous les exposer. La première est :
"(1) Le Point de Vue Correct : Comme l'a enseigné Gautama, nous devons avoir le bon point de vue quand nous considérons le malheur. Une personne qui se sent misérable ou malheureuse doit découvrir précisément pourquoi elle est misérable ou malheureuse, elle doit s'examiner et découvrir la cause de son malheur. Quand une personne a découvert par elle-même ce qui cause son malheur, cette personne peut alors chercher à atteindre la quatrième des Quatre Nobles Vérités qui est : ‘Comment puis-je trouver le bonheur ?’
"Avant de nous embarquer pour le grand voyage de la vie avec un esprit tranquille et avec l'espoir de mener notre vie comme la vie se doit d'être menée, nous devons connaître ce que sont nos objectifs. Ce qui nous amène à la deuxième étape de la Sainte Voie des Huit :
"(2) Les Aspirations Correctes : Chacun ‘aspire’ à quelque chose, que ce soit à un profit mental, physique ou spirituel. Il se peut que ce soit de venir en aide aux autres, il se peut que ce soit simplement de s'aider soi-même. Mais malheureusement, les êtres humains sont dans un très piteux état, désorientés, confus, incapables de percevoir ce qu'ils devraient percevoir. Nous devons nous dépouiller de toutes les fausses valeurs, de toutes les fausses paroles, et voir clairement ce que nous sommes et ce que nous devrions être, aussi bien que ce que nous désirons. Nous devons renoncer aux fausses valeurs, sources de malheur. La plupart des gens ne pensent que ‘je’, ‘moi’, ‘mien’. La plupart des gens sont trop centrés sur eux-mêmes et n'ont que faire des droits des autres. Il est essentiel que nous nous considérions comme des objets à étudier, que nous nous examinions comme nous examinerions un inconnu. Aimez-vous cet inconnu ? Aimeriez-vous qu'il soit votre ami proche ? Comment aimeriez-vous vivre avec lui pour une durée de vie, manger avec lui, respirer avec lui, dormir avec lui ? Vous devez d'abord avoir les bonnes aspirations pour pouvoir faire un succès de la vie, et par conséquent vous devez avoir :
"(3) La Parole Correcte : Cela signifie qu'une personne doit contrôler ses paroles, ne doit pas répandre de vaines calomnies, ne doit pas propager des rumeurs comme si les rumeurs étaient des faits. Avec la parole correcte on doit toujours donner à l'autre personne le bénéfice du doute, et on doit se taire quand la parole peut nuire à un autre, parler quand la parole est bonne, quand la parole peut aider. La parole peut être plus mortelle que l'épée, la parole peut être plus toxique que le poison le plus venimeux. La parole peut détruire une nation. Ainsi, on doit avoir la parole correcte, et la parole correcte vient de :
"(4) La Conduite Correcte : Si l'on se conduit de façon correcte, on ne parle pas de manière incorrecte. Ainsi, la bonne conduite contribue matériellement à la bonne parole et aux bonnes aspirations.
"La Conduite Correcte signifie qu'une personne ne dit pas de mensonges, ne boit pas d' ‘intoxicants’ (boissons alcoolisées — NdT), ne vole pas.
"Gautama a enseigné que nous sommes le résultat de nos propres pensées. Ce que nous sommes maintenant est le résultat de ce que nous avons pensé dans le passé. Donc, si nous pensons correctement maintenant, si nous nous conduisons correctement maintenant, nous serons ‘corrects’ dans un proche avenir.
"Gautama a dit : ‘La haine ne peut être combattue par la haine. Elle ne peut être vaincue que par l'amour.’ Il a dit aussi : ‘L'homme doit vaincre la colère d'un autre par son amour, il doit vaincre la méchanceté d'un autre par sa propre bonté.’
"Comme on me l'a si souvent appris, on ne doit pas donner de preuves de ses capacités extra-sensorielles, on ne doit pas attaquer ceux qui nous attaquent, car selon les paroles de Gautama, on ne doit pas attaquer ceux qui nous attaquent avec des injures ou avec des bâtons ou des pierres. Gautama a dit : ‘Si quelqu'un te maudit, tu dois renoncer à tout ressentiment et prendre dans ton esprit la ferme résolution de ne pas te laisser troubler et de ne pas prononcer une seule parole de colère. Tu resteras gentil, amical, et sans rancune.’
"Notre foi bouddhiste est celle de la Voie du Milieu, un code de vie, un code qui nous enseigne à faire aux autres ce que l'on voudrait qu'il nous soit fait. Le précepte suivant de la Sainte Voie des Huit :
"(5) Les Méthodes de Subsistance Correctes : Selon les enseignements du Bouddha, certaines occupations étaient nuisibles à un homme, certaines occupations qui ne pouvaient pas être celles d'un vrai bouddhiste. Par exemple, un véritable bouddhiste ne pouvait être boucher, ni vendeur de poison, il ne pouvait pas être marchand d'esclaves ou propriétaire d'esclaves. Un bouddhiste ne pouvait pas prendre ou distribuer des liqueurs. Le bon bouddhiste, au temps de Gautama, était essentiellement un homme qui errait seul par les chemins ou vivait dans un monastère.
"(6) L'Effort Correct : L'Effort Correct a une signification spéciale ; cela signifie que l'on doit procéder à sa propre vitesse, celle qui nous est la plus appropriée, sur le Chemin de la Sainte Voie des Huit. Une personne cherchant à progresser ne doit pas s'impatienter et tenter d'aller trop vite avant d'avoir appris les leçons qui doivent être apprises. Mais, de nouveau, le chercheur ne doit pas rester en arrière en péchant par excès de fausse modestie, de fausse humilité. Une personne ne peut progresser qu'à sa propre vitesse assignée.
"(7) La Disposition d'Esprit Correcte : C'est l'esprit de l'Homme qui contrôle les actions de l'Homme. La pensée est mère de l'acte ; dès que vous pensez à une chose, vous faites le premier pas vers son exécution et certaines pensées sont très inharmonieuses. Les désirs physiques peuvent distraire une personne et lui faire du mal. On peut désirer une nourriture trop abondante ou trop riche ; le désir ne provoque pas la douleur, mais l'excès de table le fait. La peine et la douleur se développent à partir d'une consommation excessive de nourriture et suivent le désir excessif de manger.
"Le bouddhiste ne doit pas oublier que les sensations sont fugaces, qu'elles vont et viennent comme le vent qui change à tout moment. Les émotions sont instables et l'on ne peut s'y fier. On doit s'entraîner afin d'avoir la juste disposition d'esprit en tout temps quels que soient nos désirs passagers.
"(8) La Contemplation Correcte : Comme Gautama le savait bien, le yoga n'est en aucune façon la réponse à l'accomplissement spirituel. Le yoga n'est qu'une série d'exercices conçus pour permettre à l'esprit de contrôler le corps physique, pour subjuguer le corps au commandement de l'esprit. Ils ne sont pas conçus pour donner l'élévation spirituelle.
"Dans la Contemplation Correcte on doit contrôler les pensées hors de propos, on doit connaître ses propres besoins réels. La Contemplation Correcte permet de méditer — de contempler — afin que, sans raisonnement, on puisse arriver par intuition à une conclusion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour soi-même."
Le Maître de l'Inde se tut, et j'eus l'impression qu'il retombait brusquement sur Terre. Il nous regarda tous, et ses yeux se posèrent enfin sur moi.
— Toi ! cria-t-il en me montrant du doigt. J'ai à te parler. Viens avec moi dans le couloir.
Je me relevai péniblement et boitillai vers la porte. Le Maître me suivit, ferma la porte et puis la rouvrit brusquement pour passer sa tête et glapir :
— Pas un mot, pas un bruit. Je reste là !
Refermant de nouveau, il s'adossa au battant.
— Tu as vu le Dalaï-Lama aujourd'hui, mon garçon. Que t'a-t-il dit ?
— Honorable Maître, m'exclamai-je, j'ai reçu l'ordre de ne rien répéter de notre conversation, de ne pas en révéler un seul mot.
— Je suis ton Maître ! rugit-il, la figure écarlate de rage. Je t'ordonne de me répondre ! As-tu parlé de moi ?
— Honorable Maître, je ne puis rien dire. Je ne puis que répéter que l'on m'a formellement interdit de raconter ce qui s'est passé.
— Je ferai un rapport sur ton insolence et ton insubordination ! Je signalerai que tu es un très mauvais élève !
Sur quoi il se pencha vers moi et me frappa de toutes ses forces, m'assenant deux gifles retentissantes, puis il rentra dans la salle de classe, rouge de colère. Je le suivis et allai reprendre ma place.
Le Maître venu de l'Inde remonta sur l'estrade et rassembla ses papiers. Il ouvrait la bouche pour reprendre la leçon quand un lama entra.
— Honorable Maître, dit-il à l'Indien, le Seigneur Abbé me prie de vous dire qu'il vous attend et que je dois poursuivre la leçon à votre place. Si vous voulez bien m'indiquer à quel point vous en êtes, je me ferai un devoir de continuer.
De mauvaise grâce, le Maître de l'Inde résuma rapidement ses derniers points et déclara qu'il s'apprêtait à nous parler du Nirvana. Puis se tournant vers nous :
— J'ai grand plaisir à quitter cette classe et je souhaite de tout cœur ne jamais y revenir.
Sur ces mots, il fourra tous ses papiers dans son sac de cuir, le ferma rageusement et sortit, laissant le lama stupéfait de cette manifestation de colère. Tout le monde sourit ; nous savions que tout irait mieux à présent, car ce lama était encore assez jeune pour se souvenir qu'il avait été petit garçon et comprendre nos sentiments.
— Eh bien, les enfants, depuis quand êtes-vous là ? Avez-vous mangé ? nous demanda-t-il. Quelques-uns d'entre vous ont-ils besoin de sortir de la classe pendant quelques instants ?
Nous lui rendîmes son sourire, et lui assurâmes que nous n'avions nul besoin de sortir. Il hocha la tête avec satisfaction, puis il alla regarder par la fenêtre pendant une minute ou deux.
Chapitre Six
NOTRE nouveau Maître le lama écarta le lutrin et s'assit sur l'estrade dans la position du lotus. Dans nos réfectoires, il y avait de grands lutrins où un Lecteur se tenait debout ou s'asseyait durant les repas, et lisait afin que nos esprits s'emplissent de pensées spirituelles tandis que notre estomac se remplissait de tsampa. Il n'était pas bien de manger en pensant à la nourriture. En classe, nos Maîtres se tenaient aussi au lutrin, aussi quand notre lama s'assit en face de nous, nous comprîmes qu'il était différent des autres.
— Ainsi, dit-il, vous venez d'apprendre ce qu'est la Disposition d'Esprit Correcte et j'espère que vous êtes en de bonnes dispositions d'esprit, parce que l'esprit est la cause de la plupart des détresses de l'Homme. Les désirs physiques peuvent être bien gênants, particulièrement dans une communauté monastique, particulièrement là où les résidents sont tous célibataires. Aussi, est-il nécessaire de contrôler l'esprit — de créer la bonne disposition d'esprit, car en créant la bonne disposition d'esprit nous sommes en mesure d'éviter les malheurs qui surviennent lorsque nous désirons toutes les choses que nous savons très bien ne pas pouvoir avoir.
"Vous savez que le Bouddha a toujours enseigné que les hommes en particulier étaient souvent détournés du bien par ce que l'on pourrait appeler l'impact visuel. L'homme normal a tendance à idéaliser la femme.
Avisant un assez grand et solide garçon, il lui sourit et reprit :
— Je sais qu'un jeune homme comme toi, qui accompagne parfois nos vieux moines au marché, n'a pas ‘les yeux dans sa poche’. Mais le Bouddha nous enseigne que cela n'est pas bon pour un moine parce que le désir est père de l'acte. La pensée nous fait faire des choses que nous savons être mauvaises.
Il nous regarda à tour de rôle et sourit en disant :
— Nous devons donc suivre la Voie du Milieu et n'être ni trop bons ni trop mauvais. On raconte l'histoire d'un voyageur qui suivait une route ; quelques minutes plus tôt il avait vu passer une femme admirablement belle et voulait faire sa connaissance, mais malheureusement il avait alors été obligé de se cacher derrière des buissons pour satisfaire un certain besoin et craignit que pendant ce temps-là cette très belle jeune femme soit passée. Il avisa un vieux moine bouddhiste et lui demanda : ‘Honorable Maître, avez-vous vu passer une très belle jeune femme ?’ Le vieux moine le regarda avec surprise. ‘Une très belle jeune femme ? Je ne puis vous le dire. Je pratique le précepte de la juste disposition d'esprit, par conséquent je puis simplement vous dire que j'ai croisé tout à l'heure un paquet de chair et d'os, mais je ne sais si c'était un homme ou une femme puisque ces choses n'ont aucun intérêt pour moi.’
Le lama ajouta en riant :
— C'est pousser l'esprit juste au-delà des limites raisonnables, et même jusqu'à l'absurdité. Cependant, poursuivons un sujet qui est généralement très, très mal compris.
Il nous expliqua que la Voie des Huit avait un objectif, un objectif en vertu duquel ceux qui suivaient la Voie atteindraient un but très recherché, atteindraient le Nirvana. Le Nirvana signifie en réalité la cessation du désir ardent, la fin du ressentiment et de la convoitise. La fin de la convoitise et des autres désirs des sens permettrait à un homme ou à une femme de parvenir à un état de béatitude.
Le Nirvana, c'est la libération du corps, la libération des convoitises et des gloutonneries de la chair. Cela n'implique d'aucune façon la cessation de toute expérience, ni non plus la cessation de tout savoir, ou la cessation de toute vie. Il est faux de prétendre que Nirvana veuille dire l'existence dans un état de néant ; cette fausse interprétation a été propagée par des ignorants qui parlaient de choses qu'ils ne comprenaient pas.
Le Nirvana est la libération des soifs, la libération des divers appétits de la chair. Le Nirvana n'est donc pas un état de contemplation béate ; c'est plutôt un accomplissement des connaissances spirituelles et une libération de tous les désirs charnels. L'état de Nirvana c'est d'être dans un état pur, pur en ce qui concerne le manque de convoitises pour les choses physiques. Mais même lorsqu'on est parvenu au Nirvana, qui est la libération des désirs de la chair, on continue toujours à apprendre des choses spirituelles et à progresser sur d'autres plans d'existence.
Les bouddhistes croient en la Ronde du Devenir, ils croient que l'espèce humaine naît sur Terre, vit sur Terre et y meurt, et ensuite revient sur Terre dans un corps différent, qu'elle renaît à la Terre afin que les leçons qui n'ont pas été apprises au cours d'une vie passée puissent être assimilées.
Le Nirvana n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit que l'on peut pointer du doigt sur une carte. C'est un état d'esprit, une condition de l'esprit, c'est la condition d'être attentionné ; la prévenance est l'une des principales vertus du bon bouddhiste, tandis que le manque d'égards est abhorré.
Nirvana ne signifie pas la perte de conscience personnelle à la cessation de la vie sur Terre ; cela signifie tout le contraire. Il y a aussi un autre Nirvana qui, dans la langue indienne, est appelé Parinirvana.
— Un bon bouddhiste, nous dit notre Maître lama, est une personne vraiment heureuse, une personne qui s'occupe d'aider les autres, une personne qui pense aux autres. Le bon bouddhiste ne respecte ni ne reconnaît les titres ou les castes existant dans des pays tels que l'Inde, car un homme n'accède pas au bonheur grâce aux biens de ses parents. Un prince peut être malheureux tandis qu'un mendiant peut être heureux. La naissance ne permet pas de découvrir la façon de vaincre la souffrance, et la fortune de ses parents n'a rien à y voir. Le seul moyen de se libérer des désirs malsains est de suivre l'utile Voie des Huit, qui apporte la connaissance de soi, la connaissance de soi qui permet d'accéder au bonheur durable.
Le lama s'interrompit et nous regarda chacun à notre tour.
— Je suppose que vous pensez que nous les bouddhistes avons plus d'adeptes qu'aucune autre religion au monde ; vous pensez que nous sommes la plus importante. Eh bien ce n'est pas exact, car à l'heure actuelle un cinquième seulement de la population mondiale est bouddhiste. Nous avons des bouddhistes en Thaïlande, à Ceylan, en Birmanie, en Chine, au Japon, en Corée, au Tibet, et un certain nombre en Inde. Il existe diverses formes de bouddhisme et elles proviennent toutes de la même source, par conséquent il est clair qu'il ne devrait jamais y avoir de frictions entre nous, puisque nous avons tous le même parent. Chacun peut penser à sa façon. Beaucoup plus tard dans nos cours, nous traiterons de l'utilité de la religion, mais pour le moment je veux que vous récitiez les ‘Refuges’.
Je prends refuge dans le Bouddha.
Je prends refuge dans la Doctrine.
Je prends refuge dans l'Ordre.
— Vous, les garçons, devez réciter cela le matin et avant de vous retirer pour la nuit, nous dit le lama. Vous devez l'avoir gravé dans votre sub-conscient. Appelez cela, si vous voulez, le symbole du Grand Renoncement consenti par le Fondateur du Bouddhisme lorsqu'il quitta le palais du roi son père et endossa la robe de moine.
"Vous, les garçons, continua-t-il, renoncerez aux attraits de la chair. Vous recevrez une formation pour être de jeunes hommes de bon caractère, de bonne conduite, de jeunes hommes à la pensée pure, car dans les jours à venir, jours d'affliction, jours dominés par le mal, des choses terribles surviendront dans notre pays bien-aimé et alors nous aurons besoin de jeunes hommes bien trempés pour partir dans ce qui est pour nous le grand inconnu et maintenir en vie notre culture. Par conséquent, vous de cette génération devez étudier et vous purifier, car nous les plus âgés ne pourrons vous suivre.
"Dans vos voyages vous rencontrerez de nombreux bouddhistes Zen. Vous vous demanderez si leur austérité est bien nécessaire car les disciples du Zen pensent que les Maîtres et ce qui enseigne — les livres et les écritures — ne sont rien que des doigts brandis pour indiquer la Voie à suivre. Pensez aux gens que vous avez vus, pensez à nos pèlerins que vous regardez d'en haut faire le tour de la Route de l'Anneau ; observez les guides et les gitans désignant du doigt un objet, ou l'un de nous à nos fenêtres, et voyez comment les yeux du pèlerin regardent invariablement le doigt plutôt que l'objet indiqué. C'est un fait que l'ignorant regarde toujours le doigt pointé plutôt que dans la direction indiquée par le doigt. Ce fait est connu de cette secte de bouddhistes que l'on appelle Zen. Leur croyance est que l'on ne peut connaître la vérité que par son expérience personnelle de la vérité. La vérité ne peut être connue simplement en en entendant parler ou en lisant une page imprimée. On ne peut tirer profit que par des expériences personnelles concrètes.
"Il est fortement recommandé de lire et d'étudier les Écritures, et d'écouter avec attention les enseignements des hommes sages. Mais tous les mots imprimés et tous les mots écrits doivent simplement servir de carburant pour le fonctionnement de son propre esprit, afin que lorsque l'on vit une expérience, on puisse rattacher cette expérience aux Grandes Vérités telles que proposées par les autres. Tout cela signifie, dit le lama en souriant, que l'on ne peut aller bien loin si l'on n'est qu'un simple théoricien ; il vous faut être un homme qui pratique aussi bien qu'un étudiant du mot écrit. Il est dit qu'une image vaut plus que mille mots, mais je dis qu'une expérience vaut plus que mille images.
Il hésita un instant et se tourna vers la fenêtre. Mon cœur bondit en pensant qu'il verrait peut-être mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, revenant de la Lamaserie de la Barrière de Roses. Mais il se retourna simplement vers nous et reprit :
— Je vais vous raconter quelque chose qui vous choquera sans aucun doute et vous fera penser que les bouddhistes Zen sont des sauvages ignorants et, qui plus est, sacrilèges ! Il y a quelque temps, au Japon, vivait un très grand et très célèbre Maître, un homme vénéré pour ses idéaux élevés, son profond savoir, et pour l'austérité de sa vie. De tous les coins de l'Orient les élèves affluaient pour se prosterner aux pieds de ce Maître et l'écouter. Un jour, il fit son cours dans un des innombrables temples, orné de nombreuses statues des Mille Bouddhas artistement sculptées dans des bois rares. Le Maître discourait dans un silence religieux quand soudain il s'interrompit, et ses élèves retinrent leur respiration en se demandant ce qu'il allait dire car il avait la réputation, bien méritée, d'être très, très excentrique.
"Quand ce sage se jeta sur le premier des bouddhas de bois et le jeta dans le feu, les élèves se levèrent tous d'un bond, horrifiés. Pendant quelques instants ce fut le tumulte, des cris, des protestations, des mains levées. Mais le sage resta calmement le dos au feu, où flambait la statue du Bouddha. Quand le bruit cessa enfin, il déclara que chacun avait des statues dans son esprit, que chacun installe des ornements, des idoles, des choses inutiles qui occupent de l'espace dans l'esprit tout comme les idoles inutiles occupent l'espace dans un temple. Le seul moyen de progresser, dit-il, est de brûler le fouillis dans son esprit, de détruire ce qui empêche le progrès. Le Grand Maître se tourna alors vers une autre statue, passa un doigt sur les épaules du Bouddha et le montra à sa classe en disant : ‘Voici de la poussière, de la poussière sur un Bouddha, mais ce n'est pas aussi grave que la poussière sur l'esprit. Détruisons donc les images sculptées, détruisons les idées fausses qui vivent en nous, car si l'on ne nettoie pas le désordre de son esprit comme on débarrasse un grenier de ses objets superflus, on ne peut progresser et passer à des sphères plus élevées de La Voie.’
Voyant nos visages scandalisés, notre lama éclata de rire.
— Ah ! Vous êtes de petits conservateurs, à ce que je vois ! Attendez un peu de visiter d'autres lamaseries, attendez de partir par le monde ! Vous découvrirez que certaines personnes n'ont que faire des enseignements de la religion, que d'autres se rincent la bouche avant d'oser prononcer le nom du Bouddha afin de ne pas souiller le nom sacré. Mais ce sont deux extrêmes, les incroyants d'un côté et les fétichistes de l'autre. La religion est une discipline qui ne peut être utile que si l'on se sert de bon sens, de modération et de La Voie du Milieu ; alors la religion peut résoudre tous nos problèmes.
Je dus grogner, ou faire un geste qui attira son attention, car le lama hésita un instant, puis il descendit de l'estrade et vint vers moi.
— Lobsang, me dit-il, tu me sembles bien troublé. Je sais que tu as vécu une singulière aventure aujourd'hui, mais il me semble qu'autre chose te tourmente et je suis sûr que ce n'est pas le léger retard de ton Guide. Dis-moi ce que tu as.
J'aurais voulu voir le sol s'ouvrir sous mes pieds et me précipiter jusqu'au plus profond des gouffres volcaniques, car je devais reconnaître que mes pensées étaient plutôt insolites. Pour tout dire, j'en avais franchement assez de la vie que l'on me faisait vivre, et je pensais que le moment était peut-être venu de l'avouer. Pour en finir.
— Honorable Maître, dis-je, le cœur battant, il est vrai que je ne suis pas satisfait. Mon esprit est en conflit, mes pensées tourbillonnent car on me pousse à suivre une voie tout à fait contraire à mes propres aspirations. J'ai été fort troublé et, tandis que j'étais assis sur le Toit d'Or, luttant contre le vent, pensant à la mort qui me guettait, j'en fus soudain heureux car je me dis que la mort mettrait fin à mes problèmes.
Le lama me considéra d'un air compatissant. Il rassembla les pans de sa robe et s'assit par terre à côté de moi, les jambes croisées dans la position du lotus.
— Lobsang, nous allons discuter ton problème, et je pense que nous devons le faire ici, dans cette classe, car je suis certain que tes camarades ont dû être aussi troublés que toi, à un moment ou un autre. Il y a très, très longtemps que je suis au Potala et il se peut que tes soucis d'aujourd'hui aient été jadis les miens.
— Honorable Maître, répondis-je, je n'ai pas le choix. J'ai dû quitter ma riche famille, chassé par mes parents qui sont des gens très puissants, et l'on m'a dit que je devais entrer dans les ordres. Comme j'appartenais à une famille de haut rang, je devais subir plus de tribulations et d'épreuves que si j'étais d'une famille pauvre. J'avais plus de choses à apprendre, plus de souffrances à connaître. Ma jambe gauche a été brûlée jusqu'à l'os sans que j'y sois pour rien. Mes deux jambes ont été brisées quand j'ai été précipité par la tempête du haut du toit et, si je puis à peine marcher, si je souffre constamment, je dois quand même assister aux cours. Mais, Honorable Maître, je n'ai jamais voulu devenir moine, seulement je n'ai pas eu le choix, j'ai été contraint de faire ce que je ne désirais pas. La religion ne m'apporte rien.
Le lama me regarda avec une grande compréhension.
— Tu commences à peine, Lobsang. La religion t'apportera beaucoup lorsque tu commenceras à comprendre la Voie du Milieu et les règles de cette vie et de la vie au-delà. Alors tu trouveras la sérénité et tu comprendras beaucoup mieux ce qu'est réellement la vie. Mais, dis-moi, à ton âge, que voudrais-tu être ?
— Du haut du Toit d'Or, j'ai vu le passeur de la Rivière Heureuse et j'ai pensé qu'il menait une vie parfaitement libre et que ce devait être bien agréable de traverser et de retraverser un fleuve que tout le monde aime, de rencontrer beaucoup de gens intéressants, des voyageurs qui franchissent nos montagnes pour en revenir chargés d'étranges marchandises et pleins d'un savoir nouveau. Mais je — je ne suis qu'un jeune garçon soumis à la discipline, je ne peux rien faire de ce que j'aimerais mais toujours obéir aux ordres, je suis contraint d'apprendre des choses qui ne m'intéressent pas, je dois m'entendre dire que ma vie sera dure mais que je travaille dans un but déterminé, que j'accomplirai une tâche spéciale.
Je m'interrompis pour essuyer mon front en sueur sur ma manche, puis continuai :
— POURQUOI ma vie doit-elle être aussi dure ?
Le Maître posa sa main sur mon épaule.
— Toute la vie est semblable à cette salle de classe ; vous venez ici, certains à contrecœur, d'autres avec joie, mais tous vous venez vous instruire, étudier, et chacun de vous doit apprendre à son propre rythme car personne, aucun professeur, ne peut forcer votre développement parce que le faire signifierait que vous avez une connaissance imparfaite du sujet. Vous devez progresser à votre propre rythme, lentement ou rapidement selon vos propres capacités, selon votre propre désir de connaissance. Toute la vie est comme cette classe ; vous venez dans cette vie comme vous venez dans cette classe. Mais quand vous quitterez cette classe dans quelques minutes ce sera comme mourir à cette vie, mourir à la salle de classe. Demain, peut-être, irez-vous dans une autre salle de classe, ce qui est sensiblement la même chose que de renaître, renaître dans un corps différent, dans des conditions différentes, dans des circonstances différentes. Vous ne savez pas ce que va vous enseigner le maître, vous ne savez pas pourquoi le maître va vous enseigner, mais lorsque dans les années à venir vous partirez par le vaste monde au-delà de nos hautes montagnes, vous découvrirez que les choses que vous avez apprises dans cette classe et dans les autres vous aideront énormément dans des voies que vous ne pouvez comprendre à l'heure actuelle.
— C'est bien ce que me dit mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, répliquai-je, mais je ne vois toujours pas comment je puis me résigner à faire des choses qui me rendent malheureux.
Le Maître se retourna pour voir ce que faisaient mes camarades, mais ils étaient tous d'une sagesse exemplaire, ils écoutaient de toutes leurs oreilles avec intérêt car ils devaient tous avoir des problèmes semblables aux miens. Nous avions tous été placés dans des lamaseries contre notre gré, sans que nous ayons notre mot à dire, et nous tâtonnions en fait dans les ténèbres, cherchant un rayon de lumière pour nous guider.
Notre Maître continua :
— Vous devez décider parmi les voies qui vous sont offertes. Toi, Lobsang, tu peux rester ici et devenir moine, ou bien partir pour être batelier, ou fabricant de cerfs-volants, ou voyageur pour aller au-delà de nos montagnes. Mais tu ne peux pas être tout cela à la fois. Tu dois décider ce que tu seras. Si tu veux être batelier, alors quitte tout de suite cette lamaserie et n'y pense plus, ne pense plus à devenir moine, ne pense qu'à être batelier. Mais si tu deviens moine — comme c'est en effet ton destin — oublie alors tout ce qui a trait au batelier, consacre la totalité de ta pensée à être moine, consacre la totalité de ta pensée à étudier comment devenir un bon moine. Et plus tu penseras à devenir un bon moine, plus cela te sera facile.
Un des garçons s'exclama alors :
— Mais, Honorable Maître, moi aussi je suis ici contre mon gré. Je voulais aller vivre au Népal, parce que je crois que j'y serais plus heureux.
Notre lama prit un air très sérieux, comme si c'était là une affaire de la plus haute importance et non les sottises de garçons qui ne savaient de quoi il parlaient.
— Mais connais-tu bien le peuple népalais ? demanda-t-il très sérieusement. Sans doute as-tu rencontré quelques personnes de ce pays, mais les autres ? Connais-tu les basses castes, les pauvres ? Sinon, si tu n'es pas souvent allé chez eux, dans leurs maisons, tu ne peux pas savoir si tu les aimerais. Je te dis que, si tu veux rester chez nous au Tibet, tu dois consacrer toutes tes pensées au Tibet. Mais si tu veux aller au Népal, alors tu dois quitter le Tibet tout de suite, aller au Népal, et ne plus penser au Tibet car si l'on divise sa pensée on divise ses forces. Nous pouvons avoir un bon flot de pensée, ou force, ou bien nous pouvons avoir des gouttes de pluie éparses qui couvrent un vaste territoire mais n'ont pas de force. Chacun de vous doit décider ce qu'il veut faire, ce qu'il veut être et puis, une fois décidé, chacun de vous doit se donner de tout cœur et avec un esprit non divisé à la réalisation de ce qu'il veut être, car si tu décides d'aller au Népal avec la moitié de ton esprit alors que l'autre moitié décide de rester au Tibet, tu passeras tout ton temps dans l'indécision, tu seras perpétuellement inquiet, tu ne pourras jamais trouver la paix de l'esprit ou la sérénité. C'est une des grandes forces du monde, une des grandes Lois que vous devez vous rappeler. Divisez l'ennemi et vous pouvez gouverner l'ennemi ; restez vous-mêmes unis et vous pouvez vaincre un ennemi divisé. L'ennemi peut fort bien être l'indécision, la peur et l'incertitude.
Nous nous regardâmes tous, en pensant que ce Maître-là nous comprenait vraiment. Mieux, bien mieux valait avoir pour Maître un homme qui était un homme, à qui nous pouvions parler et qui nous répondait sans s'adresser à nous comme si nous étions des pantins. Nous songions tous à ce Maître venu de l'Inde, à son arrogance et à son mépris.
— Honorable Maître, dis-je, je voudrais poser une question. Pourquoi certains lamas sont-ils si cruels et d'autres si bons et compréhensifs ?
Le lama sourit :
— Allons, Lobsang, il est un peu tard pour aborder des sujets aussi profonds, mais je te promets que nous allons traiter de ces choses et que nous traiterons aussi des us et des abus des religions. Mais je crois que nous avons assez travaillé pour aujourd'hui.
Il se leva, et mes camarades aussi. Cependant, voyant que j'avais du mal à me relever, le lama se pencha, glissa un bras autour de mes épaules et m'aida aussi calmement, aussi naturellement que s'il l'avait fait tous les jours de sa vie.
— Allez maintenant, mes enfants, sinon vous allez trébucher dans l'obscurité et nous ne voulons pas avoir de nouvelles jambes brisées.
Les garçons partirent en courant, pleins de joie parce que la classe s'était terminée un peu plus tôt que d'habitude. Avant de me quitter, le lama se tourna vers moi :
— Lobsang, ton Guide sera là demain matin, mais je ne crois pas que tu puisses le voir avant l'après-midi ou même la soirée, car il doit faire son rapport au Grand Initié et aux membres du Conseil Suprême. Mais il te fait dire qu'il pense à toi, et le Grand Initié lui a envoyé un message disant combien Sa Sainteté était content de toi. Et ton Guide t'apporte quelque chose, Lobsang !
Sur ce, il me sourit encore, me donna une petite tape affectueuse sur l'épaule et me laissa. Je me demandai en quoi j'avais pu plaire au Grand Initié alors que j'étais en si piteux état et que tout le monde disait que je ne causais que des ennuis. Je me demandai aussi ce que mon Guide bien-aimé m'apportait. Je pouvais à peine supporter de penser à ce qu'il pouvait bien avoir pour moi, parce que jamais de ma vie je n'avais reçu de cadeau. Je sortis lentement de la salle au moment où le moine qui faisait le ménage arrivait. Il me salua aimablement et s'enquit avec une grande gentillesse de mes blessures. Je lui dis que j'allais mieux et il me déclara :
— Aujourd'hui, je nettoyais les appartements du Grand Initié quand je les ai entendu dire que tu étais destiné à de grandes choses. Et aussi que Sa Sainteté était très satisfaite de toi. Nous échangeâmes encore quelques mots, j'aidai le vieux moine à allumer les lampes à beurre et puis je descendis péniblement, passant à regret devant le corridor menant aux cuisines pour aller me réfugier dans un des petits temples. J'avais besoin d'être seul, de réfléchir, de méditer sur le passé et contempler l'avenir.
Dans une lamaserie, il n'y a guère de solitude pour un acolyte — ou un chela, qui est le terme bouddhiste — et si nous étions accablés de chagrin ou de problèmes, le seul moyen d'être seul, le seul refuge était un de ces temples mineurs où l'on pouvait se glisser derrière une des Statues Sacrées où personne ne viendrait nous déranger. Je descendis donc et pénétrai dans un temple faiblement éclairé par des lampes à beurre crachotantes dont la fumée noircissait le mur.
Je passai devant les brûleurs d'encens, trouvai ma statue préférée et m'assis dans son ombre. À ce moment j'entendis ‘Ourrrah ! Ourrrah !’ et une tête noire familière me heurta le creux des reins, puis de grosses pattes velues trouvèrent mes genoux et se mirent à les pétrir tandis que le gros chat ronronnait de plus belle.
Pendant quelques instants je jouai avec lui, je le caressai, je lui tirai les oreilles et la queue à sa plus grande joie. Soudain il sauta sur mes genoux, s'y pelotonna et s'endormit aussitôt. Je joignis les mains et songeai à tous les incidents de ma vie, à toutes mes difficultés, au présent d'abord, en me disant qu'il était bien facile pour les autres de débiter des platitudes sur la religion, facile de parler des Règles de la Vie Juste. Mais c'était bien moins facile lorsqu'on n'était qu'un petit garçon et avait tout simplement été contraint d'embrasser une carrière ou une vocation sans avoir la moindre inclination ou le moindre désir pour une telle carrière ou vocation. Bercé par mes pensées, je dus m'endormir, assis tout droit comme nous le faisions souvent pour dormir. Le vieux chat dormait, j'étais assoupi, et le temps passa à notre insu. Les ombres s'allongèrent, le soleil se coucha, la nuit tomba. Bientôt la lune argentée apparut au sommet des montagnes et dans toutes les maisons de Lhassa les lampes à beurre se mirent à clignoter. Le vieux chat et moi dormions toujours dans 1'ombre de la Statue Sacrée.
Chapitre Sept
UN SOURD bourdonnement pénétra mon esprit assoupi. Tout près de moi, une grande force de pensée se déversait dans l'air réceptif. Mes pouvoirs télépathiques se réveillèrent. Je relevai ma tête lourde, soulevai mes paupières lasses. Ah, que j'étais fatigué ! Un léger mouvement sur mes genoux, une bouche tendre me saisit affectueusement la main.
— Aurrragh ! Mmmmrno ! me dit le Chat Gardien.
Il leva vers moi de grands yeux compréhensifs. La lueur vacillante des lampes à beurre teignait de rouge les iris si bleus au soleil. Doucement, si légèrement que je ne m'en aperçus qu'après son départ, le chat glissa de mes genoux et se confondit avec les ténèbres.
Mes jambes étaient ankylosées, la cicatrice de ma brûlure me tirait la peau, et j'avais l'impression qu'elle allait se détacher pour laisser de nouveau une blessure sanguinolente. Une douleur aiguë me parcourut le corps, me déchirant le dos, les côtes. J'étouffai un cri. Mais le spasme se calma et je regardai autour de moi, prudemment. Là, dans l'ombre violette de l'immense Statue Sacrée, je pouvais voir sans être vu.
Les fenêtres étaient des rectangles de nuit dans un mur d'ombres dansantes. J'apercevais le ciel comme du velours noir piqué de diamants, de rubis, de turquoises. Chez nous, dans l'air raréfié des hautes altitudes, les étoiles sont de toutes couleurs et non de simples points lumineux comme dans les plaines. Ici, aucune fumée ne vient souiller la pureté des cieux ni obscurcir leur grandeur. Mars était rouge, comme un rubis pâle, Vénus verte et Mercure comme un éclat de turquoise. Une poussière de diamants s'étendait comme un clair chemin à perte de vue. La lune était déjà couchée et son éclat ne venait pas atténuer celui des étoiles.
Sur les murs, les ombres dansaient, se contorsionnaient ; tantôt elles évoquaient des géants tendant les bras vers le plafond, tantôt des nains rampant près du sol. Une des lampes à beurre avait besoin d'être mouchée ; sa flamme désordonnée semblait vouloir se détacher du mur comme un insecte prisonnier qui s'agitait puis retombait épuisé pour recommencer ses efforts. J'eus soudain comme un vertige ; je m'étais réveillé brusquement d'un profond sommeil, et les ombres qui se tordaient, les voix étranges qui montaient et descendaient de l'autre côté de la Statue Sacrée m'envoûtèrent. Je levai les yeux et je fus pris de panique. La statue vacillait, elle allait tomber sur moi, m'écraser ! Ses contours ondulaient et j'allais me jeter de côté malgré mes jambes douloureuses lorsque je faillis éclater de rire. C'était une illusion — des flammes dansantes qui semblaient animer le bois sculpté.
Mes douleurs s'étaient un peu calmées. Je me mis à quatre pattes et contournai sans bruit le socle de la statue afin de voir ce qui se passait dans l'enceinte du temple. Jamais je n'y avais vu célébrer un office ; nous les garçons en étions sévèrement exclus, car c'était un des plus importants des temples mineurs. De ma cachette, je me demandai ce qui se passait. Avec précaution, relevant ma robe afin de ne pas m'y prendre les pieds et tomber, j'avançai encore et risquai un œil.
"Voilà qui est intéressant", pensai-je. Devant moi, neuf lamas en robe safran étaient assis en rond, leurs têtes faisant face au centre du cercle, et dans le centre sur un socle ouvragé reposait Quelque Chose — Quelque Chose que je distinguais mal. Il semblait y avoir quelque chose, et pourtant il paraissait n'y avoir rien là. Je frissonnai et mes cheveux rasés se dressèrent sur ma tête comme des gardes à la parade, car les doigts glacés de la peur m'étreignirent au point que je faillis prendre mes jambes à mon cou. J'eus l'impression que, sur ce socle sculpté, se tenait une créature du monde des ombres, une créature qui n'avait pas d'existence dans ceci, notre monde, et guère d'existence dans ce monde des ombres d'où elle était venue. J'ouvris de grands yeux.
Il semblait y avoir un globe de quelque chose, ou un globe de rien ; cela semblait presque sans forme et pourtant cela ondulait ! J'aurais voulu m'approcher, regarder par-dessus l'épaule d'un des lamas, mais je risquais d'être alors surpris. Je restai donc à l'ombre de la statue, je me frottai les yeux pour en chasser le sommeil, pour tenter de mieux voir, et finalement je m'avançai à quatre pattes, sur les mains et les genoux, en glissant de côté pour voir entre les épaules de deux des lamas.
Je m'aperçus — cela me vint soudainement à l'esprit — que c'était un énorme bloc de cristal de roche, parfait, sans le moindre défaut. Il reposait sur un socle ouvragé et retenait toute l'attention des lamas assis presque en dévotion devant lui. Ils le regardaient intensément, et pourtant pas assez intensément qu'ils dussent lui consacrer leurs yeux physiques, mais seulement, semblait-il, leur troisième œil. ‘Ma foi, me dis-je, moi aussi je suis clairvoyant.’ Je cessai donc de regarder avec mes yeux et laissai mes facultés de clairvoyance les remplacer ; je vis alors dans le cristal des couleurs, un tourbillon de couleur et de fumée. Ahuri, effrayé, je me sentis tomber, tomber d'une hauteur immense, tomber du toit du monde dans le plus profond des abîmes. Mais non, ce n'était pas un abîme ; plutôt, un monde s'étendait devant moi, un monde où les couleurs étaient différentes, où les normes étaient différentes. Je le contemplais du haut d'une légère éminence et je voyais des gens errer, pleins de tristesse, douloureux. C'était des âmes perdues, des âmes sans guides, des âmes cherchant à se délivrer de leurs soucis.
Alors que j'étais assis là, transporté, comme si je me trouvais sur le plan ensoleillé d'un monde différent, les lamas continuaient de psalmodier. De temps en temps, l'un d'eux levait une main et agitait une clochette d'argent et, en face de lui, un autre faisait le même geste mais sa clochette avait un autre son. Ainsi la litanie se poursuivit, montant et descendant l'octave, en glissade, pas du tout en notes séparées comme dans les autres parties du monde, mais se confondant en accords que les murs renvoyaient et qui se répercutaient en de nouveaux accords.
Le chef de ce groupe de lamas frappa dans ses mains, son voisin agita une clochette et un troisième éleva la voix pour une prière rituelle, ‘Oh, Entendez les Voix de nos Âmes’. Ils chantèrent ensuite tous les très anciens couplets du cantique, chacun à son tour, d'abord, puis à l'unisson, et la cadence de leurs voix montait et descendait, montait et descendait, m'emportant hors du temps, me soulevant hors de moi-même.
Puis vint l'ensemble des prières de ce groupe :
Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes,
Vous tous qui tremblez de peur dans le désert, sans protection.
Écoutez les Voix de nos Âmes
Afin que nous puissions protéger les exposés.
Tout comme le Premier Bâton d'Encens est allumé et que sa fumée monte vers le haut,
Laissez de même s'élever votre Âme et votre Foi,
Afin de pouvoir être protégé.
* * * * *
Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes,
Vous tous tapis de peur dans la nuit.
Écoutez les Voix de nos Âmes,
Car nous serons comme une lanterne brillant dans les ténèbres,
Nous permettant de guider les voyageurs surpris par la nuit.
Tout comme le Second Bâton d'Encens est allumé et brille de vie
Laissez votre Âme percevoir la Lumière que nous rayonnons afin que vous puissiez être guidés.
Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes,
Vous tous qui êtes coincés dans le Golfe de l'Ignorance.
Écoutez les Voix de nos Âmes,
Notre aide sera comme un pont pour traverser le gouffre,
Pour vous aider à avancer sur le Chemin.
Tout comme le Troisième Bâton d'Encens est allumé et que sa fumée s'étend,
Laissez votre Âme faire bravement un pas en avant vers la Lumière.
* * * * *
Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes,
Vous tous affaiblis par la fatigue de la Vie.
Écoutez les Voix de nos Âmes,
Car nous apportons le Repos afin que votre Âme reposée reparte gaillardement
Tout comme le Quatrième Bâton d'Encens est allumé et que sa fumée dérive oisivement,
Nous apportons le Repos afin que, dispos, vous puissiez vous élever de nouveau.
* * * * *
Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes,
Vous tous qui vous moquez des Paroles Sacrées.
Écoutez les Voix de nos Âmes.
Nous vous apportons la Paix ! Afin que vous puissiez vous attarder sur les Vérités Immortelles.
Tout comme le Cinquième Bâton d'Encens est allumé pour apporter du parfum à la Vie,
Ouvrez votre esprit afin d'être en mesure de SAVOIR !
Enfin les voix se turent. Un lama fit tinter très légèrement sa clochette, et tous les autres l'imitèrent, sur des rythmes et des sons différents formant un ensemble tonal varié, que les murs répercutèrent. Les lamas reprirent le cantique, mais tout bas, en agitant leurs clochettes. L'effet était hypnotique, mystique.
Je regardai les gens qui m'entouraient, mais étaient-ils là près de moi ? Étais-je dans un autre monde ? Ou bien les voyais-je dans le cristal ? Je ne savais plus. Pourtant, j'avais l'impression très forte d'être ailleurs, dans un autre monde où l'herbe était plus verte, le ciel plus bleu, l'ombre et la lumière plus violemment contrastées. Il y avait de l'herbe verte sous mes pieds, je la sentais ! Je pouvais y plonger mes orteils ! Je sentais l'humidité du sol imprégner mes genoux, ma robe. Mes mains aussi étaient humides et je sentais sous mes paumes les brins d'herbe et quelques cailloux. Je regardai autour de moi avec un intérêt avide. Au premier plan, je vis d'énormes rochers de pierre verdâtre marbrée de blanc. Plus loin j'en aperçus d'autres, de diverses couleurs ; celui qui m'attirait le plus était rougeâtre, strié de veinules blanches. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était la réalité de cette vision ; toutes ces choses paraissaient plus normales que la normale, les couleurs plus vives, les contours plus nets.
Une légère brise soufflait ; je la sentais caresser ma joue gauche. C'était assez stupéfiant car elle m'apportait d'étranges senteurs inconnues, exotiques. À une certaine distance j'aperçus un insecte semblable à une abeille, qui bourdonnait et voletait ; il se posa sur une petite fleur éclose dans l'herbe et pénétra sa corolle en trompette. Je voyais tout cela sans avoir conscience du passage du temps, mais soudain j'eus peur car un groupe de personnes marchait vers moi. Je les regardai, paralysé ; ces gens venaient vers moi et j'étais sur leur chemin. Certains étaient très vieux et s'appuyaient lourdement sur des bâtons ; ceux-là marchaient pieds nus, vêtus de loques. D'autres paraissaient riches, mais sans cet air prospère qui accompagne la richesse car ce qui frappait avant tout, chez ces hommes et ces femmes, c'était leur terreur, leur angoisse ; à tout moment ils sursautaient, portaient une main à leur cœur, regardaient peureusement autour d'eux et aucun d'eux ne semblait avoir conscience de son voisin ; ils semblaient se croire seuls, oubliés, désolés, abandonnés dans une terre étrangère.
Ils avançaient ainsi en groupe mais chacun dans sa solitude, attirés par les voix que j'entendais aussi : ‘Oh ! Écoutez les Voix de nos Âmes, vous tous qui errez sans guide.’ Le chant psalmodié continuait, ces gens avançaient et d'autres arrivaient, et quand ils atteignirent un certain endroit — je ne pouvais voir vraiment ce qui se passait — leur visage s'illumina d'une espèce de joie supra-terrestre, chacun se redressant comme s'il venait de recevoir la promesse d'un réconfort. Ils disparurent à ma vue, en marchant. Soudain, des cloches sonnèrent, dissonantes, et je me sentis violemment tiré, comme si on me ramenait, comme si j'étais un cerf-volant au bout d'une ficelle que l'on ramenait en luttant contre une bourrasque qui cherchait à l'emporter.
Je contemplai l'étrange panorama et j'eus l'impression que la nuit tombait car le ciel devenait plus sombre et les couleurs perdaient leur vivacité. Les objets semblaient rétrécir. Rétrécir ? Comment était-ce possible ? Pourtant c'était indiscutable, tout rapetissait, et non seulement ils diminuaient mais un brouillard semblable aux nuages célestes commençait à recouvrir la face de ce monde ; sous mes yeux horrifiés, tandis que tout devenait de plus en plus petit, le brouillard se changea en nuées d'orage, et le tonnerre gronda accompagné d'éclairs.
Le monde devint de plus en plus petit et je m'élevai de plus en plus haut. En regardant vers le bas, je pus le voir tourner sous mes pieds, puis je me raisonnai et me dis qu'il ne tournait pas sous mes pieds puisque j'étais à quatre pattes dans le temple. Mais y étais-je ? Étourdi, égaré, je ne savais que penser, lorsque je ressentis encore une fois cette secousse violente, effrayante, une secousse qui faillit bien me faire perdre l'esprit.
Pris de vertige, je levai la main pour me frotter les yeux. Et quand je les rouvris, je vis que le cristal n'était plus que du cristal de roche sans défaut, ce n'était plus un monde étrange mais une roche sans vie et sans lumière. Il était posé sur son socle sculpté comme une gemme, ou une idole, ou je ne sais quoi, et non pas comme l'admirable instrument d'une expérience sans pareille. Lentement, un des lamas se leva et prit à la base du socle une étoffe de velours noir. Il la déplia respectueusement et en recouvrit le cristal en la bordant bien tout autour. Il se prosterna trois fois et alla reprendre sa place. À ce moment son regard stupéfait me découvrit. Pendant une seconde ou deux il resta pétrifié ; le temps lui-même était paralysé, me sembla-t-il. J'entendis mon cœur battre un grand coup et s'arrêter. La nature, l'éternité, tout l'univers retenait sa respiration, attendant de savoir ce qui allait se passer.
Un murmure courut parmi les lamas. Le plus proche de moi se releva et vint vers moi. C'était le plus grand mais, à mes yeux terrifiés, il me parut plus monumental encore que le Potala lui-même. Il me dominait de toute sa hauteur et il allait parler quand un autre lama me reconnut.
— C'est Lobsang, le garçon de Mingyar, dit-il, avec soulagement me sembla-t-il. C'est notre garçon le plus télépathique. Qu'on l'amène.
Le lama géant se pencha et glissa ses mains énormes sous mes épaules, puis il me souleva dans ses bras car, ayant appris que j'étais le ‘garçon de Mingyar’, il devait savoir que je pouvais à peine marcher, aussi m'évita-il cette peine. Il me porta dans le cercle des lamas qui se mirent à me regarder comme s'ils allaient scruter mon âme, comme s'ils allaient scruter à travers mon âme, au-delà, et dans les autres royaumes conduisant au Sur-Moi.
J'avais grand-peur car je me demandais si je n'avais pas fait quelque chose de formellement interdit. J'avais choisi ce temple-là parce que les autres étaient en général pleins de petits garçons bruyants que la méditation intéressait peu. Moi, je voulais méditer.
— Lobsang ! me dit un vieux lama tout parcheminé, que fais-tu ici ?
— Honorable Maître, répondis-je humblement, depuis longtemps j'ai l'habitude de venir dans ce temple mineur pour mes méditations privées, et je m'assieds derrière une des Statues Sacrées afin de ne pas déranger d'autres personnes qui méditent. Je n'avais nullement l'intention d'interrompre votre office et en fait — à cela je pris un air penaud — je me suis endormi et je n'ai été réveillé que lorsque vous avez commencé à chanter.
Sur la gauche, la lampe à beurre mal mouchée expira soudain dans un sifflement et un nuage de fumée âcre. Dans les ténèbres, en dehors du cercle, retentit une voix familière.
— Mrrroua ! Mmmmrouah !
Mon Ami Chat se glissa entre deux lamas assis, vint vers moi d'un air important, la queue toute droite et me donna un petit coup de tête amical. Je tendis vers lui une main tremblante et passai mes doigts dans sa fourrure. Il leva les yeux vers moi, se frotta contre moi, fit ‘Aaarah !’ et s'en alla dignement, en se frayant un passage entre deux autres lamas.
Tous les lamas se regardèrent avec surprise, et puis je les vis sourire.
— Ainsi notre gardien te connaît bien, Lobsang ! Il a dit beaucoup de bien de toi, sais-tu ? Il t'a assuré de son dévouement et nous a dit que tu as parlé sans mentir.
Un silence tomba, rompu enfin par le vieux lama parcheminé, qui semblait être le supérieur du groupe ; il regarda à tour de rôle chacun des autres participants de cet office et déclara :
— Oui, je me souviens. C'est le garçon qui doit recevoir un enseignement particulier. Nous attendions le retour de son Guide avant de le convoquer ici mais, comme il est là, nous allons mettre à l'épreuve son expérience et ses capacités, afin de le juger sans être gênés par l'influence de son puissant Guide.
Un murmure d'assentiment courut autour du cercle et puis ils se concertèrent à voix si basse que je ne pus rien comprendre. C'était les lamas hautement télépathiques, les grands clairvoyants, ceux qui aidaient les autres et voilà que j'étais assis parmi eux, frissonnant de peur sans doute, mais avec eux. Un des lamas se tourna enfin vers moi.
— Lobsang, nous avons beaucoup entendu parler de toi, de tes pouvoirs, de tes possibilités et de ton avenir. En fait, c'est nous qui avons enquêté et étudié le Registre des Probabilités pour savoir ce qui pourrait t'arriver. Aujourd'hui, consens-tu à subir une épreuve afin que nous puissions déterminer l'étendue de tes pouvoirs ? Nous aimerions t'emmener faire une promenade dans l'astral, et dans le monde au-dessous de l'astral. Nous voulons t'emmener comme un ‘fantôme à travers notre Potala’.
Je le considérai avec inquiétude. On voulait me faire faire une promenade ? Mais comment pensaient-ils que je marcherais ? Je pouvais boitiller le long des corridors mais c'était tout, mes jambes n'étaient pas suffisamment guéries pour me permettre de MARCHER avec assurance ! J'hésitai, réfléchis, en tortillant entre mes doigts un pan de ma robe. Finalement je répondis :
— Honorables Maîtres, je sais que je suis à vos ordres et en votre pouvoir, mais je dois dire que je ne peux guère marcher à cause de mes accidents. Cependant, en bon moine, je me place à votre disposition en espérant que mon Guide approuverait cette décision.
Personne ne rit, personne ne sourit de cette déclaration bien pompeuse venant d'un aussi jeune garçon sans expérience, mais je faisais de mon mieux et que pouvait-on demander de plus ?
— Lobsang, nous voulons que tu t'allonges par terre puisque tes jambes ne te permettent pas d'adopter la position rituelle. Couche-toi.
Le vieux lama prit un coussin et le glissa sous ma tête, puis il me fit croiser les mains et les disposa sur mon abdomen, entre l'extrémité du sternum et l'ombilic. Cela fait, les lamas portèrent respectueusement le cristal au pied de la Statue Sacrée et s'installèrent de nouveau en rond autour de moi, ma tête occupant le centre précis de ce cercle. Un des lamas se releva et revint avec des bâtonnets d'encens et un petit brasero. Je faillis me couvrir de honte en éternuant quand un nuage de fumée passa sur ma figure et me piqua le nez.
Je sentis alors mes paupières s'alourdir, et une immense lassitude m'envahit. Les lamas ne me regardaient pas, ils regardaient un point loin au-dessus de moi. Je me forçai à rouvrir les yeux : je vis leur menton, leurs narines mais ne pus distinguer leurs yeux tant leur tête était renversée en arrière. Je me demandai ce qu'ils pouvaient bien regarder ainsi.
L'encens se mit à grésiller. Soudain j'eus l'impression que le temple bougeait, que les murs ondulaient. J'avais entendu parler des tremblements de terre et je crus que notre Potala était secoué par un séisme. La panique me prit et je dus faire de grands efforts pour rester immobile, de crainte de faire honte à mon Guide si je me relevais pour sortir précipitamment du temple alors que les lamas ne bougeaient pas.
Le balancement persista au point que j'en eus mal au cœur. Et puis il me sembla que j'étais soulevé de terre ; je vis approcher les poutres du plafond et je levai une main pour me protéger. À ma profonde surprise, ma main traversa la poutre sans même déranger la poussière qui la recouvrait.
Encore terrifié par ce mystère, je retombai rapidement et atterris aux pieds de la Statue Sacrée. Je tendis vraiment une main, sachant que mes jambes ne me soutiendraient pas mais, encore une fois, ma main traversa complètement la Statue, et mes jambes étaient fortes et fermes, je n'éprouvais nulle douleur, aucun inconfort. Je me retournai. Le groupe de lamas n'avait pas bougé. Si ! L'un d'eux avait quitté sa place. Il se tenait debout à côté de moi et une de ses mains me prenait le coude. Il me parut lumineux, plus grand que tout à l'heure et, levant les yeux vers la Statue Sacrée je vis aussi qu'elle semblait avoir grandi. La peur me crispa l'estomac, mais le lama me rassura en souriant.
— Ne crains rien, Lobsang, tu ne dois pas avoir peur. Viens avec moi.
Il me guida, une main tenant mon bras. Nous contournâmes le cercle des lamas. Je me retournai vers le centre du cercle mais il n'y avait rien ; mon corps n'était plus là. Je me tâtai avec précaution, mes membres me parurent solides, bien charnels. Furtivement, je touchai le lama qui m'accompagnait et sa chair était aussi réelle que la mienne. Il surprit mon geste et se mit à rire.
— Lobsang ! Lobsang ! Tu es maintenant dans un état différent avec ton corps. Seuls ceux qui possèdent la plus grande habileté occulte, une habileté innée, peuvent faire cela. Mais viens avec moi.
Nous nous dirigeâmes vers un des côtés du temple. Le mur approchait. Je m'arrachai à l'étreinte du lama et voulus me détourner, en m'exclamant :
— Non ! Nous allons nous faire du mal si nous continuons. Ce mur est épais, et dur !
Le lama me saisit de nouveau le bras :
— Viens, te dis-je ! Quand tu auras un peu plus d'expérience, tu verras comme tout cela est simple.
Il passa derrière moi, appliqua ses deux mains sur mes omoplates et me poussa. Le mur se dressait devant moi, une muraille grise aux pierres énormes. Il me poussa encore un peu, et alors j'éprouvai la sensation la plus extraordinaire de ma vie : je pénétrai sans effort dans l'épaisseur du mur ! Il me sembla que tout mon corps était chatouillé par des millions, des milliards de petites bulles qui rebondissaient et s'écrasaient contre moi sans me gêner, sans ralentir ma progression, mais provoquant une espèce de picotement plaisant. J'avançais sans la moindre difficulté, mais j'avais l'impression de marcher dans une tempête de sable ou de poussière qui cependant ne m'aveuglait pas ; je tendis les mains pour essayer d'attraper ce sable ou cette poussière, mais les grains infimes traversèrent mes paumes, ou le contraire, je ne sais. Derrière moi, le lama rit tout bas, en me poussant plus fort, et j'émergeai soudain de l'autre côté du mur, dans le corridor. Un vieillard surgit soudain, portant deux lampes à beurre et un objet quelconque sous le bras. Je voulus l'éviter, mais il était trop tard. Aussitôt je m'excusai de l'avoir bousculé ; cependant le vieillard passa son chemin. Il avait traversé mon corps sans s'en apercevoir ! Ou peut-être était-ce moi qui l'avais traversé — mais ni lui ni moi n'eûmes conscience de ce contact.
Guidé par le lama, je longeai des corridors, visitai avec lui des entrepôts et descendis à la cuisine.
Le vieux moine-cuisinier était là, assis sur un grand sac de cuir. Il se grattait et se curait les dents avec un brin de paille en grommelant :
— Aïe ! Il doit être temps de préparer le repas, je suppose. Quelle vie ! De la tsampa, encore de la tsampa, toujours de la tsampa, et tant de ventres à nourrir !
Nous repartîmes. Mes jambes m'obéissaient, je ne les sentais plus et, à vrai dire je ne pensais plus à mes blessures car je ne souffrais pas. Nous prenions soin de ne jamais troubler l'intimité des autres, nous ne pénétrâmes dans aucune cellule, aucun dortoir. Nous descendîmes ainsi jusqu'aux caves, jusqu'aux celliers et là nous vîmes mon vieil ami, Honorable Minou, couché de tout son long et profondément endormi. Il devait rêver, car ses pattes et ses moustaches frémissaient et ses oreilles étaient couchées. Nous approchâmes sans bruit, pensions-nous, mais soudain le chat se réveilla en sursaut, fit le gros dos, le poil hérissé, en crachant sa colère. Cela ne dura qu'un instant. Ses yeux louchèrent tandis qu'il regardait dans l'astral (comme peuvent le faire tous les chats) et il se mit à ronronner en me reconnaissant. Je voulus le caresser, mais naturellement ma main le traversa. Ce fut pour moi une bien remarquable sensation, car j'avais souvent caressé Honorable Minou et jamais encore ma main ne l'avait pénétré. Il parut aussi amusé que j'étais dérouté et me donna un petit coup de tête affectueux qui me traversa de part en part, et ce fut à son tour d'être surpris. Et puis il parut hausser les épaules, se recoucha en rond et se rendormit.
Pendant longtemps, nous errâmes dans la lamaserie, traversant les épaisses murailles de pierre, les planchers, les plafonds, jusqu'à ce que le lama me dise :
— Descendons, maintenant, car nous sommes allés assez loin pour une première fois.
Il me prit le bras et nous plongeâmes à travers le sol, émergeant sous un plafond, et ainsi descendîmes de plusieurs étages pour arriver enfin dans le couloir où se trouvait le temple. Une fois encore nous approchâmes du mur, mais je n'hésitai plus. J'avançai hardiment, traversai la muraille, et retrouvai les myriades de bulles et leur agréable picotement.
Les lamas étaient toujours assis en rond et celui qui m'avait guidé dans notre promenade me dit d'aller m'allonger de nouveau, à la même place. Je lui obéis, et au même instant je sombrai dans un profond sommeil.
Chapitre Huit
UNE CLOCHE tintait au loin, puis le son se rapprocha et elle se mit à sonner à toute volée. Bong ! Bong ! Bong ! Une cloche ? me dis-je, étonné. Et elle sonnait au même rythme que les battements de mon cœur ! La panique me prit. J'avais trop dormi, j'allais être en retard pour le premier office ! J'ouvris péniblement les yeux mais ne distinguai que neuf horribles taches blanches au sommet d'espèces de flammes couleur de safran. Où étais-je ? Que s'était-il passé ? Étais-je encore tombé du toit ? Reprenant conscience, j'éprouvai diverses douleurs aiguës dans le dos qui achevèrent de me réveiller.
Alors la mémoire me revint d'un coup et je vis que j'étais couché de tout mon long sur le sol dallé si froid, si froid ! Mon bol avait glissé et se trouvait entre mes omoplates. Mon sac d'orge — en cuir dur — s'enfonçait dans mes côtes. Je tournai lentement la tête ; les neuf lamas assis en rond me contemplaient. C'était EUX, les horribles taches blanches sur des flammes de safran ! J'espérai qu'ils ne pourraient connaître mes pensées.
— Mais SI, Lobsang, me dit l'un d'eux en souriant. Nous savons. Tes pensées télépathiques sont fort nettes. Mais relève-toi, lentement. Tu t'es fort bien conduit et tu as pleinement justifié la bonne opinion de ton Guide.
Je me relevai avec précaution, et reçus aussitôt un bon coup de tête. Le vieux chat me contourna en ronronnant et se frotta contre ma main pour se faire caresser. Distraitement, je glissai mes doigts sur son épaisse toison en m'efforçant de rassembler mes pensées et en me demandant ce qui allait encore m'arriver.
— Eh bien, Lobsang, il me semble que pour une première fois, tu as bien réussi à sortir de ton corps, me dit le lama qui m'avait accompagné dans mes pérégrinations. Nous devrons recommencer souvent, jusqu'à ce qu'il te soit aussi facile de te débarrasser de ton corps que de ta robe.
— Mais, Honorable Lama, protestai-je étonné, je n'ai PAS quitté mon corps ! Je l'ai emporté avec moi.
— Comment ? Que veux-tu dire ? s'exclama-t-il, stupéfait. Tu as voyagé en esprit avec moi !
— Honorable Lama, rétorquai-je, j'ai bien regardé le cercle et mon corps n'était pas là, il n'était pas couché par terre, alors j'ai bien dû l'emporter avec moi.
Le très vieux lama, le plus petit des neuf, me sourit.
— Tu commets une erreur fréquente, Lobsang. Car tes sens sont encore troublés.
Je me tournai vers lui. Très franchement, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il me disait, et il me sembla que c'était SES sens qui étaient troublés, car j'étais bien capable de savoir si j'avais vu ou non mon corps, et si je ne l'avais pas vu c'est qu'il n'était pas là. Sans doute devinèrent-ils à mon expression sceptique que je ne comprenais pas, car un autre lama intervint :
— Je vais te donner ma propre version de ces faits, Lobsang. Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire est élémentaire et pourtant cela trouble beaucoup de gens. Tu étais allongé par terre, et comme c'était la première fois que tu voyageais dans l'astral nous t'avons aidé, nous t'avons soutenu tandis que ta forme astrale échappait à ta forme physique, et parce que nous avons une grande expérience tu n'as rien senti, aucune secousse, aucun trouble. Par conséquent, il est évident que tu ne te rendais pas compte que tu quittais ton corps.
Je le regardai ahuri, mais je sentais qu'il avait raison. Oui... Je ne m'étais pas rendu compte que je quittais mon corps, personne ne m'avait prévenu. Mais pourtant je me souvenais bien d'avoir regardé le cercle et de n'y avoir rien vu ! Je secouai la tête pour m'éclaircir un peu les idées ; tout cela me semblait bien trop profond pour mon entendement. J'avais quitté mon corps, bon, et pourtant mon corps n'était pas resté couché là, donc s'il n'était pas là, où était-il pendant que je me promenais et pourquoi ne l'avais-je pas vu couché ici ou là ? À ce moment le vieux chat me donna un nouveau coup de tête et sauta sur mes genoux, enfonçant ses griffes dans ma robe en ronronnant, et se mit à me pétrir les jambes. Le lama qui venait de me parler éclata de rire.
— Tu vois ! Le vieux chat te dit de gratter ton cerveau et de le nettoyer afin de pouvoir percevoir les choses !
J'allongeai les mains et les passai à rebrousse-poil sur le dos du chat. Il ronronna de plus belle, et puis soudain il se laissa aller, de tout son poids. Sa tête pendait d'un côté de mes genoux, son arrière-train de l'autre, et sa queue s'allongeait sur le sol. Ces chats étaient plus grands que les chats ordinaires, ils étaient normalement féroces, mais tous nos chats de temples semblaient me reconnaître comme un frère ou quelque chose du genre, car j'étais certainement aussi populaire auprès d'eux qu'ils l'étaient auprès de moi.
— Laisse-le dormir, me dit le lama. Peut-être te donnera-t-il un bon coup de griffe de temps en temps pour réveiller ton attention. Bien ! Écoute-moi, à présent. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Souvent ils ne voient pas les choses les plus évidentes. Par exemple, me demanda-t-il en me regardant fixement, combien de balayeurs y avait-il dans le corridor quand tu y es passé ? Qui était celui qui balayait dans l'entrepôt à grain ? Et si le Père Abbé t'avait convoqué pour te demander de lui dire si tu avais vu quelqu'un dans le couloir intérieur, qu'aurais-tu répondu ?
Il attendit ma réponse mais comme je le dévisageais — bouche bée, j'en ai bien peur — il poursuivit :
— Tu lui aurais dit que tu n'avais vu personne dans le couloir intérieur parce que la personne qui y était avait parfaitement le droit d'y être, et y est toujours tellement à sa place, que tu ne pouvais la remarquer. Ainsi — tu aurais répondu que tu n'avais vu personne dans ce couloir.
Un autre lama prit la parole :
— Les Maîtres de Discipline ont parfois bien des difficultés quand ils font une enquête ; ils demandent si un étranger est venu, ou si quelqu'un est entré dans tel ou tel bâtiment, et invariablement le gardien de ce bâtiment leur répond qu'il n'a vu personne. Et pourtant de nombreuses personnes sont entrées et sorties, des Maîtres de Discipline, un ou deux lamas, un messager d'une autre lamaserie. Mais comme leur présence est normale, quotidienne, ils ne sont pas remarqués et, quant à être observés, ils pourraient aussi bien être invisibles.
L'un de ceux qui n'avait pas encore parlé hocha la tête :
— Oui, c'est exact. Je vais te demander, Lobsang, combien de fois tu es venu dans ce temple ? Souvent, je crois ? Et cependant, à en juger par ton expression tout à l'heure, tu n'avais jamais vu le socle sur lequel repose le cristal. Il est là depuis deux cents ans, il n'a jamais quitté ce temple et pourtant tu avais l'air de le voir pour la première fois. Il a toujours été là mais pour toi c'était un objet commun, usuel, par conséquent invisible.
Le lama qui m'avait accompagné dans ma promenade dans l'astral reprit :
— Toi, Lobsang, tu ignorais tout de ce qui se passait, tu ne savais pas que tu quittais ton corps, ainsi tu ne t'attendais pas à voir ton corps. Donc, quand tu as regardé, tu as vu les lamas assis en rond et ton attention s'est bien gardée de chercher ton corps. Il en est de même en hypnotisme ; nous pouvons hypnotiser une personne et lui faire croire qu'elle est absolument seule dans une pièce ; elle regarde autour d'elle, elle regarde tout sauf la personne qui se trouve dans la pièce avec elle. La personne hypnotisée, à son réveil, est prête à jurer qu'elle était seule, en toute sincérité. De même, tu as soigneusement évité de regarder l'endroit où ton corps était allongé, à la vue de tous. Tes yeux ont suivi le périmètre de notre cercle, ont fait le tour du temple mais n'ont pas regardé le seul endroit que tu croyais vouloir regarder.
Cela me donna vraiment à réfléchir ; j'avais déjà entendu parler de quelque chose comme cela, auparavant. J'avais vu une fois un vieux moine souffrant d'une migraine douloureuse. Il m'expliqua ensuite que les choses qu'il regardait n'étaient pas là ; s'il regardait une chose en face de lui, il ne pouvait voir que les choses de côté, mais s'il regardait de côté, il pouvait voir les choses en face de lui. Il me dit que c'était comme de regarder à travers une paire de tubes placés sur ses yeux, ce qui lui faisait l'effet de porter des œillères.
Un lama (je ne savais les différencier alors) me déclara :
— Les choses évidentes peuvent souvent rester invisibles parce que plus un objet est commun, familier, moins il est remarquable. Pense à l'homme qui nous apporte l'orge ; tu le vois tous les jours et pourtant tu ne le vois pas. Sa silhouette est si familière que si je te demandais qui est venu à la cuisine ce matin tu me répondrais ‘personne’, parce que tu ne considérerais pas le livreur d'orge comme une personne, mais comme une chose qui accomplit toujours la même action à la même heure.
Il me semblait bien extraordinaire que, étant allongé sur le sol, j'eusse été incapable de voir mon propre corps. Cependant, j'avais tellement entendu parler d'hypnotisme et de voyages dans l'astral que j'étais tout à fait capable d'accepter leurs explications. Le vieux lama parcheminé me sourit.
— Nous allons bientôt te donner une instruction particulière, afin que tu puisses quitter ton corps aisément à n'importe quel moment. Comme tout le monde, tu voyages dans l'astral chaque nuit, tu t'en vas dans de lointains endroits, et puis au matin tu les a oubliés. Mais nous voulons te montrer combien il est facile pour toi de quitter ton corps à ta guise, de voyager dans l'astral et d'en revenir en gardant le souvenir de tout ce que tu y as vu, de tout ce que tu y as fait. Si tu parviens à accomplir cela, tu pourras te rendre dans les grandes villes du monde et tu ne seras plus isolé ici, au Tibet, mais tu auras l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, de te familiariser avec d'autres cultures.
Je réfléchis à ce propos. Je m'étais souvent demandé comment certains des plus grands lamas pouvaient être aussi savants ; ils me paraissaient supérieurs, des Êtres à part, indifférents aux petites mesquineries de la vie quotidienne, capables de savoir ce qui se passait à tous moments dans n'importe quelle région de notre pays. Je me rappelai alors une visite que nous avions faite, mon Guide et moi. Nous nous étions rendus chez un vieillard à qui l'on m'avait présenté et nous avions causé ou, plutôt, mon Guide et lui s'étaient entretenus tandis que je les écoutais respectueusement. Soudain, le vieillard avait levé une main en disant : "On m'appelle !" Sur quoi il avait semblé se retirer, la lumière avait quitté son corps et il était resté immobile, comme un mort, comme une coquille vide. Mon Guide ne bougea pas, et me fit signe de l'imiter et de me taire. Les mains croisées sur les genoux, nous attendîmes longtemps, sans bouger, sans parler. Je considérai avec grand intérêt le vieillard apparemment mort, pendant dix minutes, vingt peut-être — il est difficile d'évaluer le temps dans ces circonstances — rien ne se passa. Enfin, le vieillard reprit des couleurs et s'agita en ouvrant les yeux. Alors — jamais je ne l'oublierai — il raconta à mon Guide ce qui se passait au même instant à Shigatse, une ville fort lointaine. Il me vint à l'idée que c'était un système de communications bien meilleur que tous les remarquables appareils qui existaient, disait-on, dans le monde occidental.
Je rêvais de pouvoir voyager dans l'astral, d'aller n'importe où à ma guise, de pouvoir franchir les montagnes, les mers, les océans, de visiter les pays étrangers. Et ces hommes, ces neuf lamas allaient me l'enseigner !
Le vieux chat bâilla, ses moustaches frémirent et il se releva pour s'étirer en faisant le gros dos, si haut que je crus qu'il allait se rompre l'échine. Enfin il sauta à terre et partit en passant avec arrogance entre deux lamas qu'il repoussa, et disparut dans les ténèbres derrière la Statue Sacrée. Le vieux lama parcheminé reprit la parole :
— Il est temps de mettre fin à cette séance, car nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons à Lobsang. Ce qui s'est passé n'est qu'un incident et nous devons reprendre nos travaux. Nous reverrons Lobsang au retour de son Guide.
Un autre lama se tourna vers moi et me dévisagea froidement :
— Il te faudra étudier avec beaucoup d'attention, Lobsang. Tu as beaucoup à faire dans la vie, tu auras des épreuves, de la souffrance, tu voyageras loin et souvent. Mais à la fin tu accompliras ce qui est ta tâche. Nous allons te donner la formation de base.
Ils se levèrent, allèrent chercher le cristal sur le socle et l'emportèrent hors du temple.
J'étais médusé. Une tâche ! Des épreuves ? Mais ne m'avait-on pas toujours dit que j'aurais une vie dure, une tâche à accomplir ? Alors pourquoi me le répéter ? Et puis, au fond, pourquoi devais-je accomplir cette tâche, quelle qu'elle fût, et pourquoi était-ce toujours moi qui devais souffrir ? Plus on m'en parlait, moins cela me plaisait. Cependant, j'avais grande envie de voyager dans l'astral et de voir toutes les choses dont j'avais entendu parler. Je me relevai péniblement, et marmonnai quelques paroles méchantes tandis que mes douleurs se réveillaient. J'avais des fourmis dans les jambes, quelques plaies et bosses, et une douleur aiguë dans le dos, là où mon bol avait soutenu mes omoplates. Songeant à ce désordre, j'arrangeai ma robe et remis mes pauvres biens à leur place accoutumée. Enfin, regardant une dernière fois autour de moi, je m'apprêtai à quitter le temple.
Sur le seuil, je fis rapidement demi-tour et me hâtai d'aller éteindre les lampes à beurre vacillantes. Je les mouchai toutes, car c'était mon devoir puisque j'étais le dernier à sortir. En retournant à tâtons vers la porte ouverte je faillis éternuer tant l'âcre senteur de beurre fondu et de mèche brûlée me piquait les narines. Dans un coin, une des lampes étincela un instant et s'éteignit.
Dans le couloir, j'hésitai et puis, ma décision prise, je tournai à droite. L'éclat des étoiles, par les fenêtres sans vitres, illuminait le corridor d'une lueur argentée. Je tournai au coin du couloir suivant et m'arrêtai soudain en me disant qu'ils avaient raison... Oui, naturellement ! Réfléchissant, je m'aperçus que j'étais bien souvent passé par ici devant un vieux moine assis dans une cellule. Je le voyais tous les jours et pourtant ne l'avais jamais remarqué. Je retournai sur mes pas et risquai un œil à la porte de la cellule. Il était là, assis par terre, aveugle, et faisait tourner inlassablement un grand Moulin à Prières. Quand on passait dans le couloir, on entendait toujours le cliquetis du Moulin du vieux moine aveugle, qui ne se taisait jamais. Il restait assis là, dans la même position, jour après jour, persuadé que sa tâche était de faire tourner le Moulin à Prières ; il ne vivait que pour cela, dans la crainte que le Moulin interrompît sa rotation perpétuelle. Nous qui passions si souvent, nous n'entendions plus le cliquetis, nous y étions si habitués que nous ne remarquions même pas le vieux moine.
Debout sur le seuil obscur, je remuai de vagues pensées tandis que le Moulin tournait en cliquetant et que le vieillard psalmodiait tout bas :
— Om ! Mani padme hum ! Om ! Mani padme hum !
Il avait la voix rauque, les mains noueuses. Je le distinguais à peine et lui ne pouvait me voir ; il tournait le Moulin, comme il l'avait toujours fait, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire avant ma naissance. ‘Pendant combien de temps pourra-t-il encore le tourner ?’ me demandai-je. Cependant, il m'avait permis de comprendre que les gens deviennent invisibles quand leur présence est si familière qu'on ne les remarque plus. Je compris aussi que les sons deviennent silence lorsqu'on y est trop habitué.
Je songeai à l'époque où j'avais été tout seul dans une cellule obscure et qu'au bout d'un certain temps j'avais perçu tous les sons de mon corps, le bouillonnement du sang dans mes veines et mes artères, et puis le battement régulier de mon cœur. J'entendais aussi, finalement, l'air passant dans mes poumons et les légers craquements de mes muscles et de mes os quand je changeais de position. Nous sommes de bruyantes mécaniques, pensai-je, et pourtant lorsque d'autres sons nous entourent, attirant notre attention, nous n'entendons pas ceux qui sont là en permanence.
Je me grattai la tête. Puis je me dis que la nuit devait être déjà fort avancée et que bientôt les trompettes sonneraient pour nous appeler à matines, à l'office de minuit. Je n'hésitai plus et, serrant ma robe autour de moi, je descendis au dortoir. Dès que je fus allongé sur le sol je sombrai dans un profond sommeil.
Je dormis peu cependant ; je me tournai et retournai, grognai et gémis, pensant à la Vie telle qu'elle était dans une lamaserie. Autour de moi, les garçons ronflaient, se retournaient, marmonnaient en dormant. L'un d'eux, qui souffrait des amygdales, émettait un curieux son gargouillant si bien que je finis par aller le retourner sur son côté. Je me recouchai et, allongé sur le dos, je me plongeai dans mes pensées. Je perçus au loin le cliquètement monotone d'un Moulin à prières qu'un moine faisait tourner inlassablement afin que ses prières fussent portées vers les cieux. J'entendis les sabots étouffés d'un cheval sur le chemin. La nuit n'en finissait pas, le temps semblait s'être arrêté. La vie était une éternité d'attente où rien ne bougeait, où le silence régnait, rompu seulement par le cliquetis d'un Moulin à Prières, des ronflements, le pas d'un cheval. Je dus m'assoupir...
Je me relevai péniblement. Le sol était dur, la pierre des dalles glacée. Près de moi, un garçon appelait sa mère, en dormant. J'allai à la fenêtre d'un pas raide, contournant soigneusement tous ces corps inertes. Le froid était intense, annonçant de la neige. Au-dessus de l'immense chaîne de l'Himalaya, l'aube se devinait à de vagues lueurs fugaces, avant de descendre avec des doigts de roses vers notre Vallée encaissée, pour la naissance d'un nouveau jour.
Les légers plumets de neige poudreuse voletant éternellement sur les hauts sommets se teignaient déjà d'or et sur les cimes scintillaient des arcs-en-ciel frissonnants que le vent déformait et reformait sans cesse. Soudain, des rayons de lumière éclatante jaillirent tandis que le soleil faisait son apparition au-dessus des cols vertigineux, apportant la promesse du jour. Les étoiles pâlirent. La voûte céleste n'était plus violette mais mauve, et puis grise, et enfin d'un bleu limpide et pâle. Toutes les montagnes étaient ourlées d'or tandis que le ciel s'éclaircissait de plus en plus. Lentement, le disque d'or du soleil s'éleva au-dessus des montagnes et inonda notre Vallée de ses rayons glorieux.
Le froid était intense. Des cristaux de glace tombèrent du ciel et s'écrasèrent sur le toit en tintant délicatement. L'air vif me pénétrait, me gelait la moelle des os. Quel singulier climat, pensai-je ; parfois il faisait trop froid pour qu'il neige, et souvent à midi, le même jour, la chaleur devenait intolérable. Et puis, en un clin d'œil, une tempête faisait rage et le vent emportait tout. Sur les montagnes, la neige était éternelle, elle était toujours là, profonde, mais sur les flancs exposés au midi, elle fondait aussi vite qu'elle tombait. Notre pays était situé à une très haute altitude, l'air était raréfié, l'atmosphère si limpide et claire qu'elle ne filtrait plus les rayons ultra-violets (ou générateurs de chaleur) du soleil. L'été, nous transpirions abondamment mais, si un nuage soudain cachait le soleil, la température baissait aussitôt au-dessous de zéro — et cela en quelques minutes.
Nous subissions souvent de grandes tempêtes de vent. La grande barrière de l'Himalaya retenait les nuées d'orage qui se formaient au-dessus de l'Inde, provoquant une inversion de la température. Alors, de terribles bourrasques dévalaient le flanc de la montagne et venaient tourbillonner dans notre Vallée, balayant tout devant elles. Les gens qui osaient sortir pendant une tempête devaient porter des masques de cuir, sinon leur visage risquait d'être complètement écorché, pelé par la poussière des rochers apportée par le vent des plus hauts sommets. Les voyageurs surpris sur la route, dans les cols, risquaient d'être emportés avec leurs tentes et leurs chameaux.
Tout en bas, dans la pâle lueur de l'aurore, un yak meugla tristement. Comme s'il avait lancé un signal, les trompettes retentirent sur le grand toit. Les conques gémirent et grondèrent, la montagne répercuta en désordre leurs échos, et je crus entendre la voix d'un orgue puissant. Autour de moi je perçus les mille sons divers d'une communauté qui s'éveille à la vie. Un chant psalmodié dans le grand Temple, le hennissement des chevaux, les marmonnements maussades des jeunes garçons grelottant dans l'air glacé et, en accompagnement incessant, le cliquetis des Moulins à Prières disséminés dans tous les bâtiments, que faisaient tourner éternellement de très, très vieux moines qui pensaient que c'était là leur unique raison de vivre.
Toute la lamaserie s'éveillait. D'instant en instant l'activité allait croissant. Des têtes rasées apparaissaient aux fenêtres, dans l'espoir d'une journée plus chaude. Une chose noire, informe, tomba du ciel et passa sous mes yeux pour aller s'écraser sur les rochers, au pied des murs. Un bol, pensai-je, et maintenant celui qui l'a perdu devra se passer de petit déjeuner jusqu'à ce qu'il s'en procure un autre. Le déjeuner ? Mais naturellement ! Une nouvelle journée commençait, et j'aurais sans doute besoin de toutes mes forces car j'espérais bien que cette journée verrait revenir mon Guide, et avant que je puisse le voir il y aurait la classe, l'office dans le temple — mais avant tout — le petit DÉJEUNER !
La tsampa est un ragoût bien peu appétissant mais je n'avais rien mangé d'autre, à part quelques confiseries venues de l'Inde, et cela bien rarement. Je suivis donc mes camarades dans le couloir, et notre petite troupe fut bientôt rejointe par des moines sortant des cellules.
A l'entrée du réfectoire, j'attendis un moment que tout le monde soit assis, car je marchais si difficilement que j'avais toujours peur d'être renversé dans la foule. J'entrai finalement et pris ma place parmi les hommes et les petits garçons assis par terre, les jambes croisées (tous sauf moi, assis les jambes repliées sous moi). Nous étions nombreux, au moins deux cent cinquante, à la fois assis en rang. Des moines-serveurs vinrent remplir nos bols de tsampa, passant entre les rangées avec leurs chaudrons et leurs grandes louches, distribuant des portions équitables à chacun. Mais avant de manger nous devions attendre le signal du Maître de Service. Enfin, lorsque tout le monde fut servi, un vieux lama monta sur l'estrade.
Il nous contempla un moment, puis il souleva le premier feuillet de son livre ; nos pages, je dois le dire, étaient de très longues feuilles de papier qui n'étaient pas réunies ensemble ni reliées comme les livres occidentaux. Ce lama souleva le premier feuillet et fit signe au Maître qu'il était prêt. Le Maître de Service leva alors la main et l'abaissa ; nous pouvions commencer à manger. Le Lecteur commença alors sa lecture des Livres Sacrés d'une voix monotone qui se répercutait dans l'immense salle voûtée et rendait une grande partie de ce qu'il disait inintelligible.
Autour du réfectoire, les Maîtres de Discipline omniprésents allaient et venaient, en silence.
Il était d'usage, dans toutes les lamaseries du Tibet, qu'un Lecteur nous fît la lecture pendant les repas, car une personne ne devait jamais penser à ce qu'elle mangeait ; la nourriture était une chose grossière, une simple nécessité du corps afin de le soutenir pendant qu'il était habité par l'esprit immortel. Il était donc nécessaire de manger, mais nous n'avions pas le droit d'y trouver plaisir. Le Lecteur lisait donc les Livres Sacrés, afin qu'alors que notre corps se nourrissait, notre esprit pût se nourrir aussi.
Les lamas supérieurs prenaient toujours leurs repas seuls, pensant généralement à quelque texte sacré ou contemplant quelque objet ou livre sacré. C'était une offense grave que de parler pendant que l'on mangeait, et le malheureux enfant dissipé surpris à bavarder était immédiatement attrapé par les Maîtres de Discipline et forcé de se coucher en travers du seuil afin que chacun fût obligé de l'enjamber, ce qui était une grande honte pour la victime.
Nous, les enfants, avions toujours fini les premiers, mais nous devions attendre que tout le monde eût terminé son repas. Il arrivait souvent que le Lecteur continuât de lire sans s'apercevoir que tout le monde attendait. Alors nous étions en retard pour la classe, par sa faute.
Enfin le Lecteur termina sa page et leva des yeux surpris, puis se tourna vers le feuillet suivant mais se ravisa, et enveloppa le livre dans une étoffe qu'il noua soigneusement ; soulevant le livre il le tendit à un moine-serviteur qui le prit, se prosterna et l'emporta. Le Maître de Service frappa alors des mains. Nous pouvions sortir, mais pas avant d'être allés nettoyer nos bols dans le coin de la salle où se trouvaient les grands sacs de cuir pleins de sable fin. Ces bols étaient notre unique ustensile car nous mangions avec les doigts, naturellement — le plus vieil ustensile du monde ! — et n'avions besoin ni de couteaux ni de fourchettes.
— Lobsang ! Lobsang ! Descends chez le Maître du Papier et rapporte-moi trois feuilles qui aient été souillées sur une face.
Un jeune lama se tenait devant moi et me donnait cet ordre. Je marmonnai, mais obéis. J'avais horreur de ces missions car je devais descendre jusqu'au village de Shö où se trouvait le Maître Imprimeur et obtenir le papier voulu.
Le papier était une chose rare, au Tibet, fort coûteuse et entièrement faite à la main, bien sûr. Le papier était traité comme un objet religieux mineur et sacré, parce que presque toujours il était utilisé pour la connaissance sacrée, les paroles sacrées, et ainsi il n'était jamais mal employé, ni jamais jeté. Si, alors qu'on imprimait un livre un feuillet était souillé, on ne le jetait pas, et la face intacte servait aux leçons des jeunes garçons. Le papier souillé ne manquait pas, car nous imprimions avec des blocs de bois sculptés à la main et naturellement ces blocs devaient être gravés à l'envers pour être en mesure d'imprimer dans le bon sens. Ainsi, en essayant les blocs on gâchait évidemment beaucoup de papier.
Je sortis du Potala par la petite porte de derrière donnant sur un chemin abrupt mais bien plus court, et où il n'y avait pas de marches ni d'escalier que je ne pourrais descendre ou gravir qu'avec difficulté. Mes camarades et moi empruntions toujours ce sentier et nous descendions en nous cramponnant aux buissons, et si nous trébuchions nous glissions jusqu'en bas dans un nuage de poussière, déchirant notre robe en lambeaux, ce que nous avions bien du mal à expliquer plus tard.
Je descendis donc par ce sentier étroit bordé de buissons. Arrivé à une petite clairière je m'arrêtai et me tournai dans la direction de Lhassa, espérant distinguer une robe safran très spéciale sur le Pont de Turquoises ou peut-être — quelle joie ! — montant déjà par la Route de l'Anneau. Mais il n'y avait que des pèlerins, quelques moines et deux ou trois lamas sans intérêt. Avec un soupir déçu, je repris mon chemin précaire.
J'arrivai enfin à la Cour de Justice derrière laquelle se trouvait l'Imprimerie. À l'intérieur je vis un très vieux moine aux doigts spatulés couverts d'encre. J'entrai et regardai autour de moi avec curiosité car l'odeur du papier et de l'encre m'avait toujours fasciné. J'examinai les blocs de bois artistement gravés que l'on emploierait pour imprimer de nouveaux livres, et je songeai avec quelque impatience au jour où j'aurais l'occasion de faire de la gravure, car c'était un art qui me plaisait énormément et, chez nous, tous les moines devaient exercer leurs talents pour le bien de la communauté.
— Eh bien, mon garçon ! Que veux-tu ? Vite ! Qu'est-ce que c'est ?
Le vieux moine-imprimeur me regardait sévèrement, mais je le connaissais depuis longtemps et s'il aboyait il ne mordait pas ; c'était au contraire un très brave homme, un bon vieillard qui avait simplement peur que les petits garçons que nous étions gâchent son précieux papier. Je lui fis part de ma requête. Il grogna, me tourna le dos et fouilla dans tous les coins, prenant une feuille et la rejetant comme s'il ne pouvait supporter d'avoir à se séparer de ses précieux papiers. Je finis par me lasser, je ramassai trois feuilles au hasard et lui dis :
— Merci, Honorable Imprimeur, j'ai mes trois feuilles. Celles-ci feront l'affaire.
Il pivota sur lui-même et me regarda, la bouche ouverte, l'image même de la stupéfaction. Mais j'étais déjà dehors avec mes trois feuilles, et quand il se remit suffisamment de son émotion pour protester, j'étais loin.
Je roulai soigneusement les trois feuilles, la face souillée à l'extérieur, les glissai sous ma robe et repartis lentement, en m'accrochant aux buissons.
Arrivé à la clairière je fis de nouveau halte, en principe pour reprendre haleine, mais en réalité pour regarder dans la direction de Sera, la Barrière de Roses. Je ne vis que des pèlerins, des colporteurs, un peu plus que d'ordinaire, peut-être, mais je n'aperçus pas celui que j'attendais si ardemment.
Je repartis enfin, rentrai par la petite porte et cherchai le jeune lama qui m'avait demandé les feuilles.
Il était seul dans une salle et je vis qu'il écrivait. Je lui tendis le papier sans un mot.
— Ah, dit-il. Tu as été bien long. As-tu fabriqué le papier ?
Ce furent là tous ses remerciements. Je le laissai donc et montai vers les salles de classe, en me disant qu'il me faudrait bien passer ma journée d'une façon ou d'une autre en attendant le retour de mon Guide.
Chapitre Neuf
DEBOUT sur le toit du magasin à provisions, je pouvais contempler toute la Vallée de Lhassa, avec ses champs et ses prés verts, ses maisons de toutes les couleurs, et le bleu du Pont de Turquoises. Plus loin, le toit d'or de la Cathédrale de Lhassa luisait au soleil, majestueux, résistant depuis des siècles à toutes les tempêtes. Derrière moi coulait la Rivière Heureuse et au-delà se dressait le cirque des montagnes altières avec leurs cols vertigineux, leurs gorges, leurs crevasses et leurs chemins montant de plus en plus haut pour redescendre vers l'Inde, le Népal, le Sikkim. Mais je connaissais tout cela. Pour le moment, je n'avais d'yeux que pour la Ville de Lhassa.
À mes pieds, sur la droite, s'ouvrait la Porte Occidentale, l'entrée principale de la ville sainte où se pressait comme toujours une foule de mendiants quêtant des aumônes, de pèlerins espérant entrevoir le Saint Homme et obtenir sa bénédiction, de colporteurs, de marchands. Une main sur les yeux pour les abriter du soleil brûlant, j'entendais monter leurs voix dans l'air léger si pur :
— La charité ! La charité pour l'amour de notre Saint Homme ! La charité afin que vous soyez secourus !
Et aussi :
— Dix roupies seulement ! Une affaire en or ! Dix roupies indiennes pour cette merveille qui vaut dix fois plus ! Non ! Vous me plaisez, messeigneurs, disons neuf roupies. Vous me donnez neuf roupies maintenant, ceci est à vous et nous nous séparons bons amis !
Sur la Route de l'Anneau, les pèlerins montaient lentement, en s'arrêtant pour se prosterner face contre terre et repartir pour se prosterner encore, comme si ce mode de locomotion singulier allait leur apporter le salut. D'autres marchaient bien droit, contemplaient les sculptures dans la roche, ces rochers de couleurs diverses ressemblant à des statues, qui sont une des curiosités de nos montagnes. J'entendis l'un d'eux s'exclamer respectueusement :
— Il y a quelqu'un sur le toit qui nous observe ! Crois-tu que ce soit un lama ?
J'éclatai de rire. Moi, un petit garçon dont la robe en lambeaux volait au vent, on pouvait me prendre pour un lama ! Pas encore, messeigneurs, pas encore, mais je le deviendrai un jour !
Tout en progressant, les pèlerins ne cessaient de murmurer leur éternelle prière :
— Om ! Mani padme hum !
Les colporteurs s'efforçaient de leur vendre des amulettes, des moulins à prières, des horoscopes. Tous ces objets étaient fabriqués en Inde et apportés ici par-delà les montagnes, mais les pèlerins l'ignoraient, tout comme ils ne pouvaient se douter que ces objets de piété n'avaient pas été bénis comme on le leur affirmait. Mais n'en est-il pas de même dans tous les pays, dans toutes les religions ? Les marchands ne sont-ils pas semblables partout dans le monde ?
De mon haut perchoir, le regard fixé sur Lhassa, je m'efforçais de pénétrer la brume légère formée par la fumée des feux de bouse de yak allumés pour réchauffer les maisons, car soudain il faisait frais. Le temps empirait certainement. Je levai les yeux vers les nuages que le vent chassait dans le ciel ; ils paraissaient chargés de neige et je frissonnai. Parfois, il faisait remarquablement chaud, peut-être 40 degrés Fahrenheit (4,4 °C) à ce moment de la journée, mais à la tombée de la nuit la température baisserait bien au-dessous du point de congélation. Cependant, tourné vers Lhassa, je ne me souciais guère du climat.
Je m'accoudai au parapet, m'appuyai de tout mon poids pour soulager mes jambes douloureuses et j'écarquillai les yeux pour tenter de percer la brume ; je regardai ainsi fixement la route de Lhassa, jusqu'à ce que mes yeux n'en puissent plus, à force de guetter ce que je désirais voir. Soudain je sursautai, le cœur battant de joie ; un lama en robe safran étincelante venait d'apparaître. Je fis un tel bond que mes faibles jambes me trahirent et je tombai à la renverse ; je restai immobile pendant quelques secondes, le souffle coupé, et puis je me relevai tant bien que mal et me penchai au parapet. Je fus alors bien déçu. Le lama en robe safran n'était pas celui que j'attendais. Je suivis des yeux son cortège, le vis franchir un portique, et suivre la Route de l'Anneau où les pèlerins se prosternèrent sur son passage. Au bout d'une demi-heure il apparut enfin sur le chemin, à mes pieds ; il leva les yeux, m'aperçut et m'adressa de grands gestes par lesquels je compris que mon Guide n'allait plus tarder.
Je fus profondément ému par tant de bonté, car les grands lamas ne faisaient guère attention aux petits garçons, en général ; cependant, j'avais déjà pu constater qu'il y avait lamas ET lamas — certains étaient austères, hautains, enfermés dans leur solitude et leur sévérité, alors que d'autres étaient joyeux et toujours prêts à aider un autre peu importe son rang, son âge, ou sa situation dans la vie ; qui pouvait dire quel était le meilleur, de l'ascète ou de l'homme compatissant ? Je préférais naturellement celui qui savait comprendre les malheurs et les souffrances des petits garçons.
D'une des plus hautes fenêtres, une fenêtre que je ne pouvais atteindre car je n'étais qu'un acolyte, une tête jaillit, qui regarda en bas ; la figure portait une moustache. Je m'inclinai respectueusement et quand je me relevai, la tête avait disparu. Pendant quelques instants, je méditai, espérant que je n'avais troublé ni irrité personne en montant sur ce toit. À ma connaissance, je n'enfreignais aucune règle, car j'avais pris la ferme résolution de ne rien faire de mal ou de défendu qui risquât de retarder l'instant béni où je retrouverais enfin mon Guide.
Par-delà le Chakpori, un peu plus élevé, j'apercevais des moines vaquant à leurs tâches ; certains semblaient marcher en procession tout autour des murailles, sans doute pour rendre grâce parce qu'un nouveau chargement d'herbes venait d'arriver sans encombre des hauts plateaux où ils croissaient. Je savais qu'un groupe de moines étaient partis comme chaque année cueillir des simples et qu'ils étaient récemment redescendus de ces hauteurs ; j'espérais pouvoir participer, un jour prochain, à ces excursions.
J'aperçus au loin une traînée de fumée. Quelques hommes allaient et venaient près d'un feu ; sans doute faisaient-ils bouillir le thé pour la tsampa. C'était certainement des marchands car ils portaient des toques de fourrure, et il n'y avait pas une seule robe de couleur vive parmi eux. Le vent fraîchissait encore. En bas, dans la Vallée, les colporteurs rassemblaient précipitamment leurs marchandises et couraient se mettre à l'abri. Les pèlerins se tassaient contre la montagne, et les mendiants eux-mêmes, oubliant leurs prétendues infirmités, bondissaient çà et là pour échapper à la tempête de sable, ou plutôt, à la tempête de poussière.
La Vallée de Lhassa était souvent nettoyée par ces bourrasques soudaines qui descendaient en trombe des sommets, chassant tout devant elles. Seuls les plus solides rochers demeuraient en place. La poussière, le sable, les cailloux, tout était emporté, mais chacun de ces grands vents nous apportait du sable propre et un poudroiement de pierre venant des grands rochers des hautes montagnes.
La tempête s'était levée si brusquement que je n'aurais pu trouver un abri, même si j'avais voulu quitter mon poste de guet. Le vent me plaquait contre le parapet avec une telle force, que je ne pouvais bouger. Je m'y cramponnai donc et cherchai à me laisser glisser au sol afin de n'être qu'une petite boule sur le toit que le vent ne pourrait soulever. Péniblement, je pliai les genoux, avec d'infinies précautions je m'accroupis et me pelotonnai sur moi-même, la figure protégée du vent chargé de pierraille.
Pendant quelques minutes, les rafales hurlèrent et glapirent comme si elles cherchaient à déraciner la montagne. Leur rugissement était plus violent encore que le son des trompettes. Mais soudain la rage des éléments se calma, et ce fut le silence, un silence étrange, surnaturel, le calme plat. Et j'entendis alors un rire léger, un rire de fille montant des buissons au pied du bâtiment.
— Ah ! dit-elle. Oh non ! Pas ici dans ce lieu Saint. Ce serait un sacrilège !
Puis elle pouffa de rire, et je vis un jeune homme et une fille apparaître, se tenant par la main, qui marchèrent vers la Porte Occidentale. Je les suivis des yeux, distraitement, et puis ils disparurent à ma vue.
Je me retournai vers Lhassa mais la tempête qui venait de nous quitter faisait maintenant rage sur la Ville Sainte. L'horizon était bouché ; je ne voyais qu'un grand nuage recouvrant tout comme une immense couverture grise. Ce nuage se déplaçait rapidement, pourtant, comme si deux Dieux tenaient chacun une extrémité de la couverture et l'emportaient en courant. Peu à peu, des bâtiments émergèrent, et puis j'aperçus le monastère des femmes, au-delà de Lhassa, et le nuage disparut vers le fond de la Vallée, de plus en plus petit, tandis que le vent s'essoufflait et laissait enfin tomber les particules de poussière et de sable.
Mais c'était la route de Lhassa que je regardais avec attention, et non une espèce de nuage stupide que je pouvais voir tous les jours ou presque. Je me frottai les yeux, j'essayai de me forcer à distinguer autre chose que ce qui était réellement là, et finalement je remarquai un petit groupe d'hommes émergeant d'un bâtiment. Certains portaient la robe safran. Ils étaient trop loin pour que je puisse reconnaître les visages mais je savais — je savais !
Le cœur battant, je suivis des yeux le petit cortège. Ces hommes progressaient lentement, dignement, à cheval. Peu à peu leurs silhouettes se précisèrent, ils atteignirent l'entrée du Pont de Turquoises et me furent cachés par ce magnifique ouvrage d'art jusqu'à ce qu'ils ressortent sur l'autre berge.
Écarquillant les yeux, je m'efforçai de distinguer chaque silhouette, en trépignant d'impatience. Ils avançaient avec une lenteur désespérante ! Enfin mon cœur fit un bond. J'aurais reconnu entre mille cette robe safran ! J'aurais voulu danser de joie, mais naturellement mes jambes ne me le permettaient pas, aussi me cramponnai-je au parapet pour maîtriser mes tremblements de bonheur.
La petite cavalcade approchait, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'elle me soit cachée par les plus hauts bâtiments du village de Shö. J'entendais à présent le claquement des sabots des chevaux, le grincement des harnais de cuir.
Haussé sur la pointe des pieds, je m'efforçai de mieux voir. En me penchant sur le parapet, j'aperçus des têtes suivant le chemin sinueux menant à la porte principale. L'une d'elles, surmontant une robe safran, se renversa, un visage me regarda, une main se leva amicalement. Pétrifié, tremblant d'excitation et de soulagement, je fus incapable de répondre à ce salut. Mon Guide était là !
Quelques paroles furent murmurées à un autre lama qui leva les yeux à son tour et sourit. Cette fois je parvins à répondre, mais l'émotion me serrait le cœur, je sentais les larmes me gagner et je craignis de m'effondrer, prouvant ainsi que je n'étais pas encore un homme.
La petite cavalcade monta, de plus en plus haut, vers l'entrée principale du Potala, la seule qui fût digne d'aussi augustes visiteurs. Je savais que je devrais attendre ; mon Guide avait son rapport à faire au Grand Initié, et puis il serait conduit dans ses appartements au sommet du Potala, où, après s'être installé, il enverrait quelqu'un à ma recherche.
Je m'écartai du parapet, époussetai mes mains et mes genoux, m'assurai que ma robe était à peu près présentable, puis je me dirigeai vers la petite maison sur le toit, y pénétrai et, avec mille précautions, entrepris de descendre à l'étage au-dessous par l'échelle. Il fallait être là, tout près, quand le messager viendrait me chercher, et je tenais à avoir le temps de mettre un peu d'ordre dans ma tenue.
Nos échelles étaient dangereuses même pour ceux qui avaient les jambes solides, ce qui n'était pas mon cas. Elles étaient faites d'un poteau vertical, lisse et poli, avec des entailles de chaque côté qui servaient de marches ; on mettait son pied gauche dans une de ces entailles, son pied droit dans une autre de l'autre côté et l'on grimpait ainsi, le poteau entre les jambes. Si l'on ne prenait pas garde, ou si le poteau était mal scellé, on risquait de glisser, à la grande joie des plus petits garçons. Ces échelles étaient d'autant plus périlleuses que si l'on y montait la nuit avec une lampe, le beurre fondu coulait sur les entailles et les rendait terriblement glissantes. Mais à ce moment, je ne pensais pas à ces périls. J'arrivai au sol sans encombre, m'époussetai de nouveau, soigneusement, grattai sur ma robe quelques taches de beurre figé, puis je descendis vers le dortoir des garçons.
J'allai tout droit à la fenêtre, je regardai dehors avec impatience, je me soulevai sur les coudes, je cherchai à passer le temps de mon mieux, mais il n'y avait plus rien à voir dehors puisque celui que j'avais attendu était entré dans la lamaserie.
Au Tibet, nous n'avions pas de miroirs — en principe, car ils étaient considérés comme des objets de vanité ; toute personne surprise devant un miroir était accusée de songer aux plaisirs de la chair plutôt qu'aux joies de l'esprit. Il nous était facile d'obéir à cette règle puisque aucun miroir n'existait au Potala ! Cependant, je désirais ardemment voir quel aspect je présentais, aussi descendis-je furtivement vers un des petits temples où je savais trouver une plaque de cuivre poli. Elle était si brillante que, après avoir passé dessus plusieurs fois un pan de ma robe, je pus me contempler des pieds à la tête. Ce spectacle me découragea, aussi partis-je à la recherche du moine-barbier, car j'avais l'impression de ressembler à une ‘Tête Noire’.
Au Tibet, ceux que l'on appelle ‘Têtes Noires’ sont les gens qui n'appartiennent pas aux Ordres religieux. Les moines, les acolytes, les trappas, les lamas ont tous le crâne rasé et sont souvent appelés ‘Têtes Rouges’ parce que le soleil est sans pitié pour cette partie exposée de leur anatomie. Les gens du commun, les laïcs, ont la tête recouverte d'épais cheveux noirs, d'où ce sobriquet. Il est bon de faire observer qu'en parlant des grands lamas nous disions simplement les ‘Robes Safran’, jamais ‘le porteur de la robe safran’ ; de même, nous parlions des ‘Robes Rouges’ ou des ‘Robes Grises’ en parlant de celui qui les portait parce que la robe indiquait le rang. De toute évidence, dans notre logique tibétaine, il devait y avoir une personne dans la robe, sinon elle n'aurait pu se déplacer seule !
Je descendis de plus en plus profondément dans les entrailles du Potala, par les corridors en pente, jusqu'à ce que j'arrive enfin à la grande salle dans laquelle officiait le moine-barbier. On l'appelait moine par courtoisie, sans doute, car il me semblait qu'il ne quittait jamais cette salle et n'assistait certainement jamais à aucun office. Comme toujours, elle était pleine de badauds et d'oisifs, de moines paresseux semblables à ceux qui passaient leur vie à la cuisine, perdant leur temps et celui des autres. Mais aujourd'hui la salle me parut particulièrement animée, et je cherchai la raison de cette excitation générale.
Sur un banc, je vis une pile de magazines jaunis, écornés, déchirés. Je crus comprendre qu'un des moines avait rendu un service quelconque à un groupe de marchands qui, par pure bonté d'âme, l'avaient remercié en lui faisant cadeau d'une collection de magazines et de journaux qu'ils avaient rapportés de l'Inde pour diverses raisons. Il y avait foule dans la salle du moine-barbier et tout le monde semblait attendre avec impatience un moine qui avait séjourné en Inde et pourrait sans doute comprendre et expliquer ce qui était écrit dans ces magazines.
Deux moines riaient et se poussaient du coude en regardant des images. L'un d'eux dit à l'autre :
— Nous allons demander à Lobsang de nous expliquer cela, il doit être un expert ! Viens par ici, Lobsang !
Je m'approchai d'eux et pris le magazine mais ils éclatèrent de rire.
— Tu le tiens à l'envers ! Tu ne sais même pas comment le regarder !
Je rougis de honte, car il avait raison. Je m'assis près d'eux et contemplai une image extraordinaire. Elle était de couleur brune, sépia, je crois qu'on l'appelle, et représentait une femme fort étrange. Elle était assise sur une table haute, devant une table encore plus haute sur laquelle il y avait une espèce de cadre ou de châssis dans lequel on voyait une image de cette même femme.
Sa robe m'intrigua fort, car elle semblait plus longue qu'une robe de moine. Elle avait une taille remarquablement fine qui paraissait être serrée par une ceinture qui la faisait paraître plus fine encore, mais pourtant ses bras étaient dodus, et quand je regardai sa poitrine je me sentis de nouveau rougir, car la robe était extraordinairement décolletée et je m'aperçus à ma honte que je songeais à ce qui pourrait se passer si elle se penchait. Mais sur cette image elle était assise toute droite.
Alors que nous contemplions cette image, médusés, un autre moine s'approcha et vint se tenir derrière nous. Une voix s'exclama :
— Que peut-elle bien faire ?
Le moine qui venait d'entrer s'accroupit pour lire ce qui était écrit sous l'image, puis il se releva et nous déclara avec importance :
— Elle se maquille, tout simplement ; elle met du rouge à lèvres et quand elle aura fini, elle se fera les sourcils. C'est une réclame pour des produits cosmétiques.
Je fus stupéfait au-delà de tout entendement. Maquiller ? Rouge à lèvres ? Faire les sourcils ? Cosmétiques ? Je me retournai vers le moine derrière moi qui savait lire l'anglais et demandai :
— Mais pourquoi veut-elle marquer l'endroit où se trouve sa bouche ? Ne sait-elle pas où elle est ?
Il me rit au nez.
— Certaines de ces personnes se teignent la bouche en rouge vif, orangé, ou rose, parce qu'elles pensent qu'ainsi elles seront plus jolies. Et ensuite elles passent un crayon brun sur leurs sourcils et une couleur quelconque sur leurs paupières. Et quand elles ont fini de dessiner leur figure elles la couvrent de poussière rose, ou beige, ou blanche.
Tout cela me paraissait bien incompréhensible.
— Mais pourquoi sa robe ne recouvre-t-elle pas le haut de son corps ?
À cela, tout le monde éclata de rire, le moine qui parlait anglais plus fort que les autres.
— Si tu pouvais voir ces Occidentales, dans les soirées, tu t'apercevrais qu'elles portent très peu d'étoffe sur la poitrine, mais beaucoup au-dessous de la ceinture.
Je me retournai, contemplai attentivement l'image en m'efforçant de comprendre. Je ne voyais pas du tout comment une femme pouvait aller et venir vêtue de manière aussi encombrante. Elle semblait ne pas avoir de pieds, car l'étoffe descendait jusqu'au sol et traînait par terre derrière elle. Cependant, j'oubliai bientôt cette dame lorsque le moine qui parlait anglais se mit à commenter d'autres magazines.
— Voyez celui-ci, il est daté de 1915. Il y a une très grande guerre en Occident, qui risque de se répandre dans le monde entier. Des hommes se battent, s'entretuent, et creusent des trous dans la terre, où ils restent, et quand les pluies arrivent ils manquent de se noyer.
— Quelle est la raison de cette guerre ? demanda un autre moine.
— Oh, peu importe, les Occidentaux n'ont pas besoin de raisons pour se battre, ils font la guerre, c'est tout.
Il prit un autre magazine et tourna les pages. Une des images représentait une chose fort remarquable, comme une grande boîte de fer qui semblait courir sur le sol en écrasant des soldats qui cherchaient à fuir.
— C'est la dernière invention, nous dit le moine qui lisait l'anglais. On l'appelle un tank, et c'est peut-être un objet qui permettra de gagner la guerre.
Nous regardâmes les images en songeant à la guerre, à toutes les âmes blessées tandis que leur corps physique était détruit. Je pensai au nombre de bâtonnets d'encens qu'il faudrait brûler pour aider toutes ces âmes errantes.
— Je vois que les Anglais forment un nouveau bataillon de Gurkhas, reprit le moine traducteur. Mais ils n'ont jamais pensé à solliciter l'assistance spirituelle du Tibet.
Je m'en félicitai secrètement car je ne voyais pas du tout le sens de cette tuerie, de ces effusions de sang, de ces souffrances inutiles. Je trouvais parfaitement stupide que les adultes en vinssent aux mains parce qu'un groupe de personnes ne parvenait pas à s'entendre avec un autre groupe. Je soupirai et hochai la tête tristement à la pensée que mon destin malheureux serait de voyager plus tard dans le monde occidental. Tout cela était prévu, mon avenir m'avait été clairement prédit, mais je n'aimais pas du tout ce que l'on m'annonçait car la vie semblait me réserver bien trop de souffrances.
— Lobsang ! rugit une voix.
Je levai les yeux et vis le moine-barbier qui me faisait signe de venir m'asseoir sur le tabouret à trois pieds. J'obéis, et il saisit la longue lame acérée avec laquelle il nous rasait la tête. Il n'employait ni eau ni savon, naturellement ; il aiguisa rapidement la lame du rasoir sur une pierre et puis, maintenant fermement ma tête de sa main gauche, il se mit à me râper le crâne. Aucun de nous n'appréciait ce procédé et nous étions tous certains de sortir des mains du barbier le crâne en sang, la peau arrachée. Cependant les Tibétains sont stoïques et ne s'enfuient pas en hurlant à la moindre douleur. J'attendis donc patiemment et me laissai faire.
— Je suppose que je dois aussi te raser le cou, me dit le moine-barbier. Il paraît que ton Guide est de retour, alors tu vas vouloir partir rapidement, hein ?
Sur quoi il me poussa la tête presque sur mes genoux, et rasa soigneusement ma nuque. À chaque coup de rasoir il se penchait pour souffler sur les petits cheveux coupés et à chaque fois — si je parvenais à le deviner ! — je retenais ma respiration parce que son haleine n'avait rien de parfumé ; il devait avoir les dents gâtées, ou je ne sais quoi. Enfin il donna un dernier coup de rasoir et m'aida à éponger le sang de mes nombreuses coupures.
— Le meilleur moyen, conseilla un des moines oisifs, c'est de coller un morceau de papier sur chaque blessure. Essayons donc !
Ce qui fut fait, si bien que je finis par ressembler à un épouvantail avec une multitude de petites cornes de papier collées aux écorchures.
Comme je n'avais rien de mieux à faire pour le moment, je restai dans la salle du barbier pour écouter les conversations. À ce que l'on disait, le monde occidental était bien troublé, tous les pays à feu et à sang. Il semblait qu'en Russie des événements étranges se déroulaient, que les Anglais avaient des ennuis, que les Irlandais se soulevaient... Apparemment, seul le Tibet restait en paix. Je me souvins alors des prophéties concernant le Tibet, connues depuis des siècles, et je savais que dans notre temps, durant ma vie en fait, nous du Tibet aurions nos propres problèmes. Je savais aussi que notre propre Dalaï-Lama bien-aimé serait le dernier véritable Dalaï-Lama et, bien qu'il y en ait un autre à venir, il n'aurait plus la même signification spirituelle.
Distraitement, je tournai une page d'un de ces magazines et découvris une image parfaitement extraordinaire ; elle représentait, me semblait-il, une multitude de boîtes avec des trous découpés dans les côtés par lesquels on voyait des visages ; les boîtes étaient attachées les unes aux autres et semblaient être traînées sur le sol par une espèce de monstre vomissant de la fumée. Sous les boîtes, il y avait des cercles réunis par deux traits. Je ne pouvais imaginer ce que c'était. À cette époque, je ne savais pas que ces cercles étaient des roues ni que je regardais un train, car au Tibet les seules choses rondes qui tournaient étaient les Moulins à Prières. Je me tournai vers le moine qui parlait anglais et le tirai par un pan de sa robe pour lui demander ce qu'était cette image. Il lut les caractères imprimés dessous et me dit que c'était un train militaire britannique transportant des soldats pour se battre en Flandre.
Une autre image me fascina au-delà de tout entendement ; elle représentait une espèce de grand cerf-volant, mais aucune ficelle ne le reliait à la terre. Ce cerf-volant semblait être un cadre recouvert de tissu, et à l'avant de celui-ci il semblait y avoir une chose qui, d'après la représentation de l'image, devait tourner, et je vis qu'il y avait deux personnes dans ce cerf-volant, l'une à l'avant et l'autre assise juste derrière. Le moine qui parlait anglais m'apprit que cette chose s'appelait un aéroplane, une chose dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je me dis que si jamais j'étais expulsé de la lamaserie ou de l'Ordre, je ne serais pas batelier, mais que je serais plutôt l'un de ceux qui faisaient voler ces étranges cerfs-volants qu'ils avaient en Occident.
Tournant de nouveau les pages, je vis une autre image qui me rendit muet de terreur — un exploit en soi à cette époque ! — car la chose qu'elle représentait avant l'air d'un long tube recouvert d'une espèce d'étoffe qui volait dans les airs au-dessus d'une grande ville en lâchant dessus de grands objets tombant sur le sol dans de grandes gerbes de terre et de maisons qui explosaient. Le moine m'expliqua que le tube s'appelait zeppelin et qu'il lâchait des bombes sur l'Angleterre. Des bombes ? Une bombe, me dit-il, était un récipient de métal rempli de poudre explosive qui faisait tout sauter quand il touchait le sol. Vraiment, pensai-je, ces magazines étaient uniquement consacrés à la guerre et semblaient ignorer la paix. J'en eus vite assez de regarder ces images qui ne servaient qu'à enflammer les passions humaines ; je remerciai le moine qui parlait anglais, puis le moine-barbier, et montai à mon dortoir où j'espérais bientôt voir arriver un messager.
J'attendis longtemps, la journée me sembla interminable. L'heure de la tsampa arriva et je descendis au réfectoire avec les autres, mais je n'avais aucun appétit. Je me forçai cependant car j'ignorais si je serais encore là pour le prochain repas.
Après avoir bien nettoyé mon bol avec du sable, je quittai le réfectoire, remontai au dortoir et regardai par la fenêtre, en attendant.
Chapitre Dix
J'ENTENDIS soudain dans le couloir la voix d'un jeune garçon criant :
— LOBSANG ! LOBSANG !
Je me hâtai de mon mieux vers la porte.
— Ouf ! s'exclama-t-il en feignant d'éponger sur son front une sueur imaginaire. Je t'ai cherché PARTOUT ! Tu te cachais, dis ! Ton Guide te demande.
— Comment est-il ? demandai-je anxieusement.
— Que veux-tu dire, comment est-il ? Tu l'as vu il y a quelques jours, pourquoi aurait-il changé ? Tu es malade, ou quoi ?
Le garçon s'éloigna en marmonnant. J'arrangeai les plis de ma robe, je m'assurai que mon bol et ma boîte d'amulettes étaient bien à leur place, puis je sortis du dortoir.
J'étais heureux de quitter le Quartier des Garçons aux murs blanchis à la chaux et de pénétrer dans le Quartier des Lamas, beaucoup plus ornés. En longeant les couloirs je pouvais voir la plupart des pièces, car les lamas ne fermaient pas leur porte. Là un vieillard dévidait son chapelet en marmonnant inlassablement : ‘Om ! Mani padme hum !’ Un autre tournait respectueusement les feuillets d'un livre très, très ancien, cherchant une nouvelle signification à tel ou tel passage contesté des écritures. J'étais un peu inquiet de voir ces vieillards s'efforcer de lire ‘entre les lignes’ pour y découvrir des messages qui n'avaient certainement jamais existé, et pour écrire ensuite des traités pompeux : ‘Une Nouvelle Interprétation des Écritures, par le Lama Un Tel’. Un moine courbé sous le poids des ans, avec une petite barbiche blanche, faisait tourner doucement son Moulin à Prières en psalmodiant tout bas. Un autre encore déclamait gravement, en se préparant au débat théologique auquel il devrait participer bientôt.
— Ne viens pas apporter des saletés sur mon plancher bien propre, sale petit garnement ! glapit soudain un vieux moine-balayeur. Ce n'est pas pour ton engeance que je travaille toute la journée !
— Va sauter par la fenêtre, Vieillard ! répliquai-je grossièrement en passant devant lui.
Il voulut me saisir, mais il trébucha sur le manche de son long balai et s'étala de tout son long. Je pressai le pas tant bien que mal afin d'avoir de l'avance lorsqu'il se relèverait. Personne n'avait fait attention à cet incident : les Moulins à Prières tournaient en cliquetant, le Déclamateur déclamait encore, et les voix continuaient à psalmodier leurs mantras. Dans une cellule, un autre vieillard toussait à fendre l'âme, ses quintes entrecoupées de borborygmes affreux. Je passai mon chemin.
Ces corridors étaient interminables car je devais monter depuis les quartiers de la Forme la plus Basse de la Vie Lamastique jusqu'aux quartiers les plus hauts, ou presque — ceux des très grands Lamas. À mesure que j'avançais je voyais de plus en plus de portes fermées. Enfin, je quittai le grand corridor pour m'engager dans un étroit couloir menant à une petite annexe, le domaine des ‘Êtres Spéciaux’. Ici, à la place d'honneur, résidait mon Guide lorsqu'il venait au Potala.
Le cœur battant, je frappai à la porte.
— Entre ! cria une voix bien-aimée.
J'obéis, et me prosternai trois fois devant le Personnage étincelant assis le dos à la fenêtre. Le Lama Mingyar Dondup me sourit avec bonté et m'examina pour voir si je n'avais pas dépéri pendant environ les sept derniers jours. Puis il me désigna un coussin, à ses pieds :
— Viens t'asseoir, Lobsang. Viens.
Il me posa alors de nombreuses questions, certaines bien difficiles ! Ce grand homme emplissait mon cœur d'amour et de dévouement. Je ne désirais rien d'autre au monde que d'être constamment auprès de lui.
— Le Grand Initié est très content de toi, me dit-il, et je suppose que cela doit se célébrer.
Il tendit la main et fit tinter une petite clochette d'argent. Un moine-serviteur apparut, apportant une table basse toute sculptée et laquée de diverses couleurs. J'avais toujours peur d'abîmer ces petites tables. Celle-ci fut placée à la droite de mon Guide. En me souriant, il se tourna vers le moine-serviteur.
— Tu as préparé la table simple pour Lobsang ?
— Oui, Maître. Je vais l'apporter.
Il revint rapidement avec une table de bois blanc toute simple chargée de bien plus beaux ‘ornements’ que l'autre : tous les trésors de l'Inde ! Il y avait des gâteaux au miel et aux amandes, des noix confites, des marrons venant d'un très lointain pays, et bien d'autres douceurs. Le moine-serviteur sourit aussi en posant à côté de moi une jarre pleine d'herbes qui calmaient les indigestions.
Un autre moine-serviteur apparut avec de petites tasses et un grand pot de thé indien fumant. Sur un geste de mon Guide, ils se retirèrent, et je me jetai sur ces confiseries qui me changeaient agréablement de la tsampa. Pas un instant je ne pensai aux autres acolytes qui ne mangeraient sans doute jamais rien d'autre que la tsampa, tant qu'ils vivraient. Mais sans doute leur palais ne saurait apprécier ces mets délicats et exotiques. Je savais que j'allais mener une vie dure, on me l'avait assez répété, je savais que bientôt je connaîtrais des nourritures bien différentes ; aussi, dans mon orgueil et mon contentement de petit garçon, trouvais-je assez naturel d'avoir un avant-goût des choses plaisantes pour compenser les choses déplaisantes que j'avais déjà endurées. Je me gavai donc avec la plus parfaite sérénité. Mon Guide me regardait en silence ; il ne but qu'un peu de thé. Mais, finalement, avec un soupir de regret, je dus m'avouer repu ; en fait, l'odeur, la vue même de toutes ces sucreries me soulevaient le cœur. J'avais l'impression que des troupes ennemies se livraient bataille dans mon estomac, je croyais voir des taches devant mes yeux et bientôt je dus me retirer dans un Autre Lieu, car le repas impromptu avait étiré douloureusement la peau de mon ventre !
Quand je revins, plus pâle mais bien soulagé quoique affaibli, mon Guide était toujours assis à la même place, serein et bienveillant. Il me sourit quand je m'assis de nouveau et me dit :
— Eh bien, Lobsang, voilà que tu as profité de ce goûter et que tu l'as perdu, mais il t'en reste au moins le souvenir. Nous allons parler de diverses choses.
Je m'installai très confortablement. Son regard errait sur mes jambes, il se demandait sans doute comment allaient mes blessures ; puis il me déclara :
— J'ai vu le Grand Initié qui m'a parlé de ton... euh... de ton vol sur le Toit d'Or. Sa Sainteté m'a tout raconté, m'a dit ce qu'elle avait vu, et aussi que tu as risqué l'expulsion pour lui dire la vérité. Le Grand Initié est très content de toi, tous les rapports qu'il a reçus à ton sujet lui ont plu, car en mon absence il veillait sur toi, et maintenant il m'a donné des instructions spéciales te concernant.
Le lama me considéra avec un léger sourire, sans doute amusé par mon expression. Encore des ennuis, pensai-je, encore des promesses de vie dure, de tribulations à venir, aussi redoutables que possible afin que, par comparaison, elles me paraissent moins affreuses. Je commençais à en avoir assez. Pourquoi, me demandais-je, ne pouvais-je être un de ces hommes qui s'envolaient dans des cerfs-volants pour une bataille, ou qui conduisaient ces chapelets de boîtes rugissantes pleines de soldats ? Ou bien, et cela me séduisait davantage encore, pourquoi ne pourrais-je gouverner une de ces grandes caisses de métal qui flottaient sur l'eau et transportaient des gens d'un pays à l'autre ? À cela, mon attention s'égara et je me posai une question — comment pouvaient-elles être en métal ? Tout le monde savait que le fer était plus lourd que l'eau, et tombait au fond. Il devait y avoir là un piège, ou alors le moine qui m'avait parlé de ces longues caisses de fer s'était moqué de moi. Je levai les yeux pour voir mon Guide qui riait, qui riait en se moquant de moi. Évidemment, il avait suivi le cours de mes pensées par télépathie, et elles l'amusaient grandement.
— Ces cerfs-volants sont des aéroplanes, le dragon à vapeur est un train, et ces boîtes de fer sont des bateaux, et — oui — des bateaux de fer flottent vraiment. Je te l'expliquerai plus tard, mais pour le moment nous avons d'autres sujets d'entretien.
Mon Guide sonna, un moine-serviteur entra et emporta ma table en souriant, amusé de voir quel sort j'avais fait aux délicates confiseries de l'Inde. Mon Guide réclama du thé et nous attendîmes tandis qu'on lui en faisait.
— Je préfère le thé de l'Inde à celui de la Chine, me dit-il.
J'étais bien de son avis ; le thé de Chine m'avait toujours un peu écœuré, ce qui était surprenant puisque j'aurais dû y être habitué comme nous n'en avions pas d'autre, en général. Mais le thé de l'Inde me paraissait plus savoureux, je ne sais pourquoi. Notre conversation sur le thé fut interrompue par le moine-serviteur qui nous apportait une nouvelle théière fumante. Il se retira, mon Guide versa du thé dans les tasses, et me dit :
— Le Grand Initié veut que l'on te retire des classes ordinaires. Tu devras venir t'installer dans un appartement, à côté du mien, et tu recevras mes enseignements ainsi que ceux de nos lamas spécialistes de premier plan. Tu auras pour tâche de préserver le plus que tu pourras de nos anciennes connaissances, et plus tard tu devras mettre beaucoup de ce savoir par écrit, car nos plus grands devins ont prédit l'avenir de notre pays, disant qu'il sera un jour envahi, et beaucoup de ce qui se trouve dans cette lamaserie et dans bien d'autres sera détruit. Grâce à la sagesse du Grand Initié, certains Documents ont déjà été recopiés afin que les copies demeurent ici pour y être détruites, tandis que les originaux seront emportés loin, très loin, là où nul envahisseur ne pourra se rendre. Mais tout d'abord, tu devras recevoir un enseignement complet sur les arts métaphysiques.
Il s'interrompit, se leva et passa dans une pièce voisine. Je l'entendis remuer, fourrager, et puis il revint, portant une boîte de bois très simple qu'il posa sur la petite table de laque. Il s'assit devant moi et pendant quelques instants demeura silencieux.
— Il y a des années et des années, les gens étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des années et des années, les gens pouvaient faire appel aux lois naturelles et utiliser des sens que l'humanité a aujourd'hui perdus, sauf dans certains cas exceptionnels. Il y a plusieurs centaines de siècles, les gens étaient télépathes et clairvoyants, mais par l'utilisation de tels pouvoirs à des fins mauvaises les humains dans l'ensemble en ont perdu l'aptitude, tous ces pouvoirs sont maintenant atrophiés. Pire encore — les humains aujourd'hui nient généralement l'existence de ces pouvoirs. Tu découvriras, quand tu iras dans divers pays après avoir quitté le Tibet et l'Inde qu'il n'est pas bon de parler de clairvoyance, de voyages dans l'astral, de lévitation ou de télépathie, parce que les gens de ces pays diront simplement : ‘Prouvez-le, prouvez-le, vous parlez par énigmes, vous dites des bêtises ; il n'y a rien de tel que ceci, ou cela, ou autre chose, car si cela existait la science l'aurait découvert.’
De nouveau, mon Guide se tut et une ombre passa sur son visage. Il avait beaucoup voyagé et s'il paraissait jeune — ou plutôt sans âge, car il était impossible de dire s'il était jeune ou vieux tant ses chairs étaient fermes, son visage lisse et son corps plein de vitalité — je savais qu'il était allé jusqu'en Europe, au Japon, en Chine et en Inde. Je savais aussi qu'il avait vécu des expériences des plus étonnantes. Parfois, il feuilletait quelque magazine apporté de l'Inde par-dessus les montagnes, et il soupirait de tristesse devant la folie des hommes en guerre. Il y avait un magazine en particulier qui l'intéressait beaucoup et chaque fois qu'il le pouvait il le faisait apporter de l'Inde. C'était un magazine bien étrange, appelé London Illustrated. Chaque fois que je pouvais en trouver un, je l'examinais avec passion car il était plein d'images représentant des choses dépassant mon entendement et ma compréhension. J'essayais de lire les images, et puis, selon les occasions, je trouvais quelqu'un pour me lire ce qui était écrit dessous dans cette langue étrangère bizarre.
Assis sur un coussin, je regardais mon Guide, glissant de temps en temps un coup d'œil vers la boîte de bois qu'il avait apportée, en me demandant ce qu'elle pouvait bien contenir. Elle était faite d'un bois que je ne connaissais pas et elle avait huit côtés, si bien qu'elle paraissait presque ronde. Je m'interrogeais, étonné par le long silence de mon Guide, quand il parla enfin :
— Lobsang, tu dois développer ton très haut degré de clairvoyance innée à un niveau plus élevé encore et la première chose que tu dois faire c'est d'apprendre à connaître ceci.
Il désigna la boîte à huit pans, comme si elle expliquait tout, mais cela ne fit qu'accroître la confusion de mon esprit.
— J'ai là un présent qui t'est donné sur l'ordre du Grand Initié lui-même. Il t'est remis afin que tu t'en serves et grâce à lui tu pourras faire beaucoup de bien.
À deux mains il souleva la boîte de bois, la contempla un instant et la déposa entre mes mains avec grand soin de crainte, sans doute, que je la laisse tomber maladroitement. Elle était d'un poids surprenant et je me dis qu'elle devait être pleine de pierres pour être aussi lourde.
— Ouvre-la, Lobsang ! me dit le Lama Mingyar Dondup. Tu n'apprendras rien en la regardant !
Je retournai l'étrange boîte entre mes mains en cherchant comment l'ouvrir, car elle avait huit côtés et je ne voyais pas de charnières, ni comment le couvercle était posé. Je finis par saisir le sommet en tournant légèrement. Alors le dessus arrondi se souleva et me resta dans la main. Je l'examinai, mais ce n'était qu'un couvercle, et je le posai à côté de moi avant de contempler ce que contenait la boîte. Je vis simplement un petit tas d'étoffe ; je le saisis pour le sortir de la boîte mais son poids me stupéfia. Étalant soigneusement ma robe afin que, si l'étoffe contenait divers objets aucun ne se brisât sur le sol, je posai ma paume à plat sur le dessus de la boîte et la retournai. Mes doigts se refermèrent sur son contenu enveloppé d'étoffe, et je posai la boîte vide à côté du couvercle, pour consacrer toute mon attention à l'objet sphérique enveloppé de tissu noir.
Quand je dépliai fébrilement l'étoffe, j'étouffai une exclamation de crainte respectueuse car je vis alors une admirable, une merveilleuse boule de cristal sans défauts. C'était vraiment un bloc de cristal, et non une de ces boules de verre employées par les diseurs de bonne aventure, mais si pur que l'on ne pouvait voir où il commençait ni où il finissait ; c'était presque comme si je tenais dans ma main une sphère de néant, si l'on oubliait son poids considérable qui était celui d'une grosse pierre.
Mon Guide me contemplait en souriant. Quand je levai les yeux vers lui, il me dit :
— Tu as la main heureuse et sûre, Lobsang, tu la tiens comme il le faut. Maintenant il faudra la laver avant de l'employer ; et te laver aussi les mains très soigneusement.
— La laver, Honorable Lama ! m'exclamai-je, ahuri. Mais pourquoi ? Elle est parfaitement nette, parfaitement claire !
— Certes, mais il est indispensable qu'un cristal soit lavé quand il change de mains, parce que j'ai touché celui-ci, et le Grand Initié l'a eu entre ses mains, et je l'ai repris ensuite. Tu ne veux certainement pas plonger dans mon passé ni mon avenir, et il est naturellement interdit de surprendre le passé, le présent et l'avenir du Grand Initié. Par conséquent, va dans la pièce voisine, me dit-il en me montrant une porte, lave-toi les mains, lave le cristal et prend bien soin de faire couler de l'eau claire dessus, de l'eau courante. Je t'attends.
Avec grand soin, j'enveloppai le cristal dans l'étoffe, glissai du coussin, plaçai le cristal en son centre afin qu'il ne roule pas par terre, puis lorsque je me fus relevé et que je me sentis plus ou moins d'aplomb sur mes jambes, je pris la boule enveloppée et quittai la pièce.
Dans l'eau, le cristal était une joie pour la vue. Tandis que je le frottais entre mes mains il semblait animé d'une vie propre, scintillante ; j'avais l'impression qu'il faisait partie de mon être, qu'il était bien à moi, ce qui était vrai. Je le posai avec précaution, et avec beaucoup de sable fin je me frottai les mains, puis je les rinçai soigneusement et repris le cristal pour le relaver, en le tenant sous le pichet que je renversai pour laisser l'eau jaillir et rebondir sur la sphère, provoquant de petits arcs-en-ciel multicolores au soleil filtrant par la fenêtre. Quand le cristal fut bien propre, et mes mains aussi, j'allai retrouver mon Guide le Lama Mingyar Dondup.
— Nous allons être beaucoup plus proches, à l'avenir, me dit-il, nous allons vivre côte à côte car ainsi le veut le Grand Initié. Tu ne dormiras plus avec les autres garçons au dortoir. Des dispositions ont été prises et demain, à notre retour au Chakpori, tu t'installeras dans une chambre à côté de la mienne. Tu étudieras avec moi et avec de savants Lamas qui ont vu beaucoup de choses, qui ont beaucoup fait et voyagé loin dans l'astral. Tu garderas ton cristal dans ta chambre, et personne d'autre ne devra jamais y toucher car il recevrait ainsi d'autres influences. Maintenant, tourne ton coussin et assieds-toi le dos au jour.
Je traînai mon coussin comme il me l'indiquait et m'assis le dos à la fenêtre, serrant le cristal entre mes mains, mais mon Guide n'était pas satisfait.
— Non, non, il faut t'assurer qu'aucun rayon de lumière ne peut tomber sur le cristal, car dans ce cas le soleil provoquera de faux reflets. Il est indispensable qu'il n'y ait aucun point de lumière dans le cristal ; tu dois plutôt en être conscient, mais sans avoir conscience de sa circonférence exacte.
Il se leva et tira un rideau de soie huilée devant la fenêtre. Aussitôt le soleil disparut ; la pièce était maintenant baignée d'une douce lueur bleu pâle, comme si le crépuscule était déjà arrivé.
Je dois dire que nous avions très peu de verre à Lhassa, ou plutôt au Tibet, car le verre devait être apporté de l'Inde ou d'ailleurs par-delà les montagnes à dos d'homme ou de yak et, lors des bourrasques soudaines qui secouaient notre ville, le verre était aussitôt brisé par les averses de pierres. Ainsi, nous avions donc des volets de diverses matières, certains en bois, d'autres en soie huilée ou similaire, qui protégeaient du vent comme de la poussière, mais la soie huilée était ce qu'il y avait de mieux car elle laissait filtrer la lumière.
Enfin, je me trouvai dans une position que mon Guide approuva. J'étais assis les jambes repliées sous moi — pas dans la position du lotus parce que mes jambes étaient en trop mauvais état pour cela — mais j'étais assis les jambes repliées sous moi et les pieds tournés vers la droite. Sur mes genoux, mes mains en coupe tenaient le cristal, le tenaient par-dessous de façon à ce que je ne puisse pas voir mes mains sous les côtés saillants du globe. J'avais la tête baissée, et je devais regarder le cristal ou dans le cristal sans voir réellement, sans fixer mon attention. Afin de contempler comme il se doit un cristal, on doit plutôt fixer son regard sur un point dans l'infini, parce que si l'on regarde le cristal on voit machinalement une tache, une poussière, un reflet, et cela détruit généralement l'effet. Ainsi — j'ai appris à toujours fixer mon attention sur un point dans l'infini en regardant apparemment le cristal.
Je me rappelai mon aventure dans le temple, quand j'avais vu les âmes errantes et que les neuf lamas avaient chanté leur cantique en ponctuant chaque allusion à un bâtonnet d'encens par un léger coup de cloche d'argent.
Mon Guide me sourit :
— Ce n'est pas le moment de lire dans le cristal ni de deviner l'avenir, car tu n'as pas encore reçu de leçon et dans ton cas nous devons nous ‘hâter lentement’. Il te faut apprendre comment tenir le cristal comme il faut, comme tu le fais maintenant d'ailleurs, mais tu apprendras qu'il y a différentes méthodes, et que tu dois le tenir différemment suivant les cas. Si tu veux voir les affaires du monde tu poseras le cristal sur un socle, et si tu veux lire pour un individu tu devras faire tenir le cristal à cet individu un instant avant de le reprendre et alors, si tu as été bien entraîné, tu verras ce que cet individu désire savoir.
À ce moment un fracas terrible retentit au-dessus de nous ; ce fut d'abord le rugissement discordant et grave des conques meuglant comme des yaks, un son qui montait en frémissant et redescendait, évoquant un très gros moine avançant péniblement en se dandinant. Je n'avais jamais su discerner de ligne musicale dans ce bruit, mais d'autres m'affirmaient que je n'avais pas d'oreille et que les conques étaient une musique ! Après les conques, ce fut l'éclat cuivré des trompettes du temple, et puis le tintement des cloches et le battement des tambours de bois. Mon Guide se tourna vers moi.
— Allons, Lobsang, nous devons nous rendre à l'Office car le Grand Initié y sera, et nous ne devons pas y manquer par courtoisie pour notre dernière soirée au Potala. Je me hâte, mais viens comme tu le pourras.
Ce disant il se leva, me donna une petite tape affectueuse sur l'épaule et sortit rapidement.
Avec grand, très grand soin, j'enveloppai mon cristal dans son étoffe, puis, avec mille précautions je le rangeai dans sa boîte à huit pans. Je posai la boîte à côté du siège de mon Guide le Lama Mingyar Dondup et puis je le suivis de loin, dans le corridor.
Acolytes, moines, lamas se pressaient, venant de toutes les directions. Cela me rappela l'affolement d'une colonie de fourmis fuyant leur fourmilière écrasée par un pied négligent. Chacun se hâtait pour arriver à temps afin de s'asseoir à la meilleure place, suivant sa classe. Je n'étais pas pressé, puisque je ne demandais qu'à m'asseoir à l'écart, sans être vu.
Le rugissement des conques se tut, puis l'éclat des trompettes. La ruée pénétrant dans le Temple n'était plus qu'un mince ruisseau, que je suivais. Nous étions à présent dans le Grand Temple, celui du Grand Initié lui-même lorsque les devoirs de sa charge lui permettaient de venir se mêler aux lamas.
Les colonnes puissantes semblaient soutenir non seulement le plafond mais le ciel de la nuit, et disparaissaient dans les nuages d'encens omniprésents, gris, bleus, blancs, tournoyant et se mêlant inlassablement sans jamais confondre leurs couleurs, comme si chaque nuage tenait à conserver son individualité.
Des petits garçons porteurs de torches couraient en tous sens pour allumer les lampes à beurre qui crachotaient et sifflaient avant que la flamme jaillisse soudain. Çà et là, une lampe brûlait mal, car l'on devait d'abord faire fondre le beurre avec la torche avant de toucher la mèche, sinon elle se consumait en fumant sans donner de lumière.
Enfin, presque toutes les lampes furent allumées et l'on apporta d'énormes bâtons d'encens qui furent enflammés à leur tour puis éteints, si bien que leur extrémité resta incandescente en dégageant de grands nuages de fumée odorante. Je regardai autour de moi ; tous les lamas étaient assis en groupe, en rangées qui se faisaient face, et la rangée suivante était dos à dos, et faisait face à une autre, et ainsi de suite. Plus loin, il y avait les moines, assis de même, et au-delà les acolytes. Les lamas avaient devant eux de toutes petites tables sur lesquelles ils disposaient divers objets, la clochette d'argent indispensable, et certains avaient un tambour de bois. Plus tard, quand l'Office commencerait, le Lecteur debout au lutrin lirait des passages de nos Livres Sacrés, et les lamas comme les moines chanteraient en choeur, et à la fin de chaque passage les lamas agiteraient leur clochette tandis que d'autres taperaient du bout des doigts sur les tambours. À chaque différente partie de l'Office, les conques rugiraient dans le lointain, parfois même dans le Temple.
L'Office commença et j'observai tout, mais ce n'était pour moi qu'un spectacle, qu'une discipline religieuse, et je me promettais depuis longtemps déjà de demander à mon Guide pourquoi tout ce cérémonial était nécessaire. Je me demandais si cela rendait les gens meilleurs, car j'avais vu tant de moines fort dévots vraiment durant l'Office, d'une dévotion édifiante, et qui, loin du temple, devenaient des brutes sadiques. D'autres, cependant, qui ne fréquentaient guère le temple ou point du tout, étaient d'une bonté exemplaire, toujours prêts à aider leur prochain et surtout le malheureux petit garçon ahuri qui ne savait pas très bien ce qu'il devait faire et vivait dans la crainte de déplaire, parce que tant d'adultes ont horreur des questions des petits garçons.
Je contemplai le centre du Temple, le centre du groupe lamastique où se tenait notre Grand Initié vénéré et bien-aimé assis, calme et serein, entouré d'une forte aura de spiritualité, et je pris la résolution de m'efforcer de prendre en toute occasion et en tout temps modèle sur lui et sur mon Guide le Lama Mingyar Dondup.
L'Office se poursuivit, monotone, et je crains bien de m'être endormi derrière mon pilier car soudain je sursautai violemment, réveillé par les cloches et les conques assourdissantes, et puis j'entendis le bruit sourd et indéfinissable d'une multitude qui se relève et le glissement de pas innombrables sur les dalles. Je me frottai les yeux et je fis de mon mieux pour prendre un air éveillé et point trop sot, comme si j'avais suivi tout l'Office.
Je me traînai, le dernier de la longue procession, vers notre dortoir en me rappelant avec bonheur que désormais je ne dormirais plus avec une foule de garçons qui déchiraient la nuit de leurs ronflements ou de leurs cris, mais que j'aurais ma chambre à moi tout seul.
Tandis que je m'enveloppais dans ma couverture, mon voisin voulut me parler, me dire que ce serait merveilleux pour moi d'avoir ma chambre, mais au milieu d'une phrase il bâilla et tomba sur le sol, profondément endormi. J'allai à la fenêtre en serrant ma couverture autour de moi et contemplai une fois encore la nuit étoilée, le léger plumet de neige poudreuse courant sur la cime des montagnes, tout argenté par la lune qui se levait. Et puis je m'allongeai à mon tour, m'endormis et ne pensai plus à rien. Mon sommeil fut paisible et sans rêves.
Chapitre Onze
NOUS longeâmes les interminables corridors en pente jusqu'à la cour intérieure où des moines-palefreniers tenaient deux chevaux tout harnachés, un pour mon Guide et l'autre pour moi, hélas ! Mon Guide fit signe à un palefrenier de m'aider à monter et je me félicitai d'avoir les jambes blessées car il était bien rare que la volonté d'un cheval ne divergeât de la mienne ; nous arrivions rarement ensemble au même point. Quand je voulais monter sur un cheval, il avançait aussitôt, et je tombais au sol, ou bien si je m'attendais à ce que le cheval avance et que je saute astucieusement, il ne bougeait pas et je passais directement par-dessus la misérable créature. Mais cette fois, mes mauvaises jambes me servant d'excuse, je fus aidé, juché sur le cheval et immédiatement je commis une de ces choses qui NE SE FONT PAS ! Je m'éloignai sans attendre mon Guide. Il éclata de rire, sachant fort bien que le malheureux cheval n'en faisait qu'à sa tête. L'animal sortit de la cour et s'engagea sur le chemin, tandis que je me cramponnais de toutes mes forces à son cou, terrifié à la pensée de tomber et de rouler au bas de la montagne.
Je fis ainsi le tour de la muraille extérieure. Une grosse figure amicale apparut à une fenêtre juste au-dessus de moi et cria :
— Au revoir, Lobsang ! Reviens-nous bientôt. La semaine prochaine nous allons recevoir un chargement d'orge de bonne qualité, bien meilleur que ce que tu as mangé ces derniers temps. Viens me voir à la cuisine dès que tu pourras nous rendre visite.
Le moine-cuisinier entendit alors les sabots d'un autre cheval, tourna la tête vers la gauche et s'exclama :
— Aouh ! Aïe ! Aïe ! Honorable Lama Médecin, pardonnez-moi !
Mon Guide arrivait, et le pauvre moine-cuisinier pensait qu'il s'était permis une impertinence, mais le bon sourire de mon Guide le rassura vite.
Mon cheval descendit au flanc de la montagne ; j'entendais mon Guide rire tout bas derrière moi.
— Il nous faudra te trouver un cheval avec le dos couvert de colle, Lobsang !
Je me retournai, assez vexé. Il pouvait parler ! Lui qui mesurait environ six pieds (1 m 83) et pesait plus de deux cents livres (90 kg) de muscles solides et qui aurait été capable de prendre son cheval sur ses épaules pour descendre dans la vallée, au lieu que ce fût le contraire. Tandis que moi, pauvre moustique, j'étais ballotté par l'énorme animal, je n'avais aucun moyen de le maîtriser ni de le guider, et cette sinistre bête à l'esprit pervers, sachant que j'étais terrifié, s'en allait se pencher tout au bord du sentier et contemplait les osiers tout au fond du précipice en hennissant de joie.
Nous atteignîmes enfin le pied de la montagne et suivîmes la Route de Dodpal parce que, avant d'aller au Chakpori, nous devions passer par un des bureaux du gouvernement au Village de Shö. Quand nous y arrivâmes, mon Guide, toujours prévenant, attacha mon cheval à un piquet et me souleva pour me poser sur le sol en disant :
— Reste là, Lobsang, je n'en ai pas pour longtemps.
Il décrocha un sac de sa selle et me laissa assis pour 1'attendre sur un tas de pierres.
— Là ! Là ! s'exclama derrière moi une voix à l'accent campagnard. J'ai vu le Lama à la Robe Safran descendre de ce cheval et pénétrer dans la maison, et voilà son jeune garçon qui surveille les chevaux. Comment te portes-tu, Jeune Maître ?
Je me retournai et vis un petit groupe de pèlerins. Ils tiraient la langue, ce qui est le salut traditionnel et respectueux, au Tibet, quand un inférieur s'adresse à un supérieur. Mon cœur se gonfla d'orgueil, se chauffa délicieusement à la gloire qui se reflétait sur moi, ‘le garçon du Lama à la Robe Safran’.
— Ah, répliquai-je, vous ne devriez jamais surprendre un prêtre de la sorte, nous sommes toujours plongés dans nos méditations, vous savez, et un sursaut trop brusque est mauvais pour la santé.
Je fronçai les sourcils, les contemplai avec sévérité, et repris :
— Mon Maître et Guide, le Lama Mingyar Dondup, le porteur de la Robe Safran, est un des plus grands Lamas de ce pays, un très haut personnage, en vérité, et je ne vous conseille pas de vous approcher de son cheval parce que cet animal est aussi un très important personnage puisqu'il a 1'honneur de porter un tel cavalier. Allons, laissez-nous, et n'oubliez pas de passer par la Route de l'Anneau, vous en tirerez grand profit !
Sur ce je leur tournai le dos, espérant m'être conduit comme un vrai moine.
J'étais assez fier de moi et pensais avoir fait bonne impression quand un rire soudain, près de moi, me fit lever les yeux avec inquiétude. Un marchand me regardait en se curant les dents, l'autre main sur sa hanche. Je me retournai vivement ; les pèlerins étaient partis, comme je le leur avais ordonné.
— Eh bien ? Que me veux-tu ? lançai-je au vieux marchand. Je n'ai pas de temps à perdre !
Le vieillard me sourit :
— Allons, allons, Jeune Maître, ne sois pas si dur envers un pauvre colporteur qui a bien du mal à gagner sa maigre vie en ces temps difficiles. N'aurais-tu pas sur toi quelques objets, quelques souvenirs que tu rapporterais de la Grande Lamaserie ? Je puis t'offrir un très bon prix pour une mèche de cheveux d'un lama, un morceau de sa robe, et un prix plus élevé encore pour tout ce qui a pu être béni par un des très grands lamas, comme ton Maître à la Robe Safran. Parle, Jeune Maître, parle vite avant qu'il revienne et nous surprenne.
Je le considérai avec un mépris mêlé d'horreur. Oh non, non pour rien au monde ! Même si j'avais eu une douzaine de robes safran, jamais je ne les vendrais pour qu'elles deviennent la proie des imposteurs et des charlatans. À ce moment, à ma grande joie, mon Guide reparut.
Le vieux marchand le vit et se hâta de s'éloigner en traînant la jambe.
— Que faisais-tu donc ? demanda mon Guide. Tu essayes d'acheter aux marchands, à présent ?
— Non, Honorable Maître, c'était lui qui voulait vous acheter, par morceaux, une mèche de cheveux, un lambeau de robe, tout ce que j'aurais pu voler, dans son idée.
Le Lama Mingyar Dondup éclata de rire, mais ce fut avec une certaine amertume qu'il suivit des yeux le marchand, lequel se hâtait visiblement.
— Il est bien regrettable que ces gens cherchent à gagner par tous les moyens, n'hésitent pas à se procurer n'importe quel objet pour lui attribuer une valeur fausse. Ce n'est pas la Robe Safran qui importe, après tout, mais l'âme de celui qui porte la Robe Safran.
Ce disant, il me souleva dans ses bras puissants et me jucha sans effort sur le cheval, qui parut aussi surpris que moi. Puis il détacha les rênes du piquet et me les mis dans la main (comme si je savais qu'en faire !) Enfin, sautant sur son propre cheval, il partit et je le suivis.
Nous suivîmes le Mani Lhakhang, laissâmes derrière nous le Village de Shö, puis le Pargo Kaling et franchîmes enfin le petit pont enjambant un affluent du Kaling Chu. Un peu plus loin, nous tournâmes à gauche, longeâmes le petit parc de Kundu et nous engageâmes enfin sur la route du Chakpori.
C'était un chemin rocailleux, difficile, plein d'ornières, où l'on avait besoin d'un cheval au pied sûr. La Montagne de Fer, que nous appelions le Chakpori, était plus haute que celle sur laquelle se dressait le Potala et notre éperon rocheux plus abrupt, plus vertigineux. Mon Guide passa devant moi, les sabots de son cheval délogeant de temps en temps des pierres qui roulaient en bondissant vers moi. Ma monture suivait docilement, cherchant avec soin où poser les pieds. Le chemin montait en pente raide ; je regardai vers ma droite — vers le sud — où coulait la Rivière Heureuse appelée Kyi Chu. Mon regard plongeait maintenant sur le Norbu Linga, le Parc du Joyau, où le Grand Initié se permettait parfois de rares instants de récréation. Pour le moment, le parc était désert, si l'on faisait exception des moines-jardiniers qui le remettaient en état après la dernière tempête. Je me rappelai comment, avant que mes jambes soient blessées, j'aimais à glisser au flanc de la montagne et traverser subrepticement la Route de Lingkhor pour pénétrer dans le Norbu Linga par mon chemin secret, du moins le pensais-je.
Nous atteignîmes enfin le sommet de la montagne, la petite esplanade de pierre devant les murs du Chakpori, la muraille extérieure qui entourait toute la lamaserie. Le moine-portier nous accueillit avec joie, et deux autres moines accoururent pour prendre nos chevaux. Je me séparai du mien avec le plus grand soulagement, mais je ne pus m'empêcher de gémir quand je me retrouvai par terre, tout le poids de mon corps sur mes faibles jambes.
— Nous allons devoir examiner tes blessures, Lobsang, me dit mon Guide. Elles ne semblent pas guérir aussi bien que je l'avais espéré.
Un autre moine emporta les bagages du lama et mon Guide le suivit, en me lançant par-dessus son épaule :
— Viens me voir dans une heure.
Le Potala était trop public pour moi, trop ‘grandiose’ ; il fallait toujours faire attention de ne pas irriter un moine sénior ou un lama junior. Naturellement, les grands lamas n'étaient jamais offensés ; ils avaient en tête des choses beaucoup plus importantes que de se préoccuper de ce qu'une personne regarde dans leur direction ou paraisse les ignorer. Comme dans tous les cas, ce ne sont que les hommes inférieurs qui créent des ennuis, leurs supérieurs étant gentils, prévenants et compréhensifs.
Je traversai la cour en me disant que je pourrais mettre à profit ce léger répit pour prendre un repas. À mon âge, et à ce stade de ma carrière, la nourriture revêtait une grande importance car, en dépit de toutes ses vertus, la tsampa ne peut vraiment apaiser la faim !
En longeant les interminables couloirs familiers, je rencontrai beaucoup de garçons de mon âge qui étaient entrés à la lamaserie en même temps que moi. Mais à présent, tout était changé, je n'étais plus un simple petit copain avec qui l'on allait en classe, avec qui l'on se battait, mais un personnage placé sous la haute protection du Grand Lama Mingyar Dondup, porteur de la Robe Safran. Déjà, le bruit avait couru que j'allais recevoir une instruction particulière, que j'aurais ma propre chambre dans les Quartiers des Lamas, que je ferais ci, ou ça, ou encore cela, et cela m'amusa, aussi, d'apprendre que mes exploits, réels ou imaginaires, étaient bien connus. Un des garçons affirma très sérieusement, et avec une grande joie, qu'il m'avait vu de ses yeux emporté du sol sur le Toit d'Or, sur les ailes d'un grand vent.
— Je l'ai vu ! s'exclama-t-il triomphalement, fier de son importance. J'étais là, à cette même place, à cette fenêtre, et j'ai vu Lobsang assis par terre. Et puis le vent s'est levé, une grande tempête de poussière et de sable, et alors j'ai vu Lobsang voler dans les airs et se débattre comme s'il luttait contre mille démons installés sur le toit. Et puis... Et puis il est tombé dans les bras d'un des Lamas Gardiens du Temple !
Un soupir s'éleva du groupe, fait d'admiration, de crainte respectueuse et d'envie, et le garçon conclut :
— Alors Lobsang a été reçu par le Grand Initié, ce qui confère à notre classe l'honneur et la distinction !
Je jouai des coudes pour me libérer de cette horde de petits garçons et de jeunes moines qui espéraient tous de moi quelque déclaration solennelle, une espèce de Révélation des Dieux, car pour le moment je ne pensais qu'à m'emplir la panse. Je les repoussai donc et descendis en boitant le long du corridor vers une salle bien connue — la cuisine.
— Tiens ! Te voilà de retour, hein ? Allons, assieds-toi petit, assieds-toi, je vais te donner à manger. À te voir, on n'a pas dû te nourrir, au Potala. Mets-toi là, je vais te servir.
Le vieux moine-cuisinier s'approcha, me donna une petite tape sur la tête et me poussa doucement, si bien que je me retrouvai assis sur une pile de sacs d'orge vides. Puis il plongea une main sous ma robe et trouva mon bol. Il repartit, en frottant mon bol qui n'en avait nul besoin, vers une des immenses marmites. Il revint bientôt, le bol plein, renversant de la tsampa et du thé autour de lui, me fit relever les jambes et écarter ma robe de crainte de la souiller et me dit :
— Tiens, mange, et mange vite parce que je sais qu'on va bientôt t'appeler — l'Abbé veut que tu lui racontes toutes tes aventures.
Heureusement pour moi, un moine entra et appela le cuisinier, qui me laissa seul pour manger ma tsampa en paix.
Le ventre plein, j'allai le remercier poliment, car c'était un bon vieillard qui pensait que tous les jeunes garçons étaient des galopins, mais aussi que ces garnements avaient besoin d'être nourris à leur faim. Je récurai soigneusement mon bol avec du sable, et ensuite je pris un balai pour nettoyer le sol autour du grand sac. Cela fait, je m'inclinai très bas devant le moine-cuisinier, qui en fut surpris et flatté, et quittai la cuisine.
À l'extrémité du couloir, je m'accoudai à la fenêtre et regardai dehors. Au-dessous de moi, il y avait le marécage, et au delà un ruisseau clair. Mais mon regard se portait plus loin, au-dessus du Kashya Linga, vers le gué où le passeur semblait avoir beaucoup de travail, aujourd'hui. Courbé sur ses rames, il tirait son bateau de peau de yak chargé de voyageurs et de paquets et je me demandai pourquoi tant de gens convergeaient vers notre Ville Sainte. Je me rappelai alors les Russes, ces Russes qui faisaient pression sur notre pays parce que les Anglais s'y intéressaient ; à présent, les Russes envoyaient une foule d'espions à Lhassa, déguisés en marchands, en pensant que les pauvres indigènes ignorants que nous étions ne s'en apercevraient pas. Ils oubliaient, ou peut-être ne l'avaient-ils jamais su, que la plupart des lamas étaient télépathiques et clairvoyants, et qu'ils savaient ce que les Russes pensaient presque aussitôt qu'eux-mêmes en avaient l'idée.
J'aimais observer tous ces gens divers, tous différents, et deviner leurs pensées bonnes ou mauvaises. Avec un peu de pratique, c'était facile. Cependant ce n'était pas le moment de perdre mon temps ni de contempler les passants ; j'avais hâte de voir mon Guide, et de me coucher. Mes jambes étaient douloureuses, la fatigue me tenaillait. Mon Guide avait été obligé de se rendre à la Lamaserie de la Barrière de Roses avant que je fusse suffisamment guéri pour me déplacer à ma guise. J'aurais dû rester couché une semaine de plus, enveloppé dans mes couvertures, par terre, mais au Chakpori — une bonne lamaserie pourtant — on n'aimait guère les enfants malades dont les blessures étaient longues à guérir et qui gênaient tout le monde. C'était donc pourquoi j'avais été envoyé au Potala où, chose curieuse, on soignait mieux les malades que dans notre ‘Temple de la Guérison’.
Au Chakpori, les élèves doués apprenaient les arts de la guérison. On nous enseignait tout ce qui concernait les diverses parties du corps, leur fonctionnement, leur importance ; nous apprenions l'acupuncture, une thérapeutique par laquelle on enfonce de très fines aiguilles dans le corps afin de stimuler certains centres nerveux, on nous apprenait à nous servir des simples, comment les cueillir, comment les connaître, comment les sécher et les conserver. Au Chakpori nous avions de grands bâtiments dans lesquels les moines, sous la surveillance des lamas, préparaient les onguents et les herbes. Je n'oublierai jamais la première fois que je les vis.
Hésitant, effrayé, je risquai un œil au coin de la porte, ne sachant pas ce que j'allais voir, ni si l'on me surprendrait. J'étais curieux car si dans mes études je n'avais pas encore atteint le stade des herbes médicinales, je m'y intéressais énormément.
Je vis une vaste salle à l'immense plafond voûté soutenu par d'énormes poutres allant d'un mur à l'autre d'où pendait une espèce de filet triangulaire fait de cordes. J'ouvris de grands yeux ; je ne comprenais pas à quoi cela pouvait servir. Et puis, tandis que ma vision s'habituait à la pénombre de ces lieux, je distinguai, à l'autre extrémité des cordes, de gros sacs de cuir qui semblaient durs comme du bois. Chaque sac de cuir portait un mot, écrit à la peinture, dont aucun n'avait de signification pour moi. Je regardai intensément, et personne ne fit attention à moi jusqu'à ce qu'un vieux lama se retourne. En m'apercevant il sourit avec une grande douceur.
— Viens, petit, entre donc. Je suis sincèrement heureux de voir qu'un garçon aussi jeune s'intéresse à nos travaux. Viens donc.
D'un pas hésitant, j'entrai dans la salle ; le vieux lama posa son bras sur mes épaules et, à ma profonde stupéfaction, il se mit à me donner des explications, il me fit connaître les différentes herbes, il m'expliqua ce qui distinguait la poudre d'herbe de la tisane et des onguents. Ce vieillard me plaisait et sa gentillesse me touchait.
Devant nous, je vis une longue table de pierre assez mal taillée, rugueuse. Je ne sais de quelle pierre elle était faite, mais c'était probablement du granit. C'était une énorme dalle de quinze pieds (4 m 60) par six pieds (1 m 83). De part et d'autre de la table des moines s'affairaient à étaler des mottes d'herbes, qui est le seul mot que je peux trouver pour les décrire parce qu'elles ressemblaient à d'épaisses mottes d'herbes, une masse de végétation brunâtre. Ils étalaient ces herbes sur la table, puis avec des pierres plates semblables à des briques, ils écrasaient les herbes en traînant la pierre vers le côté. Quand ils la soulevaient pour recommencer, je voyais que les herbes étaient broyées — réduites en purée. Ils continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'il ne restât plus devant eux qu'une espèce de pâte fibreuse. À ce moment ils reculèrent et d'autres moines s'approchèrent avec des seaux de cuir et des pierres au bord dentelé. Soigneusement, le nouveau groupe de moines grattèrent le banc de pierre pour faire tomber toute la matière fibreuse dans leurs seaux de cuir. Cela fait, les premiers moines frottèrent le banc avec du sable, le nettoyèrent complètement avec leur pierre en s'appliquant à creuser de minuscules rigoles qui maintiendraient les herbes qu'ils écraseraient.
Les autres moines emportèrent les seaux de cuir dans le fond de la salle où je distinguais à présent des chaudrons d'eau bouillante. L'un après l'autre, ils vidèrent les seaux dans un des chaudrons. Je fus étonné de voir que, dès que la pulpe d'herbes y était jetée, l'eau cessait de bouillir. Le vieux lama me fit traverser la salle et regarder les chaudrons, puis il ramassa un bâton et se mit à remuer la substance en me disant :
— Regarde ! Nous faisons bouillir ceci, et laisserons bouillir jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore et qu'il ne reste plus qu'un sirop épais. Je te montrerai ce que nous en faisons.
Il me conduisit dans un autre coin de la salle, et là je vis de grandes jarres pleines de sirop, portant diverses étiquettes.
— Voici, me dit le vieux lama en me montrant une des jarres, ce que nous prescrivons à ceux qui souffrent d'une infection catarrhale. Ils boivent un peu de ce sirop, et si le goût n'a rien de plaisant il est bien moins déplaisant que le catarrhe. Et cela les guérit !
En riant, il me conduisit dans une pièce voisine où je vis une autre table de pierre, creusée au milieu comme une auge peu profonde. Des moines armés de longues spatules de bois y mélangeaient diverses choses, sur les ordres d'un autre lama. Le vieux lama qui semblait prendre tant de plaisir à me faire visiter son laboratoire m'expliqua :
— Ici, nous avons un mélange d'huile d'eucalyptus et d'huile camphrée, auquel nous mêlons de l'huile d'olive importée très coûteuse, et avec ces spatules de bois les moines remuent le tout et le mélangent avec du beurre. Le beurre forme une excellente base pour un onguent. Les gens atteints de maladies pulmonaires trouvent un bon soulagement en s'en frottant la poitrine et le dos.
J'hésitai, et puis j'avançai la main et touchai du bout du doigt cette pâte ; prudemment, je portai mon doigt à mon nez, reniflai, et me sentis loucher. Le relent me brûla, j'eus l'impression que mes poumons étaient en feu et j'eus peur de tousser, malgré mon envie, de crainte d'exploser. Le vieux lama éclata de rire.
— Si tu mets ça sur ton nez, tes narines vont peler ! C'est un concentré, il doit être dilué avec encore plus de beurre.
Dans le fond de la salle, d'autres moines enlevaient le bout des feuilles d'une certaine plante séchée et les tamisaient soigneusement à travers un linge qui était comme un filet aux mailles serrées.
— Ces moines préparent des thés spéciaux. Par ‘thé’ nous entendons un mélange d'herbes qui peut être bu. Ce thé particulier, dit-il en se tournant et me l'indiquant, est un thé antispasmodique qui soulage les cas de tics nerveux. Quand tu viendras étudier ici, tu trouveras tout cela très intéressant.
À ce moment, quelqu'un appela le vieux lama et il me quitta, mais pas avant de m'avoir conseillé :
— Regarde autour de toi, petit, examine tout. Je suis vraiment bien heureux de voir un jeune homme s'intéresser à ce point à notre art.
Sur ce, il me tourna le dos et s'en alla précipitamment dans l'autre salle.
Je me promenai, reniflant ceci et reniflant cela. Je pris une pincée d'une certaine poudre et aspirai tant et tant qu'elle remonta dans mes narines et m'envahit la gorge, ce qui me fit tousser à fendre l'âme, à croire que je ne m'arrêterais jamais de tousser, mais un autre lama arriva et me fit boire une tisane au goût atroce, qui calma cette toux.
Une fois remis de cet incident, j'avisai un grand tonneau, contre un mur. Je m'en approchai et fus stupéfait de voir qu'il était plein de morceaux d'écorce, me semblait-il, mais d'une espèce d'écorce d'arbre que je n'avais jamais vue. J'en touchai un morceau, qui tomba en poussière entre mes doigts. Vraiment, je ne voyais pas ce que l'on pouvait tirer de ces vieux bouts d'écorce poussiéreux, plus sales et plus grossiers que ceux qui tombaient dans les allées de nos parcs. Un lama m'aperçut, comprit mon étonnement, et vint me parler :
— Tu ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas ?
— Non, Honorable Lama Médecin, répondis-je. On dirait des détritus.
Cela le fit beaucoup rire :
— Cette écorce, jeune homme, est employée pour soulager la maladie la plus commune du monde, et elle a sauvé bien des vies. Devines-tu ce que c'est ? Quelle est la maladie la plus commune ?
Il me posait là une singulière question, qui me laissait perplexe ; je ne savais que penser, ni que répondre, et je le lui dis franchement. Il me sourit.
— La constipation, jeune homme, la constipation. Le plus grand fléau des hommes de ce temps. Ceci est de l'écorce sacrée que nous importons de l'Inde. On l'appelle écorce sacrée parce qu'elle vient d'un très, très lointain pays, le Brésil, où on l'appelle cascara sagrada, ce qui signifie écorce sacrée. Nous l'employons en tisanes ou bien, pour les cas exceptionnels, nous la faisons bouillir longuement jusqu'à ce que nous obtenions un concentré que nous mélangeons à des amidons et à du sucre pour former des pilules, destinées à ceux qui ne supportent pas le goût âcre de la tisane.
Il me sourit avec une grande bonté ; je vis que mon intérêt lui plaisait.
Le vieux lama revint en hâte, il me demanda ce que j'avais vu, ce qui m'avait plu, et puis il sourit lorsqu'il s'aperçut que j'avais à la main un morceau de cascara sagrada.
— Mâche-la, mon garçon, mâche-la. Cela te fera le plus grand bien, et te guérira de la toux, parce que tu n'oseras jamais plus tousser quand tu auras mâché cette écorce !
Il fut saisi alors d'un fou rire tel qu'il me fit penser à un lutin car, tout en étant un lama médecin de haut rang, il était quand même de petite taille.
— Viens, reprit-il, viens par ici. Regarde ceci, un produit de notre pays. De l'écorce d'orme. Un certain orme que nous appelons l'orme rouge. C'est fort précieux pour tous ceux qui souffrent d'embarras gastriques. Nous l'écrasons, nous en faisons une pâte et puis nous la pressons en tablettes que le malade prend pour soulager ses douleurs. Mais attends, petit, attends. Quand tu reviendras, un peu plus tard, je suis certain que nous découvrirons que tu as un grand avenir devant toi.
Je le remerciai de sa bonté, ainsi que l'autre lama et je les quittai après cette première visite.
J'en étais là de mes réflexions et de mes souvenirs lorsque j'entendis des pas précipités ; un garçon venait m'avertir que mon Guide, le lama Mingyar Dondup, m'attendait dans ses propres quartiers, qui étaient presque les miens puisque j'allais dormir dans la chambre voisine de la sienne. Je mis de l'ordre dans ma tenue, arrangeai ma robe et me hâtai de mon mieux le long des corridors, pressé de savoir quel était mon nouveau logement.
Chapitre Douze
MA CHAMBRE était claire, petite mais bien suffisante pour moi. Je vis avec une grande satisfaction qu'il y avait deux tables basses, la première chargée de magazines et de papiers, l'autre de ces confiseries qui faisaient ma joie. Le moine-serviteur qui m'y avait conduit me déclara en souriant :
— Les Dieux de la Fortune sont certainement avec toi, Lobsang. Tu es tout à côté de la chambre du Grand Lama Mingyar Dondup.
Je le savais bien, il était inutile de me le répéter, mais il ajouta :
— Voici une porte communicante ; tu dois savoir que tu ne devras jamais franchir cette porte sans l'assentiment de ton Guide, car tu pourrais le déranger dans ses méditations. Comme tu ne peux pas voir ton Guide avant un certain temps, je te conseille de te consoler avec toutes ces bonnes choses.
Sur ce, il tourna les talons et me laissa seul dans ma chambre. Ma chambre ! Quelle chance merveilleuse. Une chambre à moi ! Je n'aurais plus à subir la promiscuité des autres garçons !
J'allai me pencher sur la table pour examiner les sucreries qui y avaient été disposées. J'eus bien du mal à faire un choix, mais je finis par me décider pour une espèce de gâteau rose couvert d'une poudre blanche. Je le saisis de la main droite et, pour que ma main gauche ne soit pas jalouse, j'en pris un autre et, ainsi ravitaillé, j'allai m'accouder à la fenêtre pour savoir dans quelle partie du bâtiment se trouvait ma chambre.
Je posai mes avant-bras sur l'appui de pierre et me penchai, lâchant ainsi un de mes gâteaux indiens, ce qui me fit émettre un vilain mot. J'avalai l'autre en hâte, de peur de le perdre aussi, puis je contemplai le paysage.
Je me trouvais à l'extrémité de l'aile sud-est de la lamaserie, au coin de l'annexe. J'apercevais le Norbu Linga, le Parc du Joyau, où quelques lamas allaient et venaient et semblaient discuter en faisant de grands gestes. Je les observai un moment ; ils étaient très amusants. L'un d'eux s'assit par terre tandis que les autres se prosternaient et lui parlaient en déclamant, et puis ils changèrent de place. Mais oui, me dis-je ! Je savais ce qu'ils faisaient. Ils répétaient leurs discours avant le débat public auquel devait assister le Dalaï-Lama en personne. Comme cela ne m'intéressait plus, à présent que j'avais deviné la raison de leurs gesticulations, je tournai mon attention vers d'autres sujets d'intérêt.
Quelques pèlerins remontaient par la Route de Lingkhor en farfouillant sous les buissons comme s'ils espéraient y trouver de l'or. Ils étaient fort divers ; il y avait d'honnêtes pèlerins, d'une foi sincère, et d'autres, que je distinguais sans mal, étaient des espions ; des espions russes surveillant les espions chinois et nous, des espions chinois guettant les espions russes et nous. Je me dis que s'ils passaient leur temps à s'espionner mutuellement ils nous laisseraient tranquilles ! Juste au-dessous de ma fenêtre, un ruisseau traversait un marécage pour aller se jeter dans la Rivière Heureuse qu'enjambait un pont menant à la Route de Lingkhor. J'observai la scène avec amusement car il y avait là un petit groupe d'enfants du village, des Têtes Noires comme nous les appelions parce qu'ils n'avaient pas le crâne rasé comme les moines. Ils jouaient sur ce pont, jetant d'un côté de petits morceaux de bois et se précipitant de l'autre côté pour les voir reparaître emportés par le courant. Un des garçons se pencha si bien sur le parapet que, avec l'aide sournoise de ses camarades, il tomba la tête la première dans le cours d'eau. Cependant, la rivière n'étant pas profonde, il eut tôt fait de regagner la berge, couvert d'une boue gluante que je connaissais malheureusement fort bien, pour avoir subi le même sort. Tous les garçons descendirent en courant vers la berge pour l'aider à se nettoyer tant bien que mal, parce qu'ils savaient bien quel sort les attendait si leurs parents apprenaient qu'ils étaient rentrés à Lhassa en laissant leur camarade en si piteux état.
Plus loin à l'est, le passeur travaillait toujours, traversant la rivière avec son bateau de peau de yak, transportant les voyageurs innombrables ; il faisait des efforts exagérés dans l'espoir d'apitoyer ses passagers et de leur soutirer un peu plus d'argent. Cela m'intéressait énormément, parce que je n'avais encore jamais navigué, si peu que ce fût, et à cette époque c'était vraiment le sommet de mon ambition.
Près du gué, il y avait un autre parc, le Kashya Linga, le long de la route menant à la Mission Chinoise, que j'apercevais d'ailleurs de ma fenêtre, avec son jardin à demi caché par de grands arbres. Nous tous, petits garçons, étions persuadés qu'il se perpétrait d'épouvantables atrocités dans cette Mission Chinoise et — qui sait ? peut-être ne nous trompions-nous pas !
Encore plus à l'est s'étendait le Khati Linga, un parc très agréable bien qu'un peu humide puisqu'il était situé sur un terrain marécageux. Au-delà, il y avait le Pont de Turquoises que j'apercevais, avec délices. J'aimais plus que tout voir des gens pénétrer sous ce pont couvert pour ressortir ensuite de l'autre côté.
Au-delà encore, derrière le Pont de Turquoises, s'étendait la ville de Lhassa avec la Salle du Conseil, les toits d'or du Jo Kang, la Cathédrale de Lhassa qui était peut-être le bâtiment le plus ancien de notre pays. Enfin, dans le lointain, se dressaient les montagnes parsemées d'ermitages et de lamaseries. Oui, ma chambre me plaisait, et je m'aperçus soudain que de là je ne pouvais voir le Potala. Je pensai aussi que les hauts dignitaires du Potala ne pouvaient donc me voir et, si je laissais tomber des cailloux ou des miettes de tsampa sur les pèlerins, nul ne me surprendrait, et les pèlerins accuseraient les oiseaux !
Au Tibet nous n'avions pas de lits, nous dormions par terre. Le plus souvent nous n'avions pas de coussins ou autre chose sur le plancher, nous nous enveloppions simplement dans des couvertures, utilisant possiblement nos robes comme oreiller. Mais il n'était pas encore l'heure de dormir, aussi m'installai-je le dos à la fenêtre afin que la lumière tombât par-dessus mon épaule, et je pris un des magazines. Le titre ne me disait rien, car c'était de l'anglais, du français ou de l'allemand et je ne connaissais aucune de ces langues. Mais je m'aperçus vite que ce magazine-là était indien, parce qu'il y avait une espèce de carte géographique sur la couverture et je finis par reconnaître certaines lettres, certaines formes de mots.
Je tournai les pages. Les mots ne signifiaient rien pour moi et je ne regardais que les images. J'étais confortablement assis, satisfait de mon sort, et tout à fait heureux de regarder les images en laissant vagabonder mon esprit. Je tournai distraitement les pages, et puis soudain j'éclatai de rire, je fus pris d'un fou rire car là, sur les deux pages centrales, il y avait une série d'images représentant des hommes debout sur la tête ou contorsionnés en poses étranges. Je comprenais ce que je voyais, enfin — c'était des exercices de yoga, prisés en Inde au point de devenir un culte. Je ris de plus belle à certaines des expressions, mais mon rire se calma brusquement car en levant les yeux je vis mon Guide, le lama Mingyar Dondup, qui me regardait en souriant par la porte de communication ouverte. Cependant, avant que je puisse me relever, il m'avait fait signe de rester assis.
— Non, pas de formalités entre nous ici, Lobsang. Réservons les égards aux grandes circonstances. Tu es chez toi, comme je suis chez moi. Mais de quoi riais-tu donc avec tant de joie ?
J'étouffai mon fou rire, et lui montrai les images de yoga. Mon Guide entra dans ma chambre et vint s'asseoir à côté de moi :
— Lobsang, tu ne dois pas te moquer des croyances des autres, tu sais, car tu ne voudrais pas voir d'autres gens rire de tes croyances. Ces hommes que tu vois sur ces images pratiquent le yoga. Je ne fais pas de yoga, ni aucun des grands lamas ne le pratique, seuls ceux qui n'ont aucune aptitude pour les choses métaphysiques font du yoga.
— Maître ! dis-je avec une certaine excitation, voulez-vous me parler du yoga, m'expliquer ce que c'est et comment les gens le pratiquent ? Tout cela me rend très perplexe.
Mon Guide examina ses mains, et me répondit enfin, en me disant :
— Oui, tu dois apprendre ces choses. Parlons-en dès maintenant. Je vais essayer de t'expliquer quelques aspects du yoga.
J'écoutai attentivement mon Guide, en prenant garde de ne pas bouger. Il était allé partout, il avait tout vu, il avait tout fait et je ne désirais rien au monde que de l'imiter en le prenant pour modèle. J'écoutai avec beaucoup plus d'attention que n'en accorde généralement un petit garçon à une grande personne.
— Le yoga ne m'intéresse pas, me dit mon Guide, parce que le yoga est uniquement un moyen de discipliner le corps. Si une personne a déjà discipliné son corps, le yoga n'est qu'une perte de temps. Ainsi chez nous, au Tibet, seules les plus basses classes pratiquent le yoga. Les Indiens en ont fait un culte et je le regrette vivement car cela les éloigne des vraies Vérités. Il est admis qu'avant de pouvoir exercer diverses pratiques métaphysiques, il faut avoir le contrôle du corps, on doit être capable de contrôler sa respiration, ses émotions, ses muscles. Mais — et il me sourit — je suis opposé au yoga parce qu'il cherche à imposer par la force brutale ce qui ne devrait être atteint que par des moyens spirituels.
Tandis qu'il parlait je regardais les images et trouvais vraiment remarquable que certaines personnes se croient obligées de se contorsionner ainsi et de faire des nœuds avec leurs membres en pensant que c'était de la spiritualité. Cependant, mon Guide reprit :
— Beaucoup d'Indiens de types inférieurs peuvent accomplir une forme de tour en se livrant au yoga. Ils sont capables d'hypnotiser et d'exécuter divers autres trucs qu'ils se sont mis à prendre pour quelque chose de vraiment spirituel ; mais c'est plutôt un truc, et rien de plus. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait pu rejoindre les Champs Célestes du fait qu'il soit capable de faire des nœuds avec son corps, dit-il en riant.
— Mais pourquoi les gens font-ils des choses aussi remarquables ?
— Certaines choses, certaines manifestations physiques peuvent être accomplies par le yoga et il n'y a pas de doute que si l'on pratique le yoga cela peut développer quelques muscles, mais cela n'aide pas au développement de la spiritualité. Beaucoup d'Indiens font des exhibitions et on appelle de tels hommes des fakirs. Ils voyagent de village en village et de ville en ville en donnant des démonstrations de yoga, en faisant peut-être des nœuds avec leurs membres, comme tu dis, ou en gardant pendant très longtemps un bras levé au-dessus de la tête, ou autres choses remarquables. Ils prennent des airs de saints comme s'ils faisaient la chose la plus merveilleuse qui soit, et parce que c'est une minorité bruyante qui se délecte de publicité, les gens en sont venus à la conclusion que le yoga est un moyen facile d'accéder aux Grandes Vérités. C'est complètement faux, le yoga aide simplement à développer ou contrôler ou discipliner le corps, et il n'aide pas à atteindre la spiritualité.
Il s'interrompit, me regarda en riant, et poursuivit :
— Tu ne me croiras peut-être pas, mais quand j'étais un très jeune homme, j'ai essayé moi-même le yoga, et je me suis vite aperçu que je perdais tant de temps à essayer d'accomplir quelques exercices puérils qu'il ne m'en restait guère à consacrer à mon progrès spirituel. Donc, sur les conseils d'un vieil homme sage, j'ai renoncé au yoga et je me suis consacré à des choses plus sérieuses.
Il me considéra, puis il tendit le bras dans la direction de Lhassa et le balança pour indiquer celle du Potala, en disant :
— Dans tout le Tibet, tu ne trouveras pas de grands lamas pratiquant le yoga. Ils passent aux choses sérieuses, et — haussant les sourcils et me regardant fixement en disant ceci — tu trouveras toujours que les yogis causent beaucoup d'agitation publique, disant combien ils sont merveilleux, combien ils sont importants, et qu'ils ont les clefs du salut et de la spiritualité. Pourtant le véritable Adepte de métaphysique ne parle pas de ce qu'il peut réellement faire. Malheureusement, dans le yoga c'est une minorité bruyante qui essaie d'influencer l'opinion publique. Le conseil que je te donne, Lobsang, est celui-ci : jamais, jamais ne te mêle de yoga, car il te sera parfaitement inutile. Tu es né avec certains pouvoirs de clairvoyance, de télépathie, etc., et tu n'as absolument rien à faire avec le yoga ; ce pourrait même être nuisible.
Tandis qu'il parlait, j'avais tourné distraitement les pages du magazine, sans y prendre garde, mais soudain je baissai les yeux et vis l'image d'un homme occidental, apparemment, qui semblait souffrir atrocement en essayant de faire un exercice. Je montrai l'image à mon Guide.
— Ah oui ! Voilà une victime du yoga. Un Occidental qui a voulu essayer un des exercices et qui s'est disloqué une articulation. Il est très, très imprudent pour les Occidentaux d'essayer le yoga parce que leurs muscles et leurs os ne sont pas assez souples ; on ne devrait pratiquer le yoga (si vraiment on y tient !) que si l'on y est entraîné dès un très jeune âge. Que des gens d'âge moyen s'y livrent — eh bien, c'est stupide et certainement nuisible. Cependant, il est ridicule de dire que la pratique du yoga provoque la maladie. C'est faux. Le yoga permet simplement d'exercer quelques muscles, et parfois une personne peut souffrir d'une dislocation ou d'un muscle froissé, mais c'est entièrement sa faute ; il ne faut pas toucher à de telles choses. Les seuls yogis que j'ai jamais rencontrés, ajouta-t-il en me prenant le magazine des mains, étaient de véritables fanatiques qui se prenaient pour des génies, qui croyaient tout savoir et s'imaginaient que la pratique du yoga était le salut du monde. Mais ce n'est qu'un exercice, un sport comme ce que vous faites, vous autres garçons, en grimpant aux arbres, en marchant avec des échasses ou en courant avec un cerf-volant. Le yoga ? Un simple exercice physique, rien de plus, rien de spirituel. Peut-être sa pratique peut-elle aider l'individu en améliorant sa condition physique si bien que, ensuite, il peut oublier le yoga et s'attacher aux choses importantes, les choses de l'esprit. Après tout, au bout de quelques années, chacun quitte son corps et peu importe alors que ce corps soit tout de muscles durs et forte ossature ; la seule chose qui importe alors est l'état de l'esprit.
Il revint sur le sujet en disant :
— Oh, et je dois t'avertir de ceci ; beaucoup de ceux qui pratiquent le yoga oublient que leur affaire est juste un culte d'entraînement physique. Au lieu de cela, ils ont pris certaines de nos pratiques de guérison occultes et ont déclaré que ces pratiques de guérison sont un complément du yoga. C'est absolument faux ; n'importe lequel des arts de guérison peut être pratiqué par une personne qui ignore tout du yoga, et qui réussit souvent bien mieux. Donc — me pointant sévèrement du doigt — ne te laisse jamais prendre par la publicité du yoga, car il peut vraiment t'éloigner du Sentier.
Il se leva pour retourner dans sa chambre, mais sur le seuil il se retourna :
— J'oubliais ! J'ai là quelques tableaux que je voudrais que tu accroches à ton mur. Viens...
Puis il revint vers moi et me souleva afin de m'éviter la peine de me lever tout seul. Je le suivis dans sa chambre et là, sur une table, je vis trois rouleaux de papier. Il en prit un.
— Ceci, me dit-il, est une très vieille image chinoise qui, il y a plusieurs centaines d'années, était faite dans du placage de bois. Elle est à présent dans la ville de Pékin, mais dans cette représentation je veux que tu étudies soigneusement la façon dont les organes du corps sont imités par des moines qui accomplissent des tâches diverses.
Il s'arrêta et me montra un détail de l'image.
— Ici, tu vois des moines occupés à mélanger des aliments et des liquides. C'est l'estomac. Les moines préparent toute cette nourriture pour la faire passer par divers tubes avant qu'elle n'atteigne d'autres moines. Si tu étudies ceci tu obtiendras une très bonne idée du fonctionnement de base du corps humain.
Il roula l'image, noua soigneusement les petits rubans qui la serraient, et déroula une deuxième gravure.
— Ici, c'est une représentation de la colonne vertébrale avec divers chakras (chakram dans le texte d'origine, chakram étant le pluriel de chakra — NdT). Tu vas ainsi voir comment les différents centres de pouvoir sont situés entre la base de la colonne vertébrale et le sommet de la tête. Ce tableau doit se trouver juste en face de toi, de sorte que ce soit la dernière chose que tu voies la nuit et la première chose le matin.
Il roula soigneusement la deuxième image, noua les rubans et prit le troisième rouleau.
— Voici une représentation du système nerveux qui te montre les choses que tu devras étudier, telles que le ganglion cervical, le nerf vague, le plexus cardiaque, le plexus solaire et le plexus pelvien. Ce sont toutes des choses que tu dois connaître parce qu'elles sont tout à fait essentielles dans ta formation de lama médecin.
Je regardai l'image en me sentant de plus en plus découragé, car il me semblait bien que jamais je ne parviendrais à comprendre toutes ces choses, les tours et les détours du corps humain, toutes ces petites lignes et ces traits tordus et compliqués représentant des nerfs ou des artères, et les grosses taches que l'on appelait chakras. Mais, me dis-je pour me rassurer, j'avais encore le temps, je progressais à mon allure et selon mes moyens, et si je n'apprenais pas autant qu'ils pensaient que je le devrais — eh bien, on ne peut pas faire plus que de son mieux.
— Maintenant, Lobsang, tu vas aller prendre l'air, me dit mon Guide. Emporte ces rouleaux dans ta chambre, et ensuite fais ce que tu veux jusqu'à ce soir... Mais pas de bêtises, hein ?
Il me sourit affectueusement, et je m'inclinai avec respect, en prenant les trois rouleaux. Je rentrai dans ma chambre, fermai la porte de communication et me demandai où je pourrais bien accrocher ces fichus tableaux. J'aperçus alors des aspérités qui semblaient avoir été prévues à cet objet. Je pris une table et, avec précaution, je la posai sous une de ces aspérités ; montant sur la table, ce qui me donnait un autre douze ou dix-huit pouces de hauteur (30 ou 45 cm), je parvins à faire passer la corde du premier tableau par-dessus et le déroulai. Puis je descendis de la table et reculai dans le fond de la chambre pour juger de l'effet. Non, ce n'était pas parfait. J'allai tirer d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que le tableau soit parfaitement droit. Cela fait, j'accrochai de même les deux autres, en m'assurant qu'aucun ne penchait. J'admirai alors mon travail en m'époussetant les mains. Souriant avec satisfaction, je sortis de ma chambre, un peu perdu et me demandant de quel côté je devais aller. Mais comme je passais devant la porte de mon Guide, j'aperçus un des moines-serviteurs au fond du couloir. Il me salua de façon amicale et me dit :
— C'est le plus court chemin pour sortir. Par ici. Cette porte est réservée aux lamas, mais on me dit que tu as la permission de passer par là.
Il me l'indiqua, je le remerciai et sortis vivement.
Devant moi s'étirait le sentier de la montagne. Sur ma droite, des moines travaillaient la terre. Je fis quelques pas sur le sentier et allai m'asseoir sur une grosse pierre d'où je contemplai la ville, assez proche pour que je puisse distinguer, dans l'air si pur du Tibet, les marchands, les moines et les lamas allant à leurs affaires.
Je changeai bientôt de place pour aller m'asseoir sur une autre pierre abritée par un petit buisson. De là, je pouvais voir le marécage où serpentait un ruisseau argenté, où l'herbe était grasse et verte, où des poissons sautaient parfois dans les mares. Soudain, j'entendis du bruit derrière moi et une voix de gorge, grave et rauque, me dit :
— Hhrrah ? Mmmraouh !
Sur quoi je reçus un bon coup de tête dans le bas du dos et je me retournai pour caresser le vieux chat qui se mit à ronronner bruyamment ; il me lécha avec sa langue râpeuse, aussi rude que le gravier du sentier. Puis il me contourna, sauta sur mes genoux, sauta à terre et bondit entre des buissons, s'arrêtant soudain pour se retourner vers moi. Il semblait m'interroger, la queue dressée, les oreilles droites, les yeux bleus étincelants. Je ne bougeai pas, aussi bondit-il de nouveau vers moi en me disant avec insistance :
— Mrraouh ! Mmrraouh !
Comme je ne bougeais toujours pas, il leva une patte, accrocha avec ses griffes le bas de ma robe et tira doucement.
— Allons, chat, que me veux-tu ? demandai-je, irrité.
Je me levai cependant, avec difficulté, et regardai autour de moi pour voir ce qui agitait ainsi le chat. Je ne vis rien mais le chat s'énervait, insistait. Il se précipita vers un buisson éloigné, puis il revint me tirer par la robe. Je le suivis donc, descendant péniblement à flanc de montagne, avec prudence, tandis que le chat bondissait autour de moi, partait en avant, revenait, sautait en l'air, ou sur moi.
En me cramponnant aux buissons, je progressai lentement et finis par atteindre l'endroit où le chat s'était tourné pour me faire face, mais il n'y avait là rien à voir.
— Chat, tu n'es qu'un idiot ! m'écriai-je, exaspéré.
— Mmrraouh ! protesta-t-il. Mmrrahou !
Et il reprit ma robe pour la faire tourner autour de mes chevilles, bondissant autour de moi et mordillant de temps en temps mes pieds nus dans mes sandales. Puis il repartit, en se retournant pour voir si je le suivais.
Avec un soupir résigné, je descendis entre les buissons et me cramponnai soudain à une branche car il y avait là une descente abrupte ; je me trouvais sur une étroite corniche et si je ne m'étais pas retenu au buisson j'aurais certainement été précipité en bas. Cependant le chat bondissait de plus belle et je lui lançai quelques injures bien senties, mais il n'en eut cure. Il me contourna et bondit soudain de la corniche ! Mon cœur faillit s'arrêter de battre, car ce chat était un très vieil ami et ma pensée fut qu'il venait de se SUICIDER !
Avec mille précautions, je me mis à genoux et, me retenant aux branches des buissons, je regardai par-dessus le bord. Quelle ne fut pas ma stupéfaction de distinguer le corps d'un moine âgé environ douze pieds (3,6 m) plus bas. Horrifié, je vis que sa tête était sanguinolente et qu'il y avait aussi du sang sur sa robe. Je pouvais voir que sa jambe droite était pliée à un angle anormal. Le cœur battant de peur, d'excitation et d'effort, je regardai autour de moi et découvris une petite pente par laquelle je pus descendre, et me trouvai ainsi à la tête du vieux moine.
Doucement, avec une terrible inquiétude, j'avançai la main. Il était vivant. En sentant le bout de mes doigts il ouvrit faiblement les yeux et gémit. Je vis que dans sa chute il avait heurté une pierre. Le chat s'était assis et me regardait avec attention.
Je caressai doucement la tête du moine, glissai mes doigts derrière ses oreilles, puis le long du cou, vers le cœur. Au bout d'un moment il ouvrit franchement les yeux et regarda autour de lui. Il me vit enfin.
— Tout va bien, lui dis-je d'une voix apaisante. Je vais aller chercher des secours. Je reviens tout de suite.
Le pauvre vieux essaya de sourire, puis ses yeux se refermèrent. À quatre pattes, ce qui était pour moi plus sûr et plus rapide, je remontai au sommet et me hâtai vers la porte réservée aux lamas. En entrant je faillis renverser le moine-serviteur qui se trouvait là.
— Vite ! Vite ! lui criai-je. Il y a un moine blessé sur les rochers !
Comme je parlais, mon Guide sortit de sa chambre et me demanda se qui se passait.
— Maître ! Maître ! dis-je, je viens de découvrir, avec l'aide d'Honorable Minou, un vieux moine blessé. Il a une blessure à la tête et sa jambe est anormalement pliée. Il a besoin de soins urgents !
Mon Guide donna rapidement quelques instructions au moine-serviteur, puis il se tourna vers moi :
— Va devant, Lobsang. Je te suis.
Nous sortîmes de la lamaserie ; je quittai le chemin pour m'engager sur le sentier abrupt, suivi de mon Guide. Je fus navré de voir que sa robe safran se salissait et se déchirait aux ronces ; la mienne était si souillée que quelques taches de plus n'avaient guère d'importance ; Honorable Minou nous attendait impatiemment. Il parut vraiment soulagé lorsqu'il vit que je revenais avec le Lama Mingyar Dondup.
Il bondit devant nous et nous arrivâmes bientôt auprès du vieux moine ; ses yeux étaient fermés. Mon Guide s'accroupit à côté de lui et tira de sa robe divers petits sacs, des pansements et une fiole pleine d'un liquide avec lequel il humecta un morceau d'étoffe qu'il tint sous les narines du vieux moine. Le moine éternua aussitôt et ouvrit les yeux. Il parut vraiment très heureux de voir qui le soignait.
— Tout ira bien, mon ami, lui dit mon Guide. Nous allons te secourir.
Le vieux moine referma alors les yeux, avec un soupir de soulagement.
Mon Guide retroussa la robe du moine, et nous vîmes de petits morceaux d'os qui transperçaient la peau, juste au-dessous du genou.
— Tiens-lui les mains, Lobsang, maintiens-le bien. Appuie-toi sur lui de tout ton poids, afin qu'il ne puisse bouger. Je vais lui remettre les os en place.
Ce disant, il saisit la cheville et la tira brusquement. Je vis les petits os disparaître sous la peau. Le geste avait été si soudain, si habile, que le vieux moine n'eut même pas le temps de pousser un cri.
Rapidement, mon Guide se tourna vers un buisson et choisit deux branches solides, qu'il cassa et, après les avoir enveloppées d'un morceau de sa robe, il les attacha à la jambe du moine. Et puis nous attendîmes.
Bientôt, un groupe de moines conduits par un lama apparut, et nous les appelâmes. Ils descendirent vers nous, entourèrent le moine blessé mais l'un d'eux, un imprudent cherchant sans doute à se faire valoir, voulut montrer qu'il avait le pied sûr. Il glissa, naturellement, et se mit à dévaler la pente sur son derrière. Un buisson le retint, mais sa robe s'y accrocha tandis qu'il tombait, et il resta ainsi pendu, comme une banane pelée, pour se balancer tout nu à la vue des pèlerins qui suivaient au-dessous de nous la Route de l'Anneau. Mon Guide éclata de rire, et donna l'ordre à deux autres moines d'aller tirer leur camarade de sa fâcheuse posture. Lorsqu'il revint vers eux, il était rouge de honte. Je remarquai qu'il aurait bien du mal à s'asseoir pendant quelques jours, car la partie de son individu qui avait été en contact avec le sol était tout écorchée par les pierres !
Cependant, les autres moines s'occupaient du blessé ; avec mille précautions, ils le soulevèrent afin de le poser sur une forte toile qu'ils avaient apportée ; ils l'en enveloppèrent pour former un tube de toile, puis ils glissèrent à l'intérieur un long bâton solide qu'ils attachèrent avec des sangles. Le blessé avait perdu connaissance, heureusement, et ne souffrait pas. Deux moines soulevèrent alors les deux extrémités du bâton et, aidés par les autres, ils remontèrent par le sentier, lentement, prudemment, jusqu'au Chakpori.
Je caressai Honorable Minou, en expliquant à mon Guide comment il était venu me chercher pour que j'aille secourir le vieillard.
— Le pauvre homme serait sans doute mort si tu ne nous avais pas avertis, Honorable Minou, lui dit mon Guide, en le caressant aussi, puis il se tourna vers moi. C'est bien, Lobsang, tu as bien commencé. Continue.
Nous remontâmes à notre tour, assez péniblement, en enviant Honorable Minou qui gambadait devant nous. Mon Guide entra dans la lamaserie Chakpori, mais je restai un moment dehors, assis sur une pierre, pour jouer avec Honorable Minou ; je le taquinais avec un morceau d'écorce, solide et flexible, et il faisait semblant que c'était un ennemi féroce. Il bondissait, miaulait, se hérissait et attaquait l'écorce, et j'étais heureux car nous éprouvions l'un pour l'autre une amitié chaleureuse.
Chapitre Treize
J'ÉTAIS vraiment bien content d'être de retour au Chakpori, parmi ceux qui m'étaient familiers. Ici, les Professeurs étaient intensément consacrés à former des lamas médecins. Mon Guide m'avait conseillé de suivre les cours sur les herbes, l'anatomie et la médecine, car le Chakpori était LE centre de tels enseignements.
Avec vingt-cinq condisciples — des garçons comme moi, des garçons plus vieux et un ou deux jeunes moines venus d'autres lamaseries — j'allai donc en classe, assis par terre dans l'une ou l'autre de nos salles ; le Maître s'intéressait à sa mission.
— L'eau ! dit-il un jour. L'eau est la clef de la santé. Les gens ne boivent pas assez pour faire fonctionner le corps correctement. Chacun mange, et les aliments stagnent dans l'estomac, faute d'eau pour les entraîner dans les intestins. Il en résulte un système digestif bouché qui affecte tout le corps, et rend inapte à l'étude de la métaphysique.
Il s'interrompit et nous regarda tour à tour comme pour nous mettre au défi de le contredire.
— Maître, hasarda un jeune moine venu d'une lamaserie mineure, si nous buvons en mangeant nous risquons de diluer les sucs gastriques — du moins c'est ce que j'ai entendu dire.
Il se tut brusquement, comme s'il avait honte de son audace.
— Excellente question, répliqua le Maître. Bien des gens ont cette impression, mais elle est FAUSSE ! Le corps a la capacité de fabriquer des sucs digestifs extrêmement concentrés, si concentrés, en fait, que sous certaines conditions ils peuvent commencer à digérer le corps !
Nous le regardâmes avec stupéfaction, et j'éprouvai une peur considérable à l'idée que je pouvais me manger moi-même ! Le Maître sourit en voyant l'effet produit par ses paroles. Pendant quelques instants, il garda le silence, afin que nous puissions réfléchir.
— Les ulcères gastriques, les irritations stomacales... comment sont-ils provoqués ? demanda-t-il.
— Maître ! répondis-je hardiment, quand un homme s'inquiète il a des ulcères de la même manière sans doute qu'il pourrait avoir un mal de tête.
— Bel effort ! approuva le Maître en me souriant. Oui, un homme s'inquiète, les sucs gastriques dans son estomac deviennent de plus en plus concentrés, jusqu'à ce que finalement la partie la plus faible de l'estomac soit attaquée, et comme les acides qui normalement digèrent la nourriture rongent la partie la plus faible et finissent par percer un trou, les élancements de douleur agitent le contenu de l'estomac et conduisent à une concentration accrue des sucs gastriques. Finalement, les acides s'infiltrent à travers le trou qu'ils ont fait et pénètrent entre les couches de l'estomac causant ce que nous appelons des ulcères gastriques. Un apport d'eau suffisant soulagerait énormément la condition et pourrait même EMPÊCHER les ulcères. Morale — quand vous avez des soucis, buvez de l'eau et réduisez le risque d'avoir des ulcères !
— Maître ! s'exclama un garçon passablement sot, j'espère que l'on ne suivra pas vos conseils à la lettre ; je suis un de ceux qui doivent apporter de l'eau jusqu'au sommet de la montagne — et mon travail est déjà assez pénible.
La plupart des gens ignorent les problèmes qui assaillent des pays tels que le Tibet. Nous avions de l'eau en quantité, mais pas où il le fallait ! Pour subvenir aux besoins des grandes lamaseries, comme le Potala ou le Chakpori, des équipes de moines-ouvriers et d'enfants transportaient des outres d'eau par les sentiers de montagne. Les chevaux, les yaks étaient mis à contribution. Inlassablement, ces moines allaient et venaient pour remplir nos citernes. Nous n'avions pas de robinets qu'il suffit de tourner pour avoir de l'eau en abondance — chaude ou froide. Nous devions aller puiser la nôtre dans les citernes. Le sable fin des rivières, porté à dos d'homme ou de yak, nous servait à nettoyer nos ustensiles, ou le sol. L'eau était PRÉCIEUSE ! Nous allions laver notre linge à la rivière, faute de pouvoir faire monter la rivière jusqu'à nous !
Le Maître ignora cette réflexion idiote, et reprit sa leçon :
— La pire maladie de l'humanité, c'est — il fit une pause pour un effet dramatique tandis que nous pensions aux épidémies et aux cancers — la CONSTIPATION ! La constipation provoque une plus mauvaise santé générale que toute autre maladie. Elle jette les bases de maladies plus graves. Elle nous rend léthargiques, de mauvaise humeur, et misérablement indisposés. La constipation peut être GUÉRIE !
De nouveau il s'arrêta et regarda autour de lui.
— Non pas par des doses massives de cascara sagrada, ni par des litres d'huile de ricin, mais en buvant suffisamment d'eau. Réfléchissez — nous mangeons. Nous prenons des aliments et ils doivent passer par notre estomac et par nos intestins. Dans ce dernier (l'intestin grêle — NdT), de courts poils appelés ‘villosités’ (qui sont comme des tubes creux) absorbent des nutriments provenant de la digestion et des aliments digérés. Si les aliments sont trop lourds, trop ‘solides’, ils ne peuvent pénétrer dans les villosités. Ils s'encastrent dans des masses dures. Les intestins doivent se ‘tortiller’ — comme on pourrait décrire l'action du péristaltisme — ce qui pousse la nourriture le long du tube digestif, faisant de la place en amont. Mais si la nourriture est SOLIDE le péristaltisme intestinal aboutit simplement à la douleur et à aucun mouvement. Donc — l'eau est indispensable pour ramollir la masse.
C'est sans doute regrettable, mais il est de fait que tous les étudiants en médecine s'imaginent souffrir des symptômes qu'ils sont en train d'étudier. Je pressai mon abdomen et je fus absolument certain de sentir une masse dure. Je me dis qu'il me fallait faire quelque chose.
— Maître, demandai-je, comment agit un laxatif ?
Le lama se tourna vers moi en souriant. Je supposai qu'il nous avait tous observés, et qu'il nous avait vus chercher les ‘masses dures’.
— La personne qui doit prendre un laxatif est une personne qui déjà manque d'eau. Elle est constipée parce qu'elle n'a pas suffisamment de liquide pour ramollir les déchets congestionnés. Il lui FAUT obtenir de l'eau, aussi un laxatif commence-t-il par forcer le corps à produire de l'eau PAR les villosités pour amollir la masse et la rendre flexible, ce qui renforce la pulsion péristaltique. La douleur est provoquée par les masses dures qui adhèrent aux parois internes — et laissent le corps déshydraté. On devrait TOUJOURS boire beaucoup d'eau après avoir pris un laxatif. Naturellement j'ajoute, pensant à notre jeune ami le porteur d'eau, que les malades doivent descendre au bord de la rivière pour boire !
— Maître ! Pourquoi les gens qui souffrent de constipation ont-ils une si mauvaise peau et tous ces boutons ?
Un garçon au TRÈS mauvais teint posait cette question, et il rougit furieusement quand toutes les têtes se tournèrent vers lui.
— Nous devons nous débarrasser de nos déchets par les moyens prévus par la nature, répondit notre Maître, mais si l'Homme fait obstacle à cette méthode, les déchets pénètrent dans le sang, bouchent les vaisseaux vitaux et le corps tente de se débarrasser des déchets par les pores de la peau. Encore une fois, la matière n'est pas assez fluide pour passer à travers les fins tubes des pores, et il en résulte un encrassement et une ‘mauvaise peau’. Buvez beaucoup d'eau, faites raisonnablement de l'exercice — et nous n'aurons pas à payer autant pour la cascara sagrada, le sirop de figues et l'huile de ricin. Et maintenant, ajouta-t-il en riant, je vous libère afin que vous alliez tous boire de l'eau en quantité !
Il nous fit signe de nous disperser et se dirigea vers la porte, mais au même instant un messager entra en trombe.
— Honorable Maître, avez-vous ici un garçon appelé Rampa ? Lobsang Rampa ?
Le Maître se retourna, me chercha des yeux et me fit signe.
— Qu'as-tu encore fait, Lobsang ? me demanda-t-il avec douceur.
Je m'avançai, à contrecœur, en boitant très bas, aussi pitoyablement que je le pus. Je me demandais, comme lui, ce que j'avais pu faire de mal.
— Ce garçon doit se rendre immédiatement chez le Père Abbé, dit le messager au lama. Je dois l'y conduire — j'ignore pourquoi.
Aïe ! pensai-je, qu'est-ce que ça pouvait bien être CETTE FOIS ? M'avait-on vu en train de jeter des cuillerées de tsampa sur les moines ? M'avait-on surpris quand j'avais mis du sel dans le thé du Maître des Acolytes ? Ou bien — sombrement je passai en revue mes ‘péchés’. Et si le Père Abbé en avait appris PLUSIEURS ? Je suivis le messager par les longs couloirs austères du Chakpori. Il n'y avait aucun luxe, pas de rideaux drapés comme au Potala. Tout était rigoureusement fonctionnel. Le messager s'arrêta devant une porte gardée par deux Surveillants et me fit signe d'attendre, puis il entra. Inquiet, je me dandinais d'un pied sur l'autre, sous le regard sévère et méprisant des Gardiens. Enfin, le messager reparut.
— Entre ! ordonna-t-il en me donnant une poussée.
J'entrai à contrecœur et la porte fut fermée derrière moi. J'entrai — et m'arrêtai involontairement, stupéfait. Il n'y avait pas d'austérité ICI ! Le Père Abbé, revêtu d'une somptueuse robe rouge et or, était assis sur une plate-forme surélevée, à environ trois pieds (1 m) du sol. Quatre lamas l'entouraient pour le servir. Reprenant mes esprits, je m'inclinai et me prosternai trois fois, selon la règle, avec tant de ferveur que mon bol et ma boîte d'amulettes s'entrechoquèrent sous ma robe. Un lama qui se tenait derrière le Père Abbé me fit signe d'avancer, et leva vivement la main pour me faire comprendre où je devais m'immobiliser.
Le Père Abbé me contempla en silence, me toisa des pieds à la tête, examinant ma robe, mes sandales, et sans doute constatant que j'avais la tête bien rasée, puis il se tourna vers un des Lamas-Assistants :
— Arrumph ! C'est le garçon en question ?
— Oui, Monseigneur.
De nouveau, ce regard, cette évaluation calculée.
— Arrumph. Urrahh ! Ainsi, mon garçon, c'est toi qui as apporté des secours au Moine Tengli ? Urrhph !
Le lama qui m'avait fait des signes remua les lèvres et me désigna du doigt. Je compris aussitôt que je devais répondre.
— J'ai eu beaucoup de chance, Monseigneur, répondis-je avec ce que j'espérais être suffisamment d'humilité.
Ce regard, de nouveau, qui m'inspectait comme si j'étais un insecte sur une feuille ! Enfin, il parla de nouveau.
— Err, ahhh ! Oui, Oh ! Je te félicite, mon garçon. Arrumph !!
Il se détourna de moi et le lama qui se tenait derrière lui me fit signe de m'incliner et de partir. Je me prosternai donc trois fois, et sortis à reculons, non sans avoir envoyé un ‘merci’ télépathique au lama qui m'avait si bien guidé par ses signes. Mon derrière heurta la porte. Je l'ouvris à tâtons, me glissai hors de la pièce et m'adossai au mur avec un ‘OUF !!’ de profond soulagement. Levant les yeux, je croisai ceux d'un de ces Surveillants géants.
— Alors ? Tu veux partir pour les Champs Célestes ? NE RESTE PAS LÀ ! rugit-il à mon oreille.
Je sursautai, soulevai le bas de ma robe et repartis dans le corridor, sous le regard mauvais des deux Gardiens. Quelque part une porte grinça et une voix dit :
— ATTENDS !
‘Par la Dent de Bouddha, qu'ai-je encore fait ?’ me demandai-je au désespoir, en me retournant pour voir qui m'interpellait ainsi. Un lama venait vers moi et — que Bouddha me pardonne ! — il SOURIAIT ! Je reconnus alors celui qui m'avait fait des signes, derrière le dos du Père Abbé.
— Tu t'es fort bien comporté, Lobsang, me dit-il avec satisfaction. Tu as agi selon les règles. Voici un petit cadeau pour toi — le Père Abbé les aime aussi, tu sais !
Il me mit dans les mains un paquet, me tapota l'épaule et me quitta. Je restai pétrifié, le paquet dans les mains, dont je devinais déjà le contenu. Les deux Gardiens me regardaient en souriant avec bienveillance car ils avaient entendu les paroles du lama. Ah ! me dis-je en les dévisageant. Un Gardien souriant était si insolite que cela faisait peur ! Sans attendre mon reste, je filai dans le corridor aussi vite que je le pus.
— Qu'est-ce que tu as là, Lobsang ? pépia soudain une petite voix flûtée.
Je m'arrêtai net, me retournai, et je vis alors un petit garçon, un nouveau. Il était plus jeune que moi et je savais qu'il avait du mal à s'adapter à notre règle monastique.
— Des gâteaux — je crois, répondis-je.
— Tu m'en donnes un, dis ? J'ai manqué le déjeuner, supplia-t-il.
Je le considérai ; il paraissait vraiment affamé. Il y avait une alcôve à provisions tout près. Je l'y conduisis, et nous nous assîmes dans le fond, derrière des sacs d'orge. Avec soin, j'ouvris mon paquet de gâteaux indiens. Le petit garçon écarquilla les yeux :
— Ah ! Je n'ai jamais rien vu de pareil !
Je lui donnai un des gâteaux roses couverts de poudre blanche. Il le goûta, et ses yeux s'arrondirent encore. Soudain, je m'aperçus que le gâteau que j'avais dans la main gauche avait DISPARU ! Un son me fit tourner la tête ; il y avait là un des chats... et il mangeait MON gâteau ! Avec grande satisfaction semblait-il. Résigné, j'en pris un autre.
— Rrrah ? fit une voix derrière moi, et une patte se posa sur mon bras. Rrarrh ? Mmmraouh !
Et voilà ! Mon deuxième gâteau avait disparu et le chat le mangeait !
— VILAIN voleur ! m'exclamai-je, furieux.
Puis je me rappelai que ces chats étaient mes amis, qu'ils étaient bons gardiens, qu'ils me consolaient quand j'avais de la peine et je m'excusai :
— Pardon, Honorable Chat Gardien, tu travailles pour gagner ta vie alors que je ne fais rien. Tiens...
Je lui donnai un autre gâteau, et puis je le pris sur mes genoux pour le caresser ; il ronronnait comme un moteur !
— Ah ! s'écria le petit garçon, ils ne se laissent jamais TOUCHER ! Comment fais-tu ?
Il tendit la main pour caresser le chat et, tout à fait par hasard, en profita pour prendre un gâteau au sucre. Comme je ne protestais pas, il se détendit, et s'installa confortablement pour le manger en paix. Le chat ronronnait, me donnait de petits coups de tête affectueux et je lui offris un autre gâteau ; mais il était repu, sans doute, car il se contenta de frotter son museau dessus, en ronronnant plus fort encore, étalant le sirop gluant sur ses moustaches. Puis, certain que j'avais compris ses remerciements, il sauta de mes genoux, s'éloigna et bondit sur l'appui de la fenêtre où il entreprit de faire minutieusement sa toilette, dans un rayon de soleil. Je l'observai un instant et quand je me retournai je vis le petit garçon prendre le gâteau contre lequel le chat s'était frotté et le fourrer dans sa bouche.
— Tu crois à la Religion ? me demanda-t-il soudain.
Si je croyais à la Religion ! Quelle remarquable question, pensai-je. Nous étions là pour étudier afin de devenir des Lamas Médecins et des Prêtres Bouddhistes, et ce petit garçon me demandait si je croyais à la Religion ! C'était fou ! FOU ! Et puis je réfléchis. Est-ce que je croyais VRAIMENT à la Religion ? À quoi est-ce que je croyais VRAIMENT ?
— Je ne voulais pas venir ici, reprit le petit garçon, mais on m'a forcé. J'ai prié notre Sainte Mère Dolma ; j'ai beaucoup prié pour ne pas venir et pourtant je suis là. J'ai prié aussi pour que ma maman ne meure pas, mais elle est morte, et ceux qui disposent des morts sont venus et ils ont emporté son corps pour le donner aux vautours. Jamais aucune de mes prières n'a été exaucée. Et toi, Lobsang ?
Adossé à un sac d'orge, je regardais le chat faire sa toilette. Lécher une patte, la passer derrière les oreilles et sur la figure. J'étais presque hypnotisé par cette cérémonie, lécher, frotter, lécher, frotter...
Mes prières ? Ma foi, maintenant que j'y pensais, elles ne semblaient pas être exaucées non plus. Alors, si la prière ne servait à rien, pourquoi prier ?
— J'ai brûlé beaucoup de bâtonnets d'encens, me dit humblement le petit garçon. Je les prenais dans le coffret de mon Honorable Grand-mère, mais les prières n'ont jamais marché pour moi. Et maintenant je suis ici au Chakpori, et j'étudie pour devenir quelqu'un que je ne veux pas être. POURQUOI ? Pourquoi faut-il que je sois un moine alors que la religion ne m'intéresse pas ?
Je pinçai les lèvres, haussai les sourcils et pris une expression sévère, comme celle du Père Abbé tout à l'heure. Puis je toisai lentement le petit garçon, des pieds à la tête.
— Écoute, dis-je enfin, nous allons abandonner ce sujet pour le moment. Je vais y réfléchir et je te donnerai ma réponse en temps voulu. Mon Guide le Lama Mingyar Dondup sait tout, et je lui demanderai de considérer cette affaire.
Comme j'allais me relever, je vis le paquet de gâteaux indiens, plus qu'à demi entamé. Impulsivement, je réunis les quatre coins de la serviette dans laquelle ils étaient enveloppés, et posai le paquet dans les mains du petit garçon stupéfait.
— Tiens, prends ça, lui dis-je, cela t'aidera à penser à autre chose qu'à la spiritualité. Et maintenant va-t'en, parce que je dois réfléchir.
Je le pris par le bras, le conduisis jusqu'à la porte et le poussai dans le couloir. Il fut ravi de partir, craignant que je change d'idée et lui reprenne les gâteaux indiens.
Une fois débarrassé de lui, je me consacrai à des choses plus importantes. Sur un des sacs, j'avais vu un magnifique bout de ficelle. J'y allai et, lentement, avec précautions, je tirai la ficelle qui fermait le sac. Puis j'allai à la fenêtre et nous fîmes une belle partie, Honorable Chat et moi ; il courut après l'extrémité de la ficelle que j'agitais, sautant par-dessus les sacs, plongeant entre eux, et nous nous amusâmes beaucoup tous les deux. Enfin, nous fûmes tous deux fatigués en même temps. Il vint me donner un coup de tête, me contempla gravement, la queue droite et me dit ‘Mrraouh !’ avant de sauter par la fenêtre pour aller vaquer à ses mystérieuses affaires. J'enroulai la ficelle, la glissai sous le devant de ma robe et sortis de l'alcôve à provisions. Quelques minutes plus tard, j'étais dans ma chambre.
Pendant quelques instants, je contemplai le plus important des tableaux. Il représentait un homme, et l'on pouvait voir l'intérieur. Il y avait d'abord la trachée ; sur la gauche de la trachée, une image de deux moines qui étaient occupés à agiter des éventails pour chasser de l'air dans les poumons. Sur la droite, deux autres moines tout aussi affairés soufflaient de l'air dans l'autre poumon. Et puis il y avait une image du cœur. Ici les moines étaient occupés à pomper du sang, ou plutôt un liquide, parce qu'on ne pouvait pas voir que c'était du sang. Plus bas, il y avait une grande salle, qui était l'estomac. Là un moine, de toute évidence un aîné, était assis derrière une table et cinq moines étaient très occupés à lui apporter des paquets de nourriture. Le moine en charge faisait le compte de la quantité de nourriture qui lui était apportée.
Plus bas encore, un groupe de moines prenaient de la bile avec des louches dans la vésicule biliaire et la mêlaient aux aliments pour les diluer et aider à la digestion. Un peu plus loin des moines étaient occupés dans ce qui était visiblement une usine de produits chimiques — le foie — où ils décomposaient diverses substances dans des récipients d'acide, et j'étais tout à fait fasciné par cette image parce qu'à partir de là tout allait en serpentant, serpentant, serpentant, pour apparemment représenter les intestins. Les moines bourraient les intestins de diverses substances. Plus bas encore il y avait les reins, où des moines séparaient des liquides différents et veillaient à ce qu'ils prennent la bonne direction. Mais ce qu'il y avait de plus intéressant à voir se trouvait sous la vessie ; deux moines étaient assis de part et d'autre d'un tuyau et contrôlaient manifestement l'écoulement des liquides. Je relevai les yeux vers la figure, et ne m'étonnai pas que cet homme ait l'air si triste avec tous ces gens à l'intérieur de son corps qui allaient et venaient et faisaient des choses si extraordinaires ! Je restai là un moment en contemplation, en imaginant je ne sais quelles histoires au sujet de tous ces petits hommes qui habitaient mon corps.
Enfin, j'entendis frapper légèrement à la porte de communication, puis elle s'ouvrit et mon Guide apparut. Il eut un sourire d'approbation en voyant que j'étudiais le tableau.
— C'est une gravure très, très ancienne, me dit-il, composée par les plus grands artistes de Chine. L'original est grandeur nature, fait de différentes essences de bois. Je l'ai vu et je puis t'assurer que c'est un chef-d'œuvre, absolument vivant... On me dit que tu as fait très bonne impression sur le Père Abbé, Lobsang. Après t'avoir vu, il m'a dit que tu avais des qualités tout à fait remarquables. J'ai pu lui assurer, ajouta-t-il d'une voix légèrement ironique, que le Grand Initié avait été du même avis.
Ma tête bourdonnait de questions au sujet de la religion, aussi osai-je demander humblement :
— Maître, puis-je vous poser une question qui me trouble grandement ?
— Très certainement. Si je puis t'aider je le ferai avec joie. Qu'est-ce qui te trouble donc ? Mais viens, passons dans ma chambre où nous pourrons nous asseoir plus confortablement et où nous nous ferons servir du thé.
Il se retourna, après un bref regard à mes maigres provisions qui avaient singulièrement diminué. Je le suivis. Dès qu'il fut dans sa chambre il appela un moine-serviteur qui nous apporta le thé et un léger repas. Lorsque nous eûmes fini, le lama me sourit en disant :
— Eh bien, dis-moi ce qui te trouble. Prends ton temps, car tu n'as pas besoin d'assister à l'office du soir.
Il s'assit dans la Position du Lotus, les mains croisées sur les genoux. Je m'installai le plus confortablement que je pus sur un coussin, tout en essayant de mettre un peu d'ordre dans mes pensées afin d'exposer mon cas le plus clairement possible et sans ‘bafouiller’.
— Honorable Maître, dis-je enfin, je suis troublé par la question de la religion ; je n'en vois pas l'utilité. J'ai prié, d'autres ont prié, et jamais nos prières n'ont été exaucées. Nous avons l'impression de prier dans le désert et que les Dieux ne nous écoutent pas. J'ai le sentiment que, tout comme ceci est le Monde de l'Illusion, la religion et la prière doivent être aussi une illusion. Je sais bien que de nombreux pèlerins viennent demander de l'aide aux lamas afin que leurs problèmes soient résolus, mais je n'ai jamais entendu dire qu'aucun l'ait été. Mon père lui-même — quand j'avais un père ! — employait un prêtre à plein temps, mais cela ne semble guère lui avoir fait de bien. Maître, pouvez-vous me dire quelle est l'utilité de la religion ?
Mon Guide resta silencieux pendant un moment, regardant ses mains jointes. Enfin, il poussa un soupir et me regarda franchement.
— Lobsang, dit-il, la religion est une chose très nécessaire, indispensable. Il est absolument nécessaire, absolument essentiel que nous ayons une religion capable d'imposer sa discipline spirituelle à ses adhérents. Sans religion, les hommes seraient pires que des bêtes sauvages. Sans religion, il n'y aurait pas de voix de la conscience. Peu importe, Lobsang, que l'on soit bouddhiste, hindou, chrétien ou juif. Tous les hommes ont le sang rouge quand ils saignent, et la foi à laquelle nous nous plions est essentiellement la même.
Il s'interrompit, comme pour voir si je le comprenais bien. Je hochai la tête et il reprit :
— Ici sur Terre, la plupart des gens sont très semblables à des enfants dans une école, des enfants qui ne voient jamais le Directeur, qui ne voient jamais le monde extérieur qui entoure leur école. Imagine que le bâtiment de l'école soit complètement ceinturé par un grand mur ; il y a certains enseignants dans cette école, mais les membres de la direction ne sont jamais vus par cette classe particulière. Les élèves de cette école auraient alors des raisons de croire qu'il n'y a pas de Directeur, s'ils n'ont pas l'intelligence de voir qu'il y a quelque chose de supérieur à l'enseignant moyen. Quand les enfants réussissent leurs examens et sont capables de passer à une classe supérieure, ils peuvent alors sortir à l'extérieur du mur qui entoure l'école, et peut-être rencontrer finalement le Directeur et voir le monde au-delà. Trop souvent, les gens demandent des preuves, il leur faut des preuves de tout, ils doivent avoir la preuve de l'existence de Dieu, et le seul moyen d'obtenir cette preuve c'est de parvenir à voyager dans l'astral, à devenir clairvoyant, parce que lorsque l'on peut voyager au-delà des limites de cette classe qui est murée, on peut voir la Grande Vérité au-delà.
De nouveau, il s'interrompit, et me considéra avec une certaine anxiété, pour voir si je suivais ses propos. Mais je le comprenais fort bien, et ce qu'il disait me semblait plein de bon sens.
— Imaginons maintenant une classe où l'on croit que le Directeur s'appelle Un tel. Mais dans la classe voisine, les élèves discutent avec nous et nous disent que le nom du Directeur est autre. Une troisième classe intervient et nous déclare que nous sommes tous des imbéciles parce qu'il n'y a pas de Directeur, car s'il y en avait un nous le verrions, nous connaîtrions son nom et nous n'aurions pas à discuter. Ainsi, Lobsang, une de ces classes est pleine d'Hindous qui appellent le Directeur par un certain nom, la classe voisine est pleine de chrétiens et ils ont un autre nom pour leur Directeur. Mais si nous allons au fond des choses, si nous extrayons l'essence de chaque religion, nous constatons que chacune d'entre elles a des caractéristiques de base communes. Cela signifie qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Être Suprême. Nous pouvons l'adorer de nombreuses manières différentes, mais du moment que nous l'adorons avec foi, c'est tout ce qui compte.
La porte s'ouvrit, et un moine-serviteur nous apporta du thé frais. Mon Guide s'en versa une tasse et but avidement, car de tant parler lui avait donné soif, et je bus aussi, parce que j'avais soif à force de l'écouter. Une excuse en valait une autre !
— Lobsang, suppose que tous les acolytes, les moines et les lamas de la lamaserie de la Barrière de Roses n'aient personne pour leur inculquer la discipline ; ils sont sept mille dans cette lamaserie, sept mille ! Suppose qu'il n'y ait aucune discipline, aucune récompense, aucun châtiment, suppose que chacun puisse faire ce qui lui plaît, selon son caprice, sans être troublé par sa conscience. Bientôt, ce serait l'anarchie, il y aurait des crimes, il pourrait se passer des choses horribles. Ces hommes sont maintenus sur le droit chemin par la discipline, la discipline spirituelle aussi bien que physique ; de même il est indispensable que tous les peuples du monde aient une religion, car on doit avoir une discipline spirituelle tout autant qu'une discipline physique, parce que s'il n'y avait que la discipline physique ce serait le règne de la force où le plus fort gagnerait, tandis qu'avec une discipline spirituelle le règne de l'amour l'emporte. Le monde d'aujourd'hui a grand besoin d'un retour à la religion, non pas une religion particulière mais n'importe quelle religion, celle la mieux adaptée au tempérament de la personne concernée.
Tout cela était bien beau, et fort sensé ; je comprenais l'utilité de la discipline, mais je me demandais pourquoi nos prières n'étaient jamais exaucées.
— Honorable Maître, dis-je, je comprends tout cela, mais si la religion est une chose si bonne pour nous, pourquoi nos prières ne sont-elles jamais exaucées ? J'ai prié et prié de ne pas avoir à venir dans cette boîte — euh — cette lamaserie, mais elles n'ont servi à rien puisque je suis ici. Si la religion sert à quelque chose, pourquoi ai-je été envoyé ici, pourquoi mes prières n'ont-elles pas reçu de réponse ?
— Comment le sais-tu, Lobsang ? Tu te fais une idée fausse de la prière. Bien des gens s'imaginent qu'ils n'ont qu'à joindre les mains et prier un Dieu mystérieux de leur donner un pouvoir sur leurs semblables. Certains prient pour avoir de l'argent, d'autres prient pour la défaite et la mort de leurs ennemis. Quand il y a la guerre, chacun des deux camps prie Dieu de lui accorder la victoire, chacun prétend que Dieu est avec lui pour frapper l'ennemi. N'oublie pas que lorsque nous prions, c'est à nous que nous nous adressons. Dieu n'est pas un Puissant Personnage assis à une table qui écoute les pétitions, sous forme de prières, et qui accorde à chacun ce qu'il désire.
Il se mit à rire avant de poursuivre :
— Imagine que tu ailles demander au Père Abbé qu'il te délivre de la lamaserie, ou qu'il te donne une importante somme d'argent. Crois-tu qu'il accédera à ta requête dans le sens que tu désires ? Il répondra bien plus probablement à ta demande dans le sens que tu ne désires pas !
C'était logique, certes, mais cela ne répondait pas à ma question ; j'observai que cela me paraissait bien inutile de prier si personne n'était là pour vous répondre ou pour vous accorder ce que l'on demandait. Je le dis à mon Guide.
— Mais ton idée de la prière, alors, est entièrement égoïste. Tout ce que tu veux à chaque fois est quelque chose pour toi-même. Penses-tu que tu peux prier un Dieu et lui demander de t'envoyer un sac de noix confites ? Crois-tu que tu peux prier et voir un grand paquet de gâteaux indiens te tomber dans les bras ? La prière doit être pour le bien des autres. La prière doit être pour rendre grâce, remercier Dieu. La prière doit consister en une déclaration de ce que tu aimerais faire pour les autres, non pour toi-même. Quand tu pries, tu donnes un certain pouvoir à tes pensées, et si possible tu dois prier à haute voix, parce que cela ajoute de la puissance à tes pensées. Mais tu dois t'assurer que tes prières sont désintéressées, tu dois t'assurer que tes prières ne contredisent pas les lois de la nature.
Je hochais la tête en l'écoutant, car il me semblait bien que les prières ne servaient pas à grand-chose. Mon Guide sourit.
— Oui, je sais ce que tu penses, je sais que tu estimes que la prière est une perte de temps. Mais suppose qu'une personne vienne de mourir, ou qu'elle soit morte depuis quelques jours, et que tu puisses voir ta prière exaucée. Suppose que tu pries que cette personne revienne à la vie. Crois-tu qu'il serait bon pour elle de revenir à la vie après avoir été morte depuis un certain temps ? Les gens prient Dieu d'abattre leur ennemi du moment. Crois-tu qu'il est raisonnable d'attendre de Dieu qu'il aille tuer quelqu'un parce qu'un fou aura prié à cet effet ?
— Mais, Honorable Maître, les lamas prient à l'unisson dans les temples et ils demandent des choses diverses. Quel en est donc le but ?
— Les lamas prient à l'unisson dans les temples avec des choses spéciales en tête. Ils prient — ils dirigent leurs pensées, autrement dit — afin qu'ils puissent assister ceux qui sont en détresse. Ils prient que ceux qui sont las puissent venir pour obtenir de l'aide, de l'aide télépathique. Ils prient que les fantômes errants perdus dans le désert au-delà de cette vie viennent afin d'être guidées, car si une personne meurt sans rien savoir de l'autre côté de la mort, elle peut être perdue dans un bourbier d'ignorance. Aussi les lamas prient — envoient leurs pensées télépathiques — afin que ceux qui ont besoin de secours puissent venir et être aidés.
Il me regarda sévèrement, en ajoutant :
— Les lamas ne prient pas pour leur propre avancement, ils ne prient pas afin d'être promus. Ils ne prient pas que le Lama Untel, qui a été un peu difficile, tombe d'un toit ou autre chose. Ils prient uniquement pour aider les autres.
Mes idées tourbillonnaient confusément dans ma tête car j'avais toujours cru qu'un Dieu, ou Notre Sainte Mère Dolma, était capable de répondre à une prière si elle était dite avec suffisamment de ferveur. Par exemple, je n'avais pas voulu entrer dans une lamaserie, et j'avais prié, prié à perdre la voix. Mais ces prières n'avaient eu aucun effet, j'avais dû entrer à la lamaserie. Il semblait que la prière était quelque chose qui ne pouvait servir qu'à aider d'autres personnes.
— Je perçois très clairement tes pensées, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue sur la question, me dit mon Guide. Pour être spirituel on doit faire aux autres ce que l'on voudrait qu'il nous soit fait. Tu dois prier pour obtenir la force et la sagesse d'apporter aide ou force et sagesse aux autres. Tu ne dois pas prier à ta propre intention, car c'est une perte de temps, un exercice inutile.
— Ainsi, observai-je, une religion est simplement quelque chose que nous devons faire aux autres ?
— Pas du tout, Lobsang. Une religion est quelque chose que nous VIVONS. C'est une norme de conduite que nous nous imposons volontairement afin que notre Moi Supérieur puisse être purifié et fortifié. En gardant des pensées pures, nous tenons à l'écart les pensées impures, nous fortifions ce à quoi nous retournons quand nous quittons le corps. Mais tu verras la vérité de tout cela par toi-même, quand tu seras plus expérimenté dans le voyage astral. Pour le moment — pendant quelques semaines encore — tu dois me croire sur parole. La religion est très réelle, la religion est très nécessaire. Si tu pries et que ta prière ne soit pas exaucée comme tu le penses, il se peut que ta prière ait été exaucée en fin de compte, car avant de venir sur cette Terre nous faisons un plan précis des avantages et des désavantages que nous aurons sur cette Terre. Nous planifions notre vie sur Terre (avant d'y venir) tout comme l'étudiant d'une grande université planifie ses cours de sorte qu'à la fin de ses études il puisse devenir ceci, cela, ou autre chose — ce pour quoi il a été formé.
— Honorable Maître, croyez-vous qu'une religion soit supérieure à une autre ? demandai-je un peu timidement.
— Aucune religion n'est meilleure que l'homme qui professe cette religion. Ici, nous avons nos moines bouddhistes ; certains moines bouddhistes sont des hommes très bons, d'autres ne sont pas si bons. Une religion est personnelle à chaque individu, chaque personne a une approche différente à une religion, chaque personne voit des choses différentes dans sa religion. Peu importe que cet homme soit Bouddhiste, Hindou, Chrétien ou Juif. Tout ce qui importe est qu'une personne pratique sa religion au mieux de sa foi et au mieux de ses capacités.
— Maître, demandai-je encore, est-il bon qu'une personne change de religion, qu'un bouddhiste devienne chrétien, ou un chrétien bouddhiste ?
— Mon opinion personnelle, Lobsang, est que sauf dans des circonstances très inhabituelles, une personne ne devrait pas changer de religion. Si une personne est née dans la foi chrétienne, et vit dans le monde Occidental, alors cette personne devrait garder la foi chrétienne, car l'on absorbe ses croyances religieuses comme l'on absorbe les premiers sons de sa langue, et il arrive souvent que si un chrétien devienne tout à coup un hindou ou un bouddhiste, certains facteurs héréditaires, certaines conditions innées tendent à affaiblir l'assimilation de la nouvelle foi, et trop souvent pour compenser cela, la personne sera avidement, fanatiquement en faveur de la nouvelle religion, tout en ayant en même temps toutes sortes de doutes et de conflits non résolus sous la surface. Le résultat est rarement satisfaisant. Ma recommandation personnelle est que comme en naissant une personne a accepté une croyance religieuse, elle devrait donc s'en tenir à cette croyance.
— Hum, murmurai-je. Il me semble que toutes les idées que je me faisais de la religion étaient à l'envers. Si j'ai bien compris, on doit donner et ne rien demander. Tout ce que l'on peut espérer, c'est que quelqu'un d'autre demandera pour vous.
— On peut demander la compréhension, on peut demander par la prière de pouvoir aider les autres, parce que, en assistant les autres, on s'assiste soi-même, en enseignant aux autres on apprend soi-même, en sauvant les autres on se sauve soi-même. Il faut donner avant de pouvoir recevoir, il faut donner de soi-même, donner sa compassion, sa miséricorde. Tant que l'on ne parvient pas à se donner, on ne peut pas recevoir des autres. On ne peut obtenir de la pitié sans d'abord montrer de la pitié. On ne peut obtenir la compréhension sans avoir d'abord donné sa compréhension aux problèmes des autres. La religion est une très grande chose, Lobsang, c'est une chose bien trop importante pour en discuter ainsi aussi rapidement. Mais penses-y. Pense à ce que tu peux faire pour les autres, pense au moyen d'apporter du plaisir et de l'avancement spirituel aux autres. Et laisse-moi te demander quelque chose, Lobsang ; tu as contribué à sauver la vie d'un pauvre vieux moine qui a eu un accident. Dis-moi franchement si ton geste ne t'a pas apporté un grand plaisir et une profonde satisfaction ? Dis-moi ?
Je réfléchis à cela et m'aperçus que mon Guide avait raison. Oui, j'avais éprouvé une immense satisfaction, en suivant Honorable Minou et en apportant mon secours au vieux moine.
— Oui, Honorable Maître, dis-je enfin. Cela m'a apporté beaucoup de joie.
Les ombres du soir s'allongeaient sur le sol et le manteau violet de la nuit s'étendait sur notre Vallée. Les lumières de Lhassa clignotaient et scintillaient au loin et des ombres passaient derrière les toiles de soie huilée. Au-dessous de notre fenêtre un des chats poussa un cri plaintif, auquel un autre chat répondit. Mon Guide se leva et s'étira. Il paraissait ankylosé, et quand je me relevai je faillis tomber de tout mon long, car nous étions assis là depuis bien plus longtemps que je ne le pensais et moi aussi j'avais les membres raides. Ensemble, nous allâmes à la fenêtre et contemplâmes le panorama pendant quelques instants, puis mon Guide me dit :
— Je crois que nous devrions nous reposer et passer une bonne nuit parce que — qui sait ? — nous aurons peut-être une dure journée demain. Bonne nuit, Lobsang. Dors bien.
— Honorable Maître, merci de m'avoir consacré tant de précieuses minutes et de vous être donné la peine de m'expliquer toutes ces choses. Je suis lent et pas bien vif d'esprit, j'en ai peur, mais je crois que je commence à comprendre. Merci. Bonne nuit.
Je le saluai très bas et me dirigeai vers la porte de communication.
— Lobsang !
Je me tournai.
— Lobsang, tu as vraiment beaucoup plu au Père Abbé, et je trouve cela remarquable. Le Père Abbé est un homme austère, très sévère. Tu t'es très bien comporté. Bonne nuit.
— Bonne nuit, répétai-je.
Je fis rapidement mes très simples préparatifs pour la nuit et puis je me couchai — pas pour dormir immédiatement, mais pour penser à toutes les choses qui m'avaient été dites, et en y réfléchissant — oui — c'était vrai, une correcte adhésion à sa religion pouvait fournir une excellente discipline spirituelle, fort adéquate.
Chapitre Quatorze
J'OUVRIS vaguement les yeux et me demandai où j'étais. Je me réveillai, à contrecœur. À l'est, le ciel était rose ; des cristaux de glace en suspension au-dessus des montagnes scintillaient, projetant des éclats multicolores. Au-dessus de moi, le ciel était encore sombre, presque violet, mais je le vis s'éclaircir rapidement et prendre des teintes mauves. Je fus secoué de frissons. Comme il faisait froid ! Ma couverture élimée ne me protégeait guère du froid glacial de la pierre sur laquelle j'étais couché. Je bâillai, me frottai les yeux en essayant de retarder de quelques minutes mon lever.
Irrité, encore à moitié endormi, je dépliai mon ‘oreiller’, qui n'était autre que ma robe. Je tâtonnai, cherchant le devant et le derrière de cette robe. Finalement, je m'en revêtis n'importe comment et m'aperçus avec colère que je l'avais mise à l'envers. Je l'arrachai nerveusement en marmonnant des mots défendus avec une telle irritation, que le tissu usé se déchira du haut en bas ! Tout nu, grelottant dans l'air glacé, je contemplai les dégâts. Cette fois, j'étais ‘bon’ ! Que dirait le Maître des Acolytes ? Je le savais bien... Il me ferait honte, il me gronderait parce que j'avais stupidement gâté une robe appartenant à la lamaserie, il me traiterait de tous les noms !
On ne nous donnait pas de robes neuves. Lorsqu'un garçon grandissait et que sa robe ne lui allait plus, on lui en donnait une autre, qui avait été portée par un garçon plus grand. Toutes ces robes étaient vieilles, usées et certaines tombaient en lambeaux. ‘Comme la mienne’, me dis-je en contemplant ses restes navrants. Je tâtai le tissu et il me parut mince, vide, sans vie. Tristement, je m'enveloppai dans ma couverture. QUE FAIRE MAINTENANT ? Judicieusement, je fis de nouvelles déchirures, ici et là et, drapé dans ma couverture, je me rendis au bureau du Maître des Acolytes. Quand j'arrivai, il était déjà en train de dire des choses vraiment horribles à un petit garçon qui réclamait une autre paire de sandales.
— Les pieds ont été faits avant les sandales, mon garçon ! Si on me demandait mon avis, vous iriez tous pieds nus mais — TIENS — tiens, voilà une autre paire. Et tâche d'en prendre soin ! Allons bon ! s'écria-t-il en m'apercevant sur le seuil, drapé dans ma couverture, qu'est-ce que tu veux, toi ?
Il me foudroyait du regard ! Il avait l'air furieux de voir qu'un autre acolyte venait le dépouiller d'un de ses précieux articles !
— Honorable Maître, dis-je, le cœur battant, ma robe est déchirée mais elle était bien usée et l'étoffe était bien mince...
— USÉE ? rugit-il. C'est moi qui décide si une chose est usée, et non toi, petit misérable ! Tu seras puni de ton audace, et tu porteras des loques !
Un des moines-serviteurs se pencha alors vers lui pour lui chuchoter quelques mots à l'oreille. Le Maître des Acolytes fronça les sourcils et glapit :
— Quoi ? Quoi ? Parle plus fort, voyons, PARLE PLUS FORT !
Le moine-serviteur glapit à son tour :
— Je disais que ce garçon a été reçu par le Grand Initié. Il a été également convoqué par notre Père Abbé, et c'est le chela de l'Honorable Maître le Lama Mingyar Dondup.
Le Maître des Acolytes sursauta :
— Au nom de la Dent de Bouddha, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Tu n'es qu'un imbécile, plus bête que le dernier des acolytes !
Le Maître se tourna alors vers moi avec un sourire parfaitement faux ; je vis qu'il faisait des efforts désespérés pour prendre un air aimable.
— Voyons cette robe, mon petit, susurra-t-il.
Je la lui tendis, si bien pliée que les déchirures étaient sur le dessus. Il me la prit des mains, en tirant légèrement, et à ma grande joie le vêtement se déchira complètement. Le Maître des Acolytes me contempla avec stupéfaction.
— En effet ! s'exclama-t-il. Ta robe n'est qu'une loque. Viens avec moi, mon garçon, je vais t'en donner une neuve.
Il me prit par le coude et sentit alors la minceur de ma couverture.
— Hum, bien élimée, me semble-t-il. On dirait que tu n'as pas eu plus de chance avec ta couverture qu'avec ta robe. Tu en auras une neuve, je te le promets.
Nous passâmes dans la pièce voisine, une vaste salle où des robes de toutes tailles étaient accrochées aux murs, des robes de lamas, de moines, d'acolytes. Il me guida, me tenant par le bras, les lèvres pincées, en s'arrêtant de temps en temps pour tâter un vêtement ; il semblait les aimer tous, et ne pas vouloir s'en séparer.
Nous arrivâmes ainsi dans un coin de la salle où se trouvaient les robes d'acolytes. Le Maître s'arrêta, se gratta la tête, se tirailla une oreille.
— Ainsi, c'est toi qui as été d'abord projeté par le vent au bas de la montagne, et puis emporté une autre fois sur le Toit d'Or ? Hum... Et c'est toi qui as été convoqué par le Grand Initié, à ce que l'on dit ? Oui... oui... Et c'est toi aussi qui as été reçu par notre Père Abbé... à qui tu as plu, paraît-il... Humm...
Il fronça les sourcils et son regard se perdit dans le lointain. J'eus l'impression qu'il se demandait si je serais de nouveau reçu par le Grand Initié, ou peut-être par le Père Abbé, et alors — qui sait ? — peut-être pourrais-je lui être utile ?
— Je vais faire une chose tout à fait inhabituelle, me dit-il. Je vais te donner une robe neuve, parfaitement neuve, qui a été faite la semaine dernière. Si le Grand Initié t'accorde sa faveur, si tu as plu à notre Père Abbé et si le grand Lama Mingyar Dondup te protège, alors tu dois être bien habillé et pouvoir te présenter devant eux sans me faire honte. Voyons...
Il me reprit par le bras et me conduisit dans une autre pièce, une annexe du vaste magasin, où se trouvaient les robes neuves qui venaient d'être tissées par les moines travaillant sous la direction des lamas. Il examina une pile de vêtements qui n'avaient pas encore été dépliés et accrochés, en tira une robe et me dit :
— Essaye celle-ci.
J'ôtai ma couverture, la pliai soigneusement et enfilai la robe neuve. Je n'ignorais pas que le fait d'avoir une robe neuve était un signe, aux yeux des autres acolytes et même des moines, que l'on avait du ‘piston’ et que l'on était donc un personnage important. J'étais donc ravi d'avoir une robe neuve car, si le fait de porter une vieille robe indiquait que l'on n'était pas un ‘nouveau’, une robe flambant neuve vous revêtait d'importance.
Cette robe m'allait bien. Le tissu était épais, moelleux, et aussitôt que je l'eus revêtue, je me sentis réchauffé.
— Elle me va très bien, Maître, assurai-je.
— Oui... Certes, certes... Hum. Je crois que nous pouvons trouver mieux...
En marmonnant tout bas, il examina la pile de robes, puis une autre pile, et finit par déplier une robe de qualité supérieure. Il me la tendit en soupirant comme si cela lui faisait mal au cœur de s'en séparer.
— Tiens... Celle-ci fait partie d'une série spéciale qui a été faite par mégarde avec du tissu de haute qualité. Essaye-la ; je pense que cela fera une très forte impression sur nos supérieurs.
Cette robe-là était magnifique et m'allait très bien, sauf qu'elle était un peu trop longue et recouvrait mes pieds ; mais au moins, elle durerait plus longtemps, et me permettrait de grandir. D'ailleurs il serait facile de la raccourcir en la retroussant à la taille, ce qui serait très pratique car le pli ainsi fait me servirait à transporter plus de choses. Je tournai sur moi-même et le Maître des Acolytes m'examina attentivement en tiraillant sa lèvre inférieure, puis il hocha la tête et observa d'une voix désolée :
— Puisque nous sommes déjà allés si loin, nous pouvons sans doute aller plus loin encore. Tu vas prendre cette robe, mon garçon, et je t'en donnerai une autre aussi, afin que tu puisses en changer.
Je le comprenais mal, car il marmonnait entre ses dents et me tournait le dos pour fouiller parmi les piles de robes. Enfin il se retourna, en secoua une pour la déplier et me déclara :
— Essaye celle-ci, pour voir si elle te va aussi. Je sais que tu es ce garçon à qui l'on a donné une chambre particulière dans les Quartiers des Lamas, alors ta robe ne te sera pas volée par un garçon plus fort que toi.
J'étais enchanté. J'avais maintenant deux robes, une pour tous les jours, l'autre pour les grandes occasions. Le Maître des Acolytes examina alors ma couverture, en faisant la grimace.
— Tu ne peux pas garder ce chiffon, déclara-t-il. Viens avec moi. Je vais te donner une autre couverture.
Il retourna précipitamment dans la grande salle et donna des ordres à un moine, qui alla chercher une échelle, sur laquelle il monta. Sur une étagère, il prit une couverture, mais sa couleur contrastait avec ma robe ; le Maître des Acolytes, poussant un gémissement de détresse, prit l'échelle et disparut dans la pièce voisine. Il en ressortit quelques instants plus tard, et me tendit d'un air navré une couverture moelleuse.
— Prends-la, mon garçon. C'est une de nos plus belles couvertures, tissée pat erreur avec de la laine de qualité supérieure. Prends-la, et n'oublie pas, quand tu te trouveras en présence de notre Père Abbé ou du Grand Initié, que je t'ai bien traité et que je t'ai bien habillé.
Sérieusement, je vous dirai que le Maître des Acolytes porta les mains à ses yeux et gémit, tant il était désolé de se séparer de son matériel de meilleure qualité.
— Je vous suis extrêmement reconnaissant, Honorable Maître, et je suis certain (ici ma diplomatie entra en jeu !) que mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, saura très rapidement percevoir votre bonté en me donnant ces vêtements. Je vous remercie encore !
Cela dit, je sortis du magasin en emportant mes richesses. Au passage, un des moines-serviteurs me cligna de l'œil, et j'eus bien du mal à ne pas éclater de rire.
Je remontai vers les appartements des lamas et tandis que je me hâtais dans le corridor, ma robe de rechange et ma couverture sur les bras, je faillis renverser mon Guide.
— Oh ! m'exclamai-je. Excusez-moi, Honorable Maître. Je ne vous avais pas vu.
Mon Guide se mit à rire.
— Tu as l'air d'un colporteur, Lobsang. On dirait bien que tu arrives de l'Inde, par-delà les montagnes. Serais-tu devenu marchand ?
Je lui racontai mes malheurs, je lui expliquai comment ma robe s'était déchirée du haut en bas. Et je lui dis, aussi, que j'avais entendu le Maître des Acolytes déclarer que tous les garçons devraient aller pieds nus. Mon Guide m'emmena dans sa chambre, et nous nous assîmes. À ce moment, mon estomac vide se rappela à mon attention en grondant ; heureusement pour moi, mon Guide perçut cet avertissement et sourit.
— Tu n'as pas encore déjeuné, à ce qu'il paraît. Eh bien, nous allons déjeuner ensemble.
Sur ce, il se pencha vers la table et agita la petite clochette d'argent.
On nous apporta de la tsampa et nous mangeâmes en silence. Lorsque le moine-serviteur eut emporté nos plats, mon Guide se tourna vers moi.
— Ainsi, tu sembles avoir impressionné le Maître des Acolytes ? Tu as dû lui plaire énormément pour qu'il te donne deux robes et une couverture neuves ! Je me demande s'il serait aussi généreux avec moi !
— Maître, je suis bien perplexe, car si le Maître des Acolytes dit que nous devrions aller pieds nus, alors pourquoi ne nous passerions-nous pas de vêtements et n'irions-nous pas tout nus ?
Mon Guide éclata de rire :
— Il y a très longtemps, bien sûr, les gens ne portaient pas de vêtements, et parce qu'ils ne portaient pas de vêtements ils n'en ressentaient pas le besoin, car à cette époque leurs corps étaient capables de compenser pour une beaucoup plus large gamme de températures. Mais maintenant, en portant des vêtements, nous sommes devenus faibles et nous avons ruiné nos mécanismes régulateurs de chaleur en abusant d'eux.
Il se tut, réfléchissant à ce problème, puis il rit à nouveau.
— Peux-tu imaginer certains de nos vieux moines obèses se promenant tout nus ? Quel spectacle ! Cependant, l'histoire du vêtement est fort intéressante car au début, dans la nuit des temps, les gens n'en portaient point et il ne pouvait y avoir aucune trahison ni tricherie, car chaque personne pouvait voir l'aura de ses semblables. Mais finalement, les chefs des tribus de ce temps-là estimèrent qu'ils avaient besoin de se distinguer du commun des mortels, aussi ornèrent-ils leur corps d'un éventail de plumes placé où tu sais, ou de bariolages de peinture faite avec diverses baies. Alors, les dames voulurent aussi avoir des ornements et portèrent des jupes de feuillages.
Je ris à mon tour, en pensant à ces personnes ainsi ornées.
— Quand le chef de la tribu et sa femme se furent couverts d'ornements, ceux qui les suivaient dans la ligne de succession au trône voulurent aussi avoir des ornements, et alors rien ne les distingua plus du chef ni de sa femme, qui furent contraints d'ajouter à leur tenue de nouveaux ornements ; cela dura pendant un certain temps, chaque clan ajoutant une parure ou une autre au point de se recouvrir presque entièrement le corps. Finalement, les femmes des castes supérieures se mirent à porter des vêtements très suggestifs, destinés à révéler à demi ce qui n'aurait pas dû être caché car — ne t'y méprends pas — quand les gens pouvaient voir l'aura, les guerres, les tromperies, les mensonges étaient impossibles. C'est seulement quand les êtres se mirent à se couvrir de vêtements qu'ils cessèrent de voir l'aura et qu'ils cessèrent d'être télépathes et clairvoyants.
Mon Guide me regarda sévèrement :
— Écoute-moi bien, Lobsang, car ce que je vais te dire concerne la tâche que tu auras à accomplir plus tard.
Je hochai la tête, pour lui montrer qu'il avait toute mon attention, et mon Guide poursuivit :
— Un clairvoyant qui peut voir l'aura d'une autre personne doit pouvoir voir le corps nu s'il veut être en mesure de donner une lecture très précise d'une maladie, et si les gens sont habillés, leur aura est contaminée.
Je me redressai, ahuri, car je ne voyais pas du tout comment des vêtements pouvaient contaminer une aura, et je le dis à mon Guide, qui me répondit :
— Une personne est nue et donc l'aura de cette personne est l'aura de cette personne et de rien d'autre. Maintenant, si tu revêts la personne d'un vêtement de laine de yak tu recevras l'influence aurique du yak, de la personne qui l'a tondu, de celle qui a peigné et cardé la laine, de celle qui a tissé l'étoffe. Ainsi, si tu veux interpréter l'aura que tu vois à travers l'étoffe tu pourras certainement révéler l'histoire d'un yak et de toute sa famille, mais ce n'est pas du tout ce que tu recherches.
— Mais, demandai-je, inquiet, comment une étoffe peut-elle contaminer une aura ?
— Eh bien, je viens de te le dire. Tout ce qui existe possède son propre champ d'influence, son propre champ magnétique ; si tu regardes par cette fenêtre tu peux voir l'éclatante lumière du jour, mais si tu tires notre toile de soie huilée, tu vois l'éclatante lumière du jour qui se trouve maintenant modifiée par l'influence de la soie huilée. Autrement dit, ce que tu vois en réalité c'est une lumière de teinte bleuâtre, et cela ne t'aidera pas du tout à décrire la lumière du soleil.
Il s'interrompit, pour me sourire, un peu amèrement, avant de poursuivre :
— C'est extraordinaire, vraiment, mais les gens ne semblent pas vouloir se séparer de leurs vêtements. J'ai toujours eu la théorie que les gens ont une mémoire raciale de ce que sans vêtements leur aura pourra être vue et lue par les autres, et tant de gens de nos jours ont des pensées coupables, qu'ils n'osent pas laisser quelqu'un d'autre savoir ce qu'ils ont dans l'esprit et gardent ainsi des vêtements sur leur corps, signe de culpabilité déguisée sous les termes impropres de pureté et innocence.
Il réfléchit quelques instants puis remarqua :
— Beaucoup de religions affirment que l'Homme est fait à l'image de Dieu, mais alors l'Homme a honte de son corps, ce qui semble impliquer que l'Homme a honte de l'image de Dieu. Il y a de quoi être perplexe. En Occident tu constateras que les gens dénudent de façon surprenante certaines parties de leur corps, mais qu'ils couvrent d'autres parties pour y attirer automatiquement l'attention. Autrement dit, Lobsang, beaucoup de femmes portent des vêtements qui sont totalement suggestifs ; elles portent des pièces rembourrées, qui étaient connues sous le nom de ‘joyeuses tromperies’ quand j'étais en Occident. Tous ces rembourrages sont conçus pour faire croire à un homme qu'une femme a ce qu'elle n'a pas, tout comme il y a seulement quelques années les hommes en Occident portaient des choses dans leurs pantalons, c'est-à-dire certains rembourrages destinés à donner l'impression d'une générosité de la nature à leur égard, et à faire croire à leur virilité. Malheureusement, les hommes les plus rembourrés étaient généralement les moins virils ! Mais une autre grande difficulté avec les vêtements c'est qu'ils ne laissent pas pénétrer l'air frais. Si les gens portaient moins de vêtements et s'ils prenaient des bains d'air leur santé s'améliorerait grandement ; il y aurait moins de cancers, beaucoup moins de tuberculose, car, lorsqu'une personne est emmitouflée dans des vêtements, l'air ne peut circuler et les microbes se multiplient.
Je réfléchis à ces paroles, mais je ne voyais pas du tout comment les microbes pouvaient se multiplier sous les vêtements et j'exprimai ma perplexité.
— Voyons, Lobsang ! répondit mon Guide. Si tu regardes le sol attentivement tu y vois plusieurs insectes, mais si tu soulèves un rondin pourri ou déplaces une grosse pierre, tu trouveras toutes sortes de choses en dessous : des insectes, des vers, et une multitude de créatures qui se reproduisent et vivent uniquement dans les endroits sombres et isolés. De même, le corps est couvert de bactéries, couvert de microbes. L'action de la lumière empêche les microbes et les bactéries de se multiplier et a pour effet de garder le corps en santé. Mais dès que l'on permet à des poches d'air vicié de demeurer sous d'épais vêtements, dans le noir, les bactéries croissent rapidement. Plus tard, ajouta-t-il en me regardant gravement, quand tu seras lama médecin et que tu soigneras les malades, tu découvriras que si on laisse un pansement trop longtemps sans soins, des vers se forment en dessous, de même que si une pierre reste longtemps au même endroit des insectes se réunissent dessous. Mais tu apprendras tout cela quand le moment sera venu.
Il se leva alors, s'étira et me dit :
— Nous devons sortir, à présent. Je t'accorde cinq minutes pour te préparer ; ensuite tu descendras aux écuries parce que nous allons faire un petit voyage.
Sur ce, il me fit signe de ramasser ma robe de rechange et ma couverture et de les emporter dans ma chambre. Je m'inclinai très bas. rassemblai mes affaires et franchis la porte de communication. Pendant quelques minutes, je me préparai en hâte, puis je descendis aux écuries comme mon Guide l'avait ordonné.
Quand j'arrivai dans la cour je m'arrêtai net, fort surpris ; on était en train d'assembler toute une cavalcade. Je restai adossé au mur, à l'ombre, et contemplai toute cette animation en me demandant pour qui l'on se donnait tant de mal. Je crus d'abord qu'un des Abbés s'apprêtait à changer de résidence, mais alors mon Guide, le Lama Mingyar Dondup, surgit et regarda vivement autour de lui. M'apercevant, il me fit signe. Mon cœur se serra lorsque je compris que cette cavalcade était pour nous.
Il y avait un cheval pour mon Guide, et un autre plus petit pour moi. De plus, nous étions suivis de quatre moines-serviteurs à cheval aussi, et il y avait quatre chevaux encore, chargés de provisions et de ballots, mais de telle manière qu'ils ne portaient pas un poids trop important et pourraient servir de chevaux de relais afin que les hommes les plus lourds ne pussent fatiguer leur monture. Les chevaux piaffaient, soufflaient, hennissaient, agitaient leur queue et j'avançai en prenant grand soin de ne pas passer derrière l'un d'eux, car une fois je m'étais laissé attirer par un cheval badin qui, dès que je fus derrière lui, me planta un sabot en pleine poitrine, avec une force si considérable que je tombai à la renverse et fis littéralement une cabriole. Depuis lors, je me méfiais.
— Nous allons dans la montagne, Lobsang, me dit mon Guide. Nous y passerons deux ou trois jours, et tu seras mon assistant !
Son regard pétilla quand il ajouta que c'était un nouveau stade de ma formation. Nous nous approchâmes de nos chevaux et celui qui m'était réservé tourna la tête et frémit, véritablement, en me reconnaissant ; il leva les yeux au ciel et hennit une protestation. J'étais de tout cœur avec lui, car je ne l'aimais pas plus qu'il ne m'appréciait. Mais un moine-palefrenier accourut, les mains en coupe pour m'aider à monter sur le cheval. Mon Guide était déjà en selle et m'attendait. Le moine-palefrenier me chuchota :
— C'est un cheval bien calme, tu ne devrais pas avoir d'ennuis avec lui — pas même toi !
Mon Guide regarda autour de lui, s'assura que j'étais juste derrière lui, les quatre moines-serviteurs à leurs postes respectifs et les quatre chevaux de bât attachés ensemble par des longes. Enfin il leva le bras et notre caravane s'ébranla. Nous descendîmes vers la Vallée.
Les chevaux que l'on me donne ont tous quelque chose en commun : chaque fois qu'il y a une descente particulièrement abrupte, ces satanées bêtes baissent la tête et je dois me cramponner à la crinière pour ne pas glisser le long du cou. Cette fois, je pris appui avec mes pieds derrière ses oreilles, ce qui ne lui plut pas davantage que je n'aimais qu'il baissât la tête ! La route descendait par paliers inégaux, il y avait une circulation intense et je concentrai toute mon attention et mes efforts à rester sur mon cheval ; je réussis cependant, comme nous abordions un virage, à lever les yeux pour contempler les jardins de ce qui autrefois avait été ma maison et ne l'était plus.
Nous descendîmes jusque dans la Vallée et tournâmes à gauche sur la route de Lingkhor. Nous franchîmes le pont sur la rivière et, comme nous arrivions en vue de la Mission Chinoise, nous tournâmes brusquement à droite sur la route menant au Kashya Linga, et je me demandai pourquoi nous avions pris une telle escorte et tant de bagages pour n'aller qu'à ce petit parc. Mon Guide m'avait simplement dit que nous allions dans ‘les montagnes’, et comme Lhassa est au centre d'une espèce de cirque entouré de montagnes de toutes parts, ce n'était pas une indication bien précise.
Soudain, je fis un bond de joie, si brusque que mon satané cheval se cabra, pensant sans doute que je l'attaquais ! Je réussis à rester en selle en me cramponnant de toutes mes forces aux rênes, si fort que sa tête se releva d'un coup ; cela le fit tenir tranquille, et m'apprit une leçon — il suffit de tirer sur les rênes et les tenir serrées... en principe ! Marchant au pas, nous vîmes bientôt la route s'élargir ; un certain nombre de marchands venaient de débarquer du bac. Mon Guide mit pied à terre, ainsi que le chef des moines-serviteurs qui alla s'entretenir avec le passeur. Il revint au bout de quelques instants, en disant :
— Tout va bien, Honorable Lama. Nous pouvons passer tout de suite.
Aussitôt chacun s'agita ; les moines-serviteurs descendirent de cheval, entourèrent les animaux de bât, déchargèrent les ballots et les paquets et les portèrent dans le bac du passeur. Puis tous les chevaux furent attachés les uns aux autres avec des longes solides, et deux des moines-serviteurs, montés chacun sur un cheval, les conduisirent tous dans la rivière. Je contemplai cet étrange spectacle ; les moines avaient relevé leur robe jusqu'à la taille, les chevaux plongèrent bravement à leur suite et nagèrent vers l'autre berge. Je vis alors que mon Guide était déjà dans le bac et s'impatientait. Ainsi, pour la première fois de ma vie, je montai dans un bateau ; les deux autres moines me suivirent. Le passeur, après avoir murmuré quelques mots à son assistant, repoussa le bateau de la berge. J'eus aussitôt le vertige car le courant s'était emparé de l'embarcation et la faisait tournoyer sur elle-même.
Ce bateau était fait de peaux de yaks soigneusement cousues ensemble et enduites d'une substance qui les rendait étanches. Puis la chose était gonflée à l'air. Les voyageurs y montaient avec leurs bagages, le passeur s'armait de deux longues spatules, ou avirons, et faisait lentement avancer le bateau vers la rive opposée. Lorsqu'il avait le vent contre lui la traversée était très, très longue, mais il regagnait le temps perdu au retour, car alors il n'avait qu'à guider le bateau que le vent poussait.
J'étais bien trop excité pour prêter attention à ce qui se passait sur le bateau. Je me souviens que je me cramponnais aux rebords, au risque de m'enfoncer un des longs clous dans les doigts. J'avais peur de bouger, car à chaque fois que je faisais un mouvement je sentais quelque chose s'enfoncer sous mes pieds. J'avais l'impression que nous ne reposions sur rien ; c'était très différent de la terre ferme et d'un bon dallage solide qui ne se balance pas. De plus, de courtes vagues houleuses nous secouaient et je finis par me dire que j'avais trop mangé au petit déjeuner, car d'étranges sensations dans le voisinage de mon estomac m'inquiétaient singulièrement ; je craignis d'être malade devant tous ces hommes, mais en retenant judicieusement ma respiration à intervalles réguliers, je parvins à préserver mon honneur et bientôt le fond du bateau racla une plage de galets. Nous étions arrivés.
Notre caravane se rassembla, mon Guide en tête et moi à une demi-longueur de cheval derrière lui, et les moines-serviteurs deux par deux, devant les quatre chevaux de bât. Mon Guide se retourna pour s'assurer que tout le monde était prêt, puis il poussa son cheval qui marcha vers le matin.
Nous chevauchâmes lentement, ballottés par le pas des chevaux, et nous marchions vers l'ouest, la direction dans laquelle le matin était parti, car nous disons chez nous que le soleil se lève à l'est et voyage vers l'ouest en emportant le matin avec lui. Bientôt le soleil nous rattrapa et brilla au-dessus de nous. Il n'y avait pas de nuages, les rayons du soleil nous brûlaient, mais quand nous passâmes dans l'ombre de grands rochers, le froid devint cruel, car à notre altitude il n'y avait pas suffisamment d'air pour filtrer les rayons du soleil et provoquer un équilibre entre sa chaleur et la fraîcheur de l'ombre. Nous chevauchâmes encore une heure et puis mon Guide atteignit une partie de la piste où il devait avoir l'habitude de faire halte. Sans qu'aucun signal eût été donné les moines-serviteurs mirent pied à terre et se hâtèrent de faire un feu de bouse de yak séchée, qui est notre combustible, et firent bouillir de l'eau qu'ils étaient allés puiser dans un ruisseau tout proche. Une demi-heure plus tard nous étions tous assis pour manger notre tsampa, et j'en fus heureux car j'avais grand-faim. Les chevaux eurent aussi leur repas, et puis on les conduisit s'abreuver au ruisseau.
Assis contre un énorme rocher, qui me paraissait aussi grand que les bâtiments du Temple du Chakpori, je contemplais à nos pieds la Vallée de Lhassa ; l'air était parfaitement pur, sans brume, sans fumées, sans poussière et l'on pouvait voir au loin, chaque chose se distinguant avec netteté. Nous apercevions les pèlerins franchissant la Porte Occidentale, les marchands sur la route, et tout en bas de la piste, le bac et le passeur qui faisait traverser la Rivière Heureuse à un nouveau groupe de voyageurs.
Bientôt, il fut temps de repartir ; on chargea les chevaux de bât et nous reprîmes tous nos montures. La piste sinueuse s'enfonçait de plus en plus parmi les contreforts de l'Himalaya. Nous finîmes par abandonner cette route qui menait en Inde et nous engageâmes sur un étroit sentier, qui devint de plus en plus abrupt, ralentissant notre progression. Au-dessus de nous, perchée sur un rocheux, nous aperçûmes une petite lamaserie. Je la considérai avec un grand intérêt et une certaine fascination, car elle appartenait à un Ordre légèrement différent, un Ordre où les lamas et les moines étaient tous mariés et vivaient dans le bâtiment avec leurs familles.
Il nous fallut plusieurs heures pour l'atteindre. J'aperçus des moines et des nonnes se promenant ensemble et je fus surpris de voir que les nonnes avaient elles aussi le crâne rasé. Très étonné, j'observai que tous les visages étaient sombres et luisants. Mon Guide se pencha vers moi pour chuchoter :
— Ici, il y a souvent de grandes tempêtes de sable et ils portent tous un épais masque de graisse pour protéger leur peau. Un peu plus tard nous devrons aussi mettre des masques de cuir.
Mon cheval avait le pied sûr, heureusement pour moi, et il connaissait mieux que moi les pistes de montagne ; j'aurais été bien incapable de le guider, car la petite lamaserie occupait toute mon attention. Je voyais des enfants qui jouaient, j'étais vraiment perplexe qu'il pût y avoir des moines vivant dans la chasteté et d'autres qui se mariaient, et je me demandai comment une même religion pouvait avoir des aspects aussi différents. Les moines et les nonnes nous regardèrent passer, puis ils se désintéressèrent de nous, nous accordant moins d'attention que si nous avions été des marchands.
Nous poursuivîmes notre ascension et finalement nous aperçûmes au-dessus de nous un petit bâtiment blanc et ocre, juché sur une corniche qui me parut tout à fait inaccessible.
— C'est là que nous allons, Lobsang, me dit mon Guide. C'est un ermitage. Nous y grimperons demain matin car le chemin est périlleux. Cette nuit, nous ferons halte pour dormir à l'abri des rochers.
Nous chevauchâmes un autre mille (1,6 km), peut-être, puis nous nous arrêtâmes parmi d'immenses rochers qui formaient une espèce de cirque, comme une soucoupe. Tout le monde mit pied à terre. Les chevaux furent nourris et mis à l'attache, puis nous mangeâmes notre tsampa, et soudain la nuit tomba comme si l'on avait tiré un rideau. Je m'enroulai dans ma couverture et contemplai le panorama, entre deux rochers. J'aperçus les lumières vacillantes du Chakpori et du Potala, et la Rivière Heureuse scintillant au clair de lune ; on aurait pu l'appeler la Rivière d'Argent car elle brillait vraiment comme un ruban d'argent pur. La nuit était calme et silencieuse ; il n'y avait pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. Dans la voûte des cieux, les myriades d'étoiles étincelaient, de toutes les couleurs. Je m'allongeai et m'endormis immédiatement.
Je passai une bonne nuit, sans aucune interruption, sans être réveillé par les offices, mais à mon réveil, au matin, j'eus l'impression d'avoir été piétiné par un troupeau de yaks. Chacun de mes muscles était douloureux, mais c'était le bas de mon dos qui me faisait le plus mal, au point que je craignais de ne pouvoir m'asseoir. Je me rappelai alors ce satané cheval, et souhaitai de tout mon cœur qu'il ait aussi mal que moi, encore que ce fût bien peu probable. Bientôt une activité intense régna dans notre petit campement ; les moines-serviteurs préparèrent la tsampa et pendant ce temps je m'éloignai un peu pour contempler la Vallée de Lhassa. Puis je me retournai et levai les yeux vers l'ermitage environ un quart de mille (400 m) plus haut. Il me fit penser à l'un de ces nids d'oiseaux collé au mur d'une maison, que l'on s'attend toujours à voir tomber d'un instant à l'autre. Je n'apercevais aucune piste, aucun sentier permettant d'y accéder.
Je retournai vers le feu de camp, mangeai ma tsampa et prêtai l'oreille à la conversation des hommes. Dès que nous eûmes fini, mon Guide déclara :
— Il est temps de repartir, Lobsang. Les chevaux et trois des moines-serviteurs vont rester ici et le quatrième nous accompagnera.
Mon cœur se serra. Comment allais-je gravir le flanc de la montagne à pied ? J'étais bien certain que si les chevaux en étaient incapables je ne le pourrais pas non plus. Cependant, des rouleaux de corde furent retirés du paquetage d'un des chevaux de bât et le moine-serviteur qui nous accompagnait, le plus grand des quatre, s'en chargea. Cela fait on me confia un sac contenant je ne sais quoi, mon Guide en prit un autre et le moine-serviteur un troisième. Les trois moines que nous laissions au camp semblaient fort satisfaits de rester seuls à ne rien faire, sinon veiller sur les chevaux.
Nous nous mîmes en marche, péniblement, en nous accrochant aux rochers, trouvant parfois un point d'appui précaire pour nos pieds. Bientôt le chemin devint plus pénible, et le moine-serviteur nous précéda avec une corde lestée de deux cailloux ; il la lançait en l'air, donnait un coup sec, les pierres tournoyaient et s'accrochaient pour retenir la corde et le moine tirait dessus pour être sûr qu'elle tenait bon. Après quoi il se hissait au sommet et maintenait la corde afin que mon Guide et moi puissions nous hisser à notre tour, par ce moyen dangereux. Nous montâmes plusieurs fois de cette façon.
Enfin, après un effort particulièrement ardu, nous atteignîmes une plate-forme rocheuse, une plate-forme qui avait peut-être trente pieds (9 m) de large et qui avait dû être formée par une avalanche, dans des temps très anciens. Je me hissai à la force des poignets, tombai à genoux, me redressai finalement, et alors je vis sur ma droite l'ermitage tout proche.
Nous restâmes là quelques instants, reprenant haleine. J'étais ébloui par la vue que l'on avait de là-haut ; je voyais le Toit d'Or du Potala, mon regard plongeait dans les cours du Chakpori. Je vis que l'on venait d'y apporter une nouvelle provision d'herbes et de simples car la lamaserie avait l'air d'une ruche ; des moines couraient en tous sens. Il y avait aussi beaucoup de circulation à la Porte Occidentale. Je soupirai ; tout cela n'était pas pour moi, car j'étais obligé d'escalader des montagnes idiotes pour aller voir des gens dans un ermitage, et qui d'autre qu'un imbécile aurait envie de vivre à l'écart derrière les murs d'un ermitage ?
Soudain, nous vîmes arriver trois hommes. L'un d'eux paraissait très, très vieux, et deux hommes plus jeunes le soutenaient. Quand ils approchèrent, nous ramassâmes nos paquets et marchâmes à leur rencontre.
Chapitre Quinze
LE vieillard était aveugle — totalement aveugle. Je contemplai ses yeux avec stupéfaction, tant ils me parurent ÉTRANGES. Au premier abord, je ne compris pas très bien pourquoi ils me semblaient si singuliers, et puis j'appris comment il était devenu aveugle.
Au Tibet, les ermites sont murés dans des cellules, au plus profond d'un ermitage. Aucune lumière n'y pénètre et si, au bout de trois ans ou de sept ans, l'ermite veut sortir, s'il estime que l'épreuve qu'il s'est imposée doit prendre fin, cela dure un temps considérable. D'abord, un tout petit trou est pratiqué dans le plafond, afin de laisser pénétrer une infime trace de lumière. Après plusieurs jours le trou est élargi et ainsi de suite, si bien qu'un mois plus tard le moine peut de nouveau y voir, car durant son incarcération volontaire ses pupilles se sont tellement dilatées que si la lumière l'inondait brusquement il serait immédiatement frappé de cécité. Ce vieillard se trouvait dans une cellule dont un des murs avait été abattu par une avalanche de pierres. Ainsi, alors qu'il était assis dans l'obscurité totale depuis une vingtaine d'années, il entendit soudain un terrible fracas ; tout un côté de son ermitage venait de s'écrouler et les rayons brûlants du soleil pénétraient dans sa cellule. Au même instant, il devint aveugle.
J'écoutai ce que le vieillard disait à mon Guide :
— Ainsi, selon la coutume, nous lui avons apporté son repas, le deuxième jour, le troisième jour rien n'avait été touché, par conséquent, comme notre Frère ne répond pas, nous pensons que son âme s'est envolée de la coquille vide de son corps.
Mon Guide prit le vieillard par le bras, avec affection.
— Ne sois pas troublé, mon Frère, car nous allons voir ce qu'il en est. Peut-être peux-tu nous conduire à cette cellule ?
Les deux autres moines nous précédèrent et nous firent traverser une petite cour. Sur la gauche, il y avait quelques minuscules cellules ; j'en comptai cinq, toutes parfaitement nues et sans le moindre confort ; il n'y avait pas de table, pas de tankas (littéralement ‘chose que l'on déroule’, ‘rouleau’, est une peinture, un dessin, ou un tissu sur toile originaire d'Inde et caractéristique de la culture bouddhiste tibétaine — NdT), rien que le sol nu de la grotte sur lequel un moine pouvait s'asseoir ou s'allonger pour dormir. Nous entrâmes dans une grande pièce obscure, perchée en équilibre précaire sur un éperon rocheux au flanc de la montagne. Cette construction ne me paraissait guère solide mais, apparemment, elle avait tenu bon pendant deux ou trois cents ans.
Au centre de cette grande pièce sombre il y avait une autre pièce. Quand nous y entrâmes, nous nous trouvâmes de plus en plus dans l'obscurité. On apporta des lampes à beurre et nous nous engageâmes dans un étroit corridor, parfaitement noir, et nous n'avions pas fait dix pas que nous nous trouvions devant un mur nu. La faible lumière des lampes à beurre semblait accentuer la profondeur des ténèbres. Mon Guide prit une des lampes et la leva ; je vis alors une petite porte, une espèce de trappe dans le mur. Mon Guide l'ouvrit et tâtonna dans ce qui semblait être un placard. Il frappa fort sur le côté intérieur du placard et écouta attentivement. Il posa ensuite sa lampe à l'intérieur et je vis que c'était une espèce de boîte dans le mur.
Mon Guide me dit :
— Ceci est une boîte, Lobsang, qui a deux portes : celle-ci et une porte intérieure. L'occupant de la cellule attend un certain temps, puis il ouvre sa porte, tâtonne et prend les aliments et l'eau qu'on a laissés pour lui. Jamais il ne voit la lumière, il ne parle jamais à personne, car il a fait vœu de silence. Or, nous avons un problème, car il n'a pas pris sa nourriture depuis plusieurs jours et nous devons savoir s'il est vivant ou mort.
Il considéra l'ouverture, puis il me regarda. Se tournant de nouveau vers le petit placard, il le mesura avec ses mains et son bras, après quoi il me mesura de même et déclara :
— Je crois que si tu ôtais ta robe tu pourrais tout juste passer par cette ouverture et forcer l'autre porte, pour voir si le moine a besoin de soins.
— Ah ! Maître ! m'écriai-je, terrifié. Mais qu'arrivera-t-il si j'entre et ne puis ressortir ?
Mon Guide réfléchit un moment.
— Nous allons d'abord te soulever et te maintenir. Avec une pierre, tu enfonceras la deuxième porte. Puis nous te laisserons glisser en te tenant par les pieds, et tu pourras tenir une lampe, les mains tendues. Tu devrais alors voir si cet homme a besoin de secours.
Mon Guide retourna dans l'autre pièce, et prit trois lampes à beurre ; il ôta les mèches de deux d'entre elles, les tressa avec celle de la première lampe et la remplit de beurre, bien tassé. Cependant, un des moines était sorti et revenait avec une grosse pierre. Il me la donna et je la soupesai.
— Maître, demandai-je, pourquoi le moine ne peut-il répondre à une question ?
— Parce qu'il a fait le serment de garder le silence pendant un certain temps, fut sa réponse.
À contrecœur, j'ôtai ma robe, grelottant dans l'air glacé de la montagne. Il faisait froid au Chakpori, certes, mais bien moins qu'ici. Je gardai mes sandales car le sol était comme un bloc de glace.
Pendant ce temps, un des moines avait repris la pierre et frappait de grands coups sur la porte intérieure. Elle tomba soudain sur le sol de la cellule avec un grand bruit et tous se pressèrent pour regarder, mais leur tête était trop grosse, leurs épaules trop larges. Mon Guide me souleva donc et me plaça horizontalement dans la boîte, et j'étendis les bras comme pour plonger ; un moine alluma les trois mèches fichées dans la lampe à beurre et la plaça soigneusement entre mes mains. Je glissai par l'ouverture ; le passage était bien étroit mais en me tortillant et en grognant, je parvins à m'insinuer à l'intérieur jusqu'à ce que mes bras et ma tête ressortent de l'autre côté. Je fus immédiatement écœuré par une odeur pestilentielle. C'était atroce, cela sentait la viande pourrie, la nourriture avariée. C'était une odeur que l'on respirait parfois quand on trouvait sur son chemin un yak ou un cheval mort ; c'était une odeur qui me donna à penser que tous les appareils sanitaires du monde s'étaient bouchés en même temps ! La puanteur me soulevait le cœur mais je parvins à me maîtriser et à soulever la lampe ; dans sa lumière vacillante qui allumait des reflets sur les murs de pierre, je vis le vieux moine. Ses yeux me regardaient fixement, des yeux brillants qui me firent sursauter de terreur, au point que je m'écorchai contre le cadre de la porte cassée, emportant un lambeau de peau de mon épaule. Je me forçai à regarder et vis que les yeux brillaient dans la lumière mais ne cillaient pas. Je remuai les pieds, pour indiquer que je voulais être tiré de ma fâcheuse position sans tarder. Dès que je fus remis sur pied dans le couloir, je rendis tripes et boyaux !
— Nous ne pouvons pas le laisser là, dit mon Guide. Il va falloir abattre le mur afin de l'emporter.
Remis de ma nausée, j'enfilai ma robe. Les moines allèrent chercher des outils et revinrent avec un énorme marteau et deux barres de fer au bout aplati. Ils enfoncèrent ces barres entre deux pierres scellées et tapèrent dessus avec le marteau. Lentement, un bloc se détacha, puis un autre et encore un autre. La puanteur était terrible. Enfin, ils eurent pratiqué une ouverture assez grande pour permettre à un homme de passer, et l'un des moines entra, portant deux lampes à beurre. Il ressortit presque aussitôt, la figure blême et, à ma grande satisfaction, se conduisit aussi honteusement que moi.
— Nous devrons attacher une corde autour de lui et le traîner dehors, dit enfin ce moine. Il tombe en morceaux, il est dans un état de décomposition avancé.
Silencieusement, un autre moine sortit et reparut avec une longue corde. Il entra par le trou dans le mur (là où la porte avait été murée autrefois) et nous l'entendîmes aller et venir.
— C'est fait, annonça-t-il en ressortant. Vous pouvez tirer.
Deux moines prirent la corde et tirèrent doucement. Bientôt la tête du vieux moine apparut, et ses bras ; il était vraiment dans un état épouvantable. Les moines le soulevèrent tendrement et le portèrent dehors.
À l'autre bout de la pièce, une porte ouvrait sur un étroit sentier montant au flanc de la montagne. Les deux moines chargés de leur macabre fardeau s'y engagèrent et disparurent derrière des rochers. Je savais qu'ils allaient porter le cadavre et le déposer sur une surface plane où les vautours le dévoreraient bientôt, car il était impossible de creuser des tombes dans le roc ; nous dépendions de ‘l'enterrement aérien’.
Pendant ce temps, notre moine-serviteur avait pratiqué un petit trou dans la muraille, au fond de la cellule, par lequel un peu de jour filtrait. Il prit ensuite deux seaux d'eau et lava avec soin la cellule. Bientôt — quand ? — quelqu'un d'autre s'y ferait enfermer pour y vivre dix ans ? vingt ans ? combien d'années ?
Plus tard, vers la fin de la journée, nous étions tous assis en rond et le vieillard aveugle déclara :
— Je sens que nous avons ici un être destiné à voyager loin et à voir beaucoup de choses. J'ai reçu des renseignements à son sujet quand mes mains ont touché sa tête. Viens près de moi, mon garçon, viens t'asseoir devant moi.
De mauvaise grâce, je m'avançai et m'assis devant le vieil aveugle. Il posa sur mon crâne rasé deux mains froides comme des glaçons ; ses doigts tâtèrent ma tête, s'attardant sur les diverses bosses de mon crâne.
— Tu auras une vie très dure, me dit-il.
Je ne pus retenir un gémissement. Tout le monde me prédisait une vie très dure et je commençais à en avoir franchement assez.
— Après bien des épreuves et des tribulations que peu d'hommes ont à vivre, reprit-il, tu connaîtras le succès juste avant la fin. Tu feras ce pour quoi tu es venu en ce monde.
Ce n'était pas nouveau pour moi. J'avais vu des mages, des devins, des astrologues et des clairvoyants et tous m'avaient répété la même chose. Après m'avoir annoncé cela, le vieillard agita les mains, aussi me levai-je pour aller m'asseoir aussi loin de lui que je le pus, ce qui le fit beaucoup rire.
Mon Guide et les autres discutèrent alors de choses très sérieuses. Je n'y comprenais pas grand-chose, ils parlaient de prophéties, de choses qui allaient arriver au Tibet, ils envisageaient les meilleurs moyens de préserver le Savoir Sacré, et parlaient de ce que déjà des mesures étaient prises pour transporter divers livres et articles très haut dans les montagnes où ils seraient cachés dans des grottes. Ils disaient aussi comment des choses contrefaites allaient être laissées dans les temples afin que les très anciens articles authentiques ne tombent pas plus tard entre les mains des envahisseurs.
Je sortis de la cour de l'ermitage et allai m'asseoir sur une pierre pour contempler dans le lointain la Ville de Lhassa dans le crépuscule. Seuls les sommets du Chakpori et du Potala étaient encore illuminés par les derniers rayons du soleil couchant. On aurait dit deux îles émergeant d'un océan violet. Petit à petit, alors que je les contemplais, les îles parurent sombrer dans les ténèbres de la nuit. Et puis soudain, la lune apparut en bordure de la montagne et sa lumière effleura le toit du Potala qui scintilla de lueurs dorées. Alors je me levai, rentrai dans l'enclos de l'ermitage, où j'ôtai ma robe, m'enroulai dans ma couverture et m'endormis.
FIN