La pensée, la raison et la peur freinent l'évolution spirituelle
La première fois que j'ai rencontré Lobsang Rampa, c'était à Londres, en 1954, avant qu'il n'écrive Le Troisième Oeil et qu'il ne devienne célèbre dans le monde entier. À l'époque je vivais au coeur de Londres avec mon mari et nos deux jeunes enfants dans une jolie maison de style Régence sur Bayswater Road. Elle donnait sur l'entrée Nord des Jardins de Kensington, qui partent du coin de Hyde Park et s'étendent jusqu'à Notting Hill Gate. Lobsang Rampa s'appelait alors Dr Carl Ku'an, et il me raconta plus tard que la première fois qu'il me vit, ce fut un jour où je faillis l'écraser dans la rue Kensington Church. Je n'ai absolument aucun souvenir de cet incident où il faillit perdre la vie ; je ne l'avais tout simplement pas vu. À cette époque il était parfaitement possible de traverser Londres à toute allure, et c'est ainsi que je conduisais ma petite voiture.
Il y avait un jardin derrière la maison, et au bout du jardin nous avions le traditionnel garage, accessible par la ruelle courant derrière les maisons. Nous avions fait construire un petit appartement au-dessus du garage pour pouvoir loger du personnel. Aujourd'hui on parlerait de femme de ménage, mais à l'époque, en Angleterre, le terme « femme de ménage » était réservé à des dames s'occupant de l'intérieur d'un riche célibataire par exemple, ou partageant avec un majordome la gouvernance d'une grande demeure. Nous n'étions pas si importants. Nous avions juste quelqu'un pour nous aider, et c'est dans l'appartement de cette personne que j'ai rencontré le Dr Carl Ku'an pour la première fois. Ce fut une rencontre inoubliable qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.
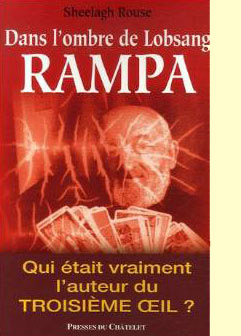 Dans l'ombre de Lobsang Rampa (25 years with T. Lobsang Rampa) - Le premier livre de Sheelagh. Elle nous raconte la première fois qu'elle a rencontré le Dr Rampa, les épreuves qu'ils ont tous endurées au cours de leurs nombreux voyages, notamment avec la presse dont le seul intérêt est de vendre des journaux à tout prix. Elle nous raconte aussi la mort soudaine et déplorée de leur petite chatte Fifi Moustaches Grises, et la façon dont Sheelagh a dû se séparer du Dr Rampa pour lui permettre de partir pour les champs célestes. Ce n'est pas une autobiographie du Dr Rampa ; c'est un aperçu privilégié de leur vie privée à travers les yeux et les expériences de Sheelagh.
Dans l'ombre de Lobsang Rampa (25 years with T. Lobsang Rampa) - Le premier livre de Sheelagh. Elle nous raconte la première fois qu'elle a rencontré le Dr Rampa, les épreuves qu'ils ont tous endurées au cours de leurs nombreux voyages, notamment avec la presse dont le seul intérêt est de vendre des journaux à tout prix. Elle nous raconte aussi la mort soudaine et déplorée de leur petite chatte Fifi Moustaches Grises, et la façon dont Sheelagh a dû se séparer du Dr Rampa pour lui permettre de partir pour les champs célestes. Ce n'est pas une autobiographie du Dr Rampa ; c'est un aperçu privilégié de leur vie privée à travers les yeux et les expériences de Sheelagh.
Broché.
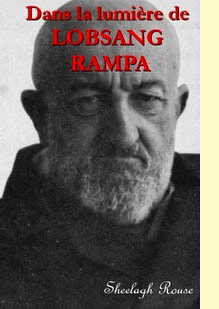 Dans la lumière de Rampa (Grace, the World of Rampa) - Après la publication de ses mémoires, Sheelagh Rouse nous offre un nouveau récit qui plonge encore davantage dans l'intimité de Lobsang Rampa, en nous livrant une série d'anecdotes touchantes mettant en lumière quelques instants de grâce vécus au quotidiens aux côtés de son ami. Ecrit à la demande de ses lecteurs qui souhaitaient en savoir plus après la lecture de son précédent ouvrage ce petit livre clarifie une fois pour toutes les rumeurs qui circulent sur Rampa depuis près de cinquante ans, tout en soulignant la bonté et la générosité désintéressée de ce personnage hors du commun qui avait le don unique de faire ressortir le meilleur chez les autres.
Dans la lumière de Rampa (Grace, the World of Rampa) - Après la publication de ses mémoires, Sheelagh Rouse nous offre un nouveau récit qui plonge encore davantage dans l'intimité de Lobsang Rampa, en nous livrant une série d'anecdotes touchantes mettant en lumière quelques instants de grâce vécus au quotidiens aux côtés de son ami. Ecrit à la demande de ses lecteurs qui souhaitaient en savoir plus après la lecture de son précédent ouvrage ce petit livre clarifie une fois pour toutes les rumeurs qui circulent sur Rampa depuis près de cinquante ans, tout en soulignant la bonté et la générosité désintéressée de ce personnage hors du commun qui avait le don unique de faire ressortir le meilleur chez les autres.
eBook
* * * * * * * * * * * *
Dans la lumière de Rampa
Suite à cette première rencontre, nous fîmes plus ample connaissance au fil des mois à force de le voir rendre des visites régulières à notre femme de ménage. Après chaque visite je le voyais dans le garage avec une boite en carton dans les mains, en train d'attraper des araignées pour son mainate, et je me demandais à l'époque si c'était cela le principal motif de ses visites – trouver à manger pour son oiseau – car je ne voyais pas pourquoi il aurait perdu son temps avec une femme qui, selon mes critères, n'avait pas grand chose à offrir en terme de conversation, je veux dire, de conversation intéressante qui pourrait motiver de fréquentes visites. Ainsi donc, j'en vins peu à peu à mieux le connaître, dans le garage, tandis qu'il ramassait araignées et autres insectes, mais je n'eus l'occasion de leur rendre visite, à lui et son épouse, que quand il eût déjà bien entamé la rédaction du Troisième Oeil, dans l'appartement une pièce qu'ils occupaient. Cette visite aussi reste gravée dans ma mémoire, à plus d'un titre.
En premier lieu, ils étaient pauvres à l'époque, très pauvres, et ce n'était vraiment pas de leur faute. C'était la période où ils avaient pris le nom de Rampa. On lui avait suggéré d'écrire un livre sur sa vie au Tibet du temps où il était lama et, après un premier refus, il réalisa qu'il n'y avait peut être pas d'autre moyen de gagner sa vie, et finit par accepter à contre-coeur. Il pensa qu'il devrait écrire sous un nom de plume, et avait légalement changé son nom de Carl Ku'an en Tuesday Lobsang Rampa. Le livre avançait bien, et à l'époque de mes premières visites les choses s'amélioraient un peu pour eux car il commençait à recevoir des avances de paiement de son éditeur, mais encore insuffisamment pour pouvoir s'offrir un meilleur logement.
J'avais l'habitude de rendre visite aux gens pauvres du pays où j'avais grandi, mais la pauvreté des villes était d'une nature complètement différente. Je parle là du district londonien de Bayswater où demeuraient les Rampa, dans un de ces sinistres lotissements de maisons victoriennes grises qui avaient connu leurs jours de gloire mais qui, à force de dégradation, étaient tombées en disgrâce, et qui étaient habitées par une dizaine de personnes ou plus, vivant dans une pièce unique avec le maigre salaire que leur payait un boulot ingrat, ou bien même sans salaire du tout, et qui parvenaient malgré tout à se « débrouiller ». La vie était une lutte permanente pour eux, et leur offrait peu d'agrément. La nourriture se faisait rare, et le peu qu'ils parvenaient à rassembler leur donnait à peine de quoi manger. La pièce unique dans laquelle ils dormaient, cuisinaient, mangeaient, et menaient leur existence était chauffée par un poêle à gaz muni d'un compteur à pièces qui avalait goulûment les maigres économies qu'ils avaient pu faire dans la perspective d'une ou deux heures de chaleur qui réconforterait leurs corps fragiles et sécherait leur vêtements. Ils partageaient les toilettes et la salle de bain avec d'autres locataires, ils devaient attendre leur tour et composer avec la crasse laissée par les autres autour de la baignoire, les saletés et les crachats dans le lavabo, et la chasse d'eau pas tirée. Telle était la toile de fond de la vie des Rampa quand je leur rendis visite pour la première fois. Ceci était nouveau pour moi et j'en fus un peu choquée.
Chez eux pourtant c'était différent. Bien que pauvrement meublé, leur intérieur ne dégageait pas cette impression déprimante, c'était comme s'ils étaient parvenus à s'élever au-dessus de leur environnement et avaient sculpté leur propre existence hors de cette pierre brute et froide, une existence reçue dans la joie, paisible et remplie. Quand on entrait chez eux après avoir subi l'odieuse traversée du rez-de-chaussée, la différence sautait aux yeux de façon criante. D'abord il y avait l'encens. Ils n'avaient pas vraiment les moyens de s'offrir de l'encens à l'époque de ma première visite, pas régulièrement, mais ce bâtonnet avait été allumé pour moi. C'est probablement pourquoi il produisit sur moi cette impression inoubliable.
Quand je pense à Lobsang Rampa, c'est encore et toujours l'encens qui me revient en mémoire, son odeur dans mes narines. La logique et le sens commun devraient me dire que cela n'est qu'un effet de mon imagination, que je ne sens pas réellement l'odeur de l'encens, que c'est impossible. Pourtant l'imagination est quelque chose de bien réel et de puissant qu'il ne faut pas sous-estimer, et quand j'ai la sensation de sentir le parfum de l'encens, je le vois lui avec les yeux de l'esprit, je le visualise clairement, avec son corps solide, ses bras forts, son crâne rasé, et sa barbe masquant une vilaine cicatrice. Je le vois en train de saisir l'épais bâtonnet allongé, le tenir pour l'enflammer avec une allumette, le contempler un instant, puis souffler la flamme doucement et le placer délicatement dans le porte-encens en laiton posé à son chevet. La vapeur grise et parfumée monte en tourbillonnant, procurant paix et tranquillité, rehaussant nos vibrations, nous pénétrant au plus profond de nous-mêmes.
Ce premier jour, Ra'ab, son épouse, était venue m'ouvrir la porte d'entrée et m'avait conduite au premier étage par un escalier bringuebalant. Je l'avais déjà rencontrée mais je la connaissais à peine, elle différait notablement des femmes que je fréquentais, et je n'arrivais pas à la classer dans ma catégorie quelque peu restreinte. Je trouvais ses réactions plutôt singulières, aux limites difficiles à définir. Elle était néanmoins la femme d'un homme pour qui j'éprouvais le plus profond respect, et je la traitais donc avec le même respect, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire. J'avais un peu d'appréhension. L'endroit paraissait malsain. Il tombait en ruines et avait des relents de cuisine défraîchie, et pour rendre les choses encore pires, les marches craquaient effroyablement à chaque pas et menaçaient de rompre à tout moment. Une fois en haut, elle ouvrit l'une des trois portes brunes du palier et me fit entrer chez eux. Le Dr Rampa était en train de se reposer sur un lit étroit, les jambes repliées, un petit chat siamois Seal point lové sur ses genoux.
Il était toujours correctement habillé, et chaque fois que je l'avais rencontré précédemment, il portait une veste noire sur une chemise rose ou bleue, avec un noeud papillon noir. Il portait des chaussures de type mocassin, faciles à enfiler, au besoin à l'aide d'un chausse-pied, et j'appris plus tard que c'était à cause des difficultés et parfois de l'impossibilité qu'il avait à se pencher en avant. Ce jour là il était chez lui en tenue décontractée, il portait une confortable robe de chambre rouge foncé au lieu de sa veste, des chaussettes grises et des pantoufles. Il m'invita à m'asseoir sur l'une des deux chaises de la pièce, l'autre étant déjà prise par un tapis bleu replié en guise de coussin, et réservé selon toute vraisemblance au chat siamois quand il n'était pas sur les genoux de quelqu'un. Je me rappelle m'être fait la réflexion que l'autre chaise semblait beaucoup plus confortable que la mienne et j'en vins à découvrir au fil du temps que cette situation était parfaitement dans l'ordre des choses chez eux. Je ne me rappelle pas m'être sentie mal à l'aise au cours de toutes les années vécues avec les Rampa, même si on me demandait régulièrement de céder la meilleure chaise à un chat siamois, car c'était la place qu'il était normal de le voir occuper. Ils n'avaient plus le mainate, qui avait succombé à la négligence dont il avait souffert avant que le Dr Rampa ne le découvrît. Ils n'avaient que le siamois Seal point comme animal de compagnie.
Je m'installai donc, et ôtai mes gants pour les déposer avec mon sac à main sur le sol, à côté de moi. Ra'ab avait posé une bouilloire sur le gaz et presque aussitôt l'eau se mit à frémir. S'emparant d'une grosse théière posée sur une étagère au-dessus de la cuisinière, elle attrapa une cuillère dans l'égouttoir et s'en servit pour prendre trois mesures de feuilles de thé d'une boîte métallique octogonale toute cabossée perchée à côté de l'évier, une de ces boîtes décorées à l'orientale qu'on offrait généralement à Noël remplies de thé, et qu'on appelle en Angleterre tea caddy (boîte à thé). Elle versa l'eau bouillante dans la théière, tandis que le petit chat dormait bruyamment et que personne ne songeait à rompre le silence – ce qu'il n'y avait pas besoin de faire ; la préparation du thé avait en soi des vertus apaisantes, comme un rituel. J'imagine qu'ils devaient boire beaucoup de thé dans la journée. Quand la nourriture vient à manquer, le thé permet de calmer un peu la faim pour un temps.
Au Tibet la préparation du thé se serait passée bien autrement. Je le savais en ayant lu le manuscrit du Troisième Oeil chapitre après chapitre au fur et à mesure de son écriture. Je savais qu'au Tibet on employait de gros pains de thé apportés de Chine ou d'Inde à dos de poney par des marchands, et que dans les lamaseries les pains seraient réduits en miettes par les moines pour les plonger dans d'énormes chaudrons d'eau bouillante. On ajoutait du sel et du bicarbonate de soude puis, après ébullition du tout, on insérait au mélange de pleines pelletées de beurre clarifié, et le tout était laissé à bouillir pendant plusieurs heures. Tandis que Ra'ab était en train de faire le thé, tout ceci me traversa l'esprit et je me dis que la vie devait être bien différente au Tibet, qu'il devait être bien difficile de s'adapter à la culture occidentale, et que le Dr Rampa se débrouillait plutôt bien pour « vivre à Rome comme les Romains ». Je le savais assez réticent à écrire sur son enfance et sur ses premières années comme lama au Tibet car il savait déjà que cela lui vaudrait célébrité, adulation, et aussi incrédulité, mais au point où il en était, après toutes ses tentatives infructueuses de recherche d'emploi, il n'avait plus le choix. Il lui fallait survivre, et pour cela il fallait des rentrées d'argent.
Assise là, il me sembla que je ne m'étais jamais sentie aussi détendue dans un environnement inconnu. C'était le deuxième aspect mémorable de cette visite, être là, assise paisiblement dans un milieu qui ne m'était pas familier, pour une première visite au cours de laquelle je me sentais vraiment chez moi, retournant mes idées dans ma tête pendant la préparation du thé. Ce n'était pas rien. J'avais souffert toute ma vie d'une timidité maladive qui était comme un nuage noir à l'horizon, et même si j'avais réussi à surmonter un bégaiement invalidant dans l'enfance, ce bégaiement était malgré tout le symptôme d'un manque d'assurance qui minait mon existence jusqu'à ce jour, qui me mettait dans tous mes états et me laissait dans la confusion la plus totale dès qu'il s'agissait de remplir mes obligations sociales, obligée de dissimuler mon état et de paraître maîtresse de moi. En présence du Dr Rampa, ce lama venu du Tibet, c'était complètement différent. Il y avait quelque chose en lui qui annihilait la peur et l'anxiété ; ces sentiments fondaient tout simplement comme le givre matinal au lever du soleil. Le simple fait de se trouver à l'intérieur de son rayonnement suffisait à produire une sensation magique, on se sentait plongé dans une aura de sécurité et de chaleur, on éprouvait le contentement qui survient quand on à réussi à s'adapter, à s'aligner, à s'accorder. Je suppose qu'en réalité c'est exactement ce qui s'était passé. J'emploi le terme « magique » car il y avait quelque chose d'inconnu qui se passait, quelque chose d'ignoré par la science, et qui le resterait longtemps.
Avant de raconter le troisième incident inoubliable de cette journée, permettez-moi de vous raconter comment j'en suis venue à évoquer ces souvenirs. Un Lecteur, qui depuis est devenu un ami, et qui avait apprécié mon précédent livre dans lequel je racontais mes années passées auprès du Dr Rampa, m'écrivit récemment pour me demander si je pouvais écrire quelque chose sur sa bonté et sa générosité. Dans sa lettre, ce Lecteur disait : « Nous avons été très touchés par le fait que le Dr Rampa ait aidé tant de personnes au cours de ses voyages, et sans vouloir nous mêler de ses affaires privées, vous avez piqué notre curiosité au vif, et nous aimerions beaucoup en lire davantage sur ces évènements. Sachant le plaisir que nous a procuré votre premier livre, en écrirez-vous un nouveau qui mettrait en lumière une telle générosité ? » Bien que sollicitée de façon délicate et persuasive, et très tentée par l'idée, je me sentais encore incapable de me lancer dans cette tâche. Moi qui n'ai jamais pris de note ni tenu de journal, comment pouvais-je me souvenir de toute la gentillesse, toute la générosité, toute la délicatesse, qui caractérisaient la vie du Dr Rampa ? Cela me semblait impossible, et même si j'arrivais à m'en souvenir, il y avait peu de chances que j'arrive à le coucher par écrit de façon lisible et attrayante.
La générosité et la gentillesse étaient naturelles chez lui, c'était sa façon de vivre au quotidien. Il ne me semblait pas facile de mettre cela par écrit, du moins AVANT. Puis au fil des mois je me suis mise à réfléchir à cette idée, et j'ai fini par me dire qu'il avait peut-être raison, cet aimable Lecteur, qu'après tout si j'essayais d'esquisser un tant soit peu la grâce vécue dans le monde de Rampa, ce pourrait être de nature à apporter quelque joie aux autres, même si seule une trace infime ne devait filtrer des histoires que je m'apprête à vous narrer, juste une petite trace, mais suffisante. Je vais donc m'y efforcer.
Le thé était prêt, infusant encore quelques minutes. Notre affable silence se prolongeait. La pièce était dépouillée, avec deux lits étroits séparés par un paravent, deux chaises, et ce qui avait dû être un guéridon de jeux au chevet du lit du Dr Rampa, recouverte d'un linge et ornée d'une petite radio de modèle ancien, d'une pendule, du porte-encens en laiton et d'une lampe de poche. Il y avait aussi une commode toute simple et, posée par terre, une machine à écrire mécanique avec une rame de papier à côté. Il y avait encore une autre petite table branlante qui portait un objet recouvert d'un linge noir. J'appris plus tard qu'il s'agissait d'un cristal d'une grande pureté dont il se servait pour pratiquer la voyance. Comme je le disais, la pièce était toute simple, dépouillée sans être misérable. Il y régnait un sentiment de bien-être. Même si sur le plan matériel la vie des Rampa paraissait précaire faute d'argent, sur un plan transcendant, sur lequel ils semblaient vivre, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ra'ab me tendit mon thé. Il y avait déjà du lait dedans, et le sucre n'était pas proposé. C'est ainsi qu'on servait le thé chez eux. Je me souviens avoir trouvé cela plutôt singulier ; chez nous, on versait le thé et on proposait ensuite le lait, le citron et le sucre séparément, laissant le choix à l'invité, mais là il n'y avait pas d'autre possibilité, aucun effort n'était déployé pour l'impressionner, on ne changeait rien aux habitudes pour lui. C'était comme ça, c'était à prendre ou à laisser. Cela me plaisait assez. Chez moi je prenais du thé au citron, mais j'appréciais ce thé, il était différent.
Nous entamâmes une discussion sur le livre qu'il était en train d'écrire, celui qu'il avait intitulé Le Troisième Oeil. Tandis qu'il m'expliquait quelque chose de sa voix calme, lente et posée, mon attention fut soudain détournée par un son, un simple son à peine audible, comme si quelqu'un était en train de pleurer ou de gémir. Presque au même instant il fut étouffé, comme si on avait mis un mouchoir ou la main sur la bouche. Nous continuâmes à discuter. Au bout d'un moment le bruit revint, plus fort cette fois. Et là il n'y avait aucun doute, c'était quelqu'un qui pleurait ou qui sanglotait, et cela venait de l'extérieur. Je regardai le Dr Rampa, mais il semblait ne s'être aperçu de rien. Je regardai Ra'ab, mais elle paraissait agacée, impatiente.
— Il va falloir faire quelque chose pour elle, Chen, dit-elle, elle est encore derrière la porte en train de pleurer.
— Vraiment ? Peux-tu lui dire que j'irais la voir bientôt, Ra'ab. Je savais qu'il était presque complètement sourd, et de toute évidence il n'avait pas entendu car il était concentré sur notre conversation et sur mes réactions.
Il ne me connaissait pas bien à cette époque et il avait besoin de se concentrer intensément sur mes paroles à cause de son problème auditif. Quand il connaissait mieux la personne c'était plus facile pour lui, il était plus familier avec la structure mentale de celle-ci et il avait moins besoin de concentration. Il était doué de clairvoyance à un degré exceptionnel, mais lorsqu'il avait à faire à plusieurs personnes étrangères à la fois, cela lui demandait un énorme effort. Quand il discutait avec quelqu'un, il se reposait sur ses facultés à lire dans les pensées et sur les lèvres, mais il faut bien se rappeler que nous pensons souvent à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de dire, ce qui complique considérablement les choses pour un clairvoyant.
Il continua à parler comme si rien ne s'était passé tandis que Ra'ab allait à la porte et l'entrouvrait juste assez pour se glisser dehors avant de la refermer derrière elle. J'avoue avoir éprouvé une sorte d'émoi à la pensée qu'il était peut-être en train de se jouer un drame derrière la porte fermée. Cela ne ressemblait à rien de ce que je pouvais vivre chez moi. Dans mon monde bien ordonné et bien élevé, il était tout simplement impossible qu'un tel drame ne puisse se produire, les gens ne se promenaient pas devant la porte des autres en pleurant, ils souffraient en silence, même si leur souffrance était peut être aussi intense. Je retins mon souffle, attendant la suite.
Ra'ab revint, s'assit sur le coin du lit et reprit son thé, muette. Je me détendis et repris ma tasse comme elle ; peut-être ce genre d'événement était-il quotidien ici, peut-être les gens se faisaient-ils assassiner, perdaient connaissance, pleuraient ou subissaient je ne sais quoi en plein jour, ici. Mon imagination allait bon train, et ce n'est pas sans difficulté que je parvins à reprendre mes esprits et revenir à la discussion avec le Dr Rampa. Bientôt ce fut pour moi l'heure de partir. Mon chien n'allait pas bien à la maison, et j'avais hâte d'aller le retrouver. Je priais le Dr Rampa de rester assis et lui tendis la main pour lui dire au revoir.
— Au revoir, j'ai été ravie de vous voir… Chen.
Il nous avait priés il y a quelques semaines, mon mari et moi, de l'appeler par ce nom qu'il réservait à ses amis proches, mais j'avais encore un peu de mal à le dire naturellement. Après une chaude et ferme poignée de main, il me dit qu'il y avait un problème avec le livre chez l'éditeur ; quelqu'un avait émis des doutes sur son authenticité. Il avait apporté les précisions demandées, mais on ne pouvait pas cacher que c'était embêtant. Je quittai Ra'ab en lui promettant de revenir bientôt.
Sur le pallier, je jetai un regard aux deux autres portes marron, mais elles restaient désespérément closes, masquant je ne sais quels sombres secrets derrière elles. J'avais du mal à bien distinguer les escaliers dans la pénombre, et en regardant par terre je pus voir une trace de quelque chose qui ne pouvait être que du sang, encore frais, d'un beau rouge foncé bien brillant, pas encore séché, allant de la dernière porte du pallier à celle que je venais de laisser. J'empoignai le bras de Ra'ab en montrant le sol.
— Regardez, du sang ! Elle haussa les épaules.
— Oui, il faut que je nettoie avant que la propriétaire ne vienne. Elle est terrible.
— Mais… qu'a-t-il bien pu se passer ? Quelqu'un doit être blessé. C'est horrible Ra'ab !
— Oh, c'est juste cette fille, l'homme pour qui elle travaille, ils se battent.
Ensuite elle tombe enceinte et… enfin, c'est une longue histoire. Si la propriétaire en savait la moitié, elle se ferait expulser. Cette fille n'a nulle part où aller. Ce n'est pas sa faute, et elle est seule dans la vie. Nous arrivâmes dans le hall d'entrée et Ra'ab ouvrit le verrou de la porte d'entrée. — Je vous accompagne au coin de la rue, j'ai quelques coups de téléphone à passer, dit-elle. Il n'y avait pas loin jusqu'au coin de la rue. Je m'étais sentie embarrassée en venant, je n'étais pas sur mon territoire, la vie bien rangée, le bon côté du miroir. Je m'étais trouvée trop élégante, mal à l'aise, et à présent, avec Ra'ab à côté de moi, ça allait un peu mieux, mais ma curiosité pris le pas sur ma gêne.
— Que pouvez-vous faire pour aider cette fille, Ra'ab, et pourquoi le faire ? Il existe des structures pour ces personnes, elle représente un poids pour vous. Chen a besoin de pouvoir avancer dans son livre, il ne doit pas être importuné par elle.
Tout en parlant je sentais sa désapprobation. Elle se tourna brusquement vers moi et me regarda d'un air à moitié hostile.
— Vous êtes puérile ; vous ne savez rien de la vraie vie. Tout le monde n'a pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche comme vous. Maintenant il faut que je vous laisse.
Tout en me parlant, elle entra dans la cabine téléphonique, puis décrocha résolument le combiné, et commença à composer son numéro, faisant tinter les pièces de monnaie dans sa poche. Je m'étais fait congédier sèchement. Je tournai les talons, quelque peu déconfite, mais déterminée à en discuter avec Chen la prochaine fois que je le verrais, et effectivement, je n'eus pas longtemps à attendre.
Une ou deux semaines plus tard, je sortais de chez Fuller, le salon de thé, avec une boîte de gâteaux dans les mains quand nos chemins se croisèrent tandis que je descendais Queensway en venant de Bayswater Road. Nous nous saluâmes et restâmes à bavarder un moment, puis je me rappelai que je souhaitais lui demander pourquoi il s'occupait de ces femmes, des femmes que je considérais importunes et inintéressantes. En réalité, cela ne me regardais pas, mais je me sentais poussée à aborder le sujet. Il y avait la femme qui vivait sur le même pallier que lui, et il y avait aussi mon ancienne femme de ménage qu'il était venu voir si régulièrement.
— Venez donc prendre une tasse de thé à la maison, lui proposai-je, J'ai une amie de la campagne qui vient me voir cet après-midi pour quelques jours, et elle adore les gâteaux de chez Fuller. Je suis sûre qu'elle ne verrait aucun inconvénient à ce que nous partagions ensemble celui-ci.
Nous descendîmes Queensway, tournâmes à droite dans Moscow Road puis à gauche vers la place Saint Petersbourg où j'habitais. Mes deux enfants étaient à l'école, aussi avions nous le temps de nous asseoir tranquillement au salon pour prendre le thé. Connaissant les problèmes qu'il avait à rester longtemps assis sur une chaise rembourrée ou dans un fauteuil, je lui avançai une simple chaise à dossier qui sembla lui convenir.
La discussion glissa aisément sur mon ex-femme de ménage. J'avais été contrainte de la licencier et j'avais un peu craint qu'il ne m'en tînt rigueur, d'autant qu'elle le considérait comme « un gentleman qui l'avait plus aidée que quiconque auparavant. »
— Vous savez, Chen, je me suis toujours demandée ce que Mme W. voulait dire quand elle me répétait sans cesse combien vous l'aviez aidée. Qu'avez-vous donc tant fait pour elle ? Et, ce qui me déconcerte le plus, c'est pourquoi vous l'avez aidée ?
Je marquai une pause en me demandant si je n'étais pas allée trop loin, mais il paraissait calme, semblant attendre la suite, aussi poursuivis-je,
— Personnellement je trouvais qu'elle ne m'aidait pas beaucoup, et – soyons francs - que c'était une incorrigible affabulatrice. Elle inventait tout le temps des histoires ahurissantes ! C'était drôle en un sens de voir qu'elle pensait me les faire avaler, et du reste au début c'était le cas, ce qui a dû l'inciter à passer à l'échelle supérieure. Tous ces gens importants qu'elle prétendait connaître ! Imaginez, elle possédait le catalogue de toute l'aristocratie du Yorkshire, et tous ces endroits où elle était allée, toutes ces choses – peu importe en réalité – mais je suis curieuse, je l'avoue, de savoir pourquoi vous perdez votre temps avec elle.
Il ne dit rien pendant un moment, et resta là, silencieux sur sa chaise, me faisant presque douter de moi-même. Mais quel doute pouvait-il y avoir ? Je savais que cette femme était dérangée.
— Il faut savoir que je raisonne différemment de vous, les gens.
Vous les gens, c'était une de ses expressions favorites, une de celles qu'il employait fréquemment, et qui nous amenait à déduire qu'il se considérait comme en dehors. Je savais déjà à cette époque qu'il était clairvoyant, qu'il pouvait voir l'aura et lire dans les pensées ; il était capable de lire le passé et l'avenir avec une grande acuité. Bien que je fusse parfaitement ignorante en matière d'occultisme, je réalisais parfaitement que sa conception de la vie devait être bien différente de celle de la plupart des gens.
Je lui servis une tasse de thé avec du lait, comme il en prenait chez lui. Il en but une gorgée, et continua.
— Je suis capable de voir les gens tels qu'ils sont REELLEMENT, et pas seulement tels qu'ils paraissent en surface. Disons que je suis capable de voir l'âme de quelqu'un. La vie est une étape vous savez, comme vous l'a dit Shakespeare, et les gens sont semblables à des acteurs vivant une existence, puis une autre. Dans une vie, on peut être mendiant, et prince ou princesse dans la suivante – oui, on peut même changer de sexe pour accomplir ce qui doit être appris dans chacune des vies. Mais je peux voir par delà l'acteur en chacun, je peux voir sa vraie valeur, ou son absence de valeur.
Il marqua une pause pour me laisser digérer ses propos. Malgré son degré d'avancement, il réalisait combien j'en savais peu, et combien tout cela était étrange pour moi, difficile à comprendre et à accepter.
— Vous pensez donc que Mme W. méritait que vous y consacriez votre temps ? C'est difficile à croire !
J'étais épouvantée à l'idée qu'elle pût en valoir la peine. C'était une femme sans éducation de la classe laborieuse, et qui de surcroît n'était même pas honnête.
— Vous ne pensez pas qu'elle ait une quelconque valeur ? demanda-t-il posément. Eh bien, la valeur que VOUS attribuez aux gens se base sur la façon dont ils se présentent à vous, à savoir, quelle école ils ont fréquenté, quel est leur niveau social et celui de leur famille, s'ils ont une conversation cultivée, comment ils s'habillent, quelles sont leurs manières, et ainsi de suite.
Cela était dit sans jugement, c'était un simple constat, et si c'était désobligeant, ce n'était pas intentionnel.
— D'un autre côté, poursuivit-il, je n'ai pas l'avantage de savoir précisément comment ils doivent apparaître pour réussir votre évaluation. Au vu de ce qu'ils ont accompli en matière spirituelle au cours de leurs vies sur terre, je vois les leçons qu'ils ont choisi d'apprendre dans cette vie. La plupart du temps la vie est trop dure, les gens s'imposent des leçons et des tâches impossibles, ils se surchargent sans prendre en considération les échecs qu'ils risquent de rencontrer sur terre.
J'étais interloquée. J'étais obligée d'accepter qu'il disait la vérité en ce qui concernait mes critères de jugement, mais en même temps, j'éprouvais le besoin de les défendre. Tout notre système reposait sur ces principes. Pourtant, je ne dis rien. Il sourit.
— Je vois que je vous ai contrariée, mais j'essaye simplement de vous expliquer pourquoi j'ai essayé d'orienter votre ex-femme de ménage sur un chemin qu'elle pourrait maîtriser. Vous pensez que c'était de l'ingérence ? Ça n'en était pas. Elle est suffisamment évoluée pour se rendre compte que j'étais différent, que j'étais en mesure de l'aider, et c'est pour cela qu'elle a sollicité mon aide. On ne peut pas détourner la tête quand on vous demande de l'aide et quand il y a de l'espoir. C'est un fardeau d'être voyant, vous savez, c'est une responsabilité qui doit être assumée. Et il y avait de l'espoir, un mince espoir certes, mais de l'espoir malgré tout, alors j'ai essayé. Elle a échoué à plusieurs reprises, et j'ai persévéré, mais finalement c'était en vain. Il n'y avait alors plus de raison de poursuivre avec elle car elle ne faisait pas d'efforts sincères. Si une personne sollicite l'aide d'une autre puis la rejette, ou si elle échoue, ce n'est pas une bonne chose, ni pour l'une ni pour l'autre. C'est comme si on glissait en arrière sur l'échelle de l'évolution. Si vous sollicitez une aide, vous devez être sérieux, vous devez avoir la ferme intention de suivre la Voie, et vous devez faire des efforts sincères.
— Je vois. Et qu'en est-il de l'autre femme, votre voisine de pallier ? Est-elle dans le même cas ?
— Non, pas vraiment. C'est une victime. Elle n'a jamais eu de chance, et elle a pris la seule voie qui s'offre à ces femmes pour vivre. Elle s'est mise avec un homme sans scrupule qui se sert d'elle. C'est toujours la même vieille rengaine. Sexe, chantage affectif, détresse. Ra'ab et moi faisons ce que nous pouvons pour elle, seulement parce que nous le devons, pour qu'elle puisse voir qu'il existe de plus belles choses dans la vie. Cela peut s'imprimer quelque part dans sa tête, et le jour où elle sera au bord du désespoir, il se peut qu'elle se souvienne. On ne peut pas passer son chemin sans rien faire. Elle n'a pas réclamé mon aide de la même manière. On dit qu'un Bouddhiste qui voit quelqu'un se noyer ne doit pas intervenir, qu'il doit le laisser se noyer pour accomplir son destin et expier son karma. Eh bien, je suis Bouddhiste, mais je suis aussi clairvoyant à un haut degré et je vois bien plus clairement que la plupart des gens. Tendre la main à cette femme est humain. Cela n'altèrera en rien son style de vie ou son choix des leçons à apprendre dans la vie, mais cela peut lui apporter de l'espoir dans ses heures les plus sombres.
— Mais vous avez des choses beaucoup plus importantes à faire ! Vous perdez votre temps.
— Vous pensez ? Si vous voyiez ce que je vois, vous auriez sûrement une opinion différente, du moins je l'espère.
Il sourit, de cette façon si caractéristique dont il était coutumier, juste avec les yeux, et nous ramena à une position plus nuancée.
— Il y a tant de forces négatives en action dans le monde qu'il est difficile de les regarder en face parce qu'elles provoquent trop de détresse. Les gens dans votre position ne les voient pas, ou bien s'ils les voient, ils leur tournent le dos et les ignorent. Je peux les regarder parce que je les ressens avec trop d'acuité et je les vois trop clairement.
Je restais assise en silence, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Même si je voulais faire quelque chose pour aider la prostituée qui vivait derrière la porte à côté de chez lui, elle ne voudrait pas de mon aide, elle aurait une attitude de méfiance et d'antipathie envers moi. Il n'y aurait aucun terrain d'entente. Peut-être était-ce, comme l'avait dit Ra'ab, à cause de mon inexpérience, de ma naissance, ou tout simplement d'une trop grande incompatibilité entre cette pauvre femme et moi. Pourtant Chen avait la capacité d'entrer en contact avec elle sur un certain plan, tout comme il l'avait avec moi sur un autre plan. Il nous était supérieur à toutes deux. À ce moment là, notre système de statut social m'apparut aussi pathétique et fragile qu'un château de cartes, il pouvait s'écrouler en un instant sans laisser de trace. Je me ressaisis. J'étais sur un terrain dangereux.
— Vous n'avez pas goûté le gâteau.
Je pris le plateau et lui en offrit une part. Il déposa sa tasse et sa soucoupe sur la petite table entre nous et se leva pour partir.
— Je suis heureux de vous avoir vue, et merci pour le thé. Vos enfants vont bientôt rentrer, et il faut que je me remette à mon livre. Il avance lentement mais sûrement.
Nous cheminâmes ensemble jusqu'au portail et échangeâmes une chaleureuse poignée de mains.
— Ne vous en faites pas pour notre conversation. Il y a tant à apprendre dans la vie, tant à voir si on regarde sous la surface.
Il avait raison. Plus de choses à apprendre, beaucoup plus, et encore davantage à découvrir sous la surface. Mais quelle quantité exactement, je n'en avais alors aucune idée.
* * * * * * * * * * * *
La mémoire est quelque chose d'intéressant. Prenez un rapport d'événement écrit au moment de sa survenue quelque cinquante ans plus tôt, il sera différent de celui que vous pourriez écrire aujourd'hui sur le même événement, de mémoire. Il est parfaitement exact que la mémoire s'émousse, qu'elle a tendance à ignorer les souvenirs désagréables, la mémoire est comme une peinture impressionniste, elle tempère la dure réalité pour en faire quelque chose d'acceptable. De la même façon, les évènements perçus avec la distance du temps sont chargés de moins d'émotion, ils sont remis à leur place véritable avec souvent plus de discernement qu'à l'époque. L'écriture de mémoire est dénuée de toute charge émotionnelle irrationnelle. À ce moment là l'écrivain est détaché et peut être plus objectif, il peut se révéler un historien plus juste. J'aborde ce point car il m'a été suggéré que mes souvenirs pouvaient être altérés et inexacts. Quand je regarde en arrière je vois une histoire, une aventure, une suite d'évènements qui constituent ma vie, et en les observant je les vois beaucoup plus clairement, et non dans une sorte de brouillard qui les rendrait inexacts, c'est vraiment l'inverse, je vois à présent ma vie avec les yeux grands ouverts, avec un regard plus tolérant sur les épreuves, plus compréhensif sur leurs causes. Nous avons tous des histoires à raconter sur notre vie et ce n'est que parce que la mienne a croisé celle d'un homme remarquable qu'elle devient intéressante et qu'elle revêt une valeur pour les autres. Et c'est parce tant de choses concernant cet homme exceptionnel – Lobsang Rampa – ont été dénaturées qu'il est devenu vital pour moi d'en donner la vraie version, avec honnêteté, même si cela doit faire voler en éclat la vision idéalisée des uns et le jugement faussé des autres.
Un autre de mes lecteurs et amis m'a fait remarquer il y a quelque temps qu'il n'avait pas dû être facile d'apprécier réellement le Dr Rampa en étant constamment à ses côtés, et qu'on devait être plus objectif en étant à distance de lui. Cet ami avait parfaitement raison, il m'était difficile de l'apprécier pleinement à l'époque parce que cela aurait créé une barrière et nous aurait empêché d'avoir une vie de famille normale. Mais avec la distance du temps, après toutes ces années, je vois tout cela avec une plus grande sensibilité, et je comprends mieux maintenant combien sa vie a dû être pesante, combien il a dû souffrir en silence, sans pouvoir donner davantage d'explications, même à nous qu'il considérait comme sa famille.
C'est en 1956 que j'ai dû aller vivre chez les Rampa. Je peux le dire parce que c'était à peu près à l'époque de la sortie du Troisième Oeil. Notre cohabitation n'était pas destinée à durer, c'était plus pour me permettre de m'établir dans une nouvelle vie, et de prendre un nouveau départ après l'échec de mon mariage. À cette époque je considérais l'aide apportée par Chen comme allant de soi, et ce n'est que maintenant, avec le recul de cinquante années, qu'elle m'apparaît dans toute sa grandeur. La raison pour laquelle je ne la voyais pas bien à l'époque, et qui la rendait si facile à accepter c'était sa façon de donner. C'était la beauté du don, et sa rareté. Ce qu'il a fait pour moi, et pour d'autres qui se sont retrouvés comme moi dans une situation inextricable, ce n'était ni de la charité, ni un acte qui attendait une quelconque reconnaissance en retour, ce n'était pas de la gentillesse dans le sens habituel du terme. C'était un acte d'amour et l'amour ne demande rien en retour. Ce n'était pas de la pitié non plus, car les faveurs accordées par pitié sont humiliantes pour qui les reçoit, et on peut dire sans risque de se tromper qu'il n'a jamais rabaissé quiconque à ce rang. Il donnait avec élégance, librement et dans la joie, dans un merveilleux élan de don de soi. Cela en rendait l'acceptation comme la chose la plus naturelle au monde, la plus facile, la plus agréable. Il m'apparaît maintenant qu'il ne voyait que peu de différence, voire aucune, entre moi et les deux autres femmes dont j'ai parlé. Nous étions toutes des êtres humains qui pataugions dans nos problèmes, embourbées dans le marécage de la vie, incapables de nous en sortir seules, comme ces oiseaux de mer dont les ailes magnifiques ont été engluées par le goudron ou le pétrole des marées noires, incapables de s'envoler, et condamnés à une mort certaine. Mais notre ressemblance à toutes les trois ne m'apparaissait pas alors. Mes critères de jugement étaient aussi artificiels et discutables que tout ce que produit l'homme, ils n'avaient que peu à voir avec la réalité ou avec les lois de la nature, c'était des critères humains, pire, des critères établis par un tout petit groupe d'élus. Je me considérais comme infiniment supérieure aux deux autres femmes. C'était ainsi que je voyais les choses, et du reste la question ne se posait même pas, car pour moi c'était un simple fait établi, à mes yeux j'entends ! Je suppose que c'est par un coup de chance, ou peut-être parce que j'avais de plus gros besoins que les leurs, que je suis allée plus loin. Je suis restée avec les Rampa, en devenant un membre à part entière de la famille pendant près de vingt-cinq ans.
Mais nous parlions du don, n'est-ce pas ?, de l'élégance du don dans le monde de Rampa. Et ce don n'est pas d'ordre matériel, même si cet aspect était aussi très présent. Je parle de réelle ouverture, comme le fait de sortir pour rencontrer les autres sur le même pied d'égalité, je parle du don désintéressé qui grandit l'autre. C'est une chose que de voir un clochard assis par terre au coin de la rue, de lui jeter une ou deux pièces de monnaie, voire un manteau ou une paire de gants, et de penser ainsi n'avoir pas trop mal agi, avoir fait preuve de gentillesse, et pouvoir se féliciter en reprenant son chemin, content de soi. Mais c'en est une autre que de s'approcher du mendiant, d'engager la conversation avec lui, de s'asseoir à côté de lui sur le trottoir, puis de prendre le temps de l'accompagner au bas de la rue pour partager un café et un repas ensemble. Puis de revenir le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'une relation de confiance s'établisse. C'est de cette façon de donner dont je parle, c'était cela le monde de Rampa, c'était le genre de choses qu'il faisait parce qu'il était libre de tout préjugés et de fausses valeurs. Combien d'entre nous seraient capables de faire ce genre de choses même s'il le voulait ? La plupart d'entre nous sont accablés du fardeau des habitudes, de la respectabilité, du soucis de garder notre petite place dans le monde sans être dérangés par les nécessiteux, une petite place que nous avons peut-être acquise en nous battant dur, en nous cramponnant comme nous pouvons aux « bonnes choses » acquises. Il y a toujours en arrière plan cette vilaine pensée qu'en nous abaissant jusqu'au niveau du mendiant nous ne retrouverons jamais la position artificielle que nous nous sommes attribuée, que nous porterons à jamais une souillure aux yeux du monde.
Lobsang Rampa comprenait parfaitement ce sens de la retenue qui empêche la plupart d'entre nous de donner véritablement, cette peur qu'en agissant de la sorte on risque de perdre quelque chose de soi-même. Il considérait cela presque comme un obstacle insurmontable pour faire de réels progrès en matière spirituelle, et cela le désolait. Je pense que cela faisait peut-être partie de son plan – le fait de donner de sa personne librement en s'ouvrant complètement, en espérant devenir un exemple que l'on finirait par suivre encore et encore. Et c'est vrai qu'en vivant avec lui au quotidien et en étant témoin de sa sincérité et de son humanité, on était capable de plus d'ouverture, de plus de capacité à donner, on devenait donc plus épanoui et moins inquiet.
Nous vivions à Londres lors de la sortie du Troisième Oeil, et ce fut un événement marquant dans la vie des Rampa car leur vie changea sur bien des points suite à la publication du livre. Il lui devenait désormais possible d'entreprendre le travail sur l'aura qui était sa mission dans la vie ; il y aurait de l'argent pour acheter des appareils photo, des pellicules, et tout ce dont il avait besoin pour ses recherches dans le domaine de l'aura humaine. Nous louâmes ensemble un appartement plus correctement meublé pendant quelques mois, et nous n'eûmes plus jamais faim ni froid comme avant. Mais malgré les soucis qu'il avait certainement et le travail supplémentaire lié à la publication du livre, il consacrait beaucoup de son temps et de son énergie à s'occuper de moi. Comme je le disais, je prenais cela le plus naturellement du monde, et c'était bien ainsi qu'il l'entendait. Mais sans son attention constante, sans son amitié et nos conversations, je me serais enfoncée dans les profondeurs de la dépression ; j'en ai maintenant la certitude. Et une dépression grave peut durer toute la vie, et même adoucie par les médicaments et les thérapies, elle peut causer des dégâts permanents pour le cerveau et l'équilibre chimique de l'organisme. Je n'ai jamais souffert de la sorte, j'en suis sortie aussi saine que la plupart des gens, plus équilibrée et en meilleur état de fonctionnement que je ne l'avais jamais été.
Au cours de nos fréquentes sorties ensemble, je découvrais des endroits de Londres que je n'avais encore jamais vus avant, alors que j'habitais cette ville depuis l'adolescence. Nous prenions l'autobus et nous marchions, et à bord des autobus nous nous asseyions à l'étage, au fond si possible car c'était là que nous aimions être. Il aimait observer les gens qui émergeaient de l'escalier, d'abord la tête puis le corps entier, et qui étaient ballottés par le démarrage du bus. Un jour quelqu'un monta un petit enfant par l'escalier, une tâche difficile quand on connaît les chauffeurs de bus londoniens ; c'était un enfant handicapé, avec le corps difforme. J'avais moi-même de jeunes enfants, et en le regardant mon coeur se mit à battre pour ce petit enfant que la vie n'avait pas avantagé. Quel genre de vie lui serait réservé ? Cela me semblait affreusement injuste de devoir débuter sa vie en étant handicapé.
— Je vois que tu as pitié de lui, Sheelagh, dit Chen*.
(* Cela peut déconcerter un peu le lecteur, mais à partir de cette époque, les dialogues entre L. Rampa et Sheelagh Rouse prennent un ton plus familier, ce que l'auteur (vivant au Canada et connaissant assez bien notre langue) a confirmé en approuvant la traduction du « you » anglais par le tutoiement)
— Comment peux-tu savoir que je suis désolée pour lui ? J'étais stupéfaite, je n'avais rien dit.
— Tes couleurs. Tes couleurs montrent tes sentiments.
Il parlait des couleurs de mon aura, ces couleurs sans cesse changeantes qui tourbillonnent autour de nous et qui peuvent indiquer à un voyant capable de les percevoir quelles sont nos émotions.
— Mais rappelle-toi que cet enfant a probablement choisi cette infirmité pour une raison bien précise, pour quelque chose qu'il souhaitait apprendre dans la vie.
— Alors nous ne devons éprouver aucune pitié ? J'observais le papa prendre un siège à l'avant du bus et mettre l'enfant sur ses genoux.
— De la pitié ? La pitié n'est pas une bonne chose, elle est humiliante. Les gens ressentent automatiquement de la tristesse quand ils sont confrontés à la souffrance, et ils veulent parfois apporter leur aide. Mais on ne devrait jamais apporter son aide à quelqu'un à moins d'y être invité, car cela deviendrait de l'ingérence dans le chemin choisi par l'autre, et cela risquerait de lui ôter la possibilité d'apprendre ce qu'il a décidé d'apprendre dans cette vie.
Je voyais qu'il était d'humeur causante. Nous allions en direction de Richmond, et donc nous avions le temps.
— D'après mes croyances, continua-t-il, nous décidons dans le monde astral, avant de venir sur terre, ce que nous devons apprendre dans la nouvelle vie qui est sur le point de commencer. S'il s'avère que les obstacles que nous avons choisis sont pires que prévus – et c'est souvent le cas – que nous nous battons dur et que nous arrivons à nous débrouiller malgré tout, et si tout à coup quelqu'un arrive en nous disant « Oh, c'est trop dur pour vous, je vais vous soulager un peu de votre fardeau », ce n'est pas une bonne chose du tout, c'est même une entrave plus qu'une aide en réalité, parce que cela bouleverse complètement les plans que nous avons établis en vue d'apprendre certaines leçons. Mais supposons que nous acceptions quand même cette aide non sollicitée, l'offre est trop généreuse pour être refusée et nous ne voyons aucune raison valable pour continuer à nous battre, car bien sûr nous n'avons pas conscience de nos plans, de ces obstacles que nous nous sommes imposés. Si nous pouvions voir dans l'astral, si nous étions tous médiums et si nous pouvions voir plus loin que notre monde en trois dimensions, nous le saurions, mais nous partons du principe que nous ne sommes pas médiums et que nous ne pouvons pas voyager consciemment dans l'astral. Alors nous prenons le chemin le plus facile.
— Pourtant il arrive parfois que notre vie nous semble absurde, que nous ressentions de la frustration sans savoir pourquoi. Nous faisons notre temps sur terre et nous arrivons à la fin, nous mourons, la Corde d'Argent est coupée, nous retournons dans le monde astral en laissant derrière nous notre corps physique comme on abandonne un vieux costume usé. Puis, une fois arrivé dans l'astral, où nous redevenons capables de voir les choses avec clarté, nous nous apercevons que nous avons gâché notre vie et que nous devons revenir sur terre pour essayer de recommencer à apprendre les mêmes leçons. Nous devons retrouver les mêmes obstacles, ce qui signifie qu'effectivement nous avons gâché notre vie en acceptant l'aide non sollicitée qui nous a été proposée.
— Oui, nous avons déjà un peu parlé de cela.
C'était manifestement un sujet qu'il lui tenait à coeur que je comprenne, la pierre angulaire sur laquelle reposait de nombreux aspects des traditions occultes.
— Je comprends ce que tu dis, mais tu sais Chen, c'est vraiment difficile de saisir ce genre de choses, c'est tellement éloigné de notre pensée occidentale, mais je dois admettre néanmoins que cela répond à certaines questions que je me posais vaguement.
Je gardais le silence une minute ou deux. Le bus s'arrêta puis repartit. J'étais toujours en train de penser à l'enfant et à l'importance de ne pas se mêler de la vie des gens quand ils ne demandent rien.
— Mais n'est-ce pas une réaction naturelle, si on est doté d'un minimum de bonnes manières, de se lever pour céder sa place à une personne handicapée par exemple, ou de lui tenir la porte ? Il n'y a sûrement rien de mal à cela.
— Non, bien sûr que non. L'aide dont je parle est d'une toute autre nature, je ne parle pas, comme tu le fais remarquer avec justesse, de la considération que l'on doit avoir envers les autres. Mais en même temps, rappelle-toi qu'il existe beaucoup de handicapés ou de personnes âgées dont l'orgueil mal placé peut se retourner contre toi si tu leur témoigne la moindre considération. Tu sais, le genre « je peux le faire tout seul », mais il s'agit là d'une manifestation de leur amertume et du manque de discernement qu'ils ont vis à vis de leur handicap. Cela ne devrait pas te décourager malgré tout, il en reste encore beaucoup qui sont reconnaissants.
Je me rendais compte qu'entreprendre de venir en aide aux autres n'était pas si facile que cela. Et qu'en était-il de ceux qui avaient besoin d'aide mais n'osaient pas la réclamer ? Et puis aussi, on ne peut pas sortir dans la rue comme ça et importuner les gens en jouant les bienfaiteurs. Je me disais aussi que pouvoir aider quelqu'un est une sorte de privilège, aussi quand cette chance se présente on devrait avoir tout intérêt à la saisir car elle risque de ne plus se représenter avant longtemps.
Nous parlions d'une foule de choses à cette époque. Nous avions aussi beaucoup plus de temps pour discuter. Par la suite, quand il commença à devenir célèbre et à être constamment bombardé de lettres et de questions, il devint plus difficile pour nous de renouer avec nos conversations à la maison, avec leurs lots de théories et de questionnements. J'apprenais dès lors les choses à travers les réponses qu'il donnait aux autres. Au cours de ces premiers mois je réalisai mes premières prises de conscience de ce qui existe au-delà du plan terrestre. Il commençait vraiment son oeuvre de salut à mon égard en entreprenant mon apprentissage avant que mon ancien univers ne s'effondre irrémédiablement, et en consacrant autant d'énergie à mon éducation. Il y avait tant de points sur lesquels je devais réfléchir, je devenais capable de relativiser un peu plus les choses et de régler mes problèmes. Sa façon de me transmettre sa connaissance maintenant que nous vivions ensemble était devenue plus sérieuse et plus dense que quand nous nous rencontrions occasionnellement auparavant. Ce qui était génial dans les premiers temps c'est que j'avais l'esprit tellement occupé que je n'avais pas le temps de broyer du noir, ni de regretter le passé, j'avais l'esprit tourné vers l'avenir et sur des choses qui me dépassaient. C'est maintenant que je me rends compte que c'était bien pensé de sa part de me faire franchir ainsi cette période ô combien désastreuse de ma vie. Quand une personne est déprimée, abattue ou affligée, il peut lui être fatal de se centrer sur elle-même et de s'auto analyser. Ce n'est qu'en prenant du recul avec elle-même que la guérison peut s'établir.
Pour faire une petite digression, quand j'ai commencé à écrire mon livre sur le Dr Rampa j'ai un ami qui m'a conseillé en toute bonne foi que je devrais aussi livrer au lecteur tous les aspects négatifs le concernant, lui-même et ma vie avec lui. D'après cet ami – et il a certainement raison – personne n'aime lire des histoires où tout se passe bien, cela devient vite rébarbatif et même suspect. Ce que les lecteurs affectionnent particulièrement ce sont les sensations fortes, les aspects obscurs et les vérités cachées, et tout le monde, m'a dit mon ami, possède des mauvais côtés qui devraient être révélés en toute honnêteté. Et ce qui ferait tout l'intérêt du livre, et qui le ferait vendre, c'est justement ce côté obscur que je suis la seule à connaître. Mais bien qu'étant tout à fait d'accord avec ce conseil pertinent, j'avais du mal à trouver si peu que ce soit d'alléchant pour rendre mon livre vraiment intéressant ! Quantité de mythes ont été mis en circulation sur Lobsang Rampa, quantité de critiques effrénées, mais il y avait en vérité très peu d'éléments factuels pour la simple raison que presque personne ne le connaissait. Comme toute personnalité brillante sortant de l'ordinaire et au caractère complexe, il y avait plusieurs aspects qui le caractérisaient, et qui le rendaient difficile à comprendre. Il reconnaissait lui-même qu'il n'était pas comme tout le monde et il faisait des efforts pour rester souple d'esprit et tolérant. Il avait grand besoin de solitude, et c'était dans ces moments-là qu'il reprenait des forces et se ressourçait.
Certaines personnes, peut-être même la plupart de ceux qui sont exposés au regard du public, veillent soigneusement à ne jamais lire aucun article ni aucune critique écrits sur eux, que ce soit en positif ou en négatif, et nous ne faisions pas exception à la règle, aussi n'est-ce que très récemment que j'ai réalisé les choses invraisemblables attribuées à Chen, et même en fait à nous trois, et tellement éloignées de la vérité qu'elles en sont ridicules. Des choses supposées avoir été faites ou dites par lui, des folles orgies organisées chez nous par exemple, et ainsi de suite, des descriptions de sa personnalité qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Sur les couvertures de ses livres il était présenté comme un mystique, ce qui ouvrait la porte à toutes sortes d'interprétations. Du reste, il était un peu responsable de ces fausses impressions, et je vais vous expliquer pourquoi.
Il y a des photos de lui, et des dessins réalisés à partir de ces photos, qui le montrent comme quelqu'un de menaçant ou d'étrange. Il avait l'habitude, quand il posait à des fins promotionnelles, d'adopter une posture rigide et sérieuse, complètement différente de son air bienveillant habituel. Ce que nous en savons, c'est que pour une raison quelconque qu'il gardait pour lui – à moins qu'il ne fût tout simplement sur la défensive – il souhaitait apparaître ainsi pour le public, mais pour autant, la raideur est une chose, et une attitude menaçante en est une autre, et je suis certaine qu'il ne souhaitait pas suggérer cette dernière, qui était à des lieues de ce qu'il était en privé. Il pouvait se montrer ferme et même terrible s'il le fallait, mais ce n'était pas son comportement habituel de tous les jours. Il est plus que probable que les choses invraisemblables rapportées sur lui prennent leur origine dans ces premières photos. Comme tout le monde le sait, les photos de couverture des livres poussent toujours le sensationnalisme à l'extrême, mais il n'avait aucun pouvoir de contrôle sur elles. On ne lui montrait jamais les couvertures de ses livres avant qu'ils ne sortent, on ne lui demandait jamais son avis sur la quatrième de couverture, mais à l'évidence les éditeurs étaient exactement dans l'état d'esprit décrit fort à propos par mon ami, à savoir que le public adore le sensationnel, et plus il y en a, plus il aime.
Il y avait un autre aspect de ce même problème de fausse impression, c'était sa voix. En général la voix de quelqu'un est un bon indicateur de sa personnalité et de son caractère. Quand vous entendez la voix de quelqu'un avant de le rencontrer, vous pouvez vous faire une idée assez précise de la personne que vous aurez en face de vous. Dans son cas, comme nous le savons, sa bouche et sa mâchoire avaient été gravement blessées sous les bottes des Japonais dans les camps de prisonniers de guerre, en d'autres mots il avait été frappé sauvagement, et j'ai toujours senti que ses cordes vocales aussi avaient été touchées par des coups reçus dans la région de la gorge, parce que sa voix manquait de la résonance et de la profondeur qu'elle avait certainement dû posséder à l'origine. Il parlait posément, ce qui devait être naturel pour lui, mais il avait une voix « ténue », qui ne collait pas du tout à sa personnalité. Quand il parlait à des personnes extérieures à la famille, ou qu'il réalisait des enregistrements, il faisait un effort conscient pour contrôler sa voix et pour lui donner l'intensité et la profondeur dont elle manquait, et pour quelqu'un à l'oreille exercée, ces efforts devaient s'entendre. Sa voix ne portait pas loin, elle paraissait comme forcée, et quelqu'un qui l'écoutait pouvait très bien se poser des questions. Sachant qu'il n'avait pas la capacité de s'exprimer comme il le faisait avant la torture, il s'efforçait de formater sa voix, mais ce faisant, il donnait au contraire le sentiment erroné d'essayer de faire impression.
Comme je l'ai dit, ce n'est que tout récemment que j'ai pris connaissance des absurdités qui circulaient à son propos. Par exemple il a été dit que Lobsang Rampa était égocentrique, dominateur, stupide et borné, qu'il avait mauvais caractère, et qu'il organisait des séances de spiritisme. J'ai du mal a reconnaître en lui cette personne, aussi examinons ces accusations et considérons-les à la lumière de ce que nous savons sur un homme plutôt connu pour sa gentillesse et son amour pour les autres. J'ai bien conscience d'avoir affirmé en plusieurs occasions que peu importait QUI était Lobsang Rampa, mais que ce qui comptait c'était son enseignement, et je maintiens cette position. En même temps, on m'a demandé d'écrire sur sa gentillesse, c'est pourquoi il est important de dresser un portrait exact, du moins aussi exact que possible, sur sa façon d'être dans la vie privée.
Egocentrique : le signe révélateur d'une personnalité égocentrique est l'utilisation fréquente des mots « je » et « moi » dans la conversation, et une apparente incapacité à comprendre que le monde entier n'est pas forcément intéressé par une conversation perpétuellement centrée sur ses propres exploits et autres prouesses, et à travers laquelle elle domine tout échange social, sans parler de la myopie avec laquelle elle regarde le monde, à travers une seule paire d'yeux, la sienne. Quelqu'un comme Lobsang Rampa, qui a consacré sa vie à enseigner aux autres et à s'intéresser aux autres ne peut pas décemment être accusé d'égocentrisme. Il parlait rarement de lui-même, et on avait même parfois l'impression que sa propre vie ne l'intéressait pas. Certes il a écrit des livres où il parlait de lui, mais s'il ne l'avait pas fait je crois que je n'aurais pas su grand chose sur sa jeunesse. C'était un homme du présent et du futur, pas du passé. Ce qui l'intéressait, c'étaient les autres et le bien-être universel. Les rares fois où il se remémorait quelque chose du passé, on était très attentif, c'était tellement rare que ça méritait qu'on écoute avec attention ! Une grande part de son succès est due au fait qu'il vivait dans le présent, et qu'il n'avait pas le goût des choses du passé, c'était comme s'il avait tiré un rideau sur le passé, qu'il ne lui servait plus à rien maintenant, c'était derrière. Le passé est ce qui nous a permis d'apprendre ce que nous savons maintenant. Et le présent est ce qui fabrique le lendemain. Vous pourriez rétorquer que ses livres parlent tous de son passé, et c'est entièrement vrai, mais il faisait bien la distinction entre ses livres et sa vie du moment. Il ne « vivait » pas ses livres, c'était juste son travail.
Il est vrai qu'il croyait beaucoup à l'estime de soi, à la conscience de soi, à la confiance en soi, et il constituait un bon exemple d'une personne possédant ces caractéristiques, car elles lui venaient de sa croyance que le premier devoir que nous avons, c'est envers nous-mêmes. Il avait la conviction que chacun de nous possède une bonne raison pour vivre, et qu'il est important de prendre soin de nous-mêmes physiquement, mentalement et spirituellement afin d'atteindre notre but. Si vous vous laissez aller à devenir par exemple toxicomane ou alcoolique, vous mettez en péril votre santé physique, mentale et spirituelle, ce qui vous empêchera d'avoir un bon travail dans ce monde, vous deviendrez quelqu'un qui aura une influence négative. Aussi est-il de votre devoir que de prendre soin de vous-mêmes. Mais est-ce de l'égocentrisme que d'avoir de l'estime de soi, une conscience de soi, et de la confiance en soi ? Je ne pense pas.
Dominateur : eh bien, certes c'était lui qui « menait la danse » à la maison, mais cela semblait aller de soi. Certains sont faits pour diriger et d'autres pour suivre. Faire partie de ceux qui suivent ne signifie pas nécessairement que l'on est faible, et être de ceux qui dirigent n'équivaut pas automatiquement à être dominateur, même si c'est vous l'élément dominant, vous qui prenez les décisions et tracez le chemin. Chen était à l'évidence l'élément dominant de la famille, tout tournait autour de lui et de son travail parce que nous savions que c'était ce qui comptait le plus, mais ce n'était pas quelqu'un de dominateur qui aurait régi nos vies à sa convenance en nous faisant faire ce qu'il voulait. Au contraire il se souciait constamment du bien-être des autres, que ce soit des membres de la famille, des amis ou des étrangers, et il lui arrivait souvent de réviser son point de vue en faveur des autres.
Stupide et borné : la plupart des enfants adressent cette critique à leurs parents un jour ou l'autre. Pour quelqu'un de la stature de Lobsang Rampa nous étions tous comme des enfants, et même souvent des enfants pas sages. Quand vous projetez délibérément de faire une chose que vous savez n'être pas bonne pour vous et si quelqu'un vient vous dire que vous ne devriez pas la faire, vous allez avoir tendance à considérer cette personne comme stupide et bornée. Et si vous estimez être un adulte plein d'expérience, même si vous ne l'êtes pas, et qu'on vient vous dire que ce ne serait pas une bonne idée de faire telle ou telle chose, vous allez vous fâcher, c'est une réaction naturelle, et parce que vous refusez d'admettre qu'après tout vous n'avez pas tant d'expérience que vous le pensiez, vous vous rebiffez en disant « quel idiot, celui-là » ou « qu'est-ce qu'il est têtu ! »
Mauvais caractère : c'est vrai qu'il avait le tempérament vif, et qu'il avait un réel pouvoir de dissuasion sur quiconque lui cherchait querelle, mais il savait rapidement maîtriser ses humeurs, sans garder de rancune au sens habituel du terme. Il lui arrivait parfois d'être impitoyable envers ceux qui l'importunaient vraiment, et dans ce cas il coupait court à toute relation avec cette personne, il l'effaçait complètement de la place qu'elle avait occupée auparavant. C'était une démarche salutaire car il n'avait dès lors plus à se tourmenter sur le tort qu'avait pu lui causer cette personne ni sur le mécontentement qu'elle avait pu susciter en lui. Il cessait tout simplement de penser à elle, comme si elle n'avait jamais existé. Il savait pardonner, mais quand on dépassait les bornes de ce qu'il estimait pouvoir pardonner, alors c'était fini, on était définitivement rayé de sa liste, pour le plus grand bien de tout le monde. C'était comme une forme de purification qui rendait impossible toute éclosion de rancune, poison nocif aussi bien pour le corps que pour l'âme.
En général quand on dit que quelqu'un a mauvais caractère, c'est souvent parce qu'il est susceptible et qu'on a du mal à s'entendre avec, du fait qu'il conserve en permanence un fond de mauvaise humeur. Chen était tout le contraire, c'était un modèle d'amabilité, quelqu'un de bonne composition doué d'un bon sens de l'humour. On l'entendait souvent rire tout bas quand il lisait quelque chose qui le surprenait, ou chanter pour ses chats. Il lui arrivait de plaisanter quand il parlait aux gens. Les étrangers ne savaient pas trop comment le prendre, ils se posaient des questions. Ils s'attendaient à rencontrer quelqu'un de pieux, d'érudit et de sérieux, et ils tombaient sur un être parfaitement humain et amusant ! Mais il était vraiment ainsi, et ces traits de caractères lui gagnaient la sympathie des quelques privilégiés qui avaient la chance de le rencontrer.
Les séances de spiritisme : jamais ! Il n'avait pas de temps à consacrer au spiritisme. Il n'a jamais organisé de quelconque réunion ni groupe de prière, jamais pratiqué la méditation collective. Il croyait profondément que l'on devait progresser individuellement et non en groupe. Il n'avait nul besoin de ces rassemblements si populaires en Amérique du Nord, et qui sont presque des sectes. En refusant catégoriquement de s'affiler à ces groupes, il s'attirait la colère de ceux qui le voyaient déjà comme leur figure emblématique, et se retrouvait en butte à leur hostilité en devenant la proie de critiques d'autant plus infondées qu'elles prenaient leur source dans l'ignorance. Mais comme toujours il maintenait son cap, ne déviant jamais de ce qu'il considérait comme juste.
* * * * * * * * * * * *
Peu après la sortie du Troisième Oeil, nous faisions nos valises pour la première de nos nombreuses étapes sur le chemin du déracinement. Nous louâmes un appartement dans Dublin, et ensuite une maison dans un charmant petit endroit de la côte irlandaise, non loin de Dublin, et qui s'appelait Howth. Ceux qui ont lu les livres du Dr Rampa savent déjà pas mal de choses sur notre vie d'alors et sur les amis qu'il se fit dans la population de ce petit village de pêcheurs.
Ben Edair était le nom de cette petite maison en pierre dominant la mer, et qui semblait presque accrochée à flanc de falaise ; elle était sans prétention, ni trop moche ni particulièrement jolie. L'entrée se trouvait à une des extrémités, et non au milieu comme dans la plupart des maisons, et on y pénétrait directement de la rue, il n'y avait pas d'allée, seulement quelques marches qui menaient directement de la chaussée à la porte d'entrée.
Une fois à l'intérieur vous réalisiez alors que vous étiez à l'étage supérieur, avec un hall d'entrée, ou plutôt un corridor, qui faisait toute la longueur de la maison. Il y avait deux pièces, ou bien trois, du côté du corridor qui donnait sur la rue, et une autre plus petite du côté de la mer, et dans laquelle était installé à demeure un télescope, et où étaient rangés les jumelles et le matériel photo. Plus loin il y avait une pièce plus spacieuse, qui était la pièce principale de la maison, avec une baie vitrée qui surplombait la mer, offrant à ses occupants une vue magnifique, un immense espace de ciel et d'eau, avec à l'horizon un gros rocher, presque une île, qui s'appelait Ireland's Eye (l'oeil de l'Irlande). Il n'était pas si loin que cela ce rocher car on pouvait facilement s'y rendre à la rame et accoster en une dizaine de minutes tout au plus, ce que nous ne manquions pas de faire souvent.
Cette pièce était tout naturellement celle de Chen. Son lit était placé à côté de la baie vitrée, ce qui pour lui était un endroit idéal. Le fait que la fenêtre ait été mal ajustée et que le vent s'engouffrât par les interstices durant les jours de tempête ne lui posait aucun problème. Il était solide comme un roc, et quand le temps tournait au froid ou à la tempête il se contentait de braver les éléments avec naturel, sans même se préoccuper de se vêtir plus chaudement. C'était comme si le froid n'avait pas de prise sur lui, comme s'il ne s'en rendait pas compte. Je le revois parfaitement, assis sur son lit en simple pyjama de coton en train de contempler le spectacle de la tempête et de se délecter des éclairs, tandis que le vent hurlait et que les vagues se fracassaient sur la plage de galet en contrebas ; pendant ce temps Ra'ab et moi restions, toutes grelottantes, emmitouflées dans nos pull de laines et nos pieds enveloppés de grosses chaussettes.
Sur ces rivages, les conditions climatiques variaient d'un extrême à l'autre, un jour nous avions un brouillard à couper au couteau, un autre des éclairs, la tempête, des vents très violents, et ensuite une mer d'huile sous un ciel serein. Le temps changeait constamment, il n'était jamais vraiment maussade. J'irais jusqu'à dire que Chen adorait cet endroit. Après sa vie trépidante dans une grande métropole, avec les hauts et les bas qu'il avait connus, il appréciait maintenant le contraste d'une existence plus proche de la nature et de ses forces, sans compromis, sans malentendu, où rien n'est factice ; c'était comme quitter l'obscurité pour la lumière, le calme après la tempête. À Howth, dans cette petite maison perchée au-dessus de la mer, il connaissait un sentiment de paix et d'harmonie qu'il ne retrouverait plus jamais au cours des années que j'ai partagées avec lui.
Tout au bout du couloir, un escalier menait à l'étage inférieur. À mi-chemin il faisait un virage dans lequel se trouvait une salle de bain, sans doute rajoutée après la construction de la maison. L'étage du bas comportait trois petites pièces qui constituaient un véritable rez-de-jardin puisqu'elles se trouvaient sous le niveau de la route, et étaient très humides. Ma chambre se trouvait là, en bas de l'escalier, à une extrémité de la maison, et il était indispensable de garder un feu dans la cheminée en hiver si on voulait dissiper l'humidité qui rampait le long des murs. J'adorais le feu, et j'adorais me mettre au lit en observant les lueurs et les formes qui dansaient au plafond avec le crépitement des flammes. C'était pour moi un raffinement qui me rappelait mon enfance et me réconfortait ; il me réchauffait à la fois le coeur et le corps.
À l'étage inférieur, face à la mer, il y avait une immense cuisine dallée avec une grande fenêtre donnant l'impression qu'on était dehors. Cette cuisine avait visiblement été conçue tout à la fois pour faire la cuisine et pour y manger car il y avait suffisamment de place pour une grande table de huit personnes confortablement installées. Les éléments de cuisine d'origine étaient encore en place, une grande cheminée et deux fours, un crochet suspendu au-dessus du foyer pour y mettre à mijoter un chaudron, mais il y avait aussi une horrible cuisinière à gaz plus moderne et plus pratique. Un vague sentier partait d'en bas de la fenêtre et conduisait à la plage de galets en contrebas où était amarré un petit canot.
La maison n'avait rien de remarquable en elle-même hormis sa situation exceptionnelle, et elle n'aurait probablement pas plu à grand monde. Pour nous, du moment que l'ameublement et la décoration nous convenaient, nous étions comblés dans la mesure où nous pouvions garder le mode de vie que les Rampa avaient adopté. Ce qu'ils possédaient était à la fois simple et pratique. C'était une période de stabilité financière qui ne changeait rien à leur façon de vivre si ce n'est que les soucis et la pauvreté avaient disparu de leur horizon, qu'il était désormais possible d'acheter le matériel nécessaire aux recherches de Chen, et qu'il pouvait apporter une aide matérielle à ceux qui, dans le besoin, croisaient d'aventure son chemin.
Sur la poignée de personnes avec qui nous nous sommes liés d'amitié, celui à qui je pense avec la plus grande affection est le policier du village, un Garda*. (* Garda : membre du corps des Gardiens de la Paix d'Irlande.)
Grand et solidement bâti, Pat avait une carrure avantageuse sur le reste de la communauté, qui le désignait parfaitement pour ce boulot. Il était de plus consciencieux à l'excès, et demeurait un peu en retrait des autres comme l'exigeait sa position. Il arborait sur le visage une expression sévère et dure qui convenait à sa fonction, mais au fond nous savions très bien, comme la plupart des gens, que c'était un masque qui cachait un coeur tendre, modeste et sincère. Il nous appelait régulièrement et passait souvent bavarder avec Chen. Il n'était pas bien difficile d'imaginer que tout en bavardant l'air de rien il faisait aussi son devoir en même temps, car en abordant ainsi un vaste éventail de sujets avec les gens, cela pouvait lui mettre la puce à l'oreille sur certains petits délits commis dans la région. Et quand ces deux là étaient ensemble, ils auraient été capables de déjouer les plans de n'importe quel malfaiteur potentiel, mais il ne se passait pas grand chose en matière de criminalité dans notre petit village ou dans le district environnant. En fait, la principale tâche de Pat consistait surtout à venir en aide aux personnes en difficulté, à arbitrer les querelles, ou à ramasser les ivrognes dans le caniveau pour les raccompagner chez eux avant qu'il ne leur arrive quoi que ce soit.
Dans sa jeunesse il avait combattu contre les Anglais, et il adorait nous raconter comment, avec une poignée de braves Irlandais, ils avaient tenu le bureau de poste de Dublin contre un ennemi d'une supériorité écrasante, l'ennemi étant bien sûr constitué par d'ignobles Anglais, même s'il ne le formulait jamais ainsi. Le fait que Ra'ab et moi-même faisions partie de l'ennemi ne lui avait visiblement jamais traversé l'esprit – les Irlandais en général sont foncièrement plein de tact, n'oublions pas qu'ils ont embrassé la Blarney Stone (la Pierre de l'Eloquence)* par milliers – mais il semblait sincère en ceci qu'il ne semblait pas conserver en lui la plus infime trace de rancune, et nos relations étaient totalement empreintes de courtoisie et d'amitié. Et aussi, comme la plupart des Irlandais, il appelait Chen « Lui », et Ra'ab « Elle ». Bien sûr, à ses yeux nous étions tous des païens, comme du reste pour tous les gens du village, et il est plus que probable qu'en bon catholique il allait chaque semaine derrière la grille du confessionnal confesser au prêtre que son plus grand péché était de nous fréquenter. Cela pouvait bien lui être pardonné car il devint le meilleur des amis, il fut l'objet d'une sollicitude et d'une attention exceptionnelles qui le sortait de sa ronde quotidienne, qui lui donnait plus d'éclat, et c'était ainsi que Lobsang Rampa rayonnait sur tous ceux qui gravitaient dans son orbite. (* Blarney Stone : bloc rocheux de dolérite inséré en haut des remparts du château de Blarney en Irlande (dans la région de Cork). Selon une ancienne légende très populaire, quiconque embrasse cette pierre se trouve gratifié du don de l'éloquence.)
Et puis il y avait Edgar. Edgar était pilote de bateau. C'était quelqu'un de sec, d'usé, et tout ridé, comme desséché par le vent et le soleil ; il faisait plus que son âge, et il avait l'habitude de remonter sans cesse son pantalon élimé qui empestait le poisson et le sel. Il avait un bateau avec son frère qui lui, n'avait pas le même panache ; en fait je ne me rappelle même pas son nom. L'été ils amenaient les gens en promenade dans leur bateau, et s'il y avait eu du monde en hiver je suis sûre qu'ils auraient continué leur activité toute l'année. C'était un simple canot de bois, capable d'embarquer tout au plus six à huit passagers assis, et équipé d'un moteur hors-bord qui démarrait d'habitude au quart de tour, mais il lui arrivait parfois d'avoir des ratés. Durant les mois d'été on le voyait quitter le port en pétaradant et naviguer à quelque distance de la côte avec à bord un ou deux touristes téméraires. En hiver les deux frères ne faisaient pas grand chose. On les voyait assis nonchalamment à côté de leur bateau à sec, en train de réparer des filets de pêche et de bavarder avec quiconque était prêt à les écouter. Il nous arrivait fréquemment de louer les services d'Edgar pour faire un tour en mer quelques heures, le plus longtemps qu'il pouvait, mais ce que nous lui payions n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la pauvreté. À en juger d'après les manières exagérées qu'il faisait en tripotant sa vieille casquette graisseuse à chaque fois qu'il nous arrivait de le croiser, je soupçonnais Chen de glisser de temps en temps quelques billets supplémentaires au fond de sa main calleuse, et il est vrai que cette main était celle d'un homme qui espérait un avenir meilleur car il était tout le temps dans le besoin.
Edgar était à la tête d'une horde d'enfants, mais l'aîné n'était visiblement pas de lui. Et du reste, sans être le moins du monde diffamatoire, je peux ajouter que le père de ce garçon était un frère catholique qui avait accordé à cette pauvre petite Mme Edgar sa « bénédiction » sous forme d'une progéniture. C'était alors considéré comme un honneur, et l'homme qui l'épousait pour en faire une honnête femme, suite à cette grossesse, recevait lui aussi la même bénédiction, du moins pouvait-on le supposer et surtout l'espérer ; c'était comme s'il rendait service au Seigneur. Pauvre Edgar, c'était la seule bénédiction qu'il recevrait jamais. Il était évident qu'il n'y avait à l'époque aucune féministe dans les environs de Howth, pas plus d'ailleurs que dans le milieu ouvrier de toute l'Irlande. Suite à ce mariage, la famille vécut dans une abominable pauvreté, et on imagine facilement l'horrible cauchemar que ce dut être de nourrir tout ce monde et de s'occuper de tous ces enfants qui arrivaient les uns à la suite des autres.
Un jour je dus me rendre chez Edgar. Les détails de cette visite importent peu, pas plus que les raisons, qui sont depuis longtemps sorties de ma tête, mais ce dont je me souviens avec une précision qui m'étonne encore et qui me terrifie, c'est l'état dans lequel ils vivaient. D'abord, leur pavillon n'était en fait qu'une simple cabane, et il y régnait une odeur pestilentielle et âcre de couches mouillées qui imprégnait tout ; il y avait des bébés et des enfants de tous les âges qui courraient de partout à moitié nus, au milieu de quelques poules décharnées qui grattaient comme elles pouvaient les immondices du dehors, le tout sous la surveillance d'un chat borgne au regard mauvais tapi au sommet d'un arbre mort.
L'aîné qui, par une ironie du sort, s'appelait aussi Edgar, se tenait à l'écart de tout cela, calme, le regard sérieux ; ses vêtements et son visage semblaient même plus propres que ceux des autres. Sa mère, le visage ridé comme une femme du double de son âge, avait les cheveux longs mal peignés, avec déjà des cheveux blancs ça et là. Quand elle me vit, cherchant comme elle pouvait à me faire plaisir, elle m'adressa un large sourire, pathétique, qui révéla une bouche à moitié édentée, tout en cherchant à masquer le fait qu'elle était véritablement à bout de forces. Je me sentis physiquement mal à l'aise de voir la vie de cette femme, abusée par une croyance en un Dieu qui, d'une façon ou d'une autre, la punissait de quelque pêché hypothétique à travers cette vie, et qui la maintenait dans un tel état de crainte qu'elle n'osait pas broncher. Je me rappelle très distinctement avoir quitté leur maison avec un poids sur l'estomac et une tristesse difficile à expliquer.
Chen arrivait un peu à les aider financièrement, mais il aurait fallu beaucoup plus de toutes façons. Il réussit à sauver le jeune Edgar de tout cela pendant quelques années en l'envoyant suivre sa scolarité à l'école des Frères Chrétiens, ce qui après tout n'était qu'un juste retour des choses. Tandis que je me sentais très frustrée face à cette foi aussi astreignante et si aliénante, Chen ne voyait pas les choses de la même façon. Il respectait leur foi, conscient que c'était une part essentielle de leur existence qu'il ne fallait ni remettre en question ni chercher à détruire. Il était triste de voir la souffrance mais pour lui c'était une composante de la condition humaine. Leur ôter leur croyance, toute cruelle qu'elle fût, toute absurde qu'elle parût de l'extérieur, les aurait détruit purement et simplement. On ne l'a jamais vu essayer de changer les croyances de base de qui que ce soit.
Hormis l'aide matérielle qu'il apportait à sa famille, il traitait Edgar le marin avec un respect qu'on n'avait probablement rarement, voire jamais dû lui témoigner de toute sa vie. Edgar était un travailleur sans éducation, pas spécialement trimeur, mais à cause surtout du manque de travail, et Chen lui parlait d'égal à égal, ils discutaient de bateaux et de mer, de navigation et de météo, des touristes, de tout ce qu'Edgar connaissait et qui avait un rapport avec lui. La vie en mer lui avait appris une foule de choses qu'il n'aurait jamais apprises sur les bancs de l'école. Les éléments étaient impitoyables mais c'étaient d'excellents professeurs, et avec Chen il avait la chance de pouvoir afficher son savoir. En peu de temps il sembla grandir en stature, il se tenait plus droit et avait le regard plus direct. Mais, comme cette femme qui habitait la porte en face des Rampa dans ce vieil immeuble de Londres, on ne pouvait, ou on ne devait pas non plus trop en faire pour rendre leur vie plus facile. Chacun d'entre eux avait choisi sa propre voie. Tout ce qu'on pouvait faire c'était leur témoigner de la reconnaissance et de la gentillesse, en espérant qu'un jour ils s'en souviendraient et ne se sentiraient pas trop seuls ni abandonnés par leur Dieu, ce Dieu en qui ils croyaient aveuglément quelle que soit la façon dont il les traitait.
Il y avait quelqu'un d'autre comme Edgar, c'était le chauffeur de taxi du coin, et lui aussi avait dû penser qu'il avait gagné le jackpot quand les Rampa se sont installés au village. Il était du genre flegmatique, solide, et peu causant. Si vous alliez chez lui, dans la rue principale, c'était toujours l'heure du repas, un repas qui s'étirait sur toute la journée et qui le laissait dans un état presque léthargique. Il n'avait jamais été du genre à demander grand chose ni à attendre quoi que ce soit de la vie, il prenait les choses comme elles venaient et était reconnaissant d'avoir une femme active qui maintenait la maison propre et rangée et qui s'occupait des comptes. Ce qui l'embêtait le plus en réalité, c'était le fait que son taxi – c'est à dire toute sa vie – était visiblement prêt à le lâcher pour terminer son existence avant lui ; et que se passerait-il ensuite ? En l'état des choses, il avait à peine de quoi maintenir sa vieille guimbarde en état de rouler, et il redoutait par-dessus tout de tomber en panne quelque part au beau milieu de la route. Il s'y connaissait un peu en mécanique, ce qui était normal vu son métier, mais ce n'était pas non plus un spécialiste, et pour lui il était hors de question d'imaginer quelque chose comme changer un moteur par exemple, et d'ailleurs c'était bien trop coûteux. Il se contentait de faire confiance au Seigneur et disait ses prières deux fois par jour, et même s'il n'était pas le plus assidu des paroissiens il avait confiance en l'efficacité de ses prières.
Nous avions souvent recours aux services du taxi, principalement pour nous rendre à Dublin, et aussi pour aller nous promener dans la campagne environnante ou sur la côte. Nous devions être ses meilleurs clients, car non seulement nous lui faisions faire beaucoup de kilomètres, mais nous lui laissions un généreux pourboire à la fin de chaque course.
Nous vivions à Howth depuis quelques temps lorsque nous décidâmes d'acheter une Heinkel, une de ces voiturettes à trois roues qui nous rendit service pour bien des choses, sans oublier pour autant notre chauffeur de taxi. On ne m'avait rien dit à la maison, mais je le vis un jour en ville au volant d'une auto flambant neuve, tout gonflé d'orgueil autant que de nourriture.
— Eh bien Ed, quelle belle voiture ! m'exclamai-je, tandis qu'il ralentissait à ma hauteur.
— Ah, vous pouvez l'dire mam'zelle. Le bon docteur lui-même en sait queq' chose.
En rentrant à la maison je parlai de la voiture, et je découvris qu'effectivement c'est Chen qui la lui avait offerte.
— Le pauvre, il était tellement terrorisé à l'idée de tomber en panne au milieu de nulle part, peut-être même avec une femme prête à accoucher sur le siège arrière ou que sais-je, qu'il fallait régler le problème.
C'était aussi simple que ça. Ce n'était qu'une voiture après tout. En soi, l'argent ne comptait pas beaucoup aux yeux de Chen, ce n'était qu'un moyen pour arriver à une fin, ce n'était que la brique de base dans ce monde soi-disant civilisé sans laquelle on ne pouvait rien faire. Du reste, il laissait à Ra'ab la gestion du budget car c'était une personne secrète et prudente par nature. Ce n'est pas qu'elle ne nous faisait pas confiance individuellement, mais elle avait du mal à faire confiance aux gens en général. À l'époque où nous vivions en Irlande nous avions dû gagner pas mal d'argent grâce au Troisième Oeil, et payer tout autant de taxes d'ailleurs, mais c'est un sujet que nous abordions rarement. Le livre était un succès, je le savais, mais à mes yeux ce n'est pas tant l'argent qu'il apportait qui comptait que le fait de voir une telle réussite après tant de dures batailles pour arriver à trouver de quoi vivre. Il était très généreux avec l'argent, il donnait toujours de trop gros pourboires, et il aidait les gens en difficulté, même plus tard lorsqu'il eut moins de moyens ; par exemple à l'époque il ne revenait jamais de Dublin sans des petits cadeaux, des petites choses pour faire plaisir, comme des boites de chocolat, des plantes, des livres.
Le revers de la médaille c'est qu'en revanche il n'aimait rien recevoir, de qui que ce soit, au point que cela devint une pomme de discorde entre nous. Pour moi c'était de l'indélicatesse, voire de l'impolitesse, et pourtant comment pouvais-je dire cela ? Il était la générosité personnifiée. Peut-être était-ce tout simplement parce qu'il se voyait comme quelqu'un de différent qui ne voulait avoir aucune attache matérielle, et qui ne souhaitait rien devoir du tout. Mais ce genre d'attitude n'était pas vraiment une bonne chose dans le sens où les gens ne le comprenaient pas, moi-même d'abord, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ressentaient le besoin d'exprimer leur estime, et qui ne pouvaient le faire autrement qu'en lui offrant des cadeaux en pensant faire plaisir. Quand ils essuyaient son refus, cela jetait un froid et ils pouvaient en éprouver du ressentiment. Il acceptait les dons d'argent car il s'en servait pour acheter du matériel nécessaire à ses recherches et des choses dont il avait besoin pour travailler, et il considérait son travail uniquement du point de vue du bénéfice que pourrait en retirer l'humanité, et en aucun cas comme un moyen de s'enrichir personnellement. Les dons d'argent étaient consacrés aux travaux qu'il menait. Mais en même temps, s'il pouvait récompenser le donateur en retour, il le faisait. On se demandait parfois s'il ne regrettait pas l'engagement qu'il avait pris, avec tout ce travail qu'il était obligé de faire, mais ce genre d'idées ne lui effleurait pas l'esprit. Par la suite, les persécutions qu'il subit de la part de ceux-là même à qui son travail pouvait profiter eurent l'air excessivement dures et déloyales.
Il acceptait volontiers de l'aide dans le travail au quotidien pour tout ce qui touchait aux choses qu'il aurait très bien pu faire lui-même, mais par délicatesse il les laissait faire par les autres. Quand on travaillait avec lui, c'était le plus charmant des guides, le plus attachant des compagnons de travail que l'on puisse imaginer. Il avait la capacité prodigieuse de vous faire sentir que vous étiez utile, capable, compétent, même si vous n'étiez pas aussi merveilleux que cela, et sûrement pas aussi bon ni aussi rapide que lui pour faire les choses. Il adorait expliquer comment procéder, toujours avec patience et humour, et je crois qu'il prenait VRAIMENT plaisir à faire sortir le meilleur d'une personne, même si elle semblait avoir peu de capacités. C'était comme un jardinier soignant son jardin, attentif aux besoins de chacun, et capable d'y répondre parce qu'il adorait voir la vie s'épanouir. Quand on vivait dans son orbite, on se sentait détendu et en harmonie, tout en travaillant activement et intensément, tandis qu'il anticipait déjà sur la suite et vous entraînait dans son sillage. Je n'imagine pas de position plus privilégiée que celle-ci, et quand je la compare avec les conditions de travail qui règnent dans le milieu des affaires, ou simplement dans le monde professionnel actuel, c'était véritablement le paradis.
Il ne se contentait pas d'être attentionné et généreux envers les défavorisés. La position sociale d'une personne ne comptait pas pour lui, et il arrivait souvent que plus la personne se trouvait à une position élevée, plus elle subissait d'épreuves, et moins il était possible de lui apporter une aide extérieure, de sorte que le riche et le puissant lui semblaient autant à plaindre que le pauvre dans certaines circonstances. Chen manifestait une irrévérence réconfortante vis-à-vis des règles et normes sociales. Il nous disait qu'il n'avait reçu aucune formation sur la façon correcte de se comporter, sur ce qui se faisait ou non, et bien que ce fût parfaitement vrai, il savait pertinemment ce que la société attendait de lui, même s'il trouvait cela superficiel et ridicule, au grand dam de son entourage. Il faisait ce qu'il estimait convenable et juste du point de vue de ses propres croyances, quelle que soit la personne qu'il avait en face de lui. Il se conduisait avec le bourgeois comme avec le paysan, avec le politique comme avec le clerc. Ils rencontraient tous des problèmes et des difficultés, même si ceux-ci variaient en fonction de la position de la personne, position qui du reste n'était à ses yeux que transitoire, et valable seulement pour la vie présente. S'il voyait un moyen d'aider la personne, ou si elle le lui demandait, il l'aidait. Il est évident, si on analyse un peu les choses, qu'il était totalement dénué de toute forme de snobisme, ce qui est plutôt inhabituel, même chez ceux qui professent une idéologie démocratique et clament publiquement leur absence de snobisme, ce qui finalement revient à en manifester sous une certaine forme, comme n'importe qui.
Avant de quitter Howth, je voudrais évoquer une autre personne dont je n'ai jamais encore jamais parlé. Elle aussi a eu l'occasion de bénéficier de la bonté de Chen, malgré une brusque interruption due à notre départ du pays pour aller de l'autre côté de l'océan.
Je prenais souvent le bus pour me rendre à Dublin. Je préférais le bus car il me laissait plus de temps pour tout ce que j'avais à faire en ville, à la différence du taxi que je devais faire attendre. Le bus me déposait au bout de Balscadden Road, à peine à cinq minutes de marche de Ben Edair, au bas de la colline puis juste au coin de la rue. Le bus passait fréquemment, il était à l'heure le plus souvent, et le trajet était en lui-même assez agréable, ne durant tout au plus qu'une demi-heure. C'était un bus à impériale, et j'avais pris l'habitude de m'asseoir à l'étage d'où la vue était meilleure et où il y avait plus de place.
C'est ainsi qu'à chaque fois que je décidais d'aller à Dublin ou que j'étais obligée de m'y rendre pour des courses – amener des pellicules à développer, aller chercher les tirages, acheter des livres ou des magazines introuvables à Howth – il y avait une femme qui, par quelque étrange coïncidence, prenait le même bus que moi et qui, poussée par une sorte de force invisible, venait systématiquement s'asseoir sur le siège juste devant le mien. C'était une coïncidence qui ne m'enchantait pas particulièrement car cette femme dégageait une odeur corporelle caractéristique qui se diffusait vers l'arrière, portée par l'air marin entrant par les vitres ouvertes, et qui assaillait inlassablement mes pauvres narines. Je ne suis pas spécialement incommodée par l'odeur d'une cour de ferme, d'un chien mouillé ou du fumier, mais je trouve l'odeur d'un corps humain négligé épouvantablement abjecte et nauséabonde. Mais il y avait pire, son cou dégoûtant, avec de la crasse noire incrustée dans les plis, et qui ne devait pas avoir vu de savon depuis des années. Je trouvais cela abominablement fascinant, presque incroyable, de voir quelqu'un laisser son cou devenir aussi sale ; j'avais les yeux rivés sur ce spectacle insolite comme sur la lumière d'un phare.
Vous allez me demander pourquoi je ne changeais pas de siège. La réponse est simple. C'était visiblement quelqu'un qui avait connu des jours meilleurs, et mon plus gros handicap était que, contrairement à Chen, j'avais reçu une éducation mondaine qui me dictait ce qui se faisait ou pas. Alors je restais là. Elle portait des vêtements qui avaient dû être splendides, et elle arborait un ou deux chapeaux, des gants et un sac à main. En hiver elle portait un ensemble en tweed de chez Harris, fané et élimé, mais qui avait dû être autrefois du bon tweed solide et pratique. L'été elle portait des imprimés Liberty, démodés depuis des années, déchirés par endroits, les ourlets pendants là où ils n'avaient pas le droit de pendre, mais des Liberty quand même, avec leurs magnifiques couleurs et leurs motifs originaux. Si j'avais changé de siège, elle l'aurait remarqué et en aurait été offensée. Il fallait faire avec son odeur repoussante, son cou répugnant, et ne pas offenser une dame réduite à l'indigence ; après tout, le ciel m'en préserve, mais ce pourrait être moi un jour, on ne sait pas. Il était possible que ce soit aussi une ancienne domestique qui avait récupéré les vieux habits de sa maîtresse, mais je rejetai cette possibilité dès qu'elle traversa mon esprit. Elle avait une curieuse façon de marcher, presque maladroite, en lançant ses pieds vers l'intérieur, avec de longues enjambées, ce qui était typique d'une éducation poussée, et avec ça elle avait malgré tout une certaine prestance et une allure altière qui la distinguait des autres. Non, il n'y avait aucun doute, elle avait des origines aristocratiques, mais quelque chose avait dû mal tourner.
Tandis que je restais assise là, mal à l'aise, impatiente de voir le bus arriver à Dublin, je me demandais souvent d'où elle venait, où elle vivait dans le village, quelle était son histoire. Je résolus de demander à quelqu'un, mais dès que je commençais à préparer mentalement mes questions – « Savez-vous où habite la dame qui sent mauvais ? » – je me rendais compte que c'était impossible. Ça ne se faisait pas, tout simplement. Je n'avais qu'à réprimer ma curiosité, c'est tout.
Puis la chance fut de mon côté un jour où, sur le chemin de retour, elle était déjà assise dans le bus. Je m'assis à plusieurs rangées de sièges devant elle et le trajet se passa sans mauvaises odeurs et tranquillement. En arrivant au terminus à côté du petit kiosque, je restai à ma place et la laissai passer devant et descendre avant moi. J'étais déterminée à la suivre jusque chez elle.
Juste à côté de l'arrêt de bus il y avait là des bâtiments, et à mon grand étonnement elle disparut de ma vue, comme un fantôme passe-muraille. Il devait y avoir une entrée cachée, évidemment, mais le temps que j'atteigne l'endroit où je l'avais perdue de vue, elle n'était plus là. Le mystère maintenant c'était de savoir qu'elle habitait quelque part là-dedans, dans cet endroit qui ressemblait à des cages à lapin que j'avais toujours imaginé abriter des pêcheurs et des putains. Mais ma filature avait échoué, elle m'avait semé. Ah, mais je ne baissai pas les bras pour autant !
Le médecin du village avait l'habitude de passer régulièrement à la maison pour surveiller l'état de santé de Chen, et un jour qu'il venait faire sa visite, il se trouve que j'étais dans la chambre de Chen en train d'enregistrer ses instructions pour répondre au courrier. Il examina son patient, bavarda un peu avec lui, puis je le raccompagnai à sa voiture.
— Au fait Docteur B., il y a une dame à Howth qui m'intrigue. Je me demande si vous la connaissez.
Je lui fis alors la description de la dame en question, en omettant discrètement de parler de son odeur.
— Oh, vous parlez de Mademoiselle E. je suppose. Est-ce bien celle qui, disons, n'est pas très propre ?
J'opinais de la tête et il poursuivit.
— C'est bien triste, elle est un peu, voyons, pas tout à fait nette, pas méchante, mais vous savez, ça ne tourne pas bien rond. Elle est pleine aux as paraît-il. Elle a choisi de vivre comme ça, elle s'entend pas avec sa famille, quelque chose comme ça. Elle porte un titre, du genre Honorable*, je suis pas très sûr, son père a des terres, un grand domaine. Vous savez ce que c'est… (* Honorable : terme utilisé au Parlement Britannique pour s'adresser à un député)
Il s'installa dans sa voiture et baissa la vitre.
— Bon, je repasserai dans quelques semaines. Le bon docteur semble aller plutôt bien, oui, plutôt bien. Bonne journée chère madame.
Et il s'éloigna. Pas très fructueux comme renseignements, mais au moins je connaissais son nom et je savais que je ne m'étais pas trompée dans mes suppositions sur sa naissance.
Ce dut être quelques semaines plus tard que je me retrouvais avec Chen en train de faire des photos dans le port. C'était par une de ces journées vivifiantes de grand vent, où vous devez cramponner tout ce que tenez en main, où vous avez les cheveux qui vous fouettent le visage, et où l'air salé dépose sa saveur sur vos lèvres. Nous étions au beau milieu de la matinée si je me rappelle bien, et les bateaux de pêche avaient tous quitté la sécurité du port pour leur activité en pleine mer, en quête de bonnes prises. Avec ce genre de temps, tous ceux qui n'étaient pas pêcheurs restaient à l'intérieur, sur les arrières, et pour eux le vent et les vagues ne représentaient rien de bien attrayant. C'était une journée à rester dedans, l'endroit était désert.
C'était moi le « mulet » dans ce genre d'excursions, je devais porter les appareils photos et les garder au sec, tout en prenant soin des différents objectifs. Il y avait trop de vent pour sortir le trépied, il aurait tangué et il fallait renoncer à son usage ; mieux valait se contenter d'une prise en main bien ferme et d'une courte exposition. Chen avait le posemètre autour du cou et s'y référait constamment.
Nous nous tenions à mi-chemin de l'extrémité du mur du port, quand mon attention fut attirée par une silhouette qui arrivait du village. J'étais en train de regarder Chen et je ne pouvais la voir que du coin de l'oeil, mais à la seconde où le cliché fut fait je tournai la tête pour regarder. Et oui, c'était bien elle, Mademoiselle E., qui avançait, comme un personnage digne d'un roman de Jane Austen*, enveloppée dans une grande cape ondoyante qui claquait au vent. Elle avait la capuche rabattue sur la tête, l'étreignant fermement au niveau du cou, mais il n'y avait aucun doute, c'était bien elle, avec sa démarche caractéristique. Que diable pouvait-elle bien faire ici à marcher le long du mur du port, comme si elle était déterminée à se rendre quelque part ; mais il n'y avait nulle part où aller, à part dans la mer. (*Jane Austen : écrivain romantique anglaise de la fin du XVIIIe, début du XIXe s., auteur notamment de Raison et sentiment, et Orgueil et préjugés)
— Regarde, Chen, il y a cette femme dont je t'ai parlé, celle qui prend tout le temps le bus de Dublin. Où donc peut-elle bien aller par ce temps en longeant le mur du port ?
J'étais plus que curieuse et je me mis à avoir peur. Et si elle se jetait à l'eau ? Il se tourna lentement d'une manière désinvolte.
— Eh bien, on en a deux pour le prix d'une, dit-il en se retournant vers moi. Ce doit être une schizophrène, elle a pas l'air bien alignée dans son corps, et en ce moment elle en est même complètement sortie, elle est littéralement à côté de ses pompes, au sens littéral du terme.
— Que veux-tu dire ?
— Bouton d'Or, ramène le matériel photo à la maison. Elle ne va pas bien. Je vais voir si je peux lui parler. Dépêche-toi maintenant, je te verrai à la maison tout à l'heure.
Quelque peu déçue, je fis ce qu'il me dit, et rentrai ranger le matériel photo à la maison, le laissant tenter une approche avec Mademoiselle E. En remontant la colline je pensais à elle. Schizophrène avait-il dit. Tout récemment nous avions reçu une lettre d'une maman dont le fils était atteint de cette maladie. Les médecins ne pouvaient pas faire grand chose pour cet enfant, ils ne comprenaient pas bien cette maladie. On aurait pu leur dire que c'était dû à un problème d'ajustement du corps astral qui n'arrivait pas à s'aligner sur le corps physique, rendant complètement inintelligibles les messages que le Sur-moi envoyait par la Corde d'Argent, mais ils ne pouvaient pas croire en l'existence du corps astral, ni de la Corde d'Argent, et encore moins du Sur-moi. Du point de vue d'un voyant cependant, c'était tellement simple, tellement évident, il voyait tout si clairement, alors que pour un non clairvoyant à l'esprit étroit c'était tout simplement inacceptable. En réfléchissant à tout cela je m'émerveillais de voir à quel point nous pouvions nous considérer comme tellement intelligents, civilisés, et avancés alors que nous étions en réalité dans l'aveuglement, incapables même de considérer ce qui pouvait exister au-delà des limites de notre monde en trois dimensions.
Le résultat de la rencontre avec Mademoiselle E. c'est que Chen réussit à établir un contact avec elle et à apporter quelque amélioration à son état, mais tout fut interrompu par la mauvaise publicité et la persécution de la presse, par ses problèmes cardiaques aussi, et par la nécessité de quitter l'Irlande pour le Canada. Les bonnes graines portent toujours leurs fruits, mais les mauvaises aussi. À cause de la jalousie et de la malveillance qui se sont exercées à l'encontre de Chen, il est peu probable que cette pauvre femme réussît à guérir complètement.
Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, mais au moins elle a pu connaître l'aperçu d'une amélioration, voir qu'il y avait une raison à son existence, un but à sa vie, au cours des quelques rencontres qu'elle avait pu avoir avec lui. Sachant qu'il avait la capacité de voir ce qui n'allait pas chez elle, et sachant que peu d'autres en dehors de lui pouvaient voir ce qu'il voyait, Chen avait senti qu'il était de sa responsabilité de faire ce qu'il pouvait. Cela faisait partie de son élégance.
* * * * * * * * * * * *
C'est ainsi que nous arrivâmes au Canada. Les deux mots « Immigrant entrant » estampillés sur nos passeports représentaient pour moi un stigmate que ma fierté aurait du mal à avaler, ce qui ne fut pas le cas pour Chen ni pour Ra'ab ; ils n'eurent pas l'air de souffrir d'un quelconque complexe, ni d'avoir été traumatisés par leur entrée dans une vie nouvelle et complètement différente, et j'eus même l'impression qu'ils l'attendaient impatiemment comme un mieux pour eux. Les îles britanniques n'avaient pas été tendres pour eux, même pour Ra'ab qui était pourtant anglaise de souche. Notre vie quotidienne au Canada reprit comme avant. Nous consacrions beaucoup de temps à répondre au courrier, c'était devenue une routine quotidienne comme d'aller au travail tous les matins, du reste c'est précisément ce que c'était. Nous ouvrions une boîte postale à chaque fois que nous nous installions dans une nouvelle ville, et tous les jours j'allais chercher le courrier, jusqu'à deux fois par jour. Nos lecteurs étaient inconstants, se laissant influencer par l'opinion publique et la presse, et ce travail ne nous rapportait rien, et certainement pas d'argent. Le courrier était tantôt dense, tantôt plus clairsemé, mais comme les écrivains aussi ont besoin de vacances, la deuxième situation n'était pas une si mauvaise chose, même si elle reflétait une baisse des ventes, et la vente de livres était notre gagne-pain.
Chen mettait un point d'honneur à s'occuper du courrier avec le plus grand soin. C'était toujours le même rituel, il était allongé sur son lit tandis que je résorbais peu à peu la montagne de courrier empilée devant lui. Il se mettait bien d'aplomb, son solide plateau de bois servant de bureau posé sur les genoux, bien à portée de main, et il sortait son coupe-papier. J'approchais une chaise, Ra'ab en approchait une autre, et dès que j'avais trouvé un stylo et un bloc-note, nous étions fin prêts. Il avait l'habitude de regarder à travers la pile de courrier pour sélectionner en premier les lettres en rapport avec ses affaires, comme celles de son agent, de son éditeur ou du comptable, qu'il traitait en priorité. Le plus souvent il dictait une réponse complète. Si elle était longue, il se servait du dictaphone, un Sony de préférence, et si elle était plus courte, je la prenais en sténo, avec mon style tout personnel, indéchiffrable par quelqu'un d'autre que moi, non pas pour conserver le secret mais parce que je n'avais jamais appris la sténo conventionnelle.
Après le courrier officiel, nous nous autorisions une petite pause avec du thé et des biscuits, parfois du chocolat, que Chen affectionnait spécialement. Puis c'était au tour du courrier des admirateurs. Avec son sens de l'organisation, il commençait par décacheter méthodiquement toutes les enveloppes à l'aide de son coupe-papier avant d'en sortir les lettres et de les empiler dans l'ordre dans lequel il sentait devoir les lire. Tous les timbres qui lui paraissaient dignes d'intérêt pour les collectionneurs étaient soigneusement rangés dans une enveloppe à part pour le jour où l'un d'eux se manifesterait ou pour ceux qu'il connaissait déjà. Les lettres de ceux qui lui avaient déjà écrit étaient placées en haut de la pile et il les lisait en général avec beaucoup d'intérêt. Il avait pris du temps à répondre à leurs premières demandes, et en voyant ainsi une deuxième puis une troisième lettre, il avait l'impression de lire des nouvelles d'une connaissance.
J'ai un ami qui s'était beaucoup offusqué du message que Chen avait fait passer dans ses livres, dès les premières rééditions du Troisième Oeil me semble-t-il, à savoir qu'il rappelait à ses lecteurs que les réponses au courrier avaient aussi un coût pour lui. Il est vrai que les frais postaux représentaient un budget non négligeable, surtout lorsqu'ils enflaient, et à l'époque où nous avions du mal à joindre les deux bouts, répondre au courrier des lecteurs devint problématique, mais jamais insurmontable au point d'y renoncer quand la personne était sincère ou qu'elle avait vraiment des problèmes, et même si elle ne joignait pas de timbre-réponse, Chen lui répondait du mieux qu'il pouvait.
Il serait faux de prétendre qu'il répondait à toutes les lettres. Mais il s'arrangeait toujours pour répondre à un bon pourcentage d'entre elles, et toujours à ceux qui en avaient réellement besoin. Ses réponses étaient toujours réfléchies et personnalisées. Il s'inquiétait beaucoup de trouver les adresses, les noms et les endroits que les gens lui demandaient. Les questions métaphysiques ou occultes ne présentaient aucune difficulté pour lui, il n'avait jamais besoin de consulter de dictionnaire ou d'ouvrage de référence, il avait tout dans la tête et il donnait le plus souvent une réponse complète, ce qu'il faisait aussi pour les questions médicales. Beaucoup de ceux qui lui écrivaient avaient des problèmes compliqués, et il traitait toujours leurs lettres avec considération et dans le respect de leur vie privée. Après avoir répondu au courrier, toutes les lettres étaient mises au broyeur pour ne laisser aucune trace indiscrète. Nous ne gardions jamais copie des réponses, sauf bien sûr dans le cas des lettres officielles.
Nous passions une grande partie de la matinée à lire le courrier et à y répondre. Dans certains cas il se contentait de me donner les grandes lignes de la réponse à faire et je m'occupais de rédiger la lettre. Avec le temps et sa santé déclinante, cela devint de plus en plus fréquent et, du fait que je le connaissais parfaitement bien, lui et son style, c'était comme si c'était lui qui écrivait. Naturellement il vérifiait toujours derrière moi. Une fois les lettres tapées, Ra'ab en corrigeait les fautes et les faisait passer à Chen qui les signait après les avoir parcourues brièvement pour vérifier que tout était en ordre.
Il lui arrivait parfois de capter une sensation particulière dans une lettre, soit en la touchant soit en ressentant une simple vibration à distance. Je me souviens particulièrement d'une de ces lettres, elle avait été envoyée par une dame de Brighton. Elle gagnait sa vie en donnant des cours de piano. Je ne me rappelle plus pour quelle raison elle lui écrivait, mais dans la réponse il lui disait ressentir qu'elle possédait certains talents artistiques, et qu'en tenant sa lettre dans la main il voyait clairement qu'elle réussirait dans cette voie. Il n'avait pas parlé de peinture dans sa lettre, et on peut imaginer la surprise de cette dame en lisant qu'elle devrait devenir artiste, car c'est quelque chose qui ne lui avait peut-être jamais traversé l'esprit. Néanmoins elle suivit ses conseils et se lança dans la peinture à l'huile. En l'espace de vraiment très peu de temps elle devint une artiste pleine de talent, exposant même à Burlington House*, et l'une de ses toiles fut acquise pour la Reine, devenant ainsi une pièce de la collection royale. (*Burlington House : ancien hôtel particulier du XVIIe s. au centre de Londres, reconverti en maison des arts et des sciences, regroupant l'Académie Royale (d'art) et plusieurs sociétés savantes)
Il y avait aussi une autre méthode de communication avec les lecteurs, c'était les cassettes audio. Dans le Londres des années 1950, il se servait au début d'un modèle de magnétophone à bande que bien peu de personnes ont dû connaître. Le pire, je me rappelle, c'est quand de temps en temps la bande s'emmêlait complètement, et j'ai devant moi une photo montrant un chat jouant avec une bande en essayant de la démêler, et je suis sûre que cette scène s'est vraiment produite avec ces bandes. Mais bientôt les premières cassettes sortirent et il ne tarda pas à essayer différents modèles. Je crois que les premières cassettes qu'il envoya aux gens étaient rondes, avec une bobine qui se dévidait dans un sens puis dans l'autre, puis il y eut les cassettes plus grandes de forme rectangulaire, et enfin les petites.
Il s'intéressait énormément à l'électronique, et je crois qu'il adorait envoyer et recevoir des messages enregistrés car cela lui donnait une bonne raison d'utiliser ces appareils. Il parlait lentement et distinctement, sans jamais se servir de notes, et faisait souvent preuve d'humour, et j'imagine que ses enregistrements devaient faire très plaisir à ses lecteurs. À l'occasion Ra'ab se joignait à lui, parfois même aussi les chats siamois avec leur voix inimitable, cette voix si particulière que l'on aime ou que l'on déteste, tout comme la musique orientale.
Nous avons vécu dans des dizaines d'endroits au Canada. On ne s'autorisait pas à accumuler de biens matériels car ils auraient entraîné des frais supplémentaires lors du déménagement suivant. Nos déménagements pouvaient se produire au sein de la même ville, parfois juste un peu plus loin, mais c'était toujours pareil quand il fallait tout emballer et tout déballer de nouveau. Je ne sais pas si c'était sa nature de tout le temps changer ainsi d'endroit, ou si c'est parce que les circonstances l'exigeaient, mais il avait l'air de toujours devoir se dépêcher de finir ce qu'il avait à faire, comme si le temps lui était compté. Par contraste avec son esprit toujours en éveil et sa vitesse d'exécution dans tout ce qu'il entreprenait, il possédait une étonnante paix intérieure. Tous ces déménagements auraient mis à mal l'équilibre nerveux de n'importe qui ne possédant pas son calme, sa paix intérieure et son détachement des valeurs matérielles. Ainsi donc cette façon de vivre passait pour parfaitement naturelle.
Durant toute cette époque, nous côtoyâmes des personnes aussi variées que nos déménagements, et là mes souvenirs sont un peu confus et je n'arrive pas à sélectionner plus spécialement une personne d'une autre dans le tas, une qui aurait plus bénéficié qu'une autre de ses cadeaux ou de sa bonté. Mais je peux dire sans risque de me tromper qu'il a laissé une profonde et durable impression partout où il est passé, et pas forcément toujours une bonne. Il y avait ceux qui étaient comme les chiens quand ils reniflent une odeur étrangère et qui dressent le poil, car il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas qui leur procure une sensation bizarre et qui leur fait peur. Pour simplifier, je dirais que ce groupe manquait de conscience spirituelle, il avait des valeurs purement matérialistes, et restait très attaché aux traditions et aux croyances religieuses issues de fausses religions. Mais la majorité des gens reconnaissait en lui un grand homme, qui savait les écouter et trouver plaisir à leur contact, même très bref. Même s'il était difficile d'établir des liens d'amitié solides et durables, sa sincérité était réelle, mais il était comme le navire qui passe dans la nuit, aujourd'hui ici, demain ailleurs.
Il y a quand même une personne que je revois très distinctement dans mon esprit, exactement comme elle était, en train de circuler dans sa chaise roulante électrique et de rendre la vie infernale à tous ceux qui avaient le malheur de la croiser. Jusqu'à ce quelle rencontre Chen. C'était une langue de vipère doublée d'une véritable peste. Il n'y a pas que son corps qui était biscornu, mais son âme avait l'air aussi usée.
C'est en Alberta que nous fîmes sa rencontre. Nous vivions à l'époque dans un immeuble neuf proche du centre ville au dernier étage, ou presque, et nous avions loué deux petits appartements contigus que les gérants avaient aimablement réunis en un seul pour nous être agréable. Ils étaient très doués pour arranger les gens. Il était difficile d'avoir des locataires. L'industrie pétrolière n'avait pas encore quitté cette partie du pays, et aucune personne saine d'esprit n'avait envie de vivre ici. Alors ils étaient contents de nous avoir, même avec des chats, ce qui n'était pas le cas dans toutes les villes canadiennes. Les animaux domestiques étaient bannis des locations, et le sont toujours du reste, et ce fut une des raisons qui nous poussa à quitter Vancouver.
Au rez-de-chaussée, en-dessous des appartements, il y avait des boutiques, et je dois avouer qu'il était pratique de n'avoir qu'à descendre l'escalier quand il faisait soit trop froid soit trop chaud dehors pour faire du shopping, et c'était le cas la plupart du temps. Dans ce rez-de-chaussée qui pouvait passer pour un centre commercial, il y avait un Safeway* et une pharmacie, avec aussi un certain nombre de bureaux, mais avec deux magasins on arrivait à trouver le minimum nécessaire pour vivre. Si on avait besoin de livres, de papeterie, de matériel électronique ou photographique, il fallait se rendre plus loin, mais en général la pharmacie, ou drugstore comme ils appellent cela en Amérique du Nord, était suffisamment achalandée en magazines et offrait quelques livres corrects. L'arrivage des nouveaux magazines avait lieu le Mardi, et tous les Mardis j'étais envoyée en bas pour voir ce qui était arrivé. Bien que la plupart des revues que lisait Chen étaient des mensuels, comme Popular Science, Mechanics Illustrated, Photography, des magasines sur les voitures ou sur l'électronique, les télescopes, l'actualité générale, etc., ils ne sortaient pas tous au même moment, de sorte qu'il n'était jamais sans lecture. Si je me trompais, il était facile de redescendre pour faire l'échange, le pharmacien étant quelqu'un de sympathique bien que légèrement insipide, mais qui cherchait toujours à faire plaisir à un bon client pour le conserver. (* Safeway : grande chaîne de supermarchés en Amérique du Nord)
Le jour mémorable où je fis ma première rencontre avec Mary, il pleuvait et il ne faisait pas très chaud non plus. Ce fut réellement une journée déplorable, ce qui déjà était assez inhabituel dans cette partie du Canada, plutôt connue pour son ciel bleu clair, même par temps froid quand le thermomètre descendait de plusieurs degrés sous le zéro, et la tristesse de cette journée semblait parfaitement convenir pour cette rencontre. Ce devait être un Mardi car c'était le jour de l'arrivage des livres. Je pris l'ascenseur jusqu'au hall, et courut au coin de la rue avec mon parapluie en main malgré le auvent qui courait tout autour du bâtiment, et comme c'était Mardi je savais qu'il y aurait de nouvelles revues si je n'arrivais pas trop tôt.
En jetant un coup d'oeil à ma montre je réalisai qu'il était vraiment trop tôt, et Mike Greene, le pharmacien, devait être en train de déjeuner, avec le gros carton de magazines encore fermé dans son bureau et attendant qu'il retire les emballages pour que son employée range le tout sur les étagères. Celle-ci n'était pas très maligne, mais elle savait trouver tout ce dont les gens avaient besoin, du tube de dentifrice aux préservatifs, en passant par l'aspirine, tandis que Mike avalait ses deux pots de yaourt aux fraises, sa pomme et sa banane, ce qui constituait invariablement son repas. Elle s'appelait Molly et adorait les cancans, surtout à l'heure où Mike mettait sur le comptoir la boîte en carton munie d'une fente avec, posée dessus, la pancarte « Pause repas, veuillez déposer vos ordonnances dans la boîte ». Elle avait l'air de croire qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans sa boutique pendant qu'il prenait son repas, mais il entendait tout, en soupirant à chaque fois qu'elle disait quelque chose, à condition qu'il ne soit pas trop absorbé par sa lecture du Globe & Mail*. (*Globe & Mail : grand quotidien Canadien de langue anglaise)
Je poussai la porte et pénétrai à l'intérieur, et je trouvai un sol encore humide, souillé par des traces de pneu et de boue. À cette époque, il n'y avait guère d'utilisateurs de chaises roulantes en ville à part Chen, car il n'y avait pas beaucoup d'aménagements pour faciliter leurs déplacements, il n'y avait pas de rampe, et on les traitait comme des parias. Les bien-portants soit les dévisageaient soit détournaient le regard en les voyant, gênés ; ce n'était pas comme aujourd'hui où ils sont normalement acceptés et où ils ne sont plus confinés chez eux ou sur leur balcon comme avant. C'est pourquoi la présence d'une personne en fauteuil roulant dans le drugstore était un évènement suffisamment rare pour être remarqué.
Je fis le tour des rayons pour voir si quelque chose était rentré depuis la semaine dernière, et de l'autre côté du rayon principal j'entendis une espèce de voix grêle et haut perchée en train de s'emporter contre Molly d'une façon qui me parut vraiment exagérée.
— Non, non, vous ne pouvez donc jamais faire les choses comme il faut, petite idiote ? Je veux CE savon, je prends toujours CE savon, si vous aviez un peu de cervelle vous le sauriez !
Et pour accentuer chaque mot on entendait taper, comme si on frappait le sol avec un bâton, d'agacement. Je me glissai au bout du rayon pour voir ce qui se passait. Et là je vis une petite bonne femme ratatinée, les jambes gonflées pointant devant elle car trop petites pour atteindre le repose-pieds, les cheveux gris frisés en une permanente toute flétrie lui couvrant à peine le crâne, des mains violacées aux doigts difformes, l'une crispée sur la manette du fauteuil roulant, l'autre tenant une canne, visiblement celle qui faisait ce tapage.
— Après tout ce temps, tout le monde aurait cru que vous seriez au courant. Et d'ailleurs où est Mike ?
Elle fit soigneusement le tour des rayons avec son fauteuil et avançait dans ma direction, visiblement à la recherche de Mike, qui devait sûrement trembler au fond de sa remise en se demandant s'il pouvait sortir sans qu'elle le voie ou si elle reniflerait sa présence.
Entre-temps cet incident regrettable avait pris fin, Mike ayant finalement réapparut pour la calmer, et le temps qu'elle demande à ce que son savon soit mis sur sa note, n'ayant pas d'argent sur elle, j'étais déjà arrivée à la porte, car il était clair que les nouveaux magazines n'avaient pas encore été mis en rayons, et qu'il fallait que je repasse plus tard. J'étais sur le point de sortir quand je vis le fauteuil roulant arriver sur moi à une vitesse incroyable. Je saisis brutalement la poignée de la porte pour en écarter vivement le battant et la laisser passer avant qu'elle ne me fonce dedans, lorsque soudain, à ma plus grande stupéfaction, elle tira à fond sur le frein, et ce fut à mon tour d'être prise à parti.
— Merci bien mais je n'ai besoin de personne pour m'ouvrir la porte, et surtout pas de gens comme vous. Non mais, vous vous rendez compte ! Ôtez-vous de mon chemin, allons !
Et heureusement, après ce dernier coup d'éclat, elle disparut en un tour de roue.
— Mon Dieu, Molly, mais qui était-ce donc ? demandai-je à moitié choquée.
Cette handicapée, quelle qu'elle soit, avait un ego surdéveloppé, et pas des plus agréables.
— Oh, c'est Mary. C'est un démon mal déguisé. C'est elle qui tient l'atelier d'artisanat pour handicapés derrière la place. J'parie qu'ils sont tous morts de trouille à cause d'elle. Y'a rien d'agréable chez elle. Y sont tous pareils, elle a pas une bonne santé vous croyez pas ? Faut pas être trop dur avec elle.
— Molly, vous êtes trop gentille. Quel que soit son état, ça n'excuse pas sa méchanceté.
Je rentrai à la maison, dégrisée et pensive.
À cette époque Chen se servait déjà d'un fauteuil roulant pour la plupart de nos sorties, ce qui, à cause du mauvais temps n'arrivait pas tous les jours. Mais dès que nous eûmes l'occasion de faire une sortie je suggérai qu'on aille jeter un coup oeil sur cet endroit pour handicapés.
— C'est quelque part, « derrière », ils font de l'artisanat, expliquai-je.
J'étais curieuse de revoir cette petite femme teigneuse, mais sur son terrain. Cette fois j'étais plus rassurée, si nous la rencontrions, je serais totalement insignifiante à côté de Chen. Et c'est précisément ce qui se produisit.
Nous trouvâmes l'endroit sans difficulté. Comme Molly l'avait dit, c'était à l'arrière d'un bâtiment et tout à fait discret à en juger par le genre de fenêtres qu'ils avaient, celles qui permettent de voir depuis l'intérieur mais pas dedans. La porte d'entrée était très large, certainement pour faciliter l'accès des fauteuils roulants, et elle était peinte en vert foncé avec une enseigne noire portant la simple mention « Atelier ».
— Ce doit être ici. Voyons s'il y a quelqu'un. Chen n'était pas réputé être timide, mais ce n'était pas non plus quelqu'un d'envahissant. Il me demanda de frapper à la porte.
— Non, plus fort Bouton d'Or, ils n'entendront jamais ce genre de petit toc-toc poli.
Sur ses instructions, je frappai donc plus fort, mais nous dûmes encore attendre, bien qu'à l'évidence il régnait une certaine activité à l'intérieur. Finalement la porte s'ouvrit tout doucement, ou plutôt s'entrebâilla, et une femme appuyée sur une béquille nous dévisagea avec insistance.
— Oui ? demanda-t-elle. Nous n'attendons pas de livraison aujourd'hui.
Et le démon apparut dans sa chaise roulante, écartant prestement la femme de sa canne.
— Poussez-vous Betty, allons, poussez-vous, qui sont ces gens ?
Elle ouvrit la porte plus grand tout en manoeuvrant son fauteuil roulant pour mieux nous voir. Et là elle vit Chen. Je me tenais derrière lui et la scène était digne d'un film de cinéma. Si sa mâchoire avait pu se décrocher, c'est ce qui se serait passé, mais elle avait le visage tellement déformé et marqué par la maladie, si parcheminé et si figé, qu'il ne pouvait exprimer aucun émotion, mais elle venait visiblement de subir un coup d'arrêt brutal, en un quart de seconde, comme si sa vie venait soudainement de basculer. Puis elle se ressaisit, mais c'était comme si elle avait atteint un achèvement. Peut-être que pour elle aussi ce fut comme lors de ma première rencontre avec Chen, où je me sentis comme en dehors de mon corps en train regarder la scène de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, elle savait que quelque chose de différent venait d'arriver dans sa vie. Il paraît, et je crois que c'est vrai, que les malades chroniques et les handicapés développent une plus grande sensibilité, et cette scène montrait toutes les apparences d'une personne qui savait instinctivement qu'elle était en présence de quelqu'un, de quelque chose de très puissant, bien plus qu'elle-même. Par exemple, la plupart des médiums authentiques ne jouissent pas d'une très bonne santé en général, car sinon ils ne pourraient pas être aussi réceptifs aux vibrations supérieures. Je ne dis pas que Mary était médium, mais elle était plus sensible et plus réceptive que la moyenne des gens bien-portants.
— Je me demandais si je pourrais visiter votre atelier, j'en ai entendu dire du bien. Et comme vous pouvez le voir, je suis moi-même handicapé.
Chen parla avec aisance, sur un ton pas trop familier, juste comme d'habitude, dégageant tranquillité et gentillesse.
C'était peut-être le premier homme pour qui elle témoignait du respect à sa simple vue. Elle nous fit faire le tour des lieux. Les problèmes de santé mentale requièrent des soins particuliers, et il semblait qu'au moins la moitié des personnes présentes dans l'atelier présentaient des signes de désordre mental à des degrés divers. Les autres étaient comme Mary, mais pas encore aussi sévèrement atteints, bien que certains étaient dans des chaises roulantes. Mary était la reine avec son fauteuil électrique et sa capacité à diriger et à organiser les choses. Ils avaient l'air de se rassembler là tous les jours dans cette grande pièce pour se livrer à divers passe-temps, échanger des idées, et rester ensemble ; c'était une sorte de refuge de jour pour handicapés. Et malgré le fait qu'elle était un véritable démon, l'endroit n'aurait jamais existé sans son sens aigu des affaires et sans ses facultés d'organisation.
Par la suite nos visites à l'atelier se firent de plus en plus régulières. Dès qu'il y avait quelque chose à la maison que Chen décidait qu'ils pouvaient utiliser, des livres, des outils de gravure, des pièces de bois à façonner, de la peinture, nous partions aussitôt pour la porte verte à l'enseigne noire. Avec le temps, un changement commença à se faire sentir en Mary. Il lui arrivait de rire, d'une voix cristalline comme l'eau qui coule sur des rochers, son visage essayait de sourire, elle était plus détendue, et sa canne austère avait disparu. L'atmosphère était meilleure et nos amis handicapés nous accueillaient toujours les bras ouverts. Leurs vies avaient changé, le démon s'était radouci. Mais elle était possessive et n'était pas décidée à trop les laisser approcher Chen. Il était à elle, de façon claire et définitive. En fait ce qui s'est passé c'est qu'elle était tombée raide dingue amoureuse de lui !
Ce qui est merveilleux dans cette histoire c'est que Chen ne fit rien pour la dissuader. Il était assez courant de voir certains de ses admirateurs, surtout des femmes, développer de véritables sentiments obsessionnels à son sujet, et là il coupait invariablement et immédiatement toute relation avec ces personnes. Mais avec Mary ce fut différent. Elle ne lisait pas ses livres et ne suivait pas son enseignement, c'était juste une âme en détresse qui avait croisé son chemin. Ce qu'elle attendait de la vie, et qu'elle n'avait plus d'espoir de trouver ni de connaître un jour, c'était une émotion forte, positive, une passion qui bouleverserait et corrigerait sa chimie corporelle, et il était tout à fait improbable pour elle qu'un homme la laisse tomber amoureuse de lui. De la créature desséchée et aigrie qu'elle était devenue après toute une vie de maladie et de rejet, elle semblait voir son âme s'ouvrir à des horizons nouveaux. Elle se réveillait chaque jour en étant heureuse d'être en vie. Elle avait enfin rencontré quelqu'un qu'elle respectait et qu'elle aimait, qui faisait partie de son existence, qui montrait de l'intérêt pour elle. Malgré la maladie et les douleurs, elle se sentait légère, elle pouvait être amusante et pleine d'esprit. C'était comme une renaissance. Elle faisait des efforts sur son apparence et elle allait même jusqu'à mettre une touche de rouge à lèvre. C'était miraculeux à voir. Je ne me souviens pas avoir entendu Chen discuter au téléphone avec quelqu'un d'autre, mais elle l'appelait régulièrement et il restait quinze à vingt minutes à parler avec elle, en tenant le combiné appuyé contre son crâne pour capter par conduction osseuse ce qu'il était incapable d'entendre. Ces appels le laissaient épuisé. Elle ne se doutait pas une seconde de la gêne qu'elle lui causait, et d'ailleurs aurait-elle renoncé en le sachant ? J'en doute. L'amour est parfois égoïste. Elle finit par succomber à sa maladie, mais elle mourut dans la paix. Elle avait reçu le plus grand cadeau entre tous, à la fin d'une vie dans un corps difforme et malade elle avait trouvé l'amour et le bonheur, ce qui l'avait transformée.
* * * * * * * * * * * *
Épilogue.
Ai-je réussi à vous donner un petit aperçu du monde de Rampa ? C'était un monde tellement différent de celui que l'on considère comme normal, et auquel on s'habitue si facilement. Ce ne fut pas non plus si facile de faire la transition avec le monde ordinaire après toutes ces années passées à vivre à ses côtés, et il y a encore une petite histoire qu'il faut que je vous raconte, et qui résume peut-être assez bien tout le reste.
J'étais venue à Vancouver pour trouver un emploi et un logement. Je ne possédais pas grand chose, rien d'essentiel, n'ayant par nature que peu de sens pratique. Mon propriétaire était quelqu'un de très correct, et un jour il passa me voir, pour percevoir le loyer je suppose, et il remarqua que les seuls couverts que j'avais étaient constitués d'un canif, d'une cuillère en plastique et d'une fourchette du même matériau. Choqué, il m'invita à monter chez lui où il avait des « doublons ». Il fouilla dans sa cuisine et trouva deux ensembles de couverts.
— Celui-ci, dit-il en montrant l'un d'eux. C'est le meilleur. Il est joli n'est-ce pas ?
— Oui, il est très joli ! C'est très gentil de votre part.
J'étais sur le point de prendre les couverts quand il s'en saisit avant moi.
— J'ai dit que c'était le meilleur. Je peux vous donner l'autre, je n'en ai pas besoin, et je ne l'aime pas trop de toute façon. Mais ça fera l'affaire pour vous.
J'étais atterrée. Il a dû me prendre pour quelqu'un d'envieux ou de cupide, mais j'avais vécu avec Chen trop longtemps. Dans le monde que je venais de quitter, dans son monde, s'il arrivait à Chen d'avoir deux exemplaires de quelque chose et qu'il rencontrait quelqu'un qui se trouvait en avoir besoin, il se séparait toujours de l'objet qu'il aimait le plus et gardait l'autre, ce qui était tout le contraire dans le monde « normal » de mon propriétaire.
Je le revois encore assis en tailleur sur son lit avec parfois deux pendules, deux canifs ou deux transistors. « Alors, lequel préférez-vous ? » nous demandait-il. Celui qui remportait la première place, le meilleur de notre point de vue et du sien, allait à la personne qu'il avait en tête. Ou bien s'il possédait un objet qu'une personne convoitait, ou si cette personne en avait besoin, il lui donnait immédiatement sans fanfare ni trompette, il pouvait s'en séparer même si c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. J'avais grandi avec cette habitude de donner ainsi, et je m'y étais tellement habituée que j'avais oublié que ce n'était pas la façon de faire dans le monde normal.
Toutefois je me demande, oui, je me demande si nous ne pourrions pas devenir des émules de sa façon de faire, de sa bonté, et cela pourrait peut-être se répandre petit à petit, et finir par devenir la manière normale de faire pour tout le monde. Une fois que vous avez réussi à surmonter vos craintes, et que vous avez commencé à donner de votre personne en toute liberté, cela devient facile, comme une habitude, et la récompense est énorme. Vous êtes payés au centuple, même si ce n'est pas exactement avec l'objet que vous avez donné. Je vous concède qu'il est difficile d'imaginer un monde sans cupidité, mais ce n'est pas une chose impossible. Il y arrivait bien, lui. Alors nous aussi nous le pouvons.
FIN.

